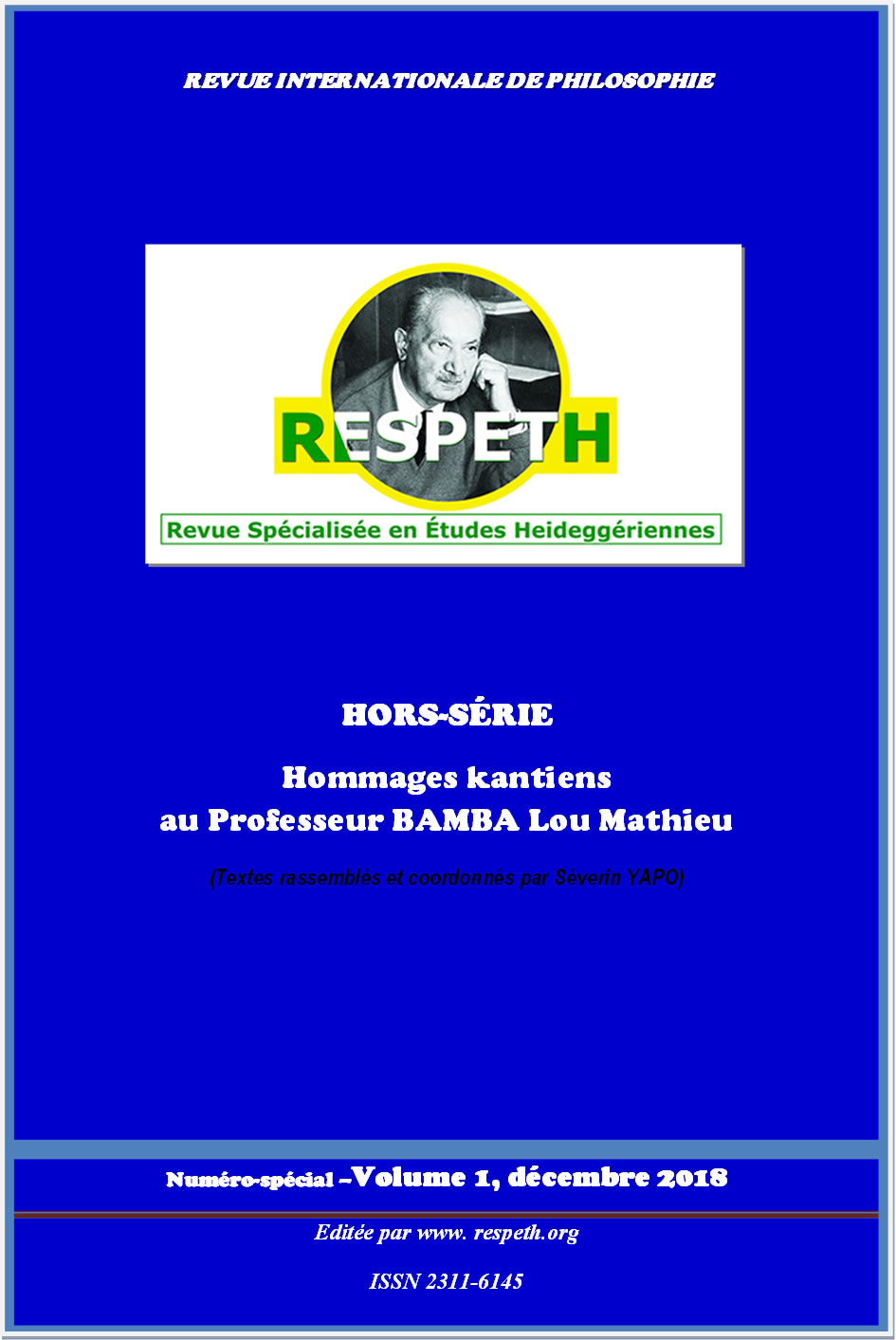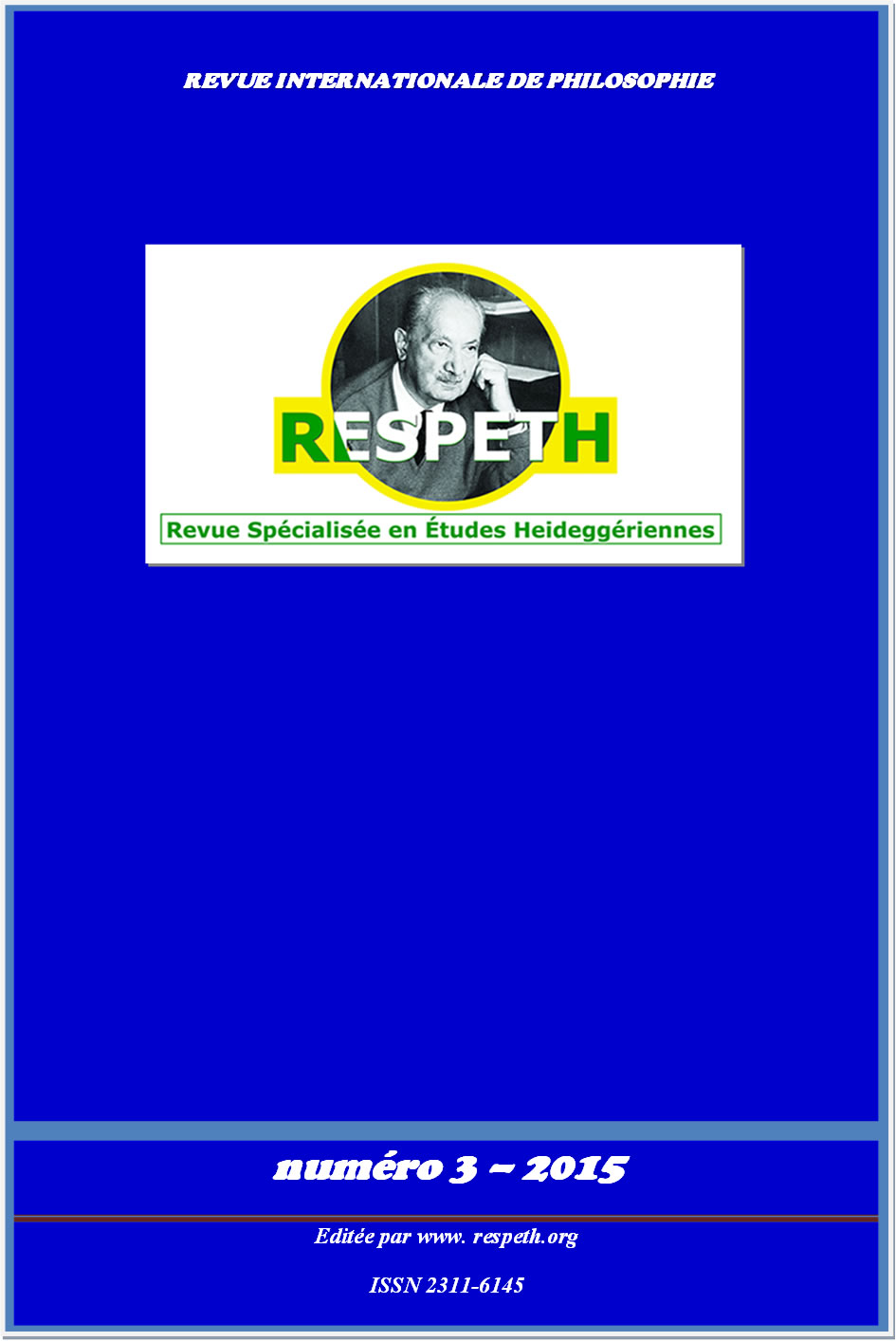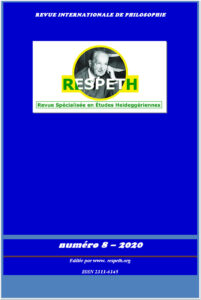RESPETH N°8-2020
SOMMAIRE
POURQUOI HEIDEGGER ?…………………………………..9
- Vers une phénoménologie sotériologique : du « seul un Dieu peut nous sauver » de Heidegger au « seul un Dieu vivant peut nous sauver » de Michel HENRY, BOKO (Sèdjro Bernadin)……………………………………………… 12
- Du Gestell technologique : quel salut pour l’humanité ?, KOUADIO (Konan Oscar)………………………………………….. 31
- Ontologie et foi dans la pensée heideggérienne, SENZÉ (Kouamé Raymond)……………………………………………… 56
- La science et Dieu chez Leibniz et Einstein, KOUASSI (Kpa Yao Raoul)…………………………………………… 71
- Et l’art créa Dieu : Hölderlin et Heidegger au sujet de la divinité de Dieu, GAINSI (Grégoire-Sylvestre M.)……………………………………………… 91
- Déchoir spirituel du monde et désir divin : l’hénologie plotinienne comme sortie des crises existentielles, KOFFI (Kouakou Marius)…………………………………………… 108
- In-quiétude et appel chez Gabriel MARCEL : le Toi absolu comme fondation onto-théologique du bonheur, KOUASSI (Moulo Elysée)……………………………………………… 128
- « Seul un dieu peut encore nous sauver ». Décryptage et lecture analytique d’une expression énigmatique à l’ère du numérique et de coronavirus, KISSEZOUNON (Gervais), TECHOU (Roland)…………………………………………… 151
- Ô poètes ! ô Dieux ! vérité(s) d’un humanisme fondamental, GOULEI (Yves Laurent)…………………………………………… 174
Présentation et Sommaire N°8 > Résumés des articles N°8
www.respeth.org, 2020
22 BP 1266 Abidjan 22 (Côte d’Ivoire)
Email : publications@respeth.org
Tél. : 00225 09 62 61 29 00225 40 39 26 95 00225 09 08 20 94
ORIENTATIONS DE LA REVUE
RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches sur Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody (Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C’est une revue internationale à caractère philosophique qui paraît une fois l’an (en édition régulière). En dehors de cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée du philosophe Martin HEIDEGGER.
La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, novatrices ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions d’ordre théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se rapportant à la pensée du philosophe :
* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les thèmes liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ;
* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ;
* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou moins heideggérien, les textes philosophiques ;
* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de Martin HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes non-occidentaux.
* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons ;
* Des comptes rendus d’ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER.
RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du concours pour le Prix d’Excellence DIBI Kouadio Augustin.
Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue RESPETH se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, les professeurs et étudiants qui s’intéressent au devenir de la philosophie d’influence heideggérienne.
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Abou SANGARÉ Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Andrius Darius VALEVICIUS, Université de Sherkrooke, Québec, Canada
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Augustin DIBI Kouadio, Prof. Titulaire, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Jacques NANÉMA, Prof. Titulaire, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Jean-Luc AKA-EVY, Prof. Titulaire, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo
Sophie-Jan ARRIEN, Prof. Titulaire, Université de Laval, Canada
COMITÉ DE LECTURE
Abou SANGARÉ Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Alexis KOFFI Koffi, Maître de Conférences, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Andrius Darius VALEVICIUS, Université de Sherkrooke, Québec, Canada
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké,
Augustin DIBI Kouadio, Prof. Titulaire, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Jacques NANÉMA, Prof. Titulaire, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Jean-Luc AKA-EVY, Prof. Titulaire, Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo
Raoul KOUASSI Kpa Yao, Maître de Conférences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Séverin YAPO, Maître de Conférences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Sophie-Jan ARRIEN, Prof. Titulaire, Université de Laval, Canada
COMITÉ DE RÉDACTION
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
REDACTEUR EN CHEF :
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
Léonard KOUASSI Kouadio, Institut National du Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle, Côte d’Ivoire
Séverin YAPO, Maître de Conférences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
MEMBRES :
Alexis KOFFI Koffi, Maître de Conférences, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Christophe PERRIN, Université Paris-Sorbonne, France
Élysée PAUQUOUD Konan, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire
Oscar KONAN Kouadio, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Pascal ROY-EMA, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Sylvain CAMILLERI, Université Catholique de Louvain, Belgique
RESPONSABLE TECHNIQUE :
Raoul KOUASSI Kpa Yao, Maître de Conférences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
SOMMAIRE
Pourquoi Heidegger ? .…………………………………………………………………..9
Argumentaire du Numéro Thématique : Seul un Dieu peut encore nous sauver.……………………………………………………………………………………11
BOKO (Sèdjro Bernadin), Vers une phénoménologie sotériologique : du « seul un Dieu peut nous sauver » de Heidegger au « seul un Dieu vivant peut nous sauver » de Michel HENRY.……………………………………….12
KOUADIO (Konan Oscar), Du Gestell technologique : quel salut pour l’humanité ?.……………………………………………………….31
SENZÉ (Kouamé Raymond), Ontologie et foi dans la pensée heideggérienne.…………………………………………………………..56
KOUASSI (Kpa Yao Raoul), La science et Dieu chez Leibniz et Einstein.………………………………………………………………………71
GAINSI (Grégoire-Sylvestre M.), Et l’art créa Dieu : Hölderlin et Heidegger au sujet de la divinité de Dieu.…………………91
KOFFI (Kouakou Marius), Déchoir spirituel du monde et désir divin : l’hénologie plotinienne comme sortie des crises existentielles.…………………………………………………………….108
KOUASSI (Moulo Elysée), In-quiétude et appel chez Gabriel MARCEL : le Toi absolu comme fondation onto-théologique du bonheur.…………………………………………..128
KISSEZOUNON (Gervais), TECHOU (Roland) « Seul un dieu peut encore nous sauver ». Décryptage et lecture analytique d’une expression énigmatique à l’ère du numérique et de coronavirus.………………………………………………………….151
GOULEI (Yves Laurent), Ô poètes ! ô Dieux ! vérité(s) d’un humanisme fondamental………………………………………….174
POURQUOI HEIDEGGER ?
Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, en terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante qu’il faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, avec Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont l’histoire consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire de beaucoup de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit nullement dans un conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise plutôt à scruter un implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport de la conscience aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun prétexte, pour autant que l’homme, quelle que soit sa particularité individuelle ou collective, ne peut pas ne pas comprendre que le point de départ de l’histoire s’inscrit nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-delà de tout ce qui nous préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de divergences ou même de conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous détermine tous : nous sommes des consciences devant les déterminités. Et la conscience ne parvient à sa vérité que dans une appartenance essentielle au Concept, comme expression d’une pensée substantielle de son rapport aux choses. De ce point de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si complexe qu’une complaisance à son égard influence négativement la marche dans l’histoire de tout peuple. La qualité de cette marche est donc déterminée par le sérieux et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans la présence des choses. Husserl, dont la philosophie est une réappropriation de la conscience, dans son essentialité, nous permet de bien comprendre qu’une pensée rigoureuse ne peut se dispenser de la vérité de la conscience dans son rapport aux choses, d’où la nécessité fondamentale de l’époché, pour accéder au moi transcendantal ; car une conscience encombrée de psychologisme rend impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son intentionnalité. C’est la réduction transcendantale pour désobstruer le rapport de la conscience aux choses. Le retour aux choses ou “droit aux choses mêmes”, comme idée substantielle de la phénoménologie husserlienne, est le retour de la conscience dans sa pureté originelle, seul gage pour rendre la philosophie, c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, comme science rigoureuse. Le célèbre article de Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, paru en 1911, en donne la pleine mesure. La conscience, étant le fondement premier de toute science, y compris la philosophie en premier, exige d’être pensée en soi, comme conscience transcendantale, pour donner au Concept toute la rigueur de son sens. La rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la réduction phénoménologique, chez Husserl, traverse toute la pensée de Heidegger, qui l’enracine dans une expérience plus originaire et plus originelle, celle avec l’Être.
Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même que celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du Népal sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la réalité non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le chien comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde sur le non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-présent. Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation constante d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité.
Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver de l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement “jeune”, qui implique, sans aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans laquelle, de toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour donner à l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une question d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, dans la mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui structure, de manière universelle, son existence.
Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige une méditation sur le rapport de l’étant à l’être. Un rapport dans lequel l’étant est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une articulation nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la métaphysique de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières pages de Être et Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est aujourd’hui tombée dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au préalable, il n’a pas manqué de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer tout l’enjeu de sa pensée : « Avons-nous une réponse à la question de savoir ce que nous voulons dire exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. Dans ces conditions, il faut poser en termes tout à fait neufs la question du sens de l’être. Sommes-nous donc seulement aujourd’hui encore dans l’aporie de ne pas entendre l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces conditions, le plus urgent, c’est de réveiller une entente pour le sens de cette question » (Idem, p. 21). Il s’agit, alors, de pousser à fond le rapport de l’homme au savoir pour qu’advienne et se maintienne, sans prétention et de manière définitive, son essence pensante, si tant est que rien ne peut possibiliser son existence, s’il n’est radicalement établi dans cette essence. Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde pensante de la garde de l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans laquelle l’homme accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à aucune race et à aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait pas le propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde de la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et poursuit sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est pleinement chez soi. Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux peuples, qu’elle soit embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut l’accueillir, avec grande sérénité et lui permettre de croître dans le secret de sa puissance, qui rend puissants les peuples qui savent la contempler dans la splendeur de sa vérité. Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin de liberté, parce qu’est libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où sont brisées les idoles de nos excessifs particularismes et de nos primitivités, dénuées du saut qualitatif, nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de cette idée heideggérienne : Là où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. Ce qui suppose qu’il faut, dès la départ, écarter, avec une violence salutaire, l’idée d’une rationalité multiple, comme si “un plus un” feraient, ailleurs, autre chose que deux. La logique n’est ni culturelle, ni géographique, c’est le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, selon Hegel, réside dans la conscience de soi, conscience parvenant à son contenu comme Concept. Ce Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi dire, des Grecs. Serait-il scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il pas revendiquer autre chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est menacée de faillite, en raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, pourrions-nous ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur fondement ultime dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, aujourd’hui, honneur à défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, pas pour des raisons de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut pas avoir un ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire “nous sommes des Grecs ?” Heidegger nous donne l’excellente réponse : « Grec, cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les différents modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée par lui, sans pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405).
Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore suffisante des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité sociale et politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se construit tout peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève dans l’horizon de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais nécessaire. Bien qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la pensée des valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas moins la question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme fondamental, comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance tout humanisme classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à sauvegarder. Il serait, alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre donnerait des directives à l’action de l’homme ; une telle orientation est, simplement, aux antipodes de la pensée de Martin Heidegger, pour qui la pensée est en soi une action radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue au rang d’action du seul fait qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à La pensée agit en tant qu’elle pense. (…) Cet agir est probablement le plus simple en même que le plus haut, parce qu’il concerne la relation de l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, p. 68). Pourquoi ? Parce que là où existent des distorsions sociales et des horizons historiques confus, la pensée ne s’est pas suffisamment accomplie, c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec vigueur et rigueur, porté son essence dans la seule relation, qui lui donne tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il pas alors bien étonnant de montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel Faye, que Heidegger est un théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait injuste d’enfermer le grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa vie (Six mois rectorat sous le régime des nazis), alors même que la commission de « Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu lieu depuis le courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe de la Forêt Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le rectorat sous le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être discrédité par son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les accointances avec le nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de pensée du dernier des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas Dieu ; et la grande intelligence n’est pas canonisation.
« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). Apprendre à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine l’humanité de l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait écrire : « Plein de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ». Puissent nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de l’Être, pour qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant.
Jean Gobert TANOH
NUMÉRO THÉMATIQUE 2020 DE LA REVUE RESPETH
« SEUL UN DIEU PEUT ENCORE NOUS SAUVER »
Pour son numéro de Décembre 2020, la Revue Spécialisée en Études Heideggérienne (respeth) lance un appel thématique.
La thématique générale est référencée à la parole de Martin Heidegger issue de son entretien avec la revue Der Spiegel : « Seul un Dieu peut encore nous sauver ». En somme, il s’agira d’évaluer l’entente heideggérienne de cette parole relativement à la problématique de la technique. La question de Dieu, telle qu’elle se présente dans l’histoire de la Philosophie, surtout ceux des auteurs avec lesquels le penseur de Messkirch a eu un véritable commerce, trouvera une résonnance particulière dans cette perspective. De même, des contributions inédites sur la question du Sacré, du Divin, etc., à l’ère contemporaine, sont attendues.
VERS UNE PHÉNOMENOLOGIE SOTÉRIOLOGIQUE : DU « SEUL UN DIEU PEUT NOUS SAUVER » DE HEIDEGGER AU « SEUL UN DIEU VIVANT PEUT NOUS SAUVER » DE MICHEL HENRY
Sèdjro Bernadin BOKO
École Normale Supérieure Porto-Novo (Bénin)
Résumé : La réduction phénoménologique permet d’approcher Dieu sans professer une foi en une religion. L’onto-phénoménologie de Heidegger et Henry a tenté de poser cette problématique de Dieu, respectivement à partir de l’être et de la vie. En ce sens, l’ontologie fondamentale du Dasein est la condition de possibilité de la question du sacré, du divin. Elle le fait à partir de la poésie. La phénoménologie de la vie, quant à elle, tente de penser Dieu à partir de la vie. C’est ainsi que le « seul un dieu peut nous sauver » devient « seul un dieu vivant peut nous sauver ».
Mots-clés : HEIDEGGER, HENRY, ȆTRE, VIE, DIEU, PENSEE ET POÉSIE.
Abstract : The phenomenological reduction makes it possible to approach God without professing a faith in a religion. The onto-phenomenology of Heidegger and Henry attempted to pose this problematic of God respectively from being and from life. In this sense, the Dasein’s fundamental ontology is the possibility condition of the sacred and the divine’s question. She makes it through poetry. The phenomenology of life, for its part, attempts to think God on the basis of life. This is how the “only a god can save us” becomes “only a living god can save us”.
Keywords: HEIDEGGER, HENRY, BEING, LIFE, GOD, THOUGH, POETRY.
Introduction
Peut-on réellement parler d’une phénoménologie sotériologique ? Le désir qui sous-tend cette question est une mise en route vers une interrogation radicale sur la célèbre et énigmatique formule de Martin Heidegger au journal der Spiegel (1966), publiée, sur sa demande, après sa mort : « Seulement un dieu peut encore nous sauver » et sur « seul un dieu vivant peut encore nous sauver » de Michel Henry, parole tout aussi énigmatique présente dans son ouvrage sur la philosophie du christianisme. Martin Heidegger et Michel Henry ont essayé de faire de la phénoménologie husserlienne une onto-phénoménologie. D’une part l’onto-phénoménologie de Heidegger trouve son expression effective dans l’ontologie fondamentale du Dasein et d’autre part l’onto-phénoménologie de Michel Henry conduit inexorablement à une phénoménologie de la vie. La phénoménologie sotériologique, que nous appelons de tous nos vœux, n’est que cette tentative de comprendre l’ontologie fondamentale et la phénoménologie de la vie comme une doctrine du salut.
Nietzsche pose de façon poignante la question de la philosophie comme doctrine du salut en ces termes : « Où trouverait-on l’exemple d’un peuple atteint de maladie et à qui la philosophie aurait rendu sa santé perdue ? » (F. Nietzsche, 1975, p. 12). Depuis Socrate, la philosophie a toujours été une thérapie, une doctrine du salut. Dans son apologie, le taon d’Athènes notifie que son philosopher n’est possible parce qu’il écoute son daïmon, la voix de la conscience. Cette voie ne fait qu’annoncer la conscience phénoménologique. Cette préfiguration transparaît dans l’intentionnalité elle-même : toute conscience est conscience de quelque chose. Certes il n’est plus question de la conscience morale, mais avant tout de la conscience comme corrélation noético-noématique. La conscience transcendantale sauve donc la philosophie de l’empirisme dogmatique et du positivisme rationaliste. Seulement cet acte auto-fondationnel pose une problématique fondamentale : Y-a-t-il quelque chose plus fondamental que le Dasein ou l’ego vivant ?
Cette question simpliste nous engage à intuitionner la possibilité d’un fond (Grund) avant le Dasein ou l’ego vivant. Le fond, qui rend possible toute chose, n’est pas le retour à Dieu, ni au divin, ni au sacré, mais à cette phénoménologie hylétique infructueuse ou phénoménologie de l’inapparent. Autrement dit, il faut prendre en compte le monde-de-la-vie, le monde avant toute recherche scientifique et chercher dans ce monde-de-la-vie le départ de toute connaissance possible. Comment le monde-de-la-vie oriente-t-il le regard du Dasein ? Heidegger propose une habitation du monde comme poète. Seul le poète est détenteur du sacré. La crédibilisation du poète est la seule topologie qui enclenche l’appel d’un Dieu sauveur. En revanche, l’appel de la vie va conduire à l’invocation d’un dieu vivant. Comment le dieu heideggérien sauve-t-il ? Comment le dieu vivant sauve-t-il. Et qu’en est-il du dieu vivant ? En d’autres termes, la phénoménologie sotériologique est-elle possible ?
Cette analyse se poursuit à trois objectifs. Le premier objectif sera une saisie intuitive de la question du divin dans la pensée de Heidegger. Il sera question de penser entre le nihilisme et l’arraisonnement technique, la possibilité d’élaborer une sotériologie heideggérienne qui passe par l’écoute de la mélodie rhétorique afin d’en décrypter la rigueur scientifique et de faire de l’ontologie fondamentale, la philosophie comme science rigoureuse. Le second objectif tentera de partir de la phénoménologie de la vie de Michel Henry pour la percée d’une sotériologie au cœur de la phénoménologie. L’équation Dieu = Vie est la clef de voûte de cette sotériologie. Enfin le troisième objectif sera une lecture croisée du dieu heideggérien au dieu vivant henryen. L’enjeu fondamental sera d’établir la phénoménologie comme une doctrine de salut.
1. HEIDEGGER ET LA QUESTION DU DIVIN
Dans une lettre adressée à Heidegger, Bultmann regrette le départ de Heidegger de la théologie. Cette correspondance prouve évidemment « sa provenance théologique. Celle-ci doit s’entendre à la fois comme son enracinement socio-catholique, sa dette à l’égard des schèmes fondamentaux de la théologie catholique et protestante, et sa sortie jamais achevée, de la théologie » (Capelle, 2011, p. 335). Entre 1909 et 1926, autrement dit avant la parution de Sein und Zeit, le jeune Heidegger étudie la théologie catholique à l’université catholique de Fribourg-en-Brigsau dans le cadre d’un programme largement consacré à la philosophie. Il tente pendant cette période d’associer une réflexion sur la facticité et les fondements de la phénoménologie, la question de l’être et le statut de la théologie, fréquentant régulièrement le théologien Bultmann, il commente l’évangile de Jean, les épîtres de Paul, les Confessions de saint Augustin, plusieurs mystiques médiévaux (Bernard de Clairvaux, Thérèse d’Avila) et revendique le compagnonnage de maître Eckhart. Il essaie d’élaborer une philosophie de la vie religieuse, puis s’éloigne du christianisme. Il problématise le rapport philosophie-théologie sur la base d’une pensée radicale de la finitude et de la transcendance de l’être, qui le conduit à la publication en 1927 de son maître livre Être et temps (Cf. Ibidem).
Lors de sa formation en théologie, le professeur Carl Braig, représentant de la théologie systématique, a contribué de façon décisive à l’orientation de la pensée de Heidegger. Heidegger est tombé, dès la classe de terminale, sur l’ouvrage de Carl Braig, De l’Être. Précis d’ontologie, paru en 1886, et dont la partie documentaire comportait « de longs extraits d’Aristote, de Thomas d’Aquin et de Suarez, ainsi que l’étymologie des mots pour les notions ontologiques fondamentales », qui seront les outils intellectuels de Heidegger. C’est grâce à lui que la tension entre ontologie et théologie spéculative, en tant que structure interne entre dans la sphère de la recherche de Heidegger (Cf. Ott, 1990, p. 62). Plus tard, le philosophe allemand résuma les rapports entre sa pensée et la théologie catholique par la formule suivante qui exprime la dette de sa pensée envers cette dernière : « Sans cette provenance théologique, je ne serais jamais arrivé sur le chemin de la pensée. Provenance est toujours avenir » (Heidegger, 1976, p. 95).
La question fondamentale est dès lors : que pourrons-nous retenir de cette fréquentation théologique de Heidegger ? Nous pourrions certifier que de cette fréquentation théologique marque d’une emprunte particulière la pensée de Heidegger. Car cette pensée sera désormais élaborée dans la tension permanente entre philosophie et théologie. Ces rapports dans la pensée de Heidegger obéissent à une triple topique. D’abord, une première annoncée dans Être et Temps, systématisée dans la conférence Phénoménologie et Théologie, commentée dans la Lettre du 8 août 1928 à E. Blochmann et ressaisie dans le cours Introduction à la métaphysique, concerne la relation « Philosophie et théologie scripturaire » : la science ontologique, rivée à la seule question de l’être et à l’écart de toute « vision du monde », est en débat avec la théologie chrétienne, science ontique élaborée à partir de la foi au Dieu crucifié. Puis, une deuxième topique manifeste la solidarité inaugurale et historique de la théologie et de la philosophie : « Philosophie et onto-théologie ». Enfin, à partir des années 1934-1935, les travaux de Heidegger s’orientent vers un nouveau type de problématique qui détermine un troisième rapport : « Pensée de l’être et attente ». C’est dans l’ouverture de l’Être que doit être pensée la survenue possible d’un dieu divin par-delà toute référence chrétienne ou antichrétienne. Les textes jalons en sont, pour l’essentiel, les Contributions à la philosophie de 1936-1938, la Lettre sur l’humanisme de 1946, le Séminaire de Zurich et les Approches de Hölderlin en 1951, Identité et Différence de 1957, et la conférence donnée à Fribourg-en-Brisgau en 1964, Quelques indications sur des points de vue principaux du colloque théologique consacré au « problème d’une pensée et d’un langage non objectivant dans la théologie d’aujourd’hui » (Capelle, 2001, p. 12).
La tension permanente entre philosophie et théologie se trouve de façon explicite dans La fin de la philosophie et le tournant (Heidegger 1976, p. 309-321). Dans ce texte où la question de fond est l’essence de la technique, nous avons l’irruption de la théologie : « le dieu vit-il ou reste-t-il mort ? N’en décident ni la religiosité des hommes ni, encore moins, les aspirations théologiques de la philosophie et des sciences. Si dieu est dieu, il advient à partir de la constellation de l’être et à l’intérieur de celle-ci » (Ibid., p. 320). Force est de constater que la question de dieu est posée seulement par la pensée. Autrement dit, cette question n’est possible qu’à l’intérieur de la constellation de l’être. C’est donc à une expérience onto-phénoménologique du divin que se risque la pensée heideggérienne. En ce sens, le philosophe allemand appert que l’ontologie fondamentale du Dasein est la condition de possibilité de la question de dieu. Ainsi donc, « fort peu nombreux sont ceux qui savent que le dieu attend la fondation de la vérité de l’estre et par là le saut d’un bond de l’être humain dans le Da-sein » (Ga 65, 417), de l’être humain parvenu à décoller du sujet comme de toute métaphysique de subjectivité (Arjakosky (dir), 2013, p. 347).
Dans sa Lettre sur l’humanisme, l’auteur de Sein und Zeit pose à nouveau frais le rapport entre l’essence de l’homme et Dieu. Il faut souligner que l’essence de l’homme est le Dasein. Cette essence de l’homme convoque désormais sur le plan ontologique le rapport du Dasein à Dieu. Il n’est point question de friser le nihilisme mais de remarquer certainement que « ce n’est qu’à partir de la vérité de l’Être que se laisse penser l’essence du sacré. Ce n’est qu’à partir de l’essence du sacré qu’est à penser l’essence de la divinité. Ce n’est que dans la lumière de l’essence de la divinité que peut être pensé et dit ce que doit nommer le mot « Dieu » » (Heidegger, 1976, p. 112). Le lien intrinsèque établi entre la vérité de l’Être et l’essence du sacré ne peut qu’entériner le rapport entre la pensée de l’être et attente de Dieu. La pensée de l’être est une action intérieure, un état différent, une ouverture de l’être-là-par et dans la pensée. Elle est une autre façon d’être au monde. Elle n’est ni théorique ni pratique. Elle advient avant cette distinction. Elle est le souvenir de l’être et rien d’autre. Elle n’a pas de résultat. Elle n’a pas d’effet. Elle satisfait à son essence dès lors qu’elle est (Safranski, 1996, 384). La pensée de l’être n’est pas une pensée calculante mais une pensée méditante. En effet, « la pensée qui médite exige parfois un grand effort et requiert toujours un long entraînement. Elle réclame des soins délicats que tout autre authentique métier. Elle doit aussi, comme le paysan, savoir attendre que le grain germe et que l’épi murisse » (Heidegger, 1976, p. 136). Dans cette attente de la pensée, s’ouvre de nouveaux possibles, le possible de l’expérience du sacré et l’advenu d’un dieu divin.
Un double diagnostic apparaît dans l’approche heideggérienne du sacré et du dieu divin : d’une part les déterminations de l’onto-théologie et d’autre part la déification de l’entendement. Le nihilisme nietzschéen met fin à l’onto-théologie à travers la question de « la mort de Dieu ». Nietzsche claironne l’abandon de l’onto-théologie grâce à son chantre Zarathoustra lorsqu’il déclame :
Ils sont morts tous les dieux : désormais nous voulons que vive le surhomme – qu’un jour en plein midi ce soit notre ultime volonté ! » Si Dieu et les dieux sont morts, au sens de l’expérience de la métaphysique élucidée, le surhomme ne prendra jamais la place de Dieu. La proposition « la mort de Dieu » indique la fin du monde suprasensible et de tous ses succédanés. Cette « mort de Dieu » tient toujours en haleine la question du Forcené : « Comment est possible cette chose que des hommes soient capables de tuer Dieu ? (Heidegger, 1962, p. 314).
Au cœur de cette question subsiste toujours la possibilité de repenser l’expérience du sacré et l’advenu d’un dieu divin. Cette expérience du sacré et l’advenu d’un dieu divin exige une pensée qui détrône la déification de l’entendement. Heidegger insiste sur cela lorsqu’il écrit :
les voyous publics ont aboli la pensée et mis à sa place le bavardage, ce bavardage qui flaire le nihilisme partout où il sent son bavardage en danger. … La pensée ne commence que lorsque nous avons éprouvé que la Raison, tant magnifiée depuis des siècles, est l’adversaire la plus opiniâtre de la pensée (Idem, p. 323).
L’homme de la pensée doit se tourner vers les poètes et interroger la manière dont ils chantent :
Les poètes sont ceux des mortels qui, chantant gravement le dieu divin, ressentent la trace des dieux enfuis, restent sur cette trace, et tracent ainsi aux mortels, leurs frères, le chemin du revirement. … Être poète en temps de détresse, c’est alors : chantant, être attentif à la trace des dieux enfuis. Voilà pourquoi, au temps de la nuit du monde, le poète dit le sacré (Idem, p. 324).
Le penseur dit donc l’Être et le poète nomme le Sacré. En définitive, la tâche poétique essentielle consiste à dévoiler ce secret de l’Être qui s’ouvre dans une quadruple orientation. La poésie instaure l’Être dans la parole. Elle est la poésie de l’Être. C’est donc l’Être, qui, dans la poésie, a le premier et le dernier mot ; c’est lui qui parle à cette croisée des chemins de la Terre et du Ciel, des Dieux et des Hommes. « La poésie est cette prise de la mesure, à savoir pour l’habitation de l’homme » (Heidegger, 1958, p. 238). La poésie est par excellence une mesure. Le poète prend cette mesure lorsqu’il dit les aspects du ciel de telle sorte qu’il se plie à ses apparences, comme à cette étrangère où le Dieu inconnu se « délègue ». Le dire poétique des images rassemble et unit en un seul verbe la clarté et les échos des phénomènes, l’obscurité et le silence de l’étranger. Par de tels aspects le Dieu étonne. Dans et par l’étonnement, il manifeste sa continuelle proximité. Dieu est proche de nous grâce à la pensée et la poésie. C’est pourquoi Heidegger rappelle cette proximité de Dieu dans son entretien à Spiegel : « Seul un Dieu peut encore nous sauver. La seule possibilité qui nous reste dans la pensée et dans la poésie, c’est la disponibilité pour la manifestation de ce Dieu ou pour l’absence de ce Dieu dans la catastrophe : que nous sombrions face au Dieu absent » (Heidegger, 1976). Si la pensée dit l’Être et la poésie nomme le sacré, alors les deux pourront assurer à l’homme la possibilité du salut. Le « Dieu qui peut nous sauver » n’est ni le dieu de la théologie naturelle, ni celui de la théologie dogmatique. « Ce Dieu, l’homme ne peut ni le prier ni lui sacrifier. Il ne peut, devant la Causa sui, ni tomber à genoux plein de crainte, ni jouer des instruments, chanter et danser » (Heidegger, 1968, p. 306). Ce Dieu n’advient que par l’onto-phénoménologie de Heidegger. C’est à partir de la question de l’Être que se pose la question de Dieu. Michel Henry posera la question de Dieu à partir de la Vie. Il affirmera à suite de Heidegger : « Les hommes voudront mourir – mais non la Vie. Ce n’est pas n’importe quel Dieu aujourd’hui qui peut encore nous sauver, mais – quand partout et s’étend sur le monde l’ombre de la mort – Celui-là qui est Vivant » (Henry, 1996, p. 345). Selon Henry, seul un Dieu vivant peut encore nous sauver. Avant de penser le rapport entre le Dieu heideggérien et le Dieu vivant d’Henry, nous allons aborder d’abord le rapport entre la phénoménologie matérielle et le christianisme.
2. HENRY ET LA PHENOMENOLOGIE DU CHRISTIANISME
La phénoménologie du christianisme est la compréhension du christianisme à partir de l’onto-phénoménologie de Michel Henry. Cette onto-phénoménologie est une phénoménologie de la Vie. En effet, « la phénoménologie de la vie s’inscrit dans le grand courant philosophique qui a pris naissance en Allemagne à la fin du XIXe siècle avec Edmund Husserl et qui, avec des penseurs majeurs comme Martin Heidegger et Max Scheler, s’est continué à travers tout le XXe siècle pour être vivant aujourd’hui, en France notamment » (Henry, 2010, p. 59). Elle s’écarte de la phénoménologie historique parce qu’elle a pour objet la Vie qui est de part en part phénoménologique. La Vie n’est ni un étant ni un mode d’être de l’étant. La seule vie qui existe est la vie phénoménologique transcendantale qui définit le mode originaire de la phénoménalité pure, à laquelle nous donnons le nom de révélation. La révélation propre à la vie est une auto-révélation. Cette auto-révélation veut dire d’une part que la vie qui accomplit l’œuvre de la révélation et d’autre part, ce qu’elle révèle, c’est elle-même. La révélation de la vie et ce qui se révèle en elles ne font qu’un (Cf. Idem, p. 64-65). Si la révélation de la vie coïncide dans l’immanence avec ce qu’elle révèle, comment la vie se révèle-t-elle ?
Pour répondre à cette question, nous admettons que l’auto-affection reste la voie noble pour décrire l’autorévélation. Mais étant donné qu’il y a une connexion essentielle entre le pur fait de vivre et l’affectivité, une autre voie s’ouvre : celle du christianisme. Car au dire de Jean, Dieu n’est pas seulement Vie, il est Amour. De plus, Henry justifie que « le vivant parvient dans la Vie en s’appuyant sur le propre parvenir de la Vie en soi, en s’identifiant à ce dernier – à l’auto-révélation de la Vie elle-même identique à la Révélation de Dieu » (Henry, 1996, p. 73). Nous ne voudrions pas, sans pour autant nous écarter, en face de cette ouverture à Dieu, réitérer cette célèbre question heideggérienne : « Comment Dieu entre dans la philosophie moderne, mais dans la philosophie en tant que telle ? » (Heidegger, 1968, p. 290).
Loin de chercher à détailler et à restituer la réponse du philosophe de Fribourg lors de son séminaire d’Hiver en 1957, notons tout de même que l’enjeu de cette question est de comprendre comment et pourquoi la philosophie s’achève et s’accomplit en coïncidant avec la religion manifeste, chrétienne. Revenons à cette question qui comme un rythme cadence toute la conférence. « Comment Dieu entre-t-il en philosophie ? » L’interlocuteur principal de Heidegger est évidemment Hegel. D’une part, nous avons Dieu, partout présent en philosophie (le dieu grec) et d’autre part Dieu, révélé en Christ. Le génie de Heidegger est de substituer à Dieu révélé en Christ (dont Hegel dire qu’il est « le gond autour duquel tourne toute l’histoire du monde ») un dieu anonyme et religieusement indéterminé dont il en réduit définitivement la divinité et la puissance, puisqu’il le place en résidence forcée et le soumet à l’ordre métaphysique (Franck, 1998, p. 148).
En ce sens, le philosophe allemand pense que Dieu entre dans la philosophie par la Conciliation. La Conciliation nous révèle l’être comme le fond qui apporte et qui présente ; et ce fond à lui-même besoin d’une fondation-en-raison appropriée, à partir de ce qu’il fonde lui-même en raison : c’est-à-dire qu’il a besoin d’une causation par la Chose la plus originelle, par la Chose la plus primordiale entendue comme Causa sui. Tel est le nom qui convient à Dieu dans la philosophie. Ce Dieu, l’homme ne peut ni le prier, ni lui sacrifier, ni tomber à genoux plein de crainte, ni jouer des instruments, chanter et danser. En effet, le Dieu comme Causa sui, qui n’est pas le Dieu des philosophes, est peut-être plus près du Dieu divin. Mais ceci veut dire seulement qu’une telle pensée lui est plus ouverte que l’onto-théo-logique ne voudrait le croire (Cf. Ibid., p. 306).
Henry ne s’est jamais posé cette question de l’entrée de Dieu dans sa phénoménologie de la vie. Mais, sa compréhension de Dieu n’est pas radicalement différente du divin heideggérien. La Causa sui pourrait être appliquée à la compréhension henryenne de Dieu. Car l’une des équations du christianisme qu’on trouve chez Henry est : Dieu est Vie. Sans doute, le philosophe de Montpellier n’est pas le premier à penser ainsi. Car, Hegel écrit dans un manuscrit théologique de jeunesse, L’essence du christianisme et son destin : « Dieu ne peut pas être enseigné, ni appris, car il est vie, et ne peut être saisi que par la vie » (Heidegger, 1980, p. 158). « Dieu est Vie », l’une des équations fondamentales du christianisme, existe donc chez Hegel. La manière dont la question de Dieu se pose chez Henry est réellement proche du système hégélien. Car, le tableau que nous offre la lecture heideggérienne de l’histoire de la métaphysique en constatant l’accomplissement et l’achèvement de la philosophie hégélienne par la religion manifeste, le christianisme semble être proche du schéma henryen.
Toutefois, nous ne voulons pas inscrire l’onto-phénoménologie de Henry dans une tradition onto-théo-logique. Parce que, « la phénoménologie (…) s’oppose dans le principe à la métaphysique pour autant qu’elle s’en tient délibérément au phénomène tel qu’il se montre de lui-même » (Henry, 2000, p. 303). Ceci étant, il est aberrant de lier la phénoménologie de la vie à l’onto-théo-logie. Car, la question fondamentale de l’onto-théo-logie – comment Dieu entre-t-il dans la philosophie ? – n’est pas le problème de la phénoménologie de la vie. Le problème de la phénoménologie de la vie est de parcourir la grande coïncidence qu’elle découvre avec le christianisme. Il n’est plus simplement question d’une Conciliation mais d’une approche phénoménologique du christianisme : Je voudrais m’interroger sur la possibilité d’une approche phénoménologique du christianisme – étant entendu qu’il ne s’agit pas de proposer une interprétation mais qu’une telle « approche » devrait pouvoir conduire au cœur du christianisme. Je dirai tout de suite qu’une phénoménologie capable de remplir un tel programme est la phénoménologie de la vie (Henry, 2004, p. 103).
Tout en écartant la phénoménologie historique qui a pris naissance chez Husserl et l’herméneutique, Henry ose un chemin radicalement fidèle à la méthode phénoménologique. Il veut atteindre le cœur du christianisme. Ceci n’est rien d’autre qu’un geste de réduction phénoménologique : « Aller droit aux choses ». Comment a-t-il pu atteindre le cœur du christianisme ? Que découvre-t-il ? Avant tout qu’est-ce que le christianisme ? L’introduction de C’est moi la Vérité aborde ouvertement cette question : « appellerons-nous « christianisme » » (Henry, 1996, p. 7). Avant de traverser cette introduction pour voir ce qu’il se profile à l’horizon, efforçons-nous selon nos possibilités de tracer de façon historique le dialogue de Henry avec le christianisme. Notons pour commencer que le christianisme est présent dès le début de la quête philosophique de Henry. Cette présence se traduit par la place qu’occupe maître Eckhart dans L’Essence de la Manifestation.
En 1966, dans son essai sur l’ontologie biranienne, Henry trouve dans le christianisme le paradigme de ce qui fut sa « première grande émotion ». Le christianisme place en réalité avant tout la vie. Avant toute action, il y a la vie pas n’importe quelle vie mais la vie de l’ego. En effet, la rencontre avec Maine de Biran lui a permis d’accorder une place centrale à l’action. En ce qui concerne la philosophie de cette dernière, l’auteur de Philosophie et phénoménologie du corps écrit : « La philosophie de l’action de Maine de Biran n’est pas une philosophie de l’action par opposition à une philosophie de la contemplation ou de la pensée, elle est une théorie ontologique de l’action et son originalité, sa profondeur ne réside pas dans le fait d’avoir déterminé le cogito comme un « je peux », comme une action et comme un mouvement, elle consiste dans l’affirmation que l’être de ce mouvement, de cette action et de ce pouvoir, est précisément celui d’un cogito » (Henry, 1966, p. 74). Ce qui découle d’une telle affirmation est une théorie nouvelle du mode de connaissance par lequel le mouvement nous est donné. Celui-ci est précisément celui de l’expérience interne transcendantale, le mouvement nous est donc connu d’une façon immédiate, absolument certaine, et son étude est comprise dans le projet d’une philosophie première (Cf. Ibidem). Par ailleurs, l’essai sur l’ontologie biranienne est une « destruction phénoménologique » de la philosophie de l’action, thématisée dans sa conclusion. Avant d’évoquer la conclusion, arrêtons-nous sur la question du travail de la destruction (Heidegger, 1929, § 6).
La destruction henryenne part de l’oubli de la vie. C’est à partir de cette hypothèse que Henry va relire l’histoire de la philosophie et envisager la possibilité d’un savoir de la vie. L’oubli de la vie doit faire l’objet d’une élucidation radicale. Comment pourrions-nous comprendre cet oubli ? La compréhension de cet oubli repose sur le principe fondamental de toute la pensée de Henry : « l’essence de la transcendance réside dans l’immanence » (Henry, (2011, 1965), § 52, p. 479). En ce sens, l’oubli de la vie est lié à « la dissimulation de la Vie phénoménologique absolue qui est la seule vie réelle, celle qui ne cesse en son « vivre » de s’éprouver soi-même » (Henry, 1996, p. 57). A l’aurore de sa quête philosophique, Henry affirme que « la dissimulation de l’essence était rapportée, non à une incompréhension défaillance de la pensée, mais à cette essence même, à la structure ontologique de la réalité » (Henry, (2011, 1965), § 52, p. 478). Le statut de l’oubli fait qu’il outrepasse le cadre de l’oubli comme un mode de la pensée. Car il n’est pas le corrélat ou l’envers d’un souvenir possible. C’est-à-dire, nous oublions ce à quoi nous ne pensons pas ou ne pensons plus. De ce que nous oublions de la sorte, cependant, nous pouvons toujours nous souvenir. De tout ce qui se montre à nous dans la vérité du monde, nous nous souvenons et l’oublions tour à tour (Cf. Henry, 1996, p. 186). L’oubli de la vie rompt avec la vérité du monde et par conséquent avec la dialectique oubli et souvenir.
En effet, l’oubli de la vie est un oubli ontologique fondamental. Il est « l’oubli de la présence pure, le fait pour la pensée de ne pas penser à cette essence qui, cependant, la rend possible et se trouve toujours présente » (Henry, (2011, 1965), § 52, p. 483). En clair, l’oubli est celui de la pensée parce qu’elle se dirige vers l’extériorité hors de laquelle se retient l’essence originelle de la présence pure, l’immanence. Voilà pourquoi, « la confusion ruineuse de la Vie avec un étant vivant ou, pour parler un autre langage, avec un organisme vivant, résulte directement de la carence phénoménologique de la pensée occidentale de son impuissance permanente à penser la Vie comme vérité et, qui est plus, comme l’essence originelle de celle-ci » (Henry, 1996, p. 62). Seule la phénoménologie de la vie pourrait penser l’immanence de la vie qui se dérobe à la pensée occidentale. La phénoménologie de la vie ne peut que donc dans son rapport au christianisme parler du Dieu vivant.
3. DU DIEU HEIDEGGERIEN AU DIEU VIVANT HENRYEN
La phénoménologie sotériologique est la tentative de réponse que propose Heidegger et Henry à la question de la technique. En face du déchaînement de la technique, Henry affirme plus d’une fois que le salut viendrait de ce qui est au commencement : « Que pouvons-nous faire ? Nous écrier avec l’un des grands penseurs de ce temps :
Seul un dieu peut encore nous sauver ! » Mais ce dieu habite en nous, il est la vie qui ne cesse de nous donner à nous-mêmes avec ses prescriptions insurmontables, qui ne cesse, malgré le tumulte, de faire entendre sa voix. Peut-être est-ce aux intellectuels et aux philosophes de l’entendre, de ne plus se précipiter aveuglément dans les voies ouvertes par le savoir scientifique, de se souvenir et de dire qu’il en existe un autre, plus ancien et plus essentiel, et qui, en effet, peut seul aujourd’hui nous sauver (Henry, 2004, p. 38-39).
Henry fait allusion à la déclaration énigmatique de Heidegger en 1976 lors d’un entretien télévisé où ce dernier dit : « Seul un dieu peut encore nous sauver…et non mon prochain ». Dans son ouvrage Heidegger et l’hymne au sacré, Brito pense que le Dieu qui est en jeu n’est ni le dieu des philosophes, ni celui des chrétiens mais le dieu des poètes dont Heidegger veut préparer la venue par la poésie. Pour aller plus loin ce Dieu pourrait faire penser à celui des Beitragäe qui est « tout autre par rapport à ceux qui ont été et ne cessent d’avoir été, tout autre, par rapport même au Dieu christique » (Heidegger, 2013, p. 459).
Dans les § 252-256 et 279, Heidegger parle du « Dieu à l’extrême ». En effet, le Dieu à l’extrême possède un aspect suprême unique ; il se tient au-dehors de la détermination comptable que repèrent les dénominations : « mono-théisme », « pan-théisme », « a-théisme ». Avec la mort de ce Dieu (les sous-espèces de théismes), c’en est fini de tous les théismes. La pluralité des Dieux n’est surmontée à aucun chiffre ; bien au contraire, elle dépend de la richesse intime des fondements et des abîmes dans le site d’instantanéité où scintille et où se met à couvert le signe qu’envoie le Dieu à l’extrême.
Le Dieu à l’extrême n’est pas la fin, mais au contraire l’autre commencement de possibilités pour notre histoire, que personne n’est à même de mesurer. Préparer l’apparition du Dieu à l’extrême, c’est prendre le risque ultime de la vérité de l’estre, grâce à laquelle seulement réussit l’opération de restituer l’étant à l’être humain. Mais, comment le Dieu à l’extrême sauve-t-il l’homme ? Heidegger dit qu’il n’est pas question de rachat c’est-à-dire au fond un prosternement de l’être humain. Au contraire, c’est l’implantation de la pleine essence plus originale (fondamentation du là qu’il s’agit d’être) au sein de l’estre : c’est reconnaître que l’homme fait partie de l’estre à travers le Dieu ; c’est l’aveu du Dieu – aveu qui ne lui fait rien perdre, pas plus qu’à sa grandeur – selon lequel il est un être en besoin de l’estre. Alors, là où il faut à Dieu l’être humain, là où l’homme en tant qu’être le là doit avoir fondamenté son appartenance à l’estre. Alors, l’éclair d’un instant, l’estre, comme entre-deux le plus intensément tendu, est égal au rien ; le Dieu l’emporte sur l’homme en puissance, et l’homme surpasse le Dieu dans la rencontre de la vérité de l’estre. Bref, l’enracinement de l’homme dans l’estre par la médiation de Dieu a en soi la garantie de la grandeur non pas de l’éternité vide et gigantesque, mais de la voie la plus courte.
Le Dieu de l’extrême est le commencement où s’entreprend la très longue histoire en empruntant sa voie la plus courte. Ceux qui sont tournés vers l’avenir du Dieu à l’extrême, menant la bataille du litige monde et terre arriveront à gagner de haute lutte l’avenance. En même temps, la massification déchaînera toutes les tromperies et emportera tout ce qui vit et pense à demi, tout ce pour quoi la tradition n’est là que pour tranquilliser. Est-ce alors le temps des Dieux sera révolu ? Est-ce que débutera alors la retombée dans la vie des êtres pauvres en monde, à qui la terre n’est plus que chose exploitable ? Selon Heidegger pour rompre avec ce paradigme, où tout est maintenant inséré dans une planification qui vise à optimiser la maniabilité et l’exactitude des processus de sécurisation pour aboutir à une maîtrise « totale », il faut la retenue et garder le silence qui vont être la manière la plus ardente de fêter le Dieu à l’extrême. La retenu et le silence vont nous aider à recueillir dans le poème l’avenir du Dieu à l’extrême.
Ce Dieu à l’extrême ne fait pas alternative avec le dieu chrétien ; il ne se présente pas comme un nouveau dieu contre les anciens. Le dernier dieu indique l’être-dieu le plus pensable. C’est donc le Dasein qui sauve Dieu et non le contraire. Car la foi et la théologie sont congédiées comme chez Henry. Henry va parler du Dieu vivant qui est au-delà de la philosophie et la théologie. Mais comment ce Dieu vivant nous sauve-t-il ? Mais avant tout, qu’est-ce que le salut ? Dit autrement, comment faut-il penser le rapport entre la technique et la religion ?
Henry n’a jamais abordé ouvertement ce qu’il entend par salut. Mais en partant de son analyse de la barbarie, nous pouvons déchiffrer le sens du concept de salut. Le concept de salut reçoit son contenu du christianisme. Selon le christianisme, le salut est à la fois une délivrance du danger et un retour à la condition initiale. Il y a donc un aspect négatif et un aspect positif. Nous retrouvons ici ces deux aspects. Pour mettre fin au ravage de la terre par la technique, il faut d’une part repenser la science à partir de la vie et d’autre part que l’homme retrouve sa condition de fils de la vie, fils de Dieu. Par ailleurs, Heidegger s’intéresse à la question du salut lorsqu’il parle du rapport des mortels et de la terre dans son « Quadriparti ». Ainsi écrit-il :
Les mortels habitent alors qu’ils sauvent la terre – pour prendre le mot « sauver » dans son sens ancien que Lessing a encore connu. Sauver (retten) n’est pas seulement arracher à un danger, c’est proprement libérer une chose, la laisser revenir à son être propre. Sauver la terre est plus qu’en tirer profit, à plus forte raison que l’épuiser. Qui sauve la terre ne s’en rend pas maître, il ne fait pas d’elle sa sujette : de là à l’exploitation totale, il n’y aura plus qu’un pas (Heidegger, 1958, p. 178).
Dès lors, le salut ne concerne pas une réalité future mais pose le problème de l’habitation de la terre. « Dans la libération de la terre, dans l’accueil du ciel, dans l’attente des divins, dans la conduite des mortels, l’habitation se révèle comme le ménagement quadruple du Quadriparti » (Ibidem). Seulement, Heidegger veut habiter la terre en poète mais Henry veut l’habiter en tant que Fils de la Vie, Fils de Dieu. C’est ainsi que la religion comme lien avec « le Dieu vivant » interviendrait dans le domaine de la technique. Comment faut-il comprendre le salut du Dieu vivant ? Ce n’est pas que Dieu prend la place des hommes mais qu’il suscitera des hommes comme Héraclès, le héros moral par excellence, qui dans la mythologie grecque a mis fin au déchainement de la force prométhéenne non éclairée par la sagesse de Zeus. Qui sont ces Héraclès dans notre situation de détresse ? Ces Héraclès sont des fils de la vie. A vrai dire, les philosophes sérieux, dont parle Husserl dans la Krisis, sont selon Henry les fils de la vie. Car, en présence de l’évanouissement de la possibilité intérieure de l’homme, de son « essence », qui fait de lui une coquille vide, ce creux ouvert à tous vents et susceptible d’être rempli désormais par n’importe quel contenu, dû à la science et à l’incapacité de la philosophie moderne à préserver cette possibilité, seule la phénoménologie de la Vie a la vocation de défendre l’homme véritable. En effet, ce que condamne la phénoménologie de la Vie à ce niveau ce n’est pas la science en tant que telle puisqu’elle fait partie de notre être-au-monde. En effet, « la science a quelque chose à voir avec le fait que l’homme n’ait pas été autorisé à séjourner dans la sécurité d’un monde de la vie, ne le pourra plus jamais » (Blumenberg, 2011, p. 94). En vérité, le séjour des fils de la vie n’est possible que dans le monde. C’est pour penser ce rapport au monde, que les fils de la vie auront à cœur de scruter la science à partir de la vie. C’est à cette seule condition que le Dieu vivant nous sauve.
Conclusion
La phénoménologie sotériologique est cette tentative de lire le seul Dieu nous sauve de Heidegger et le seul Dieu vivant de Michel Henry. Nous avons tenté de comprendre ces deux affirmations du rapport entre la théologie et la phénoménologie. La question du Dieu sauveur est abordée dans une perspective onto-phénoménologique. L’onto-phénoménologie est la condition de possibilité de la phénoménologie sotériologique. La phénoménologie sotériologique n’est pas une simple compréhension de la philosophie comme doctrine de salut. Elle veut faire de l’humain le seul capable de poser et de se poser radicalement la question de Dieu. En faisant dépendre la question de Dieu à la pensée de l’être-vie, elle assure au Dasein et aux fils de la vie la possibilité d’habiter le « Quadriparti » : « Il n’y a pas les hommes, et en plus de l’espace ; car, si je dis « un homme » et par ce mot je pense un être qui ait manière humaine, c’est-à-dire qui habite, alors en disant un homme je désigne déjà le séjour dans le « Quadriparti » » (Heidegger, 1958, p. 186). Le séjour dans le « Quadriparti » se trouve autrement chez Henry. Nous pouvons reconstituer un « Quadriparti » henryen : au lieu de « la terre et le ciel, les divins et les mortels qui forment tout dans une Unité originelle » nous avons « la terre et le ciel, la Vie et les vivants qui forment tout dans une unité originelle ». Cette unité originelle sauvegardée par la poésie doit être décryptée par une pensée méditante. C’est pourquoi la pensée de l’être porte en soi l’attente de Dieu et pourrait sauver notre humanité du péril.
Références bibliographiques
ARJAKOSKY P., Fédier, F., et France-Lanord, H., 2013. (dir), Le dictionnaire Martin Heidegger, Paris, Cerf, 1450 p.
BLUMENBERG H., 2011, Description de l’homme, traduction de l’allemand et préface de Denis, Paris, CERF, 830 p.
CAPELLE P., 2011, « Martin Heidegger (1889-1976) une triple tension « philosophie-théologie » », dans philosophie et théologie à l’époque contemporaine, IV, volume dirigé par Jean Greisch et Geneviève Hébert, Paris, Cerf, 340 p.
CAPELLE P., 2001, Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger, Paris, Cerf, 283 p.
HEIDEGGER M., 1976, Acheminement vers la parole, traduit de l’allemand par Jean Beaufret, Wolgan Brokmeier et François Fédier, Paris, Gallimard, 258 p.
HEIDEGGER M., 2013, Apports à la philosophie de l’avenance, traduit de l’allemand par François Fédier, Paris, Gallimard, 605 p.
HEIDEGGER M., 1996, C’est moi la vérité, pour une philosophie du christianisme, Paris, Éditions du Seuil, 344 p.
HEIDEGGER M., 1962, Chemins qui ne mènent nulle part, traduit de l’allemand par Wolgang Brokmeier, Paris, Gallimard, 315 p.
HEIDEGGER M., 1976, Der Spiegel, 31 mai 1976.
HEIDEGGER M., 1958, Essais et conférences, traduit de l’allemand par André et préfacé par Jean Beaufret, Paris, Éditions, 351 p.
HEIDEGGER M., 2011, Généalogie de la psychanalyse, Le commencement perdu, 3e édition, Paris, PUF, 400 p.
HEIDEGGER M., 2008, La barbarie, 2è édition, Paris, PUF, 287 p.
HEIDEGGER M., 1998, Nietzsche et l’ombre de Dieu, coll. Epiméthée, Paris, PUF, 480 p.
HEIDEGGER M., 2010, Phénoménologie de la vie I, De la phénoménologie, Paris, PUF, 224 p.
HEIDEGGER M., 2004, Phénoménologie de la vie IV, Sur l’éthique et la religion, Paris, PUF, 248 p.
HEIDEGGER M., 2011, Philosophie et phénoménologie du corps, essai sur l’ontologie biranienne, 6e édition, Paris, PUF, 282 p.
HEIDEGGER M., 1968, Questions I et II, traduit de l’allemand par André Préau, Paris, Gallimard, 582 p.
HEIDEGGER M., 1966, Questions III et IV, traduit par Jean Lauxerois et Claude Roëls, Paris, Gallimard, 489 p.
HENRY, M., 2011, L’essence de la manifestation, 4e édition, Paris, PUF, coll. « Epiméthée », 928 p.
NIETZSCHE F., 1975, La philosophie à l’époque tragique des Grecs, suivi de Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, textes et variantes établis par G. Colli et M. Montinari traduits de l’allemand par Jean-Louis Backes, Michel Haar et Marc B. de Launay, Paris, Gallimard.
OTT H., 1990, Martin Heidegger, éléments pour une biographie, traduction de J. M. Belœil, Postface de J.M. Palmier, Paris, Payot, 418 p.
SAFRANSKI R., 1996, Heidegger et son temps, traduit de l’allemand par Isabelle Kalinowski, Paris, éditions Grasset & Fasquelle, 474 p.
DU GESTELL TECHNOLOGIQUE : QUEL SALUT POUR L’HUMANITÉ ?
Konan Oscar KOUADIO
Université Alassane OUATTARA, Bouaké (Côte d’Ivoire)
Résumé : Décrire les technologies modernes et leurs excès ou méfaits en vue de les corriger est une entreprise qui demeure lettre morte car sous l’angle de son efficacité, la technique est appréciée trop pauvrement. Pour Martin Heidegger, il faut regarder de près la technique et la questionner afin de s’ouvrir à son essence comme Gestell ou « Arraisonnement ». Lequel Arraisonnement correspond au retrait le plus total de l’être au profit de l’étant et, subséquemment, à une dévastation écologique, anthropologique et ontologique, signes d’un assombrissement du monde. Seulement, comme un choc en retour, là où subsiste le péril dû au Gestell s’ouvre aussi un chemin de salut : ce flot vertigineux des inventions technologiques, incline l’homme à renouer avec la conscience du sacré afin de s’assurer plus de sérénité et une nouvelle espérance. Ainsi, est-il enjoint à l’être humain d’être dans l’habitation ontologique.
Mots-clés : TECHNIQUE, ESSENCE, ARRAISONNEMENT, PERIL, SERENITE, SALUT.
Abstract : Describing modern technologies and their excesses or misdeeds with a view to correcting them is an undertaking that remains a dead letter because from the point of view of its efficiency, technology is appreciated too poorly. For Martin Heidegger, it is necessary to look closely at technology and to question it in order to open up to its essence as Gestell or ‘Inspection’. This lnspection corresponds to the most total withdrawal of being in favour of beingness and, subsequently, to an ecological, anthropological and ontological devastation, signs of a darkening of the world. However, like a backlash, where the peril of the Gestell remains, a path to salvation also opens up : this dizzying flow of technological inventions inclines man to reconnect with the consciousness of the sacred in order to ensure more serenity and a new hope. Thus, the human being is enjoined to be in ontological habitation.
Keywords: TECHNIQUE, ESSENCE, INSPECTION, PERIL, SERENITY, SALVATION
Introduction
Du premier dessin préhistorique sur les parois d’une grotte aux premiers pas d’un homme sur la lune, et de la taille du premier silex jusqu’à la fabrication industrielle du dernier gadget, la technique jalonne, de bout en bout, l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui encore, un regard synoptique porté sur le monde autorise à dire que la technique ou la technologie « se confond avec l’air que l’on respire » (G. Hottois, 1990, p. 8). Ces mots justifient l’affirmation d’un technocosme ou une technosphère, désignant une omniprésence de la technologie dans notre monde actuel au point d’en faire un « système technicien », selon le mot de Jacques Ellul (2004, p. 88). Pourtant, le rapport de l’homme à la technique ne manque pas de partager les jugements sur la valeur de celle-ci : d’une part, la technique est considérée comme le modèle triomphant de la raison, se développant sans cesse avec des technologies renouvelées. En témoignent les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et les nouveaux mouvements scientifiques comme le transhumanisme, à l’aune desquelles peut se mesurer, l’immense puissance de la technique dont la volonté est de parfaire, d’améliorer la condition et les capacités humaines. D’autre part, un regard de condoléances semble accompagner les technophiles pour autant que ce développement de la technique, bien que produit par l’intelligence humaine, semble lui échapper. L’impression est telle que cette intelligence ne peut plus s’empêcher de produire, par la technique, des objets qui ne seraient plus à son service mais au service desquels elle serait. Le développement de la technique semble ainsi avoir un vice rédhibitoire en ce que l’homme semble y épuiser son humanité :
Du totalitarisme qui marque la rencontre de l’homme des Temps modernes et de la technique déterminée planétairement à la démocratie planétaire, l’homme épuise son humanité à servir, à son insu, parfois même convaincu du contraire, au bon fonctionnement de la technique (D. Saatdjian, 2013, p. 1276-1277).
Devant cette ambivalence, faut-il appréhender la technique uniquement à l’aune de son efficacité ? Au mieux, cerner la technique dans la perspective de son efficacité ne revient-il pas à la juger uniquement sous l’angle de nos valeurs ? Qu’y a-t-il de plus absurde que s’en tenir qu’à cet angle étriqué !? La pensée de Martin Heidegger qui est l’épine dorsale de la présente réflexion n’est ni technophobe ni technophile car, pour lui, « il serait insensé de lancer un assaut, tête baissée, contre le monde technique. Ce serait avoir la vue courte que de condamner le monde technique » (M. Heidegger, 1976, p. 176). Tout semble clair : le « penseur de la forêt noire » nous convie non à un rejet de la technique mais à la penser quant à sa portée et ses limites. Il n’est donc pas question de déprécier la technique mais d’en penser les fondements car selon le penseur de Fribourg, décrire la technique et ses excès ou méfaits en vue de les corriger n’est pas penser la technique pour autant que les critiques contre la technique se déploient encore dans l’horizon de l’efficacité qui est proprement technique. Bien plus, penser la technique revient à la saisir quant à son essence. Dès lors, quelle est l’essence de la technique ? Aussi est-il qu’en toile de fond de l’essence de la technique, à ce qu’elle est, Heidegger nous propose de méditer ses implications métaphysiques. Quelles implications métaphysiques recèle alors le dis-positif technologique ? Faut-il y déceler un péril pour l’homme ? Á vrai dire, la technologie moderne, mue par une envie d’améliorer la condition humaine s’engage dans un processus de trans-formation de la nature. Cela se matérialise aujourd’hui par l’émergence de mouvements scientifique et scientiste comme le transhumanisme ou le posthumanisme. Partant, quel(s) fondement(s) métaphysique(s) recèle le profil de « l’homme augmenté » prôné par le transhumanisme, dans la critique heideggérienne de la technologie moderne ? Faut-il appréhender ce nouveau profil de l’homme comme un péril pour celui-ci ? En somme, de fond en comble, il faut, avec Heidegger, questionner la technique. Et si « questionner, c’est travailler à un chemin, le construire » (M. Heidegger, 1958, p. 9), quel chemin le questionnement de Heidegger quant à la technique travaille-t-il à construire ? Mieux, quel chemin permettra-t-il à l’homme moderne de maîtriser le cours et les finalités précises qui cadre avec le développement technologique ? En clair, la pensée de Martin Heidegger offre-t-elle une voie de salut à l’humanité face au péril technologique ?
1. ENTRE APOGÉE ET DÉCLIN : LA TECHNIQUE Á L’ÉPREUVE DE L’AMBIGUÏTÉ.
1.1. De la technique à la technologie, histoire d’une continuité ignorée.
D’entrée de jeu, un balisage terminologique s’avère incontournable pour mieux conduire notre réflexion. Qu’entendre par technique et technologie ? Ces deux termes se rejoignent-ils ? Par ailleurs, la technique antique est-elle assimilable à la technique moderne, celle d’aujourd’hui ?
La réponse à ces interrogations nous incline à céder à la tentation d’une aventure étymologique. Qu’indique alors l’étymologie du mot technique ? Ce mot dérive du grec tecknicon qui désigne ce qui appartient à la tecknè. Ce mot tecknè, dès l’aube de la langue avait la même signification qu’épistémè qui renvoie à veiller sur une chose, la comprendre. Tecknè veut, à son tour, dire « s’y connaître en quelque chose ». Ainsi la technique relevait du domaine du savoir et du savoir-faire. C’est entre le VIIème et le Vème siècle avant Jésus-Christ que le domaine de la technique va se définir de façon plus précise avec ses caractères propres. Dès lors, qui dit technique ou tecknè dit « savoir spécialisé », « procédés secrets de réussite ». La technique rentre alors dans la sphère du faire. Elle désigne, en somme, un ensemble de procédés bien définis et transmissibles, destinés à produire certains résultats jugés utiles. Seulement, au cours de l’histoire, la technique va prodigieusement évoluer sous plusieurs formes.
De fait, pendant des milliers d’années, l’homme ne s’est servi que d’outils. Et, ces outils qui se sont multipliés, dès les temps néolithiques, sont en réalité un prolongement direct du corps, de l’adresse, de l’intelligence, de l’expérience de l’artisan. Pour en avoir le cœur net, donnons la parole à H. Bergson (1932, p. 334) :
Si nos organes sont des instruments naturels, nos instruments sont, par là même, des organes artificiels. L’outil de l’ouvrier continue son bras ; l’outillage de l’humanité est donc un prolongement de son corps. La nature, en nous dotant d’une intelligence essentiellement fabricatrice, avait ainsi préparé pour nous un certain agrandissement.
En clair, les outils sont un prolongement, une extension de la nature. Il n’y a donc pas de scission entre les deux entités. On peut remarquer ici que le corps demeure le moteur des outils qui, en réalité, permettent de l’économiser et de le protéger. Dans cette forme de technique dite « artisanale antérieure » (M. Heidegger, 1958, p. 10), l’homme n’a pas encore abandonné la nature ; rien ne le sépare de son outil, de son œuvre.
Seulement, la technique va prendre une autre forme ou orientation à partir du XVIIIème siècle sous l’instigation, un siècle plus tôt, de penseurs comme R. Descartes (1966, p. 84), pour qui :
Au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature.
Par là, Descartes donne les bases d’une philosophie pratique et inaugure, de facto, la technique moderne qui consacre la substitution de l’outil, arrachant ainsi l’homme au milieu naturel pour l’introduire dans une nouvelle sphère : celle de la machine (technique). C’est désormais l’usage de la machine par l’homme, au lieu et place des forces naturelles. C’est alors reconnaître que l’homme n’est plus dans une attitude de passivité face à la nature. En clair, la conception moderne de la nature s’oppose radicalement à celle traditionnelle qui tendait à sacraliser la nature. La technique moderne conçoit donc la nature comme un univers réductible à des rapports mathématiques dont les mouvements sont régis par un ensemble de lois. C’est bien ce que souligne L. Ferry (2013, p. 19-20) en ces termes : « la nature, le monde tout entier, obéit au principe de raison, que rien n’y advient sans raison, de sorte que la nature cesse d’être mystérieuse ou sacrée pour devenir un objet de science ». Elle proclame la domination de l’homme sur la nature. La technique s’entend, au total, comme une matérialisation de l’intelligence en vue de maîtriser la nature.
En sus, il convient de préciser que le développement technique évoque à la fois l’extension considérable du machinisme et l’application croissante des sciences aux techniques par lesquelles s’effectue la transformation de la réalité. Il y a donc une théorisation des techniques que désigne le vocable « technologie ». En d’autres mots, il peut être évoqué un parallélisme des progrès scientifiques et techniques, c’est-à-dire une constance entre le niveau d’amélioration des connaissances de type scientifique et les applications techniques qu’il est possible d’en tirer. Et ce, depuis le XVIIème siècle avec la naissance du mécanisme chez R. Descartes et le développement de la science expérimentale avec C. Bernard. Nous trouvons ainsi réponse à notre question initiale portant sur la nuance entre la technique et la technologie. En réalité, ces deux termes se rejoignent pour autant que la technologie désigne l’étude des techniques de pointe mises sur pied aujourd’hui. D’ailleurs, A. Lalande (2006, p. 1107) ne manque pas de préciser que « le mot (technologie) est employé pour technique ou ensemble de techniques ». Mais alors, l’homme arrive-t-il à trouver son équilibre dans cet univers ? En clair, l’auto-développement de la technologie quoiqu’inévitable est-il libérateur ou funeste ?
1.2. Efficacité de la technique moderne : entre prouesses et illusions
Partons de cette assertion bergsonienne :
Des machines qui marchent au pétrole, au charbon, à la « houille blanche », et qui convertissent en mouvement des énergies potentielles accumulées pendant des millions d’années, sont venues donner à notre organisme une extension si vaste et une puissance si formidable, si disproportionnée à sa dimension et à sa force, que sûrement il n’en avait rien été prévu dans le plan de structure de notre espèce : ce fut une chance unique, la plus grande réussite matérielle de l’homme sur la planète. (H. Bergson, 1932, p. 334).
Que faut-il retenir ici si ce n’est une attestation de bonne exécution délivrée au développement technologique par Bergson ? Rappelons qu’Aristote disait ironiquement que l’humanité pourrait se passer d’esclaves si un jour les navettes marchaient toutes seules, à l’exemple des trépieds miraculeux qui, disait-on, sur un simple signe des habitants de l’Olympe venaient d’eux-mêmes se ranger pour l’assemblée des dieux. Au regard des immenses prouesses technologiques aujourd’hui, ne faut-il pas, rétrospectivement, considérer cette boutade d’Aristote comme une prophétie ! Á l’image des olympiens, juste une pression de l’index sur une surface suffit, aujourd’hui, pour ̎ changer notre monde ̎. En effet, il faut avouer que par le progrès technologique, l’homme de la civilisation contemporaine s’est créé un monde engagé résolument dans un élan progressiste et qui, a priori, semble changer au mieux, sa façon d’agir et de vivre. Chaque année et ce à tous égards concernés, les prouesses technologiques susceptibles de changer la planète et la société pullulent.
Ainsi, au niveau du vieillissement ou de la maladie par exemple, le progrès des techniques devrait permettre d’assurer la conservation de la santé laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres bien de cette vie. Aujourd’hui, plusieurs traitements destinés à ralentir ou inverser le vieillissement sont en phase d’essai. Ils bloquent la sénescence des cellules liées à l’âge et réduisent l’inflammation responsable de l’accumulation de substances toxiques ou de pathologies dégénératives comme Alzheimer, le cancer ou les maladies cardiovasculaires. En juin 2019, la start-up américaine Unity Biotechnology a, par exemple, lancé un test de médicament contre l’arthrite du genou. Également, faisant allusion à cette capacité de la technologie à « doper » le corps humain par la thérapie génique B. Minier (2019, p. 13) fait la description suivante quant à l’appareil implanté dans le corps de Moïra, personnage principal de son ouvrage M, Le bord de l’abîme :
On appelait ça de la stimulation cérébrale profonde : des électrodes implantées dans la zone frontale de cerveau, celle qui agit sur l’humeur, et reliées par des fils qui passaient sous le cuir chevelu et la peau du cou à un mini-ordinateur et à une batterie logée dans sa poitrine. Les électrodes lisaient l’activité de son cerveau et l’ordinateur réagissaient, si besoin était, pour l’envoi d’une impulsion électrique. Tout ça en quelques millièmes de seconde (…) Bref un miracle technologique.
L’œuvre, en fait, à travers le personnage Moïra, jeune française qui se retrouve à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique, dépeint le pouvoir quasi illimité des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle. Tout cela confirme et conforte le projet cartésien de domination et de transformation de la nature afin de nous affranchir des limites de l’humaine condition. Mieux, pour les nouvelles technologies aujourd’hui, il s’agit même de se substituer à la nature créatrice sinon d’augmenter ses capacités grâce à l’usage des sciences et techniques.
Et, tout cela ne manque pas de favoriser l’émergence de courant scientifique comme le « transhumanisme » qui, dans son déploiement semble abolir la frontière Homme-machine. Ce courant d’idées entend promouvoir l’usage des sciences et techniques en vue d’améliorer les capacités physiques et mentales des êtres humains et de prolonger considérablement la durée de vie. Son vocabulaire et sa vision du monde tourne autour de « l’homme augmenté, l’eugénisme libéral, le prolongévisme, la colonisation spatiale comme réponse à la crise climatique » (F. Damour, D. Doat, 2018, p. 8). En somme, la technologie, mieux, la biotechnologie semble avoir transformé radicalement la condition humaine. En sus, cette capacité qui est donnée à l’homme de se trans-former grâce au pouvoir de la biotechnologie, est aussi le terreau du posthumanisme. L’humain aujourd’hui se crée ou se recrée.
Avec le posthumanisme, la frontière homme-machine s’amenuise et est abolie. L’histoire de l’humanité semble donc connaître un immense bouleversement pour autant qu’elle doit désormais s’élargir aux non humains, aux humanoïdes (cyborg, clones, robot), aux objets intelligents, façonnés par la technologie. Ici, l’intelligence de l’homme est trans-posée dans la machine sous forme d’intelligence artificielle. Au surplus, il ne s’agit plus d’augmenter les capacités humaines mais de fabriquer l’homme : c’est le passage de l’homme augmenté à l’homme fabriqué. Il n’est plus question d’augmenter le corps mais de le dépasser de manière radicale. Au total, grâce à la biotechnologie aujourd’hui « l’humanité est sortie de l’animalité au double sens du mot « sortie » : elle en vient – et en garde maintes traces – mais elle est ailleurs, sur une tout autre orbite » (A. Kahn, 2000, p. 11). Mais dans cet « ailleurs », l’homme trouve-t-il réellement son équilibre ? La vitesse exponentielle à laquelle évoluent les technologies aujourd’hui, ne donne-t-elle pas le tournis à l’homme au point de perdre le contrôle de lui-même et de ses inventions ?
Autant le feu peut aider à cuire des aliments, autant il peut provoquer un incendie. Ainsi, si la technique est le feu aux mains de Prométhée, ce feu ne semble pas échapper à la règle du manichéisme. Toute technologie possède alors sa part d’avantages mais aussi des risques.
Il y a tout d’abord un risque de mauvais usage des technologies : à mesure que nous devenons de plus en plus « connectés », il devient facile de nous espionner. Ainsi que le confirme cet aveu d’impuissance d’Éric Schmidt, PDG de Google, rapporté par B. Minier (2019, p. 7) : « Il sera de plus en plus difficile pour nous de garantir la vie privée ». Les nouvelles technologies semblent mettre ainsi l’homme à nu ; Il y a une sorte d’envahissement de l’univers de l’homme par les machines. On pourrait parler d’une mécanisation de la vie de l’homme, brisant ainsi le mur entre l’espace privé et l’espace public. Cette invasion est plus perceptible avec les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) qui transposent l’homme dans le virtuel.
De fait, la vie réelle est faite de ̎ rencontres ̎ de l’autre entendu comme une partie du moi, car en réalité, l’homme ne saurait être une province autonome. Mieux, « nous vivons endormis dans un monde en sommeil. Mais qu’un ̎ tu ̎ murmure à notre oreille (…), le ̎ moi ̎ s’éveille par la grâce du ̎ toi ̎ (…). La rencontre nous crée » (G. Bachelard, 1969, p. 9). Seulement, à y voir de près, les écrans développés par les TIC aujourd’hui recèlent le danger insoupçonné de faire basculer le genre humain dans l’étrangeté absolue des uns vis-à-vis des autres comme le laisse penser cette description faite par Minier : « Un sur deux se penchait sur son téléphone, occupé à pianoter ou à lire ses messages, à mater des vidéos sur Facebook ou sur YouTube, à se connecter à Wechat, et à Webo … » (B. Minier, 2019, p. 14). C’est alors reconnaître que les TIC aujourd’hui sont sources de dislocation sociale : elles nous éloignent les uns des autres, tout en nous éloignant de la réalité.
Enfin, sans risque de se tromper, on pourrait aussi évoquer le danger de perte de contrôle qui se traduit par un dépassement de nous-mêmes par nos propres technologies. Il y aurait ainsi, dans le déploiement ou le développement de nos technologies, un risque qui affecterait la survie même de l’humanité. C’est bien le cas de l’intelligence artificielle (IA) qui si elle atteint un degré d’intelligence comparable à l’humain, devient capable de s’améliorer elle-même. Il y a donc un risque d’explosion d’intelligence et de perte de contrôle qui pourraient entraîner un surclassement de l’homme par la machine, notamment les humanoïdes. C’est pourquoi, Elon Musk, cofondateur et PDG de Tesla et de SpaceX, nous avertit en ces termes : « J’ai accès aux IA les plus en pointe, et je pense que les gens devraient être réellement inquiets » (B. Minier, 2019, p. 17).
En somme, il faut signifier qu’au regard de l’accroissement des inventions technologiques et de leur impact sur l’homme, on pourrait penser que les hommes de sciences auraient oublié la sentence d’Hippocrate : « D’abord ne pas nuire ». Car, en réalité, si les récentes inventions technologiques inspirent de grandes espérances, force est de reconnaître qu’elles réveillent aussi beaucoup de craintes : le savoir qui s’incarne dans la technique est, en réalité, un instrument de pouvoir non pas au service de l’homme contre la nature mais comme instrumentalisation de la nature et de l’homme.
Ces constats sont aptes à nous rendre perplexes quant à la valeur du rapport de l’homme à la technique. L’appréciation de la valeur du rapport de la technique à l’homme tombe alors sous le coup d’une ambiguïté et semble n’offrir aucune voie de salut pour l’humanité. Mais n’est-ce pas parce que la technique est appréciée trop pauvrement sous cet angle ? Cet angle, celui de la perception instrumentale de la technique ne nous barre-t-il pas l’accès à son essence ? Quel est alors le mode de dévoilement véritable de la technique par lequel son essence peut être révélée ? Au total, ce sont moins les aspects visibles du monde technique que le « visages » métaphysique qui semble s’y cacher qui intéresse Heidegger. Ainsi, nous invite-il à « dégager ou déceler les arrière-mondes (les soubassements philosophiques) qu’il dissimule et qui le rendent compréhensible » (L. Ferry, 2013, p. 18).
2. LE GESTELL COMME PRO-VOCATION DE L’ÉTANT ET MODE DE DÉVOILEMENT DE LA TECHNIQUE MODERNE.
2.1. De la primauté de l’essence de la technique sur son efficacité.
Pour mieux appréhender la technique, l’attitude authentique serait de regarder de si près celle-ci au sens où regarder de près une chose signifie la penser, la mettre en question et quêter son essence. Quelle est alors, regardée de si près, l’essence de la technique ?
« L’essence de la technique n’est absolument rien de technique » (M. Heidegger, 1958, p. 9) car l’essence d’une chose ne s’épuise pas avec son apparence concrète. Il va sans dire que pour Heidegger l’essence de la technique ne saurait être un objet technique particulier. Ainsi que l’indique G. Hottois (2005, p. 350) :
Heidegger ne s’intéresse pas aux techniques dans leur diversité physique et leur dynamique concrète. Un tel intérêt focalisé sur des étants (les machines) et leurs pouvoirs effectifs, demeurerait nihiliste et ne dévoile rien. Ce qui requiert Heidegger, c’est l’essence ou l’être de la technique […].
Comment alors saisir concrètement l’essence de la technique ?
Pour entendre ce qu’est l’essence de la technique, il est indiqué de porter un regard sur la distinction que Heidegger (1958, p. 40) établit entre le « Wesen » et l’« essentia » dans La question de la technique :
Ainsi le Ge-stell, en tant qu’il recueille l’adresse destinale du dévoilement est bien das Wesen [l’aître] de la technique, mais en aucun cas Wesen [essence] au sens du genre et de l’essentia. Si nous prêtons attention à ce point, alors nous frappe quelque chose d’étonnant : c’est la technique qui exige de nous de penser ce que nous entendons habituellement par Wesen.
Au lieu et place du sens technique, c’est du côté de la métaphysique qu’il faudra saisir l’essence de la technique. Et ici, l’essence de la technique est dévoilement en tant que quelque chose sort hors du retrait qui l’abritait pour advenir à la lumière de la présence. L’essence, dans ce sens, ne doit donc pas être perçue au sens platonicien de ce qui perdure, ce qui est constamment présent. La technique, serait-on tenté de le dire, n’a jamais un sens technologique mais possède plutôt une signification métaphysique et caractérise le type de rapport que l’homme entretient avec la nature. Et contrairement à la technè grecque dont le mode de dévoilement de l’étant est poétique, la technique moderne est dévoilement sous le mode de la pro-vocation : « Le dévoilement qui régit la technique moderne est pro-vocation » (M. Heidegger, 1958, p. 20).
Somme toute, apprécier la technique moderne sous l’angle de son efficacité équivaut à une perception instrumentale de celle-ci. Et, celle-ci est adossée au rapport entre moyens et fin qui laisse apparaître, en toile de fond, la question de la causalité si chère au philosopher aristotélicien. Ici, la technique est perçue comme un instrument, un moyen donné à l’homme pour atteindre des fins. Or, nous dit Heidegger, le moyen en tant que cause est « ce qui répond d’une autre chose » (M. Heidegger, 1958, p. 13). Autrement dit, toute cause est cause en se fondant sur un ordre plus profond, plus originel et dont elle répond. Et cet ordre plus profond est la pro-duction pour autant que « les quatre causes jouent à l’intérieur de la pro-duction. C’est par celles-ci que, chaque fois, vient au jour aussi bien ce qui croît dans la nature que ce qui est l’œuvre du métier ou des arts » (M. Heidegger, 1958, p. 17). Aussi est-il que « pro-duire a lieu seulement pour autant que quelque chose de caché arrive dans le non-caché. Cette arrivée repose, et trouve son élan, dans ce que nous appelons le dévoilement » (M. Heidegger, 1958, p. 17). In fine, la technique en tant qu’instrument appelle à un ordre plus profond dont elle semble répondre en tant que son mode dévoilement car tout compte fait, « la technique n’est pas seulement un moyen ; elle est un mode du dévoilement » (M. Heidegger, 1958, p. 18). Dans ces circonstances, nous sommes en droit de nous interroger : quel est le mode de dévoilement qui régit la technique ? Du reste, n’est-ce pas par ce mode de dévoilement que se révèle l’essence même de celle-ci ?
2.2. La pro-vocation de l’étant comme mode de dévoilement de la technique moderne
De prime abord, qu’est-ce que la pro-vocation ? Faut-il l’entendre au sens courant du terme ? Dans un sens large, « provoquer » s’inscrit dans le champ lexical de la violence. Ce terme renvoie donc à une incitation ou une excitation consistant à susciter un comportement violent, non naturel d’une chose ; à l’amener à sortir de son mouvement naturel, l’exciter pour qu’elle s’ex-pose, c’est-à-dire qu’elle se pose là-devant nous. Voilà ce en quoi consiste « provoquer ». Le tout revient donc à contraindre une chose à se livrer à nous. Heidegger abonde dans le même sens lorsqu’il rapporte l’essence de la technique à la pro-vocation car ici, la technique moderne comme provocation nous signifie qu’en son essence, celle-ci est une mise en demeure de la nature. Laquelle mise en demeure consiste à exciter la nature pour que celle-ci livre son fond, son contenu. La pro-vocation transforme la nature en fonds et stock d’énergie disponibles pour l’homme et c’est bien cela que Heidegger nomme « arraisonnement » ou « Gestell ». Mais comment a lieu le dévoilement provocant dans la technique moderne ?
Prenons pour appui cette image que nous donne M. Heidegger (1958, p. 21-22) :
La centrale électrique est mise en place dans le Rhin. Elle le somme (stellt) de livrer sa pression hydraulique, qui somme à son tour les turbines de tourner. Ce mouvement fait tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique, pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. Dans le domaine de ces conséquences s’enchaînant l’un l’autre à partir de la mise en place de l’énergie électrique, le fleuve du Rhin apparaît, lui aussi comme quelque chose de commis. La centrale n’est pas construite dans le courant du Rhin (…). C’est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale.
Par cette image, nous nous apercevons que la volonté ou le projet humain de dominer et maîtriser la nature l’insère dans un nouveau type de rapport avec elle. Ce qui apparaît principalement dans le déploiement de la technique moderne, c’est la violence exercée sur la nature. Celle-ci [la technique moderne] est bien différente et contraire même à la technè grecque qui s’entend comme un dévoilement poïétique, produisant conformément à la nature. Cette différence est encore plus perceptible dans la comparaison que Heidegger fait entre le paysan et l’agriculteur moderne : « Le travail du paysan ne provoque pas la terre cultivable » (M. Heidegger, 1958, p. 22). En fait, le paysan met la graine en terre et la laisse aux soins des forces de croissance naturelles afin que celles-ci la fassent germer. Le paysan ensemence le champ et implore la générosité de la terre sans la contraindre. L’image du paysan traduit l’élan dans lequel s’inscrivait la technique traditionnelle telle qu’elle était mise en œuvre chez les Grecs. Ici subsiste un mystère, celui de la croissance qui se déploie dans le secret.
Pour ce qui est de la terre, le changement de perception n’est pas moins visible. Car la conception grecque faisait de celle-ci le monde de l’Être ou des êtres car elle renferme les forces de croissance. Elle est pensée comme physis, c’est-à-dire « croissance, naissance » et décrit la force de ce qui pousse de l’intérieur toutes les choses et les être à croître et à se développer. Ainsi, dans la culture traditionnelle, la terre est considérée comme la « suprême déesse », « l’indestructible infatigable » selon le mot de Sophocle. La terre était ainsi perçue comme le lieu providentiel du séjour humain : « ce sur quoi et en quoi l’homme fonde son séjour » (M. Heidegger, 1962, p. 37). Loin d’être simplement une étendue de sol composée de plusieurs couches ou encore une simple planète du système solaire, la terre avait pour le paysan d’autrefois, mais aussi pour les Grecs de l’antiquité, une connotation ontologique. « La terre, c’est le sein dans lequel l’épanouissement reprend, en tant que tel, tout ce qui s’épanouit. En tout ce qui s’épanouit, la terre est présente en tant que ce qui héberge » (M. Heidegger, 1958, p. 45). La terre est ainsi vue comme la Mère bienveillante et généreuse au sein de laquelle tout s’épanouit. C’est pourquoi, donnant la parole au professeur S. Diakité, il peut affirmer ceci quant à ce respect quasi-religieux voué à la terre, à la nature : « L’homme de la pure tradition africaine éprouve un respect démesuré pour la nature et vit autant que faire se peut, au rythme des palpitations du « cœur de la nature ». Il a une attitude religieuse à l’égard de la nature » (S. Diakité, 1985, p. 32).
C’est un rapport d’une autre nature que l’agriculteur moderne a à la nature et à la terre. Celle-ci n’est plus considérée comme le lieu ontologique de l’épanouissement humain. De son statut de Terre-Mère pourvoyeuse de vivre et de séjour aux hommes, la terre est devenue un seul support sur lequel l’homme fait pousser des aliments. Dans la technique moderne, l’homme se détourne de son rapport ontologique à la terre pour en faire un simple objet à connaître, maîtriser et exploiter. Avec le développement de la technique moderne, la terre est devenue un objet pour le sujet humain. L’homme se tient en dehors et face à la terre. La terre est ainsi désacralisée. Elle est même modifiée, convoquée à produire plus par l’apport d’engrais chimique, pour une exploitation meilleure. L’homme « force la terre à sortir du cercle de son possible (…), la pousse dans ce qui n’est plus le possible et qui est donc l’impossible » (M. Heidegger, 1958, p. 113). Pour tout dire, la puissance technoscientifique a arraisonné le dynamisme de la nature. La cause est que l’étendue de l’action humaine s’est accrue tant et si bien que même les entrailles de la terre, les profondeurs insoupçonnées des océans sont explorées et exploitées abusivement.
La technique moderne est donc en son essence une pro-vocation de la nature, de l’étant en sa totalité même. Avec elle, la nature est poussée au-devant d’elle-même afin de se dévoiler comme un vaste réservoir d’énergie exploitable et de matières premières. Son dévoilement provocant n’épargne aucun élément de la nature. La nature devient autre et autrement. Elle acquiert un mode de présence foncièrement et fondamentalement différent de celui de la production poïétique. Ainsi, pour pasticher A. Kahn (2000, p. 1), pourrait-on s’interroger de la manière suivante : « Et l’homme dans tout ça ? ». Selon Heidegger, dans un tel déploiement de la technique, l’essentiel en tant que ce qui permet à l’homme de bâtir une historialité consistante semble être congédié ; l’homme semble ne plus trouver un équilibre existentiel. Il tâtonne tel un aveugle tapant le sol avec le bout de sa canne pour trouver une voie. Partant, l’être humain est exposé à un péril à la fois anthropologique, écologique et ontologique. Mais en face de ce danger, dans cette méditation qui nous engage à l’ouverture à l’essence de la technique, ne nous est-il pas donné, par là-même, d’entendre un appel libérateur ? Si toute lumière brille en laissant autour d’elle une zone d’ombre, ne faut-il pas, subséquemment, aussi reconnaître qu’au cœur des ténèbres, subsiste toujours, une fine pointe lumineuse à contempler ? D’où viendra alors cet appel salvateur, cette pointe lumineuse ?
3. DU PÉRIL AU SALUT : L’APPEL DES DIEUX
3.1. Du développement des technosciences comme péril pour l’humanité.
De la transformation de l’homme en « ressources humaines » à la fabrication de la bombe à hydrogène, en passant par la fabrication de cadavre dans les chambres à gaz et les camps d’extermination ainsi que les blocus et la réduction de pays à la famine, il faut avouer que le pouvoir de la technologie expose aujourd’hui l’humanité au danger d’extermination, d’explosion et de dévastation.
Á vrai dire, le constat, quant au déploiement des technosciences aujourd’hui est alarmant, et ce d’autant plus que les conséquences fâcheuses sur la vie et la nature inquiètent. La puissance de la technologie s’exerce au détriment de celle de l’homme et de sa pensée ainsi que la nature. Et ce n’est pas le récent sommet du G20 sur le climat qui nous dira le contraire. Immanquablement, la rationalité technique dans son aventure technisante a fini par confondre l’homme et la nature à l’outil technique : « L’homme dans ses excès veut se passer de la nature en tant que donnée, il veut construire une « nature » qui soit une vraie « dénaturation » » (S. Diakité, 1985, p. 33). Et ce constat du professeur S. Diakité ne manque pas de pertinence d’autant plus qu’il est confirmé par le communiqué de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture estimant qu’en termes de volume de bois dans le monde de 2000 à 2010, plus de cent millions de mètres cube de bois auraient été illégalement coupés par an (FAO, Novembre 2005). En clair, il y a aujourd’hui une crise environnementale mondiale due à la surconsommation causée par la pression du marché international. C’est donc dire que « le passage d’une économie agricole à une économie industrielle bouleverse l’utilisation de l’espace » (A. Vallée, 2002, p. 21). Tout cela dénote du danger d’écocide qui sous-tend le déploiement des technologies de nos jours. Et, ce péril écologique ne manque pas d’impacter négativement la vie humaine elle-même, donnant lieu à un péril anthropologique.
De fait, les nouvelles technologies telles qu’elles se déploient conduisent inéluctablement l’humanité au bord du gouffre. Il se produit une sorte de menace sur la vie humaine ainsi que le souligne le penseur de Fribourg : « On ne considère pas que ce que les moyens de la technique nous préparent, c’est une agression contre la vie et contre l’être même de l’homme » (M. Heidegger, 1990, p. 143). En réalité, la raison en s’instrumentalisant a anéanti, jusqu’à la dernière trace, l’homme dans son individualité pour faire place à l’objet technique. D’ailleurs, aujourd’hui, les nations militairement puissantes ne cherchent-elles pas des occasions de guerre aux seules fins d’expérimenter leurs armes et manifester leur super puissance ! Aussi est-il que les récentes apparitions de courants scientistes tels que le transhumanisme et le posthumanisme évoqués plus tôt dans notre réflexion sont bien à craindre. Ces faits ne pouvaient manquer de raviver les inquiétudes de Heidegger : « L’humanité sur cette terre se trouve dans une situation dangereuse » (M. Heidegger,1990, p. 147). Il y a donc un déclin ou une décadence du genre humain jusque dans son être-là historial ouvrant la voie à un péril ontologique car tout compte fait :
Heidegger ne parle pas simplement du danger de la technique et de la science modernes pour les hommes, au sens où ils pourraient en faire de mauvaises applications ou un usage néfastes -, mais du danger qu’est l’être lui-même pour autant qu’il se destine, à notre époque ontologique spécifique, selon un déploiement d’essence conjoint de la présance du présant, de l’homme, de la science et de la technique » (D. Pradelle, 2006, p. 287).
Á vrai dire, l’arraisonnement en tant que mode destinal du dévoilement atteint l’homme dans son être. En effet, s’il est bien établi que la pensée est la mesure exacte de l’homme, il convient d’avouer que la technique semble lui porter un véritable coup d’estocade. Avec le déploiement de la technologie par la rationalité tout azimut, la pensée (méditante), en tant qu’élément essentiel de l’homme, est mise sous le boisseau. La pensée pensante, celle qui nous rapporte à l’être en tant que ce qui destine notre rapport authentique aux choses, est mutilée. Ainsi, la technologie, par son activité dominatrice nous dissuade de séjourner dans l’essentiel, c’est-à-dire la pensée de l’être : « l’habitude possède en propre cet effrayant pouvoir de nous déshabituer d’habiter dans l’essentiel – et souvent de façon si décisive qu’il ne nous laisse plus jamais parvenir à y habiter » (M. Heidegger,1987, p. 141). Et ce déclin de l’être consacre inéluctablement le déclin de notre être. L’homme en tant que Da-sein semble avoir perdu le chemin de pensée, cette voie sûre pouvant le conduire à la clairière hébergeante de l’être. La pensée perd ainsi du terrain et l’esprit s’avilit. L’homme tombe alors dans un dépérissement ontologique ; son leitmotiv est l’avoir au détriment de l’être. Si toute la dignité de l’homme réside dans la pensée, que vaudra alors un homme sans dignité !
En sus, il faut le dire, ce basculement périlleux de l’homme dans l’avoir qui entraîne un musèlement de la pensée méditante conduit, subséquemment, à une réification de la parole. De façon concrète, disons qu’avec l’avènement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), il semble avoir une déliquescence de la Parole, pourtant élément essentiel de l’être-homme. Disons avec Heidegger que « la langue est décapitée et rendue immédiatement à la machine. Il est clair que le rapport à la langue qui rend possible un tel phénomène est la compréhension de celle-ci comme simple instrument d’information » (M. Heidegger, 1987, p. 154). Autrement dit, le langage humain est « machinisé », automatisé et instrumentalisé. Sans nul doute qu’une telle situation fait plonger l’homme dans ce que Heidegger appelle « l’existence inauthentique », c’est-à-dire une existence simplement banale, dénuée de profondeur car sans souci de l’essentiel qui se trouve congédié.
In fine, retenons que la dévastation due au déchainement meurtrier des technosciences plonge l’humanité dans un gouffre périlleux. On pourrait alors soutenir que le développement des technologies est déicide : pour autant que la nature est désacralisée, l’espace existentiel est désormais sans dieux car que tout y mis à découvert. La nature est désacralisée plongeant ainsi l’être-homme dans une misère spirituelle. Cela confirme que le péril est fondamentalement spirituel ainsi que l’entend Heidegger : « La destruction provient de l’effrénément qui se consume en sa propre subversion, se faisant ainsi entreprise de malfaisance. Le mal est toujours provenant d’un esprit » (M. Heidegger, 1976, p. 63). Á l’ère de la technologie qui est aussi celle du machinisme, la voix des dieux, dans ce vacarme des machines, n’est plus audible. Dès lors, devant la menace du péril, quelle voie de salut est-il donné à l’homme d’emprunter ? Peut-on encore sauver l’homme ou vient-il trop tard pour les dieux ? Mieux, subsiste-t-il encore une possibilité que le divin puisse encore avoir pour l’homme quelque égard ?
3.2. L’appel du divin comme voie de salut pour l’humanité.
« Plus nous approchons du danger, et plus clairement les chemins menant vers « ce qui sauve » commencent à s’éclairer » (M. Heidegger, 1958, p. 48). Et ce chemin salvateur demeure dans notre attention à ce qui, jusque-là, est resté inaudible à cause du vacarme créé par les machines technologiques. Ainsi, tel un athlète mal inspiré qui a raté son départ, il faut à l’homme de repartir du bon pied, c’est-à-dire du lieu originel, pour que s’enracine véritablement son élan car « nous nous demandons si la réussite d’une œuvre de qualité ne requiert pas l’enracinement dans un sol natal » (M. Heidegger, 1968, p. 138). Ainsi, est-il enjoint à l’homme de se tenir dans le « Quadriparti », unissant le ciel et la terre, les mortels (hommes) et le divin. Mais au fait, à quoi renvoie le concept de divin chez Heidegger ?
Autant le salut, au sens heideggérien, devra être interprété comme un changement paradigmatique dans notre rapport au monde sous-tendu par « l’appel des dieux », autant le divin doit être re-pensé. En effet, le divin ne doit plus être vu à partir de l’homme, selon une tournure anthropologique qui lui obstrue, en réalité, les possibilités du moindre accès. Avec « le petit magicien de Messkirch », le divin s’appréhende comme ce qui est saisi à partir de lui-même ; il ne doit qu’à soi-même son propre surgissement. Mieux, « ce n’est pas le dieu que nous attendons, mais, au mieux, le dieu qui nous attend » (P. David, 2013, p. 347) et nous appelle. Appel par lequel l’être-homme, par un détour dans le passé, se défait de toute subjectivité pour revenir à ce qu’il était. « Repartir du bon pied », comme déjà évoqué, revient donc à faire « le-pas-en-arrière » (Der Schritt-Zurück) ; Pas salutaire qui consiste à se réconcilier avec la nature au sens grec de physis. Par ricochet, la commémoration du passé devient la voie du salut, voie par laquelle il est désormais donné à l’homme de re-entendre la voix des dieux. Mais qu’entendre par physis si ce n’est l’éclosion, le dévoilement, c’est-à-dire la dimension où toute chose vient s’épanouir dans son être !?
Par là-même, dans l’essence du péril, nous sommes résolument tournés vers la garde de l’être. Au péril de la différence ontologique, seul l’étant dans son ensemble semble avoir retenu l’attention de la technologie dans son déploiement. L’être, de cela qu’il « n’est rien d’étant » y étant porté aux profits et pertes sous le régime de « l’oubli de l’être ». En clair, l’être s’y efface au profit de la profusion de l’étant. L’être est versé du côté du nihil, du néant (ne-ens) du fait qu’il n’est rien d’étant. Le miracle de l’être s’efface devant celui de l’abondance de la variété du seul étant. Néanmoins, au cœur du brouillard, une lueur semble scintiller, ainsi que l’attestent ces mots de M. Heidegger (1968, p. 315) :
Dans l’essence du péril se présente et habite une faveur : à savoir la faveur qu’est le tournant de l’oubli de l’être jusque dans la vérité de l’être comme prise en garde. Dans l’essence du péril, où le péril est comme péril, le tournant est tournant vers la garde, est cette garde d’elle-même, est ce qui dans l’être est salvateur.
En réalité, c’est seulement lorsque nous sommes dans une sorte d’ouverture à l’essence de la technique (comme Gestell) que nous réalisons de façon inattendue l’appel libérateur de l’être : « Quand nous nous ouvrons proprement à l’aître de la technique, nous nous trouvons pris, d’une façon inespérée, dans un appel libérateur » (M. Heidegger, 1958, p. 34). Autrement dit, l’essence de la technique nous éveille, paradoxalement, à la nostalgie fondamentale de l’être tombé dans l’oubli. Mieux, la méditation sur l’essence de la technique permet d’appréhender la vérité de l’homme comme Da-sein en tant qu’il est la projection de l’homme dans la garde de l’être pour autant qu’en celui-ci, tout se tient dans la donation et le retrait. En tant que tel, l’appel divin est une exhortation à se rapporter à l’être comme source d’où provient cet appel. La méditation sur l’essence de la technique offre, au bout du compte, la possibilité à l’être humain de souscrire au breuvage du divin entendu comme le saut d’un bond de l’être humain dans le Da-sein, saut par lequel celui-ci parvient à décoller de la subjectivité car tout compte fait, « ce n’est qu’à partir de la vérité de l’être que se laisse penser le sens du sacré » (M. Heidegger, 1946, p. 351). Penser la technique c’est donc se trouver sur le plan de l’histoire de l’être. Mais que nous vaut ce recueillement auprès de l’être, ce regain de conscience du sacré ? Mieux, en quoi cet enracinement dans l’être est-il apte à fonder le salut ?
La méditation sur l’essence de la technique offre à l’homme la possibilité d’un autre commencement. En cela même, il est donné à l’homme de réaliser sa finitude. N’est-ce pas à juste titre que Martin Heidegger écrit ceci !? : « C’est justement dans l’expérience que fait l’être humain d’être ainsi commis et requis par quelque chose qu’il n’est pas et qu’il ne domine pas lui-même, qu’il découvre la possibilité de comprendre que l’être use de l’homme et qu’il en a besoin » (M. Heidegger, 1995, p. 261). En tant qu’être fini, il doit constamment se rattacher à l’être en tant que ce qui le tient et le destine afin de pouvoir en assurer la garde et retrouver un soi authentique. Retrouver un soi authentique assure à l’homme un pouvoir-être authentique qui s’écarte de l’auto-affirmation de la subjectivité. Ainsi, est-il donné à l’homme d’accéder à une véritable liberté.
Aussi est-il que cette relation substantielle avec l’être élève l’homme à un accomplissement, une plénitude d’humanité qui, de façon pratique, balise son agir. D’une part, l’agir humain, en tant qu’il s’enracine dans l’être, a toujours le souci de soi et des autres. Ainsi, dans son usage de l’objet technologique, l’homme sera-t-il guidé par le souci de l’autre. Il se rapporte à l’autre dans une relation humanisante ; l’autre en tant que son alter ego et l’autre au sens large de tout ce qui se trouve dans son environnement. C’est à ce seul prix que les conférences sur la sauvegarde de l’environnement ne resteront pas lettres mortes et que l’homme s’engagera à restaurer son espace en reconsidérant la nature avec mesure. D’autre part, l’enracinement dans l’être conduit à orienter l’agir non pas comme résultant de la volonté subjective mais dans le sens d’accepter de lâcher prise, de laisser les choses advenir par elles-mêmes, de façon poétique car, à vrai dire, « plein de mérite, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la terre » (M. Heidegger, 1962, p. 113). Ce propos confirme l’idée que l’homme n’est pas une province autonome. En tant qu’être fini, il a toujours recours à quelque chose qui le dépasse et le fonde et dont il doit se mettre à l’écoute.
Enfin, soulignons que l’enracinement dans l’être permet à l’homme d’avoir un regard empreint de Sérénité sur l’objet technique. L’homme réalise, en réalité, qu’il a en partage avec la technique, un lieu commun qui est l’être. Á partir de là, celui-ci ne doit nullement se laisser dominer par l’objet technique mais plutôt manifester une certaine égalité d’âme devant la production technologique. Cette sérénité est bien le signe d’un certain rapport libre à la technique. Ainsi que le signifie Heidegger : « le rapport est libre quand il ouvre notre être (Dasein) à l’essence (Wesen) de la technique » (M. Heidegger, 1958, p. 9). L’enjeu ici est la liberté de l’homme vis-à-vis de l’objet technique tant celui-ci semble englouti par les productions technologiques.
Conclusion
L’espace existentiel de l’homme semble aujourd’hui tenu, de part en part, par la technologie. Aussi est-il que du point de vue de leur efficacité, les technologies mises au point par l’homme moderne semblent faire la douloureuse épreuve de l’ambiguïté. Pis, les tentatives de vouloir régler les problèmes liés à la prolifération des inventions technologiques sous un angle purement technique semblent aujourd’hui rester lettres mortes pour autant qu’elles restent figées sur leur efficacité, barrant l’accès à l’essence. C’est alors vers la métaphysique que Martin Heidegger nous enjoint de porter notre regard pour accéder à l’essence de la technique. Ainsi la technique est-elle essentiellement entendue comme la métaphysique achevée pour autant qu’elle ressortit au destin de l’être « tombé dans l’oubli ». Mieux, en son essence, la technique se révèle comme Gestell ou Arraisonnement et correspond au retrait de l’être et à l’ensemble des manières (Ge) qu’a l’étant de se poser (stellen) dans la présence, de se dispenser à l’homme. Il s’en suit une certaine absolutisation du rationnellement connaissable privilégiant l’étant représentable. Par conséquent, une telle entreprise ne manque pas d’entraîner un dessèchement spirituel chez l’homme conduisant à un danger de dévastation de l’humanité et d’assombrissement du monde. Partant, l’homme semble désormais vivre dans un espace existentiel marqué par l’absence des dieux. Cependant, pour Heidegger, si la méditation sur l’essence de la technique nous révèle un péril inhérent, elle offre aussi la possibilité grande de souscrire au breuvage du divin et d’arracher l’homme de l’autophagie spirituelle. Dès lors le cri heideggérien de détresse due au Gestell est en même temps une interpellation à nous réconcilier avec l’être. Se réconcilier avec l’être, c’est entreprendre d’habiter dans le Quadriparti qui désigne l’espace de rencontre entre le ciel et la terre, les mortels et les dieux. Ici, l’homme pourra retrouver toute la consistance de son être-là au monde et se rapporter aux objets techniques avec Sérénité. En somme,
Le Dasein pourrait être sain et sauf dans l’Avenir, seulement si celui-ci considère à nouveau les valeurs du passé aujourd’hui négligées, en tant que terre natale. Dans ce sol natal, patrie-mère, demeure la terre promise pour la conquête de l’essence humaine (A. Kouakou, 2007, p. 29).
Références bibliographiques
BACHELARD Gaston, 1969, Préface du Je et tu de Martin Buber, Paris, Aubier.
BERGSON Henri, 1932, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF.
DAMOUR Franck, DOAT David, 2018, Transhumanisme, quel avenir pour l’humanité ?, Paris, Éditions Le cavalier bleu.
DAVID Pascal, 2013, « dieu(x) », Le dictionnaire Martin Heidegger, Paris, Éditions du Cerf.
DESCARTES René, 1966, Discours de la méthode, Paris, Garnier-Flammarion.
DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question africaine du développement, Paris, L’Harmattan.
ELLUL Jacques, 2004, Le système technicien, Paris, Éd. Le Cherche-Midi.
HEIDEGGER Martin, 1976, Acheminement vers la Parole, trad.fr. Jean BEAUFRET, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1962, Approche de Hölderlin, Trad.fr. C. ROELS, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1995, Écrits politiques 1933-1966, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1986, Essais et conférences, trad. fr. André PREAU, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1946, « Lettre sur l’humanisme », Œuvres complètes, Volume 9, trad.fr. Jean BEAUFRET, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1976, « La fin de la philosophie et le tournant », Questions IV, trad. fr. Jean BEAUFRET, François FEDIER, Jean LAUXEROIS, C. ROELS, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1987, Qu’appelle-t-on penser ?, Trad. fr. Alovs BECKER et Gérard GRANEL, Paris, PUF.
HEIDEGGER Martin, 1990, Questions III & IV, trad.fr. Jean BEAUFRET, François FEDIER, Julien HERVIER, Jean LAUXEROIS, Paris, Gallimard.
HOTTOIS Gilbert, 1990, Le pragmatisme Bioéthique, Bruxelles, Université De Boeck.
HOTTOIS Gilbert, 2005, De la renaissance à la postmodernité. Une histoire de la philosophie moderne et contemporaine, Paris, Éditions De Boeck Université.
KAHN Axel, 2000, Et l’homme dans tout ça ?, Préface de Lucien Sève, Paris, Nil éditions.
KOUAKOU Antoine, 2007, « Culture et violence chez Martin Heidegger », in LE KORE, Revue Ivoirienne de Philosophie et de Culture, N°39, Abidjan, EDUCI.
KOUASSI Marcel N’dri, 2013, Heidegger et la question du transfert des technologies en Afrique, Abidjan, CRESTE Éditions.
LALANDE André, 2006, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 2e édition « Quadrige », Paris, PUF.
MINIER Bernard, 2019, Le bord de l’abîme, Paris, XO éditions.
PRADELLE Dominique, 2006, « Science et technique chez Heidegger », Heidegger. Le danger et la promesse, Paris, Éditions Kimé.
VALLÉE Annie, 2002, Économie et environnement, Paris, Seuil.
ONTOLOGIE ET FOI DANS LA PENSÉE HEIDEGGÉRIENNE
Kouamé Raymond SENZÉ
Université Alassane OUATTARA, (Côte d’Ivoire)
Résumé : La réhabilitation de la métaphysique, à travers la pensée de l’Être par Martin Heidegger, conduit sa réflexion sur la Foi, domaine mystique et mystérieux de la vie humaine. Elle repense l’humanité de l’homme et donne, dans la proximité de l’Être, une nouvelle dimension à sa croyance. Indiquant le lieu d’habitation de la pensée, Heidegger montre que le destin de l’homme déterminant qui séjourne dans le Quadriparti, s’accomplit sur la terre, en tant que mortel, dans l’attente de l’accueil du ciel et tisse des relations avec les divins dans l’ ek-sistence, un horizon nouveau pour asseoir son humanisme.
Mots-clés : ONTOLOGIE, FOI, ABSOLU, HOMME, EK-SISTENCE, RELIGION, DIEU.
Abstract : The rehabilitation of metaphysics, through the thought of the Being by Martin Heidegger, leads his reflection on Faith, the mystical and mysterious domain of human life. It rethinks the humanity of man and gives, in the proximity of the Being, a new dimension to his belief. Indicating the place of habitation of thought, Heidegger shows that the destiny of the determining man who dies in the Quadriparti, is fulfilled on earth, as a mortal, waiting for the reception of heaven and weaves relations with the divine in ek-sistence, a new horizon to establish his humanism.
Keywords: ONTOLOGY, FAITH, ABSOLUTE, MAN, EK-SISTENCE, RELIGION, GOD.
Introduction
La pensée heideggérienne est, pour toute pensée contemporaine, cette immensité qu’on rencontre partout et, à laquelle on ne peut se détourner si aisément, même en la fuyant. Elle se montre comme le carrefour de toutes les pensées qui tentent de saisir l’homme dans le monde. Dans ses œuvres, Heidegger trace les sillons de la pensée qui fait l’expérience pensive des conditions de l’homme dans sa relation avec le monde. Il éveille perpétuellement l’esprit au contact de sa pensée qui se déploie vers son site et, par la même occasion, appelle l’homme à croire en son être dans l’appel de l’Être. Cela montre clairement que toute croyance de l’homme est liée à l’Être et, « « Ce qui donne plus à penser » donne à penser dans ce sens originel, qu’il nous abandonne à la pensée. Ce don qu’il nous fait, ce cadeau est véritablement la dot que recèle notre être » (M. Heidegger, 1959, p. 137). D’où notre sujet : Ontologie et Foi dans la pensée heideggérienne. Mais pourquoi l’Ontologie et la Foi ? Qu’est-ce qui motive le choix d’un tel sujet ?
Ce sujet nous introduira au cœur des questions qui touchent à la fois la Foi et l’Ontologie heideggérienne. En formant l’idée de la pensée déployante, dans l’essence de l’homme, c’est-à-dire celle par laquelle celui-ci laisse sans cesse parler son être, l’essentiel de la pensée consiste à croire en l’homme, dans sa relation à l’Être. Elle est cette pensée qui conduit dynamiquement la Foi, dans la réalité humaine, sous le signe l’ek-sistence. Alors, comment comprendre le lien entre l’Ontologie et la Foi dans la pensée heideggérienne ?
Notre réflexion consistera à jeter un regard sur la Foi qui se cultive dans l’ontologie heideggérienne en vue de donner ses caractéristiques. Et pour ce faire, elle se déploiera suivant un rythme ternaire. Dans un premier temps, nous montrerons l’ontologie et la pensée de l’Absolu, dans un deuxième temps nous expliquerons la foi dans le penser heideggérien et en dernière instance, il s’agira pour nous de présenter la philosophie de la religion chez Heidegger.
1. L’ONTOLOGIE ET LA PENSÉE DE L’ABSOLU
L’importante question qui nous interpelle tous est celle de l’Être et sa pensée. Elle nous appelle à réfléchir sur la question, pour comprendre le mystère qui tourne autour de l’Être, afin de donner à l’ontologie sa valeur fondamentale. Elle demande que nous ayons un regard sur l’univers sans doute multiple de l’ontologie, pour savoir que la pensée de l’Être s’est, à un moment donné, absolutisée.
1.1. L’absolutisation de la pensée de l’Être
L’histoire de la philosophie enseigne que la pensée de l’Être qui avait germé dans la philosophie présocratique, va connaître diverses interprétations. Elle va se lier à des systèmes particuliers qui la conduiront dans l’Absolu. C’est le cas de Platon qui fut le premier à initier un système philosophique appelé la « dialectique », cette science qui élève l’esprit de l’homme jusqu’à « l’Idée du Bien », sommet de la connaissance.
En effet, Platon met en scène, par son système, un rationalisme absolu par le mouvement de la « Raison », appelé « puissance dialectique » qui nie le sensible considéré comme une « copie » de la réalité du « monde intelligible ». En disant : « Ainsi lorsqu’un homme essaie, par la dialectique, (….) d’avoir saisi par la seule intelligence l’essence du bien, il parvient au terme de l’intelligible… » (Platon,1966, p. 291), Platon voit, dans sa parole, celle qui pénètre au plus profond de la pensée elle-même, afin de la conduire vers le suprême.
Rassemblant les choses sous le couvert du « Bien » dans le « monde intelligible », la pensée se tient avec le sujet pensant qui atteint, dans l’Absolu, l’Être vrai, dans l’intuition intellectuelle. Elle est la voie susceptible d’amener le penseur vers la connaissance éclairée par les lumières du plus Haut, et de lui faire comprendre que tout provient de l’Absolu. Cette pensée énonce en elle, l’idée d’une essence stable, d’une permanence des choses dans le monde intelligible. Elle trace les sillons de la théorie des formes ou des Idées en supposant qu’ il y a une identité naturelle entre la pensée et la chose ; et déduit que toute pensée qui dit la chose, dit formellement l’Être et vice-versa. Sur cette voie, le penseur s’assure d’avoir atteint, dans sa pensée, un fondement inébranlable. Il établit, dans l’Absolu, le premier principe de toutes choses et énonce les germes de la philosophie première, c’est-à-dire la science « de l’Etre en tant qu’être » (Aristote, 2000, p. 110) chez Aristote ; qui s’occupe des principes des sciences et de l’action aussi bien que la connaissance des choses divines. La pensée qui s’absolutise, apparaît donc comme le premier principe de l’ontologie. N’est-ce pas le début de la théologalisation de l’origine de l’homme, avec la religion chrétienne ?
1.2. La théologalisation de l’homme
L’homme est, selon La Bible, le pur produit de la parole de Dieu qui apparaît comme le maître de la création. Sa parole vient du Ciel et atteint profondément l’homme, le plus important des êtres sur la terre. Elle le définit et lui permet d’assurer sa suprématie sur toutes les choses, en tant qu’être parlant, créé à l’image de Dieu. C’est pourquoi, « Au commencement était la parole (…) Tout est venu à l’existence par elle. (…) ce qui est venu à l’existence en elle était vie et la vie était la lumière des humains » (La Bible, Jean 1 à 4, 2002, p. 1035).
Cette conception biblique enseigne que l’homme se convertit sous le verbe du Divin et fait, chaque fois, des louanges et des prières au créateur en vue d’atteindre la maturité. Reconnaissant Dieu comme son bienfaiteur, une vérité est essentielle pour l’homme : c’est qu’il est animé par l’intelligence que lui a attribuée le Père et, par laquelle il parvient à se former les idées et à donner un sens clair aux choses, sous le couvert de la divinité. « Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l’homme pour voir comment il les appellerait. L’homme appela de leurs noms toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et les animaux de la campagne » (Idem, Genèse 2, v.19 à 20, p. 2).
Créé à l’image de Dieu, l’homme cultive l’intelligence qui est signifiée par les paroles extérieures, provenant de Dieu, être doté de toutes les connaissances. Il ne pense et ne connait que quand il tourne son regard vers Dieu qui détermine son existence. Une telle pensée est chrétienne et défend, avec ferveur, la définition de l’humanité et ses attributs, sur cette trame de l’univers divin. C’est pourquoi, penser, c’est croire en Dieu afin d’éclairer l’existentiel et rend communicable les expériences ineffables de l’homme dans lesquelles coïncident fait et possible, liberté et destin, et montre que « L’homme qui prend vraiment conscience de la liberté acquiert en même temps la certitude de Dieu » (K. Jaspers, 1965, p. 45). Cela établit un lien entre l’existence de l’homme, la liberté et Dieu ; et pose le fondement d’une philosophie de l’Absolu que refuse Heidegger.
1.3. Heidegger et le refus de la philosophie de l’Absolu
Heidegger refuse toute philosophie qui idéalise l’homme et qui met son existence sous l’égide du Dieu chrétien. Une telle philosophie suscite, pour lui, une indignation parce que la pensée de Dieu manque de détermination. C’est pourquoi, « « Une philosophie chrétienne » est un cercle carré et un malentendu (…) dont on a fait chrétiennement l’expérience, c’est-à-dire de la foi, et c’est la théologie » (M. Heidegger, 1967, p. 20). Ce dire se montre comme la sortie de la pensée de l’Absolu pour se conduire à son origine déterminante dans laquelle est inscrit le destin de l’homme, à savoir l’entente de l’Être.
La pensée, selon Heidegger, est le lieu où le questionner, dans sa profondeur, remet, à l’entreprise philosophique, son être-en-avant existential qui fait surgir la pensée de l’Être. En tant que le lieu du questionnement, celle-ci cherche le « pourquoi » des choses et de son être ; et en même temps, suscite en l’homme une expérience fondamentale à travers « le saut ». (Die Sprung) (Idem, p. 18). Le saut, entendu comme l’expérience du surgissement de la pensée, indique le chemin de son futur qui prend appui sur son passé et réalise son présent. En tant qu’une ouverture, la pensée détermine, dans son essence, l’essence de l’homme et prône son existence en rapport avec son être.
Dans ce contexte, la pensée reprend son fondement, en tant qu’une réflexion sur l’homme, dans son combat avec l’Être. Elle tente de résoudre le problème de l’humanité en crise de pensée tout en montrant les conditions vraies de l’homme, en tant qu’habitant de la terre, qui se reconnaît dans l’ek-sistence. Et, « engagé dans le destin de l’ek-sistence.», (M. Heidegger, 1964, p. 57), l’homme doit croire en lui et fonder toute sa foi sur sa relation à l’Être afin d’assurer son humanisme.
2. LA FOI DANS LE PENSER HEIDEGGERIEN
La parole heideggérienne a pour objectif fondamental de libérer l’homme (Dasein) de sa condition précaire pour le décrire comme un être-au-monde, dans ce monde. Elle l’incite à croire en lui-même, dans l’accomplissement de son être.
2.1. La croyance au Dasein, une réalité humaine
Le Dasein, dans la philosophie heideggérienne, se présente avant tout comme un étant. Il est un étant particulier qui se montre comme une essence qui admet une existence. Cette essence repose sur l’existence et s’actualise dans l’essence de l’homme, par son pouvoir- être, à savoir l’ensemble de ses possibilités. « L’étant, que nous avons pour tâche d’analyser, nous le sommes nous-mêmes à chaque fois (…) Comme étant de cet être, il est livré à son propre être. (…) L’« essence » du dasein tient dans son existence » (M. Heidegger, 1986, p. 73), dit Heidegger. Le Dasein signifie, pour lui, l’homme-en-situation se projetant dans l’avenir. Il n’est pas l’homme comme tel mais l’individu en tant qu’être-au-monde qui offre un être à lui-même. C’est l’être de l’étant humain en tant qu’être-là. Il est l’être possible. Cette possibilité lui donne le pouvoir de se mouvoir et de tendre vers les autres étants, dans le monde.
Se distinguant lui-même des autres étants, même en étant parmi eux, il est en mouvement. Il est l’existant qui nous fait découvrir le monde comme un étant qui se meut. En tant qu’un être-au-monde, le Dasein rend manifeste tout le monde et ses composants. « cette possibilité appartient au Dasein lui-même (…) Le Dasein est donc la condition de possibilité des découvertes que nous faisons dans le monde » (M. Corvez,1966, p. 24). Dans la possibilisation du monde, le Dasein adresse la parole, qui n’a pas une origine divine, aux autres. Cette parole est plutôt le propre du Dasein, en tant qu’être-au-monde coexistant qui communique avec les autres, à travers une langue. En tant qu’élément constitutif du Dasein, la parole est liée à ses existentiaux qui possèdent l’écoute et le silence. Son être manifeste, par la langue parlée intelligente, son authenticité ; et démontre que le Dasein est un être parlant qui, dans la communication, se soucie des autres et de lui-même, dans le monde. Il est un être de souci. (Die Sorge)
Étant un être-jeté pour la mort, le Dasein cherche dans le souci à se disposer, c’est-à-dire à s’ouvrir au monde afin de mieux le comprendre. Dans son angoisse, il se temporise et se réalise en toute liberté. N’étant déterminé par aucune cause, le Dasein transgresse toute situation en s’appuyant sur le « ne pas » de l’angoisse qui lui donne la capacité de se mouvoir de façon libre, en tant qu’être-au-monde. Se reconnaissant comme un être propriétaire de son être dans l’autre aspect de l’angoisse, le Dasein chante, dans l’essence de l’homme, le chant de la liberté. Cette liberté est, selon Heidegger, celle de l’homme lui-même. « La liberté humaine est la liberté pour autant qu’elle perce dans l’homme et le prend sur soi le rendant ainsi possible. ». (M. Heidegger, 1987, p. 134). C’est dire que la liberté rend l’homme plus propre à soi en lui donnant la possibilité de choisir et de se saisir soi-même. Donc, l’ontologie du Dasein est une pensée qui responsabilise l’homme, lui donne le pouvoir de tout faire dans le monde, et lui permet de concevoir son assise dans l’ek-sistence.
2.2. L’ek-sistence et l’assise de l’homme
Se définissant comme une sortie de soi, un surgissement surgissant de l’Être, l’ek-sistence se conçoit, dans la philosophie heideggérienne, comme une pensée de l’Être en vue de laquelle l’homme ek-siste. Elle est une réalité qui met l’homme au centre du monde et le présente comme cet être qui existe pour lui-même, en tant qu’habitant qui a pour mission de sauver la terre. Alors, comment comprendre cette existence de l’homme qui se manifeste sous la forme de l’ek-sistence ? Si l’ek-sistence est marquée par le sceau de l’Être, n’est-il pas fondamental de trouver à l’homme une habitation sérieuse, en tant qu’être humain pensant et parlant qui fait un appel à son humanité, considérée comme la pauvreté de la nature humaine ?
Avec Heidegger, il est à comprendre en effet que l’ek-sistence est un élément constitutif fondamental de l’homme qui donne un sens à sa vie. Elle définit l’homme. Elle lui donne cette assurance d’être toujours dans le sillage de l’Être. Et personne ne peut contester qu’elle soit l’élément de la possibilisation de son être. En tant que mode fondamental d’appréhension de l’homme et de sa reconnaissance comme cet être-au-monde qui s’articule, l’ek-sistence favorise l’ouverture de l’être de l’homme. Elle donne la signification au monde et aux choses en vue de leur réalisation. Dans son déploiement dans l’ek-sistence, l’homme parvient à faire l’expérience de la pensée comme la manifestation de son propre être. Il retrace son avenir par la pensée de l’Être, cherche à y habiter conséquemment et à accomplir pleinement et indéfiniment son ek-sistence qui constitue le sol de sa croyance.
Dans une telle situation, l’homme se doit de penser originellement les choses, dans le monde, en mettant l’ek-sistence au premier rang. Cela lui exige une nouvelle approche de l’existence qui le porte et le transporte vers le site de son habitation qu’est l’ek-sistence, dans laquelle il demeure et séjourne en sûreté. « Être mis en sûreté veut dire : rester enclos (engefriedet) dans ce qui nous est parent (in das Frye), c’est-à-dire dans ce qui est libre (in das Freie) et qui ménage toute chose dans son être » (M. Heidegger,1958, p. 176). L’essence de l’homme réside donc dans l’habitation où il ek-siste.
Sous ce rapport, l’habitation constitue pleinement pour l’être de l’homme, en tant qu’ek-sistant, une sorte d’abri où il fait le ménagement de son être, et pense librement sa condition d’homme sur cette terre des mortels. L’homme, pour Heidegger, trouve toujours dans l’habitat ; ce qui est habituel, dans l’étendue de son habitation. Autrement exprimé, l’habitation décrit les conditions de l’homme, en tant qu’habitant de cette terre des mortels ; et montre que « la condition humaine réside dans l’habitation, au sens de séjour sur la terre des mortels » (Ibidem). Ce lieu sacré pose le sens de l’ek-sistence dans laquelle l’homme se met au centre du monde. Il y met sa foi, tisse une relation profonde avec son être et prend, dans son rapport à l’Être, une disposition particulière pour la croyance.
L’habitation implique donc fortement l’homme et se présente comme une exigence pour sa sauvegarde et celle de la terre, par le nouvel évangile, dans l’horizon temporel du monde. Elle est une pensée de l’homme déterminant qui tourne son regard hors du monde chrétien, pour le conduire vers l’existence déterminante dans laquelle il répond à l’appel de son être. Il accueille l’Être et se met en co-relation en vue de se déterminer comme un être humain ek-sistant ; ayant la possibilité de cultiver l’humanité, à travers l’expérience du Quadriparti.
2.3. L’expérience du Quadriparti et le salut de l’homme
L’homme véritable ne peut faire l’expérience du Quadriparti et trouver son salut, avec Heidegger, qu’à condition qu’il se reconnaisse comme un mortel. En tant qu’habitant de la terre, il réside sous le ciel, abritant le soleil et les autres choses célestes. Il n’est homme que quand il est au centre de cette quadruple expérience et se présente comme le seul être capable de ménager son habitation afin de laisser librement l’être du Quadriparti se manifester sur la terre. Assurant le temps des choses, il fait face aux messagers de la divinité et ; par sa vie sacrée, manifeste la présence de dieu, dans le dévoilement et le retrait de cette expérience.
Dans l’expérience du Quadriparti, ce qui est privilégié est la terre comme le lieu où l’homme véritable défend son destin et l’oriente librement dans une destination en vue de préserver son être et les choses. Refusant de remettre son destin au Dieu chrétien, il pense, par lui-même et dans la croix, le fondement dynamique des choses. Loin d’être la croix des chrétiens sur laquelle les romains crucifièrent Jésus selon les Évangiles de Luc, appelant à une adhésion totale du croyant à la foi chrétienne, la croix, chez Heidegger, est la relation de l’homme aux choses, dans l’habitation qui « se révèle (ereignet sich) comme le ménagement quadruple du Quadriparti » (Idem, p. 178).
Ainsi, l’habitation et le Quadriparti sont tous deux engagés dans une libre relation. Ils sont inséparables de sorte que ce qui vaut pour l’un vaut pour l’autre. Ils résident dans la proximité dans le seul but de préserver et d’unir les choses. C’est le moment du ménagement d’un espace dans lequel se laisse, selon Heidegger, passer la présence sur « le pont ». Quel rôle joue le pont dans la philosophie heideggérienne ?
Le pont est, dans la philosophie heideggérienne, un habitat de l’homme qui exprime l’ek-sistence. Il est un chemin par lequel on achemine les choses dans un réseau de communication tout en assurant le lien entre la terre et le ciel, les divins et les mortels. Il constitue, en même temps, le point de leur rassemblement. « Le pont, à sa manière, rassemble auprès de lui la terre et le ciel, les divins et les mortels. (…) Le pont – entendu comme ce rassemblement du Quadriparti que nous venons de caractériser – est une chose (ein Ding) » (Idem, p. 181). Il est une chose qui fait exprimer beaucoup de choses.
Le pont permet de révéler, d’une certaine manière, le Quadriparti en lui accordant une bonne place. En lui, se trouve un espace ménagé pour les choses et pour l’homme. Il est cet espace sacré dans lequel l’homme reçoit, par sa croyance, tout secours et la bienveillance. Ce qui sous-entend que « C’est du sacré que le croyant attend tout secours et toute réussite » (R. Caillois, 1963, p. 21). Le pont rassemble l’homme et les choses de façon originelle et les met en éclat et en confiance dans le Quadriparti. Il les fait habiter dans cet espace sacré et permet à l’homme de trouver son salut, par la célébration libre de son habitation. Il est le chemin de la méditation qui se comprend comme la parole pensante dans laquelle l’homme se recueille et assure son séjour comme un mortel habitant la terre, sous le ciel, ménageant l’espace sacré ; pour accueillir le divin. Le pont est donc, dans la pensée heideggérienne, le sol de la religion.
3. LA PHILOSOPHIE DE LA RELIGION CHEZ HEIDEGGER
Heidegger montre que, dans l’ek-sistence, l’homme fait l’expérience de la pensée parlante, en tant qu’être-au-monde, tourné vers l’avenir. Il sillonne le paysage énigmatique qui s’exprime comme une visite du monde mystérieux de l’Être lui adressant une invitation, dans la recherche du Salut, dans la patrie.
3.1. La patrie, le Destin de l’homme
Heidegger suppose que l’ek-sistence trouve son achèvement dans la pensée fondamentale où l’homme cherche sa véritable patrie pour cultiver son humanité. Elle est essentiellement la pensée de l’essence de l’homme, comme le point de départ de l’ontologie fondamentale qui introduit ce dernier dans le destin de l’Être en l’y projetant. « Ce destin advient comme éclaircie de l’Être… » (M. Heidegger, 1964, p. 95-97). Ce dire montre que l’homme doit chercher sa véritable habitation à partir de l’Être : se bâtir une pensée authentique, signe de sa patrie. Il se doit de cultiver l’Être dans ce lieu portant son essence. Cela suppose une éclaircie de l’Être qui sonne la cloche du matin de l’histoire de l’homme, en l’appelant à séjourner dans la patrie.
Dans la patrie, l’homme dépasse la pensée de l’étant absolu, cause de sa vie et met fin aux différentes interprétations sur son humanité. Il répond à la question fondamentale de l’habitation, déterminant le bâtiment qui abrite son être, dans son attente à l’Être. Appelant l’Être dans la proximité, la patrie devient pour l’homme, le lieu de son séjour. « La patrie de cet habiter historique est la proximité de l’Être » (Idem, p. 99).
Dépassant l’absence de patrie qui consiste à asseoir la pensée sur la métaphysique de la subjectivité et sur le destin préétabli affairant à l’humanisme, l’homme prépare son avenir dans la célébration de l’Être. Libérant sa pensée de la torpeur pour rendre son humanité déterminante, l’homme fait appel à l’Être, dans sa pro-venance. Cet appel le destine à la vérité de l’Être et actualise sa pensée. « En regard (…) de patrie qui affecte l’homme, (…) il a à découvrir la vérité de l’Être et se mettre sur le chemin de sa découverte » (Idem, p. 107). Dans ce rapport, le destin de l’homme est de découvrir l’Être et le célébrer.
Cette célébration est le moment où les choses appelées à la proximité, dans leur présence, se présentent comme celles qui résident dans leur absence. Elle est l’annonce remuante du chant qui fait vibrer les choses, dans leur absence, pour les attirer vers leur présence. En son sein, toutes les choses se rassemblent sous l’appel et déploient leur être. « Il y a, dans l’appel même, un site qui est non moins appelé. C’est le site pour la venue des choses, présence logée au cœur de l’absence » (M. Heidegger, 1976, p. 23), dans le monde.
Ce monde, loin d’être le lieu où se pavanent l’homme et toutes les choses créées par Dieu, selon la pensée judéo-chrétienne, est bien le cadre où toutes les choses sont en gestation et portent en elles-mêmes, la détermination de faire un geste. Il se traduit comme le point de rassemblement de l’homme et des autres choses dans la mutualité. Le monde est donc « Ce cadre uni de Ciel et Terre, Mortels et Divins, ce cadre qui est mis en demeure dans le déploiement jusqu’à elles-mêmes des choses… » (Idem, p.24). Ce monde, en expliquant donc la relation intime de l’homme avec les choses, dans le Quadriparti, révèle sa relation mystérieuse avec l’Être.
3.2. Être-homme : une relation mystérieuse dans la pensée heideggérienne
Le couronnement des pensées authentiques plonge le lecteur dans le domaine mystique et mystérieux de la pensée humaine. Il est parlant et fait incursion dans le vaste univers sacré de l’ek-sistence où l’homme appelle tout ce qui lui est fondamental afin de relever toutes sortes de défi. Cet appel de l’homme est compris comme son engagement pour la pensée de l’Être ; étant donné que son destin d’être de possibilité et parlant y est lié.
Définir l’homme, en effet, dans cet univers mystique de l’Être, c’est avant tout, révéler toute sa dimension, le mesurer dans l’immesurable afin de calculer, dans l’incalculable, la distance qui le sépare dans le rapprochement de cet être mystérieux. Il est le croyant qui a la possibilité de s’unir de façon intime et directe avec l’Être, sur le principe fondamental de la co-existence. Cette relation se définit comme Être-homme. Détenant la possibilité et la connaissance, l’Être-homme se présente comme une union où la volonté humaine laisse, en elle, librement manifester l’Être en toute plénitude. Cette union entre l’Être et l’homme se présente, dans l’espace sacré de la co-existence, comme le milieu par lequel les deux se trouvent à l’unisson, dans leur distinction. Étant leur ouverture sous l’égide de l’appel, cette union est le moment par lequel l’homme répond, de façon libre, à l’appel de l’Être. Répondre librement pour l’homme n’est-ce pas croire en sa capacité de se déterminer dans l’univers sacré et mystique de l’Être ?
Si nous admettons avec Heidegger que « Le langage est bien plutôt la maison de l’Être en laquelle l’homme habite et de la sorte ek-siste, en appartenant à la vérité de l’Être sur laquelle il veille.». (M. Heidegger, 1964, p. 85.), il est clair que le langage fait habiter l’homme en assurant sa garde. Il tient l’Être-homme comme une détermination fondamentale de l’homme, lui-même, en tant qu’être-au-monde situationnel. Il le met en situation de se croire et de croire en ses possibilités libres ; de manière à envisager un libre accomplissement de son existence sur la terre. Il manifeste librement son destin dans cet espace appelé terre. « Être homme veut dire : être sur la terre comme mortel, c’est-à-dire : habiter. » (M. Heidegger, 1958, p.173). Un tel dire ne renferme-t-il pas la relation mystérieuse entre l’Être et l’homme ?
Certainement ! Cette vision heideggérienne, qui se dégage de la phénoménologie de l’homme, apparaît comme le champ fécond de la croyance humaine, au plus profond de l’homme lui-même. Un tel acte demande qu’il se connaisse soi-même afin de donner une orientation à sa vie dans l’univers sacré qu’est sa relation à l’Être. Il doit assumer son affirmation en tant qu’un être n’ayant aucune relation avec un être absolu sur la terre. Se faisant dans sa relation, son statut d’être croyant vacille dans l’acceptation mystérieuse de l’Être, dans son essence. En somme, Être-homme, c’est cultiver la nouvelle religion dans l’univers sacré où l’homme reprend le chant, dans la célébration de l’Être, sur la terre. N’est-ce pas ce qui fait de Heidegger, un philosophe religieux ?
3.3. Heidegger, un philosophe religieux ?
Si pour l’homme moderne, une religion provient avant tout de la croyance, l’expérience intérieure y participe énormément. La foi religieuse, dans le penser heideggérien, se comprend comme le lien mystique et mystérieuse entre l’Être et l’homme. Elle est la divination de toutes les forces dans l’essence de l’homme. Cela montre que l’homme religieux se fait, se soumet à l’Être et se sacrifie sur son autel qui est le pont, dans le quadriparti.
En analysant cette relation, Heidegger pose la vie religieuse de l’homme comme une expérience orientée ontologiquement vers l’existence. Elle est perçue dans l’être propre de l’homme et le rapproche naturellement de toutes les situations liées à son essence. En lui donnant la possibilité de penser l’essence de son être, la vie religieuse pousse aussi l’homme à répondre à l’appel de l’Être, dans l’existence. Dans cette relation déterminante, « L’homme déploie son essence de sorte qu’il est le « là », c’est-à-dire l’éclaircie de l’Être » (M. Heidegger, 1964, p. 61). Le message profond que lance Heidegger à travers ce dire est une invitation à mieux penser l’homme et son existence.
En tant qu’être-au-monde, l’homme religieux se montre présent au monde et le monde se présente, à son tour, à lui comme un moyen de sa possibilité. Abritant l’être-là dans son essence, il est ce nouveau dieu qui trouve librement son équilibre dans le quadriparti, par la manifestation profonde de l’ek-sistence qui donne un sens à l’événement. Il détermine les conditions de sa propre existence et trouve en soi les ressources nécessaires pour sa propre destinée. Une telle pensée est donc une philosophie dans laquelle l’Être-divin est l’Être-homme.
Conclusion
Ce qu’il faut comprendre de la réflexion heideggérienne sur l’Ontologie et la Foi, c’est qu’elle s’inscrit dans le domaine mystique et mystérieux de la vie humaine. Elle a pour but de repenser l’humanité de l’homme et de donner, dans l’histoire de la métaphysique, une nouvelle dimension à la croyance . Dépassant les pensées de l’Absolu qui idéalisent l’homme ou qui font de lui un être créé par Dieu, la foi heideggérienne le conduit dans la proximité de l’Être. Elle indique le lieu d’habitation de sa pensée et révèle sa pleine responsabilité face à son ek-sistence. Dans la foi, l’homme bâtit en tant que bâtisseur, et dans ce bâtiment, s’engage à la revendication de son humanité par la pensée de l’Être. Il pratique la religion dans un horizon nouveau pour asseoir son humanisme.
Références bibliographiques
ARISTOTE, 2000, Métaphysique, Trad. J. Tricot, Paris, Vrin, Coll. Librairie philosophique, 309 p.
CAILLOIS Roger, 1963, L’Homme et le Sacré, Paris, Gallimard, 256 p.
CORVEZ Maurice, 1966, La philosophie de Heidegger, Paris, PUF, 142 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et conférences, Trad. A. Préau, Paris, Tel Gallimard, 349 p.
HEIDEGGER Martin, 1959, Qu’appelle-t-on penser ?, Trad. G. Granel, Paris, PUF, 262 p.
HEIDEGGER Martin, 1964, Lettre sur l’humanisme, Trad. R. Munier, Paris, Aubier-Montaigne, 189 p.
HEIDEGGER Martin, 1967, Introduction à la métaphysique, Trad. G. Kahn, Paris, Tel Gallimard, 226 p.
HEIDEGGER Martin, 1976, Acheminement vers la parole, Trad. J. Beaufret, W. Brokmeier et F. Fédier, Paris, Tel Gallimard, , 260 p.
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et Temps, Trad. F. Vezin, Paris, Nrf Gallimard, 592 p.
HEIDEGGER Martin, 1987, De l’essence de la liberté humaine, Introduction à la philosophie, Trad. E. Martineau, Paris, Nrf Gallimard, 296 p.
JASPERS Karl, 1965, Introduction à la philosophie, Trad. J. Hersch, Paris, Plon, 10/18, 190 p.
La Bible, 2002, Trad. L. Segond, Paris, Société Biblique Française, 1220 p.
PLATON, 1966, La République, Trad. R. Baccou, GF-Flammarion, 507 p.
LA SCIENCE ET DIEU CHEZ LEIBNIZ ET EINSTEIN
Kpa Yao Raoul KOUASSI
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
Résumé : La science a connu des bouleversements importants avec les apports de la physique classique de Newton et la physique relativiste d’Einstein. Pour poser les problèmes épistémologiques du fondement de la science, avec la physique, nous assistons aussi à un recours aux questions et explications touchant Dieu, alors qu’elles sont réservées à la métaphysique. L’explication métaphysique de Dieu avec Leibniz, devenue une réduction métaphysique, semble hésitante. Elle a suscité une adhésion qui a fini par devenir un dogme dont la science a besoin avec Einstein par une explication scientifique de Dieu. La science vient du Dieu monarque leibnizien devenu le Dieu cosmique d’Einstein. Dieu crée le monde suivant une formule dont la clé manque à la métaphysique, mais c’est à la métaphysique d’ouvrir les perspectives d’un autre a priori pour la science. Comme ces nouvelles perspectives ne font pas disparaître la métaphysique, une complémentarité entre la métaphysique et la science est envisageable pour cerner les liens entre la science et Dieu.
Mots-clés : COSMIQUE, DIEU, EXPLICATION, MONARQUE, RELATIVITÉ, SCIENCE.
Abstract : Science has undergone major upheavals with the contributions of Newton’s classical physics and Einstein’s relativistic physics. To pose the epistemological problems of the foundation of science with physics, we are also witnessing a recourse to questions and explanations concerning God, while they are reserved for metaphysics. The metaphysical explanation of God with Leibniz, which has become a metaphysical reduction, seems to stumble. It sparked an adherence that ended up becoming a dogma that needs science with Einstein by a scientific explanation of God. Science comes from the Leibnizian monarch God who became the cosmic God of Einstein. God creates the world, according to a formula that the key is lacking in metaphysics, but it is up to metaphysics to open up the perspectives of another a priori for science. As those new perspectives do not make metaphysics disappear, a complementarity between metaphysics and science is possible in order to identify the links between science and God.
Keywords: COSMIC, GOD, EXPLANATION, MONARCH, RELATIVITY, SCIENCE.
Introduction
Dans le projet de Galilée de fonder la science sur la mathématique, Dieu est retiré de la science. Or, la physique classique de Newton, plus mathématique que celle de Galilée, ouvre la porte au retour de Dieu en science dont Leibniz se fait un grand défenseur. Au lieu de réussir une étude scientifique de Dieu pour justifier sa démarche, Leibniz fera appel à la métaphysique ; ce qui a pour conséquence d’accorder un fondement dogmatique à la science. Grâce aux travaux de la relativité, Einstein postule une sortie du dogmatisme métaphysique, mais qui s’oriente en direction d’une explication scientifique de Dieu. Peut-on expliquer scientifiquement Dieu ? Dieu est une réalité non empirique, mais selon Leibniz, l’explication métaphysique postule que Dieu est celui qui détient les lois de la science et la gouverne comme un monarque. En quoi l’explication du Dieu monarque de Leibniz est-elle féconde pour la science ? L’explication métaphysique dérange la science à cause d’un retour au dogmatisme dans une ambiance où de nouvelles possibilités d’autonomie s’offrent à la science depuis les travaux de la relativité. Mais si l’homme n’arrive toujours pas à se passer de Dieu malgré les apports de la relativité, en quoi l’explication scientifique de Dieu proposée par Einstein est-elle plus féconde que l’explication métaphysique héritée depuis Leibniz ? Ne faut-il pas envisager une complémentarité entre l’explication métaphysique et l’explication scientifique de Dieu pour sortir du dogmatisme et fonder la science avec plus d’objectivité ?
Ce travail n’a pas pour but de repenser les définitions de Dieu, mais de montrer qu’une étude scientifique de Dieu est possible avec Einstein, si nous pouvons passer de l’explication métaphysique leibnizienne de Dieu à l’interrogation scientifique de la formule de Dieu créant le monde. Grâce à la méthode synthétique, trois voies s’offrent à nous : les liens entre la science et Dieu par la métaphysique, l’approche scientifique de Dieu dans le dépassement du Dieu monarque et l’ouverture de l’approche métaphysique par les bouleversements épistémologiques de la relativité.
1. LA SCIENCE ET LE DIEU MONARQUE ET DE LEIBNIZ
Depuis la physique classique de Newton, les questions de la physique au sujet de Dieu sont fondamentales, parce qu’elles ont un impact sur la science en général et sur la conception même de Dieu. Selon A. Thayse (2013, p. 5), « parce qu’elles sont les plus fondamentales, les questions qui traitent de notre destinée sont plus essentielles ». Ces questions essentielles mettent la science en rapport avec Dieu. Poser à nouveau ces mêmes questions essentielles revient à les reprendre en des reformulations différentes, prenant toujours pour point de départ celles « que se posa au dix-septième siècle le philosophe et mathématicien Wilhelm Gottfried Leibniz » (Ibidem). W. G. Leibniz, à la suite de ses prédécesseurs, conserve une place de choix à Dieu, dans les questions essentielles, pour aboutir à la nécessité de mettre en relation la science et Dieu. Dans le Discours de métaphysique, Leibniz (1993, p. 23), commence avec « la perfection divine » comme le principe fondateur de la science, et c’est chez l’homme seul que la science, fondée par Dieu, trouve son importance. C’est dire que Leibniz a une haute idée de la science, dans la confiance placée en l’homme. Mais de ce « que Dieu possède la sagesse suprême et infinie de la manière la plus parfaite » (Ibidem) et que toutes ses créatures sont parfaites, comment soutenir que l’homme seul est fait pour la science ?
La négation de trouver la science dans le monde des pierres, des plantes et des animaux est justifiée comme un a priori tracé depuis longtemps. Sans pouvoir sortir de cet a priori, Leibniz réduira les rapports de Dieu à ses créatures en ce qui concerne la science et la morale aux dispositions divines. Leibniz (1993, p. 60) pense que « Dieu en concourant à nos actions ordinairement ne fait que suivre les lois qu’il a établies ». La conséquence, c’est que de même que Dieu obéit à ses propres lois, de même la science ne peut découvrir des lois scientifiques différentes de celles de Dieu. Et c’est à la métaphysique de soutenir cette thèse et de montrer que la science est seulement propre aux hommes. Cette thèse défendue dans le Discours de métaphysique donne aussi l’impression que la science n’a pas la réponse à cette préoccupation qui est d’ordre métaphysique.
La réponse métaphysique vient compléter l’interprétation des lois scientifiques du savant. C’est dire que la science est voulue par Dieu, mais sa place au cœur de la science est perçue par la métaphysique qui doit la faire connaître à toutes les sciences. Pour déterminer cette vérité fondamentale, le Discours de métaphysique va aussi analyser les états de Judas avant la trahison et Judas le traître. Au lieu de penser la trahison comme une imperfection dans l’œuvre de Dieu, Leibniz (Idem, p. 62) en fait une question métaphysique et soutient qu’« à cette question, il n’y a point de réponse à attendre ici-bas ». La réponse de Leibniz est déjà une intuition des différents temps qui ne peuvent se ramener à un seul temps. Il faudrait attendre l’époque d’A. Einstein pour rendre effective cette intuition. L’effort leibnizien a consisté à montrer que pour ce qui est du fondement de la science en rapport avec Dieu, une partie du problème doit être traitée en dehors de la science, c’est-à-dire suivant un temps qui n’est pas déterminable à partir de la science, mais à partir de Dieu lui-même.
Étudier la science et Dieu chez Leibniz revient à introduire un temps en dehors du temps de la science et dont l’explication est possible en métaphysique. En poursuivant la démarche de l’explication métaphysique de la relation entre la science et Dieu, Leibniz ajoutera aussi la morale. La parfaite réalisation de la morale est dans la figure de « Jésus-Christ » (Idem, p. 72). Or Jésus-Christ est venu nous apprendre comment adorer Dieu. La science, soutenue à la fois par la métaphysique et la morale, a aussi affaire à un Dieu « monarque » (Idem, p. 70) du monde des esprits (dont l’homme fait partie). Les actions du Dieu monarque sont toujours parfaites et la perfection des hommes en tant qu’esprits, « expriment plutôt Dieu que le monde » (Ibidem), alors que « les autres substances expriment plutôt le monde que Dieu » (Ibidem). Mais en quoi cela est-il avantageux pour les hommes, puisque « Dieu tire d’eux infiniment plus de gloire que du reste des êtres » (Idem, p. 70-71) ? En ramenant tout à la gloire rendue à Dieu dans le modèle de Jésus-Christ, Leibniz n’a-t-il pas ignoré l’apport du passé dans la fondation de la science ? Selon T. Obenga (1990, p. 118), « pour Héraclite d’Éphèse (…), Dieu était le principe de l’unique principe de l’Univers, un Univers éternel comme son principe. (…) Ce n’est là qu’une reprise des idées égyptiennes. Râ est l’âme et la conscience du monde ». D’où vient alors la démarche de Leibniz qui veut ignorer le Dieu Râ pour nous destiner au Dieu de Jésus-Christ ?
La conception de Dieu par Héraclite, est restée quelque peu occultée dans l’histoire, et cette occultation ne vient pas de Leibniz. En effet,
depuis Parménide et Platon, la réflexion qu’on appelle philosophie a toujours aspiré à une connaissance a priori, c’est-à-dire à un savoir qui ne dépende pas de l’expérience et qui soit, par conséquent, nécessaire et universel. De Parménide à Wolff, le domaine de l’a priori est celui des vérités immuables et éternelles que peut atteindre le νούς, la raison, l’organe divin en nous. » (J. Grondin, 1989, p. 13.)
Le Dieu de Leibniz ne réduit pas la fondation de la science. De plus, l’a priori a changé. Leibniz a maintenu cet a priori comme essentiel pour la science. Dans La Monadologie, son dernier ouvrage, où les créatures sont des monades, le Dieu monarque revient encore pour fonder à la fois la métaphysique et la science, la hiérarchie des êtres et la perfection des créatures. Mais en quoi le choix de La Monadologie vient-il donner plus d’autorité au Discours de métaphysique et sauver la thèse de Leibniz sur le statut de l’explication métaphysique de Dieu en science ? L’explication métaphysique de Leibniz se base sur la monade. C’est dans La Monadologie, ouvrage écrit en 1714 en Français, et traduit en 1721 en allemand par Koehler, et publié en 1840 par Erdman en français, que Leibniz présente explicitement la monade. En 1881, E. Boutroux fera une autre publication de La Monadologie d’après les trois manuscrits. Pour Boutroux, La Monadologie est un ouvrage qui se présente comme un résumé de l’ensemble de la philosophie de Leibniz qu’il compose en français pendant son dernier séjour à Vienne pour le prince Eugène de Savoie, texte qu’il garda dans une cassette comme un trésor d’un prix inestimable. En tant que résumé, ce texte permet alors de ramasser l’essentiel de la pensée de Leibniz. La Monadologie suit une démarche ascendante ou progressive, qui va des créatures à Dieu, et celle descendante qui va de Dieu aux créatures.
Dans ces sept premiers paragraphes de La Monadologie[1] où Leibniz présente la monade du point de vue externe, il commence par la définir comme une substance simple. Il l’oppose à la fois aux composés, aux atomes, aux accidents, aux réalités qui commencent naturellement et à celles qui subissent un changement ou l’altération. La substance simple est aussi sans partie. Suivant cette hypothèse, Leibniz doit nécessairement séparer, au § 3, la monade de la nature géométrique (espace), et la lier à la nature elle-même sous la couverture de « véritable Atome de la Nature ». Leibniz renverse le schéma initial qui partait de la mathématique pour arriver à la métaphysique. Ce renversement métaphysique l’est aussi dans la démarche qui commence par l’étude de l’extériorité de la monade. La monade est une découverte métaphysique et ne commence pas naturellement. Ainsi, la science en relation avec Dieu, est pensée comme rentrant aussi en relation avec la métaphysique. L’a priori métaphysique de Dieu devient alors un a priori pour la science. Dieu tire sa gloire dans l’adoration des hommes à travers les lois de la science. Est-ce à dire que l’homme de science qui n’adore pas Dieu ou qui ignore la métaphysique, passe à côté de l’essentiel ? Pour Leibniz, il s’agit de voir les choses autrement. En effet, ce n’est pas à partir des lois physiques ou de la chimie, ou de l’alchimie que la monade est rendue possible. Mais pourquoi la métaphysique n’a pas été capable de mieux présenter la monade depuis ses origines pour fonder objectivement la science ?
Selon le § 7, la démarche utilisée par la métaphysique, surtout celle de la scolastique, ne pouvait pas conduire à la découverte des monades comme substances simples, parce qu’elle a confondu l’intérieur et l’extérieur des monades et a créé aussi des fissures dans chaque monade. De plus, la science, en visant l’extérieur de la monade, a oublié cet extérieur pour se contenter de l’intérieur à travers des compositions subissant le temps, le mouvement mécanique et niant l’activité du Dieu monarque. La métaphysique jusque-là, n’ignorait pas l’activité du Dieu monarque, mais elle l’a confondue à tort avec l’activité des accidents (des causes secondes) et des substances n’ayant pas à leur tour la qualité du Dieu monarque. C’est pourquoi, selon le § 7, « ni substance, ni accident ne peut rentrer de dehors dans la monade. » Il faut une nouvelle ouverture au cœur de la métaphysique pour que l’explication métaphysique de Dieu rende possible la relation entre la science et Dieu.
Aux paragraphes 8 à 17, Leibniz étudie la nature interne de la monade en tenant compte de ses qualités. Ainsi, si la qualité apparaissait chez Aristote comme un accident, chez Leibniz, elle prend une autre valeur : elle permet de justifier les actions internes des substances simples et de montrer ainsi qu’elles ont le pouvoir de représentation, et d’appétition. Par les qualités internes de la monade Leibniz déduit les différents principes métaphysiques et scientifiques en montrant aussi que la nature de la monade, en ses actions internes, est aussi liée à la monade en ses actions externes. Par la nécessité de l’intériorité de la monade, se déterminent les différentes monades et l’infini du pouvoir du Dieu monarque : il y a une infinité de substances simples (la spécification et la variété de substances simples), à la fois du point de vue externe (la quantité, la pluralité), que la qualité, mais, au plan épistémologique, le moment n’était pas encore venu pour penser le temps de différentes manières, afin de sortir de la conception fixe du Dieu monarque qui dérange aussi la science.
La science et le Dieu monarque de Leibniz nous maintiennent dans le schéma d’un retour aux Anciens, alors qu’il s’agit de comprendre autrement le monde à partir des nouvelles découvertes scientifiques de Newton au sujet de la force. Depuis les travaux de Newton, la force était devenue l’a priori de la physique, et le Dieu monarque devrait être abandonné en science. Ce qui est surprenant c’est que Leibniz le sait, mais préfère réorienter le débat sur la force en introduisant le concept de monade à partir des problèmes que les Anciens ont trouvés. En effet, dans le schéma d’Aristote, la physique dépendait de la métaphysique. En reprenant les questions métaphysiques des Anciens à partir d’Aristote, Leibniz s’inscrit dans cette démarche, mais il trouve insuffisante la réponse de la physique classique dans l’explication de la cause des existants et du mouvement. Avec la monade, il fonde l’existence de la force comme ce qui subsiste en dehors de tout mouvement et qui en est la cause. Cette hypothèse rejette la thèse de l’atome comme une réalité absolument rigide.
La fondation de la science à partir de la monade retrouve la place centrale de Dieu, mais tend à détourner l’explication scientifique par l’explication métaphysique. En effet, le rejet de la rigidité de l’atome est la conséquence du rejet de l’autonomie de l’atome au profit de sa dépendance du Dieu monarque et de la reconsidération de la force comme une substance. Ainsi en maintenant les actions du Dieu monarque, Leibniz maintient intuitivement l’existence des temps relatifs. En transformant la monade en substance simple, il intuitionnait aussi la force quantique dont il n’avait pas les fondamentaux scientifiques. Le moment n’était pas encore venu pour penser en direction des quanta, mais la réponse métaphysique était déjà essentielle. L’échec de Leibniz est de n’avoir pas réussi à découvrir avec des calculs précis, l’essence du monde. D’ailleurs, Leibniz est tombé en exaltation devant la loi de la gravitation universelle de Newton, traduite dans la force et maladroitement renvoyée par lui à la figure de Jésus-Christ ; ce qui crée une confusion au sujet de l’autonomie de la science et la liberté de la foi du savant. Ainsi, au lieu d’utiliser le calcul infinitésimal pour fonder sa physique comme l’a fait Newton, Leibniz a réduit le champ d’exploration de la physique par l’explication métaphysique de l’action du Dieu monarque. C’est comme si l’explication métaphysique apportée par La Monadologie, invite à repenser le statut de Dieu au cœur de la science.
Leibniz a montré que le lien entre la science et le Dieu monarque peut être expliqué par la métaphysique. L’explication métaphysique fonde l’hypothèse qui soutient que la science n’échappe pas à la métaphysique comme un complément. Ainsi, si avant Leibniz, la métaphysique est la base de la science, pour lui, la métaphysique vient compléter la science et cette fonction est nécessaire. La nécessité de la fonction de la métaphysique s’appuie sur le principe suivant lequel les lois de la nature dépendent du Dieu monarque et cette fonction de la métaphysique envers la science fait partie des lois du Dieu monarque. Mais la démarche de Leibniz a ramené la compréhension du Dieu monarque à un Dieu adoré le plus parfaitement par l’homme dans la figure de Jésus-Christ ; ce qui n’est pas sans problème comme le remarquera plus tard A. Einstein contre Leibniz.
2. LA SCIENCE ET LE DIEU COSMIQUE D’EINSTEIN
L’explication métaphysique de Dieu par Leibniz insiste sur le lien rendu nécessaire entre la métaphysique et la science. Le problème est que la science chez Leibniz est aussi liée à la métaphysique ; d’où l’interprétation du temps en rapport avec Dieu, qui changera chez Einstein dans son effort de dépasser la physique classique, chantre des absolus. Dans un échange entre G. Pessis-Pasternak et I. Prigogine, ce dernier présente autrement le Dieu monarque de Leibniz en rapport avec le temps. Ainsi, si avec Leibniz, « pour Dieu il n’y a ni passé, ni présent, ni futur puisqu’il voit tout simultanément » (G. Pessis-Pasternak, 1999, p. 25), cette conception du temps est dépassée par l’approche relativiste qui repense aussi le rapport entre Dieu et la science. Mais là où les choses se compliquent, c’est que Leibniz est resté croyant, alors qu’Einstein était un « incroyant (…) détaché de toute religion et assez méfiant » (J.-C. Carrière, 2005, p. 165).
Einstein s’est détaché de la religion et s’est plus rapproché de l’art en rapport avec la science. Le Dieu monarque leibnizien est abandonné chez lui au profit du Dieu cosmique. Le Dieu révélé juif qu’a connu Einstein est abandonné au profit du Dieu cosmique. C’est le Dieu cosmique qui est aussi le Dieu de la religion cosmique. Einstein (2009, p. 26) soutient « vigoureusement que la religion cosmique est le mobile le plus puissant et le plus généreux de la recherche scientifique. ». Est-ce à dire que ce qui se dit et se vit dans « les Églises » (2009, p. 26) et qui fonde la science chez Leibniz, rompt avec la science ? Si tel est le cas, le projet leibnizien de fonder une complémentarité entre la science et la métaphysique devrait être abandonné. Le vœu de l’abandon de la métaphysique au profit d’une science autonome n’est pas toujours poursuivi, puisque dans les faits, on assiste aussi à un abandon des croyances religieuses au profit de la liberté de l’homme à vivre sans le Dieu monarque. Selon A. Thayse (2010, p. 7), « en Europe occidentale, les priorités se sont modifiées, les états d’esprit ont évolué, la société s’est transformée, une autre culture s’est développée ».
Le retour au projet leibnizien ou au Dieu monarque semble une utopie, mais l’absence du Dieu monarque a fait du champ de la source de la science un champ de non-sens, puisque chacun doit partir de soi-même comme valeur. Comme il est difficile de trouver en soi-même cette valeur pour la rendre valable pour tous, un retour au Dieu monarque semble souhaitable. Mais un tel souhait n’est-il pas un mauvais combat contre la « philosophie naturelle » (M. Clavelin, 2016, p. 163) pensée par « Descartes et Galilée » (Ibidem), dans la rupture avec « l’omnipotence divine » (Ibidem) ? Or, la métaphysique semble revenir à la surface et le rejet de l’omnipotence de Dieu, garant des lois de la science, semble plus dangereuse que son acceptation. En effet, pour Thayse, il s’agit de renverser cette situation de non-sens par un retour au sens dans la prise en compte du message des Églises. Mais comment renoncer à cette tendance à la mode, de vivre loin du Dieu des Églises qui est aussi celle recommandée par Einstein, pour donner une véritable assise à la science ?
Einstein reproche aux Églises d’enseigner de tout comprendre par la pratique des effets dépendants du Dieu monarque. Ainsi la science ne devrait pas être connue par les effets pratiques du Dieu monarque, mais elle doit être animée par la passion qui rend possible la religion cosmique. Il faut sortir avec Einstein de l’action du Dieu monarque puisqu’elle ne montre pas que la passion est essentielle dans la religion et dans la science. Mais la passion dont parle Einstein est-elle plus essentielle pour la science et le genre humain que la passion du Christ dont l’Église en fait le moteur de toute grande œuvre ? Est-ce à dire que pour la science, la passion d’un chercheur est de loin plus grande que la passion du Christ pour le genre humain ? La religion cosmique qui fonde l’esprit scientifique, « se distingue de la croyance des foules naïves qui envisagent Dieu comme un être dont on espère la mansuétude et dont on redoute la punition » (2009, p. 27). Mais Einstein n’a-t-il pas une vue réduite de la religion, surtout qu’il tend à tout ramener au niveau des sentiments de l’homme rendu non-coupable de toute culpabilité ?
Selon la manière de voir d’Einstein, la causalité intéresse l’esprit scientifique, alors que sans nier par le passé la causalité, Leibniz entrevoyait une source épanouissante pour l’homme : la Grâce. La religion chrétienne préconisée par Leibniz est basée sur la Grâce. La Grâce est l’expression de la bonté divine. C’est elle qui fonde aussi l’harmonie parfaite entre le monde naturel et le monde moral comme le règne de la grâce, c’est-à-dire l’omniprésence de la bonté divine. Ainsi, au § 88 de La Monadologie, cette harmonie est à la fois universelle et préétablie, parce qu’elle est la manifestation, partout de la grâce divine comme une justice universelle, « pour le châtiment des uns, et la récompense des autres » (§ 88). Tout dépend de la grâce ; d’où l’harmonie. Mais Leibniz va plus loin, en concluant ainsi La Monadologie : « si nous pouvions entendre assez l’ordre de l’univers, nous trouverions qu’il surpasse tous les soins des plus sages, et qu’il est impossible de le rendre meilleur qu’il est » (§ 90). L’harmonie nous précède en tout et est l’œuvre du Dieu monarque.
La Grâce nous rapproche de l’idée et de la réalité « d’un Dieu personnifié » (J. R. Dos Santos, 2012, p. 23) qui est une idée « naïve, voire puérile » (Ibidem) pour Einstein. Ce Dieu est le « Dieu de la Torah » (Ibidem) en qui Einstein prétend ne pas croire « parce qu’il s’agit d’un concept anthropomorphique, une chimère forgée par l’homme pour tenter d’influencer son destin et lui offrir une consolation dans les moments difficiles » (Idem, p. 23-24). Le Dieu monarque de Leibniz n’est pas le Dieu d’Einstein. Le Dieu d’Einstein est le « Dieu de Spinoza, qui se manifeste dans l’ordre harmonieux de ce qui existe » (Idem, 2012, p. 26). Alors que le Dieu monarque se prouve par les principes a priori et les principes a posteriori, pour Einstein, « il est impossible de prouver l’existence de Dieu, tout comme il est impossible de prouver sa non-existence. Nous avons seulement la capacité de sentir le mystère, d’éprouver une sensation d’éblouissement face au merveilleux système qui régit le système de l’univers. » (Idem, p. 27.) Ainsi, parce que l’homme peut sentir, il est impossible qu’il n’y ait pas un Dieu, non pas celui qu’il faut servir, mais un Dieu grand architecte et source de la science.
La religion cosmique trouve alors son fondement dans la capacité de l’homme à s’émerveiller afin de fonder la science. Est-ce à dire que les autres services rendus au Dieu monarque trahissent la mission contemplatrice de l’homme comme fondatrice de la science ? Au lieu de voir la question sous cette forme, Einstein préfère chercher « la formule de Dieu » (Idem, p. 520), c’est-à-dire « la preuve scientifique de l’existence de Dieu » (Idem, p. 521). Au fond, « Einstein cherchait à déterminer s’il y avait une vérité cachée dans la Bible, il ne recherchait pas des vérités métaphoriques et morales, mais des vérités scientifiques » (Idem, p. 529). De plus, contrairement à Leibniz, « Einstein croyait en une harmonie transcendante, pas en un pouvoir mesquin. Il croyait en une force universelle, pas en une divinité anthropomorphique » (Idem, p. 530).
La religion cosmique, fondée sur le Dieu cosmique, a permis à Einstein de mettre en place la relativité. « La théorie de la relativité restreinte ébranle deux piliers de la physique, édifiés depuis deux siècles » (L. Seksik, 2008, p. 71) que sont « la notion d’espace et la représentation du temps » (Ibidem). C’est dire que si d’un côté Leibniz a insisté sur la complémentarité nécessaire de la métaphysique et de la science, et de l’autre, il s’est appuyé sur la physique de Newton, ses approches sont naïves pour Einstein. La naïveté vient du fait que « la physique de Newton forme un tout qui constitue la base des connaissances humaines sur le monde » (Idem, p. 73), et cette base est devenue un dogme qui sape, à son tour, les bases des dogmes religieux, de la métaphysique et de la science. Le dogme qui fonde aussi la physique de Leibniz prend appui sur « cette bible newtonienne, (…) l’arbre défendu » (Idem, p. 75). Au fond, la complémentarité entre la métaphysique et la science n’est pas une mauvaise chose, mais ce qui pose problème à Einstein c’est qu’une physique est devenue une « parole d’évangile » (Ibidem) et l’absence de la religion cosmique a conduit à « se vouer aux livres saints de la physique classique » (Ibidem).
Les bases de la physique classique sont aussi dominées par l’éther « que nul n’a jamais vu, dont personne n’a jamais démontré l’existence, qui défie les lois de la physique, et semble être une réponse simpliste à un insoluble problème » (Ibidem). L’absolu placé dans l’éther a aussi conduit à la justification naïve des autres absolus. « Tout cela doit être remis à plat » (Idem, p. 208). Mais pour y arriver, il fallait à Einstein les travaux expérimentaux de Michelson Morley, grâce à qui « l’éphémère éther luminifère s’est indéfiniment perdu » (Tiberius José, 2016, p. 49). Est-ce à dire que si ces expériences avaient eu lieu plus tôt, les bases de la physique classique auraient été différentes ? Ce n’est pas ce choix de la continuité qu’a fait la nature. « Si le progrès avait été continu et organique, tout ce que nous avons par exemple en théorie des nombres ou en géométrie analytique aurait pu se découvrir après Euclide en quelques générations » (A. Koestler, 2012, p. 511). C’est dire que le changement de base en physique contemporaine qui influence aussi les autres disciplines dites sciences, s’annonce comme faisant aussi partie du plan du Dieu monarque de Leibniz.
Le Dieu cosmique a engendré une religion qui a permis d’ébranler les bases de la physique classique et aussi de sortir de la naïveté pour fonder la science sur de nouvelles bases. Or, pour Leibniz, tout est voulu par le Dieu monarque. C’est dire que la rupture que veut installer Einstein dans le but de sauver la science, n’est pas toujours bien opérée. Certes, il ne s’agira plus de faire du temps et de l’espace des absolus pour la science, mais Einstein est incapable de justifier le fondement existentiel du Dieu cosmique et ne réussit pas à évacuer la complémentarité métaphysique voulue par Leibniz. De plus, ce n’est pas la première fois qu’une telle tentative récusant le Dieu monarque, est faite et a échoué. « La science post-galiléenne a prétendu se substituer, ou succéder légitimement à la religion ; aussi, en ne réussissant pas à fournir les réponses fondamentales, a-t-elle causé non seulement une frustration intellectuelle, mais aussi une famine spirituelle » (Op. cit., p. 537). Il faut alors réussir à surmonter la rupture qui engendre d’autres ruptures.
La religion cosmique est la source de la physique d’Einstein. Cette religion a fini par envahir Einstein qui aurait détruit la paix du monde par une deuxième catastrophe après le désastre au Japon. Au nom de la recherche de la vérité scientifique, on ne saurait suivre Einstein jusqu’au bout, surtout qu’il a voulu remplacer une religion par une autre, et la religion cosmique n’a pas encore fini son dessein de remplacer définitivement la religion du Dieu monarque. Ce qui est original avec Einstein, c’est qu’il a montré que la manière naïve d’adorer le Dieu monarque, engendre à la fois la frustration intellectuelle et la famine spirituelle. À défaut d’appeler la métaphysique du nom de religion cosmique, Einstein nous a permis de comprendre que la religion du Dieu monarque a une finalité qui nous conduit à l’absolu, alors que celle du Dieu cosmique nous conduit à la science. La foi existe désormais à la fois en science et en religion, et chacun doit y mettre du sien pour faire avancer son domaine. La religion du cosmique rendue possible, est aussi la réponse que les absolus doivent être remis à leurs places, mais tout n’est pas absolu.et pour comprendre les bases de sa religion (la religion cosmique), Einstein a dû également s’appuyer sur la Bible.
3. LE PSAUME 90 ET LA RELATIVITÉ
L’explication scientifique de Dieu, de sa formule, de ce qu’il est pour la science, restera celle d’une « faim intellectuelle de l’homme » (A. Koestler, 2012, p. 537) si A. Einstein n’avait pas découvert la relativité. Selon le principe de la relativité restreinte, « si K’ est relativement à K un système de coordonnées qui effectue un mouvement uniforme sans rotation, les phénomènes de la nature se déroulent, relativement à K’, conformément aux mêmes lois générales que relativement à K » (A. Einstein, 2001, p. 26). Grâce à la relativité, l’espace et le temps ne sont plus absolus et le temps est la quatrième dimension de l’espace. De plus, « d’après la Mécanique classique et d’après la Théorie de la relativité restreinte, l’espace (l’espace-temps) jouit d’une existence indépendante vis-à-vis de la matière ou du champ » (Idem, p. 212). Cette déduction montre que l’espace et le temps, qui sont aussi utilisés en religion, doivent être repensés. La base de nos croyances se trouve alors transformée par une manière plus simple de comprendre le monde. Mais ce résultat, Einstein ne l’aurait pas découvert si ces travaux n’avaient pas abouti à la relativité de la relativité générale, puisque la relativité, en sa première formulation, ne supprimait pas définitivement les contradictions que soulevait la présence de la lumière qui vient remplacer l’éther.
Les hommes ont mis du temps pour comprendre les problèmes liés à l’espace et au temps afin de sortir des conflits entre les preuves scientifiques de l’origine du monde et des créatures et les conceptions religieuses. « Selon la relativité de la relativité générale, (…) l’espace ne jouit pas d’une existence indépendante vis-à-vis de « ce qui remplit l’espace » et dépend des coordonnées » (Ibidem). La démarche d’Einstein a consisté à s’inventer un Dieu dont les actions permettront de vérifier ses propres équations. Plusieurs recherches qui ont finalement conduit à ce résultat extraordinaire, tirent leur force de la relation établie entre le psaume 90 et la relativité. Comme Leibniz, Einstein était convaincu que les lois de la science sont immuables et sont l’œuvre d’un Dieu. Il s’agissait alors d’écrire les équations de manière à les faire coïncider avec les vérités bibliques. De cette façon, s’ouvrait avec Einstein la démonstration scientifique de Dieu et de son action en science.
La démarche d’Einstein n’avait pas pour ambition de prouver scientifiquement l’existence d’un Dieu révélé et proche des hommes, mais de comprendre que ce qui se dit de ce Dieu révélé dans la Bible, est explicable scientifiquement. L’explication scientifique veut alors montrer qu’il faut surmonter les métaphores pour aller à la science. Grâce au psaume 90, Einstein trouve une harmonie entre la conception biblique du temps et la théorie de la relativité. Ainsi « « Mille ans, à tes yeux » représente le temps dans une perspective, « un jour qui passe » représente la même période de temps sous une autre perspective » (J. R. Dos Santos, 2012, p. 532). Leibniz est resté au niveau de la morale, il n’avait pas les arguments scientifiques pour poser le problème autrement, et découvrir le « caractère fini (non fini) de la vitesse de la lumière » (A. Einstein, 2016, p. 54). Il fallait de nouveaux outils scientifiques et mathématiques pour sortir de l’interprétation naïve du psaume 90 et entreprendre le temps sous différents modes.
Les interprétations naïves, dans la religion, la philosophie et la science consistent en ce que les débats tournent autour des « six jours de la Création, tels qu’ils sont décrits par la Bible » (J. R. Dos Santos, 2012, p. 536). Être naïf, c’est réduire toute l’explication scientifique des six jours à la physique classique ou à toute autre physique qui fait fi « de la relation entre l’espace et le temps sur la terre et l’espace-temps dans l’univers » (Ibidem). Nous devons sortir de la naïveté pour comprendre, avec Einstein, que la relativité restreinte rentre aussi dans l’élaboration de la relativité générale. En effet, « quand il parle d’un jour, l’Ancien Testament fait (…) référence à un jour terrestre. Mais, selon les théories de la relativité, plus un objet a de masse, plus le passage du temps est lent à sa surface » (Idem, p. 536-537). La démonstration d’Einstein remplace la métaphore par la vérité scientifique. Suivant les calculs obtenus par la relativité, on peut établir, avec lui, que les six ont un vrai sens. En effet, si pour la Théorie de la relativité générale la masse courbe l’espace et que les grosses masses modifient le temps de manière significative, la contradiction entre les différents temps est dépassée par l’harmonie entre le temps sur la terre et le temps vu en dehors de la terre. Une explication scientifique des six jours bibliques est possible. Ainsi durant les six jours, « chaque duplication de la taille de l’univers a accéléré le temps par un facteur de deux. (…) Le premier jour biblique dura 8 milliards d’années. Le deuxième jour dura 4 milliards, le troisième dura 2 milliards, le quatrième dura 500 millions d’années et le sixième jour dura 250 millions d’années. » (Idem, p. 538.)
L’explication scientifique des réalités de la Bible, avec Einstein, montre que Dieu n’est pas coupé de la science. Toutefois, son obsession pour l’explication scientifique l’amène à tout ramener au Dieu cosmique et à réduire le Dieu de la Bible à « un Dieu jaloux mesquin, jaloux et vaniteux qui exige adoration et fidélité » (Op. cit., p. 543). Comment dépasser alors le Dieu supposé mesquin par le Dieu adoré de Leibniz ? Ce dépassement s’impose puisque « dans le travail d’Einstein, c’est que l’histoire biblique de l’univers, quand le temps est mesuré d’après les fréquences de la lumière prévue par la théorie du Big Bang, cadre avec l’histoire scientifique de l’univers » (Ibidem). Sans nier les efforts de la métaphysique, la démarche employée par Einstein propose une nouvelle piste qui passe par l’explication scientifique. Il ne s’agit pas d’envisager le dépassement par un simple dépassement, mais de comprendre, avec d’Einstein, comment arriver à nous faire une meilleure idée du Dieu adoré, à partir de l’explication scientifique. La recherche d’Einstein, au sujet de la formule de Dieu, le conduira à un code « See sign » (Idem, p. 673) qui donne « Genesis. Au fond, Einstein veut nous dire : See the sign in Genesis. « Regardez le signe dans la Genèse. » » (Ibidem).
La réponse trouvée dans la formule du Dieu d’Einstein, c’est le nouveau commencement avec l’homme, alors que tout a commencé avec la formule de Dieu. « Que la lumière soit ! » (Idem, p. 704). Dieu a utilisé cette formule pour faire le premier commencement. Dans la nouvelle création qu’il réalise avec l’homme, tout commence avec la lumière de la résurrection du fils de l’homme. Ainsi, si, au départ, tout est exaltant avec la création naturelle, il faudrait alors passer de l’exaltation à l’adoration réelle du Dieu révélé. Dieu a permis à l’homme de décoder sa formule pour entrer en communion avec Lui. Ainsi il faudrait remplacer la vision d’Einstein, qui réduit Dieu, à celui de Spinoza, par la redécouverte du Dieu de Leibniz qui est le Dieu adoré. Le Dieu adoré est réel et ne peut être confondu au Dieu cosmique. Selon C. Morazé (1986, p. 249), « le Dieu chrétien n’est pas celui des Parménides, des Socratiques ni des Stoïciens. Il n’est compatible ni avec l’éternel retour d’un temps cyclique, ni avec les mouvements « errants » dans les trois dimensions : il en est à la fois l’en deçà, l’Homme et l’au-delà. » Est-ce à dire que c’est seulement pour la science que le Dieu cosmique est possible ?
La science ne s’arrête pas à elle seule. Einstein soutenait que l’existence ou la non-existence du Dieu cosmique ne peut être prouvée. Et la nature de Dieu et son statut dans l’histoire des hommes trouvent leur importance dans l’unité qui lie ceux qui adorent et ceux qui sont en admiration devant la grandeur de Dieu. La Monadologie de Leibniz a eu le mérite de découvrir, au § 90, le Dieu adoré comme l’auteur de tout, le Maître, la Providence, le grand chef d’État. Ces attributs anthropomorphiques rejoignent les autres attributs évoqués à partir du §85. L’adoration ne justifie pas l’anthropomorphisme, mais la nécessité d’étendre notre manière de voir l’homme. L’homme a un corps et une âme et appartient à deux règnes naturels qui sont en harmonie parfaite. « L’une des causes efficientes, l’autre des causes finales (…), entre le règne physique de la Nature et le règne Moral de la Grâce, c’est-à-dire, entre Dieu considéré comme architecte de la Machine de l’Univers et Dieu considéré comme Monade de la cité des esprits » (§ 87). L’harmonie justifie donc les séparations dans le monde, les hiérarchies et la cause unique du monde. Leibniz a introduit ainsi au cœur du monde naturel, le monde moral comme ce qu’il y a « de plus élevé et de divin dans les ouvrages de Dieu » (§ 86).
Le Dieu cosmique a voulu se laisser décoder, non pas par les sources de la science, mais à travers la Bible, le socle de la croyance au Dieu adoré ; ce qui justifie les deux règnes de Leibniz. Grâce aux travaux d’Einstein, la Bible ne se présente plus comme un ensemble de simples amas de récits fantastiques, mais comme un ensemble de faits trouvant leur harmonie dans l’Esprit qui les habite. C’est dire que le nom de Dieu, même s’il change, ne remplace pas le vide qu’on pourrait créer si on veut se passer de Dieu chez Leibniz et Einstein. Le psaume 90, qui est un texte biblique et le livre de la Genèse auquel nous revoie Einstein sont des arguments pour soutenir que Dieu est toujours présent en science. L’effort des travaux d’Einstein, avec le Dieu cosmique, est d’avoir ouvert les yeux de tous sur la conception naïve de Dieu qui ruine les fondements scientifique, métaphysique et religieux et les adosse à de faux absolus dont il faut se débarrasser.
Conclusion
Cette étude a permis de montrer la science et Dieu sont inséparables chez Leibniz et Einstein, mais Dieu s’entend de différentes manières. Avec Leibniz, Dieu adoré ou Dieu monarque, remplit les missions de la fondation de la science, de la métaphysique, de la religion et de la morale. Cette vision n’est pas partagée par Einstein qui accuse Leibniz et ses héritiers de saper les bases des dogmes religieux et des fondements de la métaphysique et de la science par une pensée naïve. Dieu est nécessaire en science, mais il faut sortir de la physique classique pour saisir sa vraie place en science. Il a fallu le génie d’Einstein pour nous mettre en présence du Dieu cosmique fondement des nouvelles bases de la science. Le Dieu monarque ou Dieu adoré a, par pure grâce, accordé à l’homme le privilège de l’adorer plus que tout. Ce privilège, cher à Leibniz, doit être encore actualisé parce que les hommes, voyant tout suivant les normes du Dieu monarque, courent le risque de réduire le temps à la dimension de la terre et, à la longue, d’en faire un absolu, pire que celui que voulait combattre Einstein. Tout l’effort d’Einstein a consisté à montrer que la science a toujours besoin de Dieu car il est l’autre dimension du temps que découvre la relativité. Que Choisir alors de ces deux manières de voir la relation entre la science et Dieu ? Dans la troisième partie nous avons montré qu’il y a une nouvelle lecture de Leibniz et d’Einstein qui s’impose et qui les réconcilie. L’objectif visé a été atteint puisque nous avons montré que selon le nom ou la fonction qu’on lui donne, Dieu est l’auteur de la science chez Leibniz et chez Einstein et une explication scientifique de Dieu est possible.
Références bibliographiques
CARRIÈRE Jean-Claude, 2005, Einstein s’il vous plaît, Paris, Odile Jacob, 243 p.
CLAVELIN Maurice, 2016, Galilée, cosmologie et science du mouvement suivi de Regards sur l’empirisme au XXe siècle, Paris, CRNS EDITIONS, 392 p.
DOS SANTOS José Rodrigues, 2012, La formule de Dieu, Trad. Carlos Batista, Paris, Hervé Chopin, 717 p.
EINSTEIN Albert, 2009, Comment je vois le monde ?, trad. Maurice SOLOVINE et Régis EINSTEIN Albert, 2016, Conceptions scientifiques, trad. Thibault DAMOUR, Paris, Flammarion, 176 p.
EINSTEIN Albert, 2001, La relativité, trad. Maurice SOLOVINE, Paris, Payot, 220 p.
GRONDIN Jean, 1989, Kant et le problème de la philosophie : l’a priori, Paris, Vrin, 205 p.
KOESTLER Arthur, 2012, Les somnambules. Essai sur l’histoire des conceptions de l’Univers, Paris, Les Belles Lettres, 595 p.
LEIBNIZ Wilhelm Gottfried, 1993, Discours de métaphysique, Paris, Pocket, 307 p..
LEIBNIZ Wilhelm Gottfried, 1999, La Monadologie, Paris, Delagrave, 231 p.
MORAZÉ Charles, 1986, Les origines sacrées des sciences modernes, Paris, Fayard, 506 p.
OBENGA Théophile, 1990, La philosophie africaine de la période pharaonique 2780-330 avant notre ère, Paris, L’Harmattan, 567 p.
PESSIS-PASTERNAK Guitta, 1999, La science : dieu ou diable, Paris, Odile Jacob, 243 p.
SEKSIK (Laurent), Albert Einstein, Paris, Gallimard, 2008, 304 p.
THAYSE André, 2010, Dieu caché et le voilé : l’une et l’autre alliance, Paris, L’Harmattan, 204 p.
THAYSE André, 2013, Dieu personnel et ultime réalité. Je serai qui je serai (Exode 3, 14), Paris, L’Harmattan, 159 p.
TIBERIUS José, 2016, Théorie de la Relativité, éléments et critique, www.molwick.com, Molwick, 176 p.
ET L’ART CRÉA DIEU : HÖLDERLIN ET HEIDEGGER AU SUJET DE LA DIVINITÉ DE DIEU
Grégoire-Sylvestre M. GAINSI
Université de Poitiers/Institut catholique de Paris
Résumé : Pour Hölderlin, Dieu est à venir. C’est pourquoi seul le retrait exprime l’apparaître du divin. Telle est aussi la vision que partage M. Heidegger dont l’ontologie avoisine trait pour trait cet Être se manifestant mais toujours en retrait. L’enjeu de ce retrait, comme révélation de la divinité de Dieu, est ce que nous voulons percevoir dans ce travail qui confronte la vision des deux figures du romantisme transcendantal allemand que sont Hölderlin et Heidegger. Le retrait-manifesté du divin se délègue à travers diverses formes et figures, c’est-à-dire au travers du divin que le poète peut représenter par son pouvoir artistique dans sa relation avec la nature.
Ainsi, inventer la divinité passe par l’art et la nature. Seul l’art peut dire la divinité dans une approche plus divine. Il chante, dans la vérité, les figures de délégation divine. La célébration, par Hölderlin, de la délégation de Dieu comme Père, comme Unique Fils, comme Esprit, révèle la profondeur de sa pensée poétique qui sort Dieu de son retrait et Le ramène au pays natal. De même, pour Heidegger, le mode d’apparaître du divin est le même. Et son pays natal que le langage heideggérien, toujours poétique, nomme “origine” (Herkunft), n’advient qu’en allant au-delà de ce qui apparaît. Par son art, le poète invente Dieu et Le chante au cœur de la philosophie et de la théologie.
Mots-clés : ART, DIEU, DIVINITE, NATURE, RETOURNEMENT NATAL, RETRAIT, PERE.
Abstract : According to Hölderlin, God is to come. That is why only withdrawal expresses divine’s appearance. This is also the vision of M. Heidegger whose ontology is closely related to this Being showing itself but always hiden. The stake of this withdrawal, as God’s divinity’s revelation, is what we aim to perceive in this work which confronts the vision of the two figurehead of German transcendental Romanticism that are Hölderlin and Heidegger. The manifested-withdrawal of the divine is delegated through various forms and figures, we mean throughout the divine that the poet can represent, using his artistic power in his relationship with nature.
In this way, inventing the divinity passes by art and nature. Only art can express divinity in a more divine approach. He sings indeed the figures of divine delegation. Hölderlin’s celebration of the delegation of God as Father, as Only Son, as Spirit shows the depth of his poetic thought that brings God out of his withdrawal and brings Him back to his homeland. Similarly, for Heidegger, the divine appearance mode is the same. And his homeland, which the Heideggerian language, always poetic, calls “origin” (Herkunft), happens only beyond what appears. Through his art, the poet invents God Whom he sings in both philosophy and theology.
Keywords: ART, GOD, DIVINITY, NATURE, NATAL REVERSAL, WITHDRAWAL, FATHER
Introduction
Au nombre des protagonistes du romantisme transcendantal allemand, F. Hölderlin et M. Heidegger sont deux grandes figures de proue après Kant qui en est l’innovateur. Tandis que Hölderlin (1770-1843) pourrait encore appartenir au courant idéaliste provoqué par Hegel, c’est directement relié à Kant que Heidegger (1886-1976) pense que la question du divin peut encore être résolue grâce à l’art poétique. Ainsi, Hölderlin et Heidegger vont se rejoindre dans la vision restauratrice de l’art comme création au sens de provocation de la divinité de Dieu.
Pour ces deux penseurs de l’art poétique, c’est la philosophie qui fait advenir les dieux. Dans le cadre précis du dieu judéo-chrétien, c’est par voie transcendantale que l’art rend favorable l’idéalité de l’idée chrétienne de Dieu. Pour eux, la poésie est le commencement et la fin de la philosophie. La philosophie comme la poésie est la connaissance héraclitéenne de l’unité des contradictoires. Et les organes de cette connaissance sont l’Esprit, la Nature, ou une espèce d’harmonie. Hölderlin est considéré comme le plus grand poète lyrique de langue allemande. Il est aussi considéré à la fois comme le créateur du mythe poétique allemand et de l’art poétique allemand. Heidegger voit en lui le plus grand penseur de l’idéalisme allemand. Tous deux vont procéder à la re-visitation des dieux grecs respectivement dans Tragédie d’Empédocle pour Hölderlin et Beitrage zur Philosophie pour Heidegger.
La force de ces penseurs réside dans le questionnement de leurs analyses visionnaires de l’histoire de notre culture sur des millénaires, basculant autour du pivot littéraire critique des Anciens et des Modernes, du passage de la Grèce à l’Allemagne natal ; passage de la Tragédie à l’Hypérion. Ecrit entre 1797 et 1799, Hypérion demeure le cœur de l’œuvre de Hölderlin. Par des hymnes et des Odes, il chante le retour au pays natal : c’est le retournement natal revenant de son autre Grèce où les dieux se sont retirés. C’est de ce retrait des dieux dont parlera Heidegger plus tard. Déjà dans ses cours de jeunesse, Phénoménologie de la vie religieuse (1921-2) où il confronte l’idée chrétienne de Dieu comme accomplissement de la Grèce antique, Heidegger affirme sans réserve : “Herkunft bleibt Zukunft” (Provenance demeure à venir). Le Quadripartite, encore entendu Das Geviert montre la permanence des dieux malgré leur retrait provoqué par l’avènement du Dieu chrétien.
Pour tenter de découvrir comment l’art poétique permet de maintenir au cœur de chaque apparition de Dieu la divinité, nous essaierons d’abord de voir ce qu’est la divinité pour ces deux penseurs. Ensuite, nous découvrirons, avec eux, la figure de Dieu comme Père et la manière dont cette paternité est mise en image dans l’art et la nature. Puis, nous tenterons de comprendre en quoi le retrait de Dieu est manifestation de sa divinité comme l’illustre le Christ, ultime figure mais non exhaustive du Père qui nous promet à son tour l’Esprit, le Feu divin.
1. LA DIVINITÉ EN QUESTION : DE F. HÖLDERLIN À M. HEIDEGGER
Heidegger livrait sur Hölderlin ce précieux témoignage : « Hölderlin n’est pas pour moi un poète quelconque… Hölderlin est pour moi le poète qui fait signe en direction de l’avenir, le poète qui attend le Dieu » (M. Heidegger, 1935, p. 260). Partant, pour Hölderlin, Dieu est l’instance qui n’est pas encore là, c’est l’a-venir. Bernard Sichère (2008, p. 260), commentant Heidegger, souligne que « cette manifestée est à penser comme issue de Dieu lui-même, de Sa décision […] de se manifester à nous ». Confrontons la vision des deux figures pour mieux percevoir le point de convergence de leur conception de la divinité.
1.1. Dieu in “En bleu adorable”
Hölderlin est celui qui attend Dieu ou n’aperçoit de divin que dans l’attente de Dieu. Dieu n’est pas encore là. Le Dieu est celui qui est dans l’avenir ; il est celui qui vient et qui doit se manifester. C’est en ce sens que Hölderlin, dans son poème « En bleu adorable », aborde plus nettement la question de la divinité quand il se demande si Dieu ne se manifeste pas comme le Ciel ? Cela revient à dire que Dieu se manifeste au sein de l’étant comme ce qui, surmontant absolument tout étant, est invisible et inconnu. Dieu est l’Invisible qui prend figure. Il est l’Ailleurs absolu qui se délègue en une forme angélique ou céleste. Dieu est le Dieu caché, qui se délègue dans les demi-dieux qui le manifestent et qui sont les figures visibles du Dieu invisible. Il se délègue en même temps dans la lumière du Ciel, dans le Tonnerre, dans l’Eclair, dans la colonne de nuée au Sinaï. Ce en quoi il se délègue apparaît entièrement changé. En fait, il y a de l’Inconnu qui surgit au sein du Connu. Mais Hölderlin nous fait remarquer qu’en Grèce, les dieux se sont dérobés et même le Dieu chrétien lui-même s’est retranché loin de toute visibilité. Hölderlin, parlant des Célestes (désignation collective) ou des Anges, parle aussi du Dieu comme « Très Haut », « l’Ether » et « le Père » (§ 9).
Mais en fait, de quel Dieu s’agit-il ? De quel Père parle-t-il ? Il s’agit bien sûr du Dieu-Père qui est la référence signifiante permettant au sujet de ne pas sombrer dans le chaos. Toutefois, ce Dieu-Père se tient à grande distance vis-à-vis des hommes. Cette distance fait partie du mouvement du retrait. Mais ce Dieu-Père est en même temps un ami fidèle :
Dure la bienveillance toujours pure, L’homme peut aller avec le Divin se mesurer. Non sans bonheur. Dieu est-il inconnu ? Est-il, comme le ciel évident ? Je le croirais. Plutôt. Telle est la mesure de l’homme. Riche en mérites, mais poétiquement toujours, Sur terre habite l’homme. Mais l’ombre de la nuit avec les étoiles n’est pas plus pure, si j’ose le dire que l’homme qu’il faut appeler une image de Dieu (F. Hölderlin, 1977, § 2).
Dieu, de quelque manière qu’on l’approche, ne saurait donc être une puissance menaçante mais une puissance aimante. Dieu est Père qui soutient les hommes comme des enfants : « Lui qui, au tournant du temps, quand le sommeil nous gagne/ nous redresse et de lisières d’or/ nous soutient comme des enfants. » (B. Sichère, 2008, p. 270). Dans son poème “Pain et Vin”, Hölderlin portera plus notre attention sur le Fils de Dieu en la figure du Christ. Toutefois, le Christ n’est pas le Seul médiateur filial en qui l’Ether se délègue. Cependant, il l’évoque comme une figure accomplie du divin du seul fait qu’il reste poétiquement, voire esthétiquement envisageable. C’est sous la figure des dieux grecs déjà apparus et enfin disparus que Hölderlin, voit advenir le Christ comme la récapitulation plénière. Ainsi, entre autres dieux, Dionysos, Hercule et le Christ sont les Fils du Très-Haut pour Hölderlin :
Oui ils disent avec raison qu’il concilie le jour avec la nuit, Guide les astres du ciel éternellement s’élevant, déclinant. Joyeux en tout temps, comme le feuillage du pin toujours vert Qu’il aime, et la couronne qu’il a choisie de lierre, Car il demeure et apporte lui-même la lueur des dieux enfuis, Aux abandonnés de Dieu plongés dans les ténèbres. Ce que les chants des Anciens prédirent aux enfants de Dieu ; Vois ! Nous le sommes, nous ; c’est le fruit des Hespérides ! C’est merveilleux et exact lorsque cela s’accomplit en l’homme, Le croit qui l’éprouva ! Mais quoi qu’il advienne, Rien n’agit, car nous sommes insensibles, des ombres avant que notre Père l’Azur reconnaisse chacun et appartienne à tous. Mais jusque-là, vient comme porteur de torches du Très-Haut le Fils, le Syrien, parmi les ombres ici-bas (F. Hölderlin, Brot und Wein, 2008, § 9).
Dieu est donc Celui qui se délègue en maintes figures. Et comme toute figure se prête à une représentation, nous pouvons dire que la représentation fait des figures de Dieu, Dieu. C’est de cette représentation où Dieu se dit comme Père et que réalise la figure chrétienne de Dieu qui est la manifestation de la Divinité de Dieu dont seul l’art poétique rend possible. Il n’en va pas autrement pour Heidegger même si pour lui, la question du sens de l’être dont il se sert pour relire l’histoire de la philosophie ne dit pas être assimilé à Dieu. Autant l’être se voile et se dévoile autant Dieu est le « proche-lointain ». C’est-à-dire, le déjà là du pas encore.
1.2. « Herkunft bleibt Zukunft » : Provenance demeure à venir
C’est dans le déferlement technique contemporain que Heidegger constate la dédivinisation du monde. Il constate l’envahissement de nouveaux dieux non comme un refus des anciens mais comme possibilité d’accomplissement de la divinité de Dieu. C’est pourquoi dans l’énigmatique déclaration faite au Journal Das Spiegel en 1966 à savoir « Seul un Dieu peut encore nous sauver », se trouve récapituler tout le chemin de penser du penseur du sens de l’être :
Méditer sur le danger du Gestell ne revient pas à le dénoncer, au contraire fait-il aussi de la technè un prodigieux éloge comme appartenant à l’essence de l’homme ». La technique a réduit l’essence de l’homme en termes de « chose disponible » laissant à l’homme l’illusion qu’il la maitrise. D’où : « Le règne du Gestell signifie ceci : l’homme subit le contrôle, la demande et l’injonction d’une puissance qui se manifeste dans l’essence de la technique et qu’il ne domine pas lui-même […]. Seul un dieu peut encore nous sauver (M. Heidegger, 1958, pp. 9 à 48).
Pour lui, ce qui apparaît dans l’être est le retrait du divin, lequel n’apparaît que dévoilé. Cela, Heidegger le concevait dès les débuts de sa carrière sous la figure du Dieu chrétien. Au moment où il doit abandonner sa carrière de théologien chrétien au profit de l’inévitable questionnement sur l’être, c’est encore dans l’idée chrétienne du Dieu-Père que Heidegger reconnaît la figure sublime du Divin. Herkunft bleit Zukunft (Provenance demeure à venir) entend montrer qu’en face du déclin de la théologie de la « mort de Dieu » énoncée avec Nietzche, l’époque qui est la nôtre est incontestablement celle de l’attente de Dieu au sens d’une « Provenance à venir » : « Ohne diese theologische Herkunft wäre ich nie auf den Weg des Denkens gelangt. Herkunft aber bleibt stets Zukunft »[2] (M. Heidegger, 1959, p. 96).
Pour le penseur de l’être décidé à cerner le divin de Dieu, tout doit être en mesure de révéler le divin à l’exception de l’être, objet de la métaphysique, car Dieu est « sans être ». Si Dieu est, il ne se laisse point advenir. Seule une ontologie fondamentale le fait entrevoir à travers l’horizon d’une pensée finie, laquelle se dispose dans ce qu’il donne à voir de Lui-même. « Es gibt Sein » (ça donne l’être) devient inéluctablement « Es gibt Gott » (ça donne Dieu). La donation (Gegebenheit) originaire du divin se déploie dans son « Absence-présence » où ce qui dévoile le divin est le même qui le voile. Autrement dit, le phénomène divin ne devient manifeste que dans l’élucidation du couple voilement-dévoilement. C’est dans le Hölderlins Hymnen (GA Gesamensausgabe, 39) que le philosophe va le rappeler :
Celui qui dit avec sérieux : “Dieu est mort” et joue sa vie là-dessus, comme Nietzsche, n’est pas un athée. Ceux qui manipulent leur dieu et l’utilisent comme un couteau de poche sont bien les seuls à le croire. Quand on perd son couteau, il n’est plus là. Mais perdre son dieu signifie autre chose – et pas seulement parce que le dieu et le couteau de poche sont des choses de nature différente. L’athéisme est donc une chose très particulière ; car beaucoup de gens, qui restent prisonniers d’une confession traditionnelle qui ne les a jamais bouleversés parce qu’ils ont trop le goût de leurs aises ou trop d’habileté, sont plus athées que les grands douteurs. Le renoncement forcé aux anciens dieux, l’endurance de ce renoncement sont la sauvegarde de leur divinité (M. Heidegger, GA 39, p. 95).
La proximité avec la divinité de Dieu que recherche Heidegger est, avant tout, l’expression de la vie de foi que peut conférer tout rapport à Dieu. Il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que la provenance qu’il questionne ici reste bien son milieu social marqué à la fois par le catholicisme et le protestantisme. Le christianisme ne lui apparaît alors pas seulement comme un paradigme religieux. Il lui offre la religiosité par laquelle toute existence, quoique subsistant loin de Dieu, peut se mettre en chemin de pensée du divin :
Et qui voudrait méconnaître le fait que tout le chemin que j’ai parcouru jusqu’ici fut tacitement accompagné par le débat avec le christianisme, un débat qui ne fut pas et qui n’est pas un problème glané au hasard, mais la sauvegarde de la provenance la plus propre (…), et qui est en même temps le détachement douloureux de tout cela. Seul celui qui fut ainsi enraciné dans un monde catholique réellement vécu, aura quelque idée des nécessités qui ont influencé le chemin de mon questionnement parcouru jusqu’ici, telles des secousses telluriques souterraines (GA, 66, 1998, p. 415).
L’épreuve n’est donc plus celle de Dieu, mais la preuve du divin que délivre le christianisme. Une délivrance qui reste la provenance à laquelle le christianisme ne serait pas encore parvenu. A quoi aurait contribué alors les deux mille ans de religiosité manifestement élaborée. Avec le penseur du sens de l’être, on s’inscrit sur un chemin où l’être se donne. Aucun épisode de la vie de Heidegger n’est à délaissé pour comprendre l’a-venir de la provenance de l’origine (Herkunk) et dont le devenir s’origine dans le christianisme comme provenance et non pas ontologie.
2. L’A-VENIR DU DIVIN ENTRE PATERNITÉ ET DÉITÉ
Pour Hölderlin tout comme Heidegger, Dieu est le lointain le plus proche. C’est par le langage poétique qu’on le perçoit mieux. Ce langage tente de cerner la paternité comme la figure la plus rapprochée de Dieu qu’il faut concevoir pour aujourd’hui. Pendant que cette figure accomplie de divinité se réalise en terme de Paternité pour Hölderlin, Heidegger le pose comme Déité.
2.1. L’art au fondement de la Paternité de Dieu
Loin de faire une psychanalyse de la pensée de Hölderlin sur la figure du Père, comme le soutiennent certains auteurs tel que Jallet Gilles – parce qu’Hölderlin étant orphelin de père à l’âge de deux ans, avait en lui une image de Père qui a habité toute sa pensée et ses poèmes – nous pensons qu’il aurait une certitude d’un père qui a existé et qui continue peut-être d’exister. Pour nous, la figure de Père attribuée à Dieu, Hölderlin la tire de son retour à la tragédie grecque où la figure de Dieu-Père est bien présente. La question essentielle est de savoir qui est le Père pour Hölderlin ?
Il va lier la figure du Père à celle de Dieu dans son poème Qu’est-ce que Dieu ? « Inconnu, néanmoins/ Plein d’attributs est le visage/Du ciel, de lui. Les éclairs en effet/ sont la colère d’un Dieu. Plus un est/ Invisible. » (G. Jallet, 1985, p.18). Dieu est donc Invisible. Cela tranche radicalement avec sa représentation, car il n’y a que le visible qui soit représentable. Et qu’est-ce qui est représentable ? De quoi ou de qui parle l’art poétique ? Sûrement du divin qui n’est que l’acte et la sortie de Dieu. Le divin est la manifestation de Dieu. Si Dieu reste invisible, sa divinité est plus que visible. Ainsi, toute figure de Dieu, y compris celle du Père notamment, n’est qu’un appel à être du divin.
Le Père est invisible, Dieu est invisible. C’est pourquoi G. Jallet (1985, p.18) énonce la formule « Père = 1+1 ». Le visage du père au ciel reste encore invisible et Dieu demeure caché et donc les deux manquent toujours. Il faut le découvrir à travers la poésie et l’art. La figure du père est associée ou configurée à Dieu :
Nul plus que toi, d’entre les Dieux et les humains qui m’ont formé, /
Ne me fut, ô Ether, ô Père ! ami fidèle ; même avant/
Que ma mère m’eût pris dans ses bras, de son sein nourri, /
Tu m’entourais avec douceur, tu me versais un vin céleste, /
Le souffle saint avant tout autre chose dans mon naissant cœur. » (F. Holderlin, 2008, p. 83).
C’est donc le Ciel qui vient en aide et prend soin du poète, mais non sans orage, sans mélancolie. Et il revient au poète de tenir debout et ferme en son humanité pour saisir le contenu. Il faut, de fait, pour percevoir la divinité de Dieu comme certitude du divin toujours absent, habiter le monde en poète :
Mais c’est à nous pourtant qu’il appartient de rester debout, tête nue, ô Poètes ! Sous les orages de Dieu, de saisir de notre propre main le rayon du Père, l’éclair lui-même, et de tendre aux foules, sous le voile de chant, le don du Ciel. Que notre cœur, comme un cœur d’enfant, soit pur, que soient nos mains vierges de faute, le Rayon du père, le pur éclair ne nous brûlera point. Et dans son ébranlement suprême, sa douleur à la douleur unie d’un dieu, le cœur éternel restera à jamais (G. Jallet, 1985, p. 20).
Ce don du ciel est bien l’expression dont même le retrait du père n’a pas altéré l’action. Le père en retrait reste éternellement vivant par les différentes mises en image de sa figure. Chacune de celles-ci doit en être l’expression de sa déité.
2.2. La déité ou l’art de Dieu
Le Quadripartite encore entendu das Geviert est l’un des textes majeurs qui cherchent à justifier cette harmonisation du divin et de l’humain. « Vier » est la désignation allemande du nombre cardinal quatre, et « Ge » indique un rassemblement. Geviert serait alors le participe passé du verbe Viere, quadro en latin dont le sens évoque la possibilité de former un « ensemble harmonieux, un carré parfait ». D’où le substantif das Geviert sert à Heidegger en un sens singulier pour désigner « l’entièreté du monde » dans son rapport à l’Ereignis. Autrement dit, « lorsque résonne le mot Geviert, tout (les mortels et les divins, la terre et le ciel) doit donc être entendu comme advenant à soi à partir de l’Ereignis : als Ereignete » (M. Heidegger, GA 14, 51). Toute « Chose » qui advient ou se manifeste, fait advenir l’être : « Le quadriparti uni du ciel et de la terre, des divins et des mortels, qui est mis en demeure dans le déploiement jusqu’à elles-mêmes des choses, nous l’appelons le Monde » (M. Heidegger, Q.IV, p. 76). Ce n’est que dans l’unissonance du monde que le mortel peut déployer la responsabilité du sacré, das Heilige.
Françoise Dastur identifie ce « Indemne » (le Sacré) comme « cette éclaircie du monde au sein de laquelle seules toutes choses, et Dieu lui-même, peuvent s’annoncer et accéder à l’apparaître ». (F. Dastur, 2011). C’est là la loi primordiale de l’être manifestée depuis les Grecs en passant par la scolastique entre les couples d’opposés, être et devenir, être et apparence, être et penser, être et devoir.
C’est dans les Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) que s’illustre nettement cette prépondérance du Dasein à faire coordonner les quatre éléments pour l’avènement de l’être : « La relation du Da-sein (écrit volontairement avec un tiret) à l’Être appartient au déploiement de l’Être (die Wesung des Seyns) lui-même, ce qui peut aussi se dire ainsi : l’Être requiert le Da-sein et ne se déploie pas sans cette venue à soi (Ereignung) » (M. Heidegger, 1964, p.135). On comprend ici que le Dasein ne répond plus aux attributs de l’homme soumis à la subjectivité métaphysique. Il participe de lui-même à l’avènement du « Quadriparti » : « les hommes, les dieux, la terre et le ciel ». L’arrière fond théologique de cette considération des quatre éléments, le divin inclus, vise à une pensée de l’être du divin ou plus précisément du divin de Dieu comme le précise Darwiche Frank : « Le divin n’est pas tout simplement en vis-à-vis, et dire de celui-ci qu’il n’a rien d’une réflexion objectivante ni d’une simple présence ne suffit pas. Le divin qui donne le dire depuis le Sacré des lieux instituant le monde mondant par le Geviert n’est pas seulement dans le vis-à-vis que permet l’Unter, il est aussi dans la proximité (Nähe), auprès de chacun des quatre » (F. Darwiche, 2009, tome 134, p. 309-332).
L’affrontement entre terre et monde (Streit) qui s’ensuit comme préfiguration du « Ge-Viert », (GA 5, 32), justifie combien la moindre « chose » qui cherche à questionner le monde doit faire nécessairement évoquer dans un ensemble inséparable le Geviert, terre et ciel, les divins et les mortels : « Lorsque nous regardons le ciel, nous pensons le divin ; lorsque nous nous tournons vers la terre, nous pensons le divin ; lorsque les dieux nous parlent, nous pensons le divin ; lorsque nous prenons garde à l’homme dans son Dasein, nous pensons le divin. Le divin est toujours déjà à côté de chacun des quatre dans l’intimité (Innigkeit) de la proximité (Nähe) » (H. Birault, dictionnaire Heidegger, 2013, art. Dieux).
2.3. L’art, figure accomplie du divin : L’Esprit du peuple en question
L’art est l’expression de la spiritualité d’un peuple. M. Heidegger ne le dit pas explicitement. Cependant, il ne le pense pas moins. C’est dans cette vision hégélienne de l‘art, où le christianisme accomplit l’esprit spirituel de l’Occident, que l’on découvre aujourd’hui l’art africain dont Souleymane Bachir Diagne, à la suite de Léopold Sédar Senghor, révèle l’enjeu à la fois religieux et spirituel. Ainsi, toute la richesse artistique de l’Afrique s’imprègne et prend sa source dans la religiosité. Cette œuvre est inépuisable. Et ce qui la caractérise, c’est qu’elle a toute sa valeur dans son milieu de naissance. Ceci, parce que : « hors de son milieu, retiré de son contexte, non seulement géographique mais aussi social, l’objet perd son identité culturelle ».
L’auteur poursuit et montre que « de la panoplie du “colonial” au mur du “collectionneur” associé aujourd’hui à l’art contemporain, on tend à oublier la relation de l’objet africain avec son milieu d’origine, faisant abstraction de l’évidente implication ethnologique ». Cet art reste encore bien inconnu et par les Occidentaux et par les africains eux-mêmes. Art rituel, l’art religieux africain est fortement empreint de valeurs symboliques avec une absence prononcée d’un style décoratif. Relevant de la croyance religieuse de l’artiste, il est constaté que toutes les œuvres ou du moins tout objet d’art de l’Afrique relève de l’animisme et n’a de sens que lorsqu’il est remis dans ce contexte des croyances et des cérémonies au service desquelles il est :
[…] le masque a un effet esthétique direct, indépendant de toute association d’idées, en raison de sa forme, et de la combinaison de ses parties. Les yeux sont des cercles grossiers, irréguliers, nettement soulignés, la lèvre supérieure énorme en forme de demi-cercle les relie à la bouche et en fait une série rythmique qui est constituée jusqu’au-dessus des yeux. La lèvre inférieure, droite, horizontal, forme un contraste et relie la bouche à la base du nez et aux lignes horizontales du front, ouvrant ainsi une nouvelle série de rythmes. Le nez, une pyramide aux arêtes vives, se répète dans les cônes côtelés qui forment les cheveux barrant le front. La crête verticale qui surmonte le nez le relie aux cheveux formant un pont au travers d’un espace qui, autrement, serait vide, et contrebalance la masse épaisse des traits du bas de la figure. Il se joint au nez et à la bouche pour former un dessin cunéiforme subordonné au reste : à droite et à gauche de ce coin, et en résultant, on trouve deux plans en forme de bouclier ; chacun d’eux est percé par un œil et constitue une version réduite du contour total de la figure. Ces rythmes opposés impressionnent l’œil et l’esprit comme une série de chose puissants réitérés sous forme de lignes, de sillons, de creux grossiers, alternant avec des intervalles adoucis, comme des éclats de tambours et de cuivres en musique. Distribuée, espacée, opposée fortement ou incorporée à une autre par la répétition du thème, chaque forme donne son effet esthétique total, le pouvoir de l’ensemble est rendu cumulatif et constitue comme un foyer en vertu de l’unité du plan (S. B. Diagne, 2007, p. 65).
Ainsi, se confond le sens que donne Jean-Luc Marion au sujet de l’idole et de l’icône dans son ouvrage Dieu sans l’être (1982). L’idole et l’icône ont un sort commun à partir du terme grec “eidôlon” qui signifie Image, Représentation, Imagination et qui en français donne idole. Par voie de conséquence, nous trouvons pour notre part, que la vérité philosophique de l’art africain ne saurait se trouver dans le rythme tel que le pense Léopold Sédar Senghor mais plutôt dans cette relation métaphysique du visible à l’invisible mettant en symbiose l’idole et l’icône. Léopold voulut montrer en effet, le caractère fonctionnel de l’œuvre d’art, partant de l’image analogique du rythme pour affirmer que l’art africain participe d’un « monde mystico-magique ». Ceci n’est rien d’autre que le reflet de l’Esprit du peuple. L’Esprit est la forme réalisée de la paternelle figure hölderlienne du divin. Heidegger qui conteste l’idée de Révélation, ne rejette point l’enjeu chrétien de Dieu que seul l’Esprit rend manifeste.
Cet Esprit est un don promis par le Fils[3] (cf. Jn. 14, 16). Et Hölderlin le souligne nettement quand il parle de l’Esprit comme une flamme reçue : « Du Divin, nous avons reçu beaucoup. La flamme en nos mains fut remise. » (G. Jallet, 1985, p.157). Il est ce feu que nous devons aller chercher en Grèce pour le faire revenir au pays natal : le feu de Dieu. « Cherchant, cherchant la vie, tu vois jaillir brillant un feu divin profondément hors de la terre, et toi, avec ton effrayé désir, tu t’abîmes dans la fournaise de l’Etna. » (G. Jallet, 1985, p. 89). L’Esprit, selon Hölderlin, nous fait nous découvrir nous-mêmes. Il œuvre là où l’homme est en quête du bien plus haut. C’est dans cette écumante fournaise de l’Esprit que le poète doit être sacrifié avant de pouvoir dire Dieu. Et c’est encore l’Esprit qui parachève l’image du Christ qui peut s’éloigner au ciel et continuer à régner du ciel sur la terre. « Tel il m’apparaît, ce bien de l’heure où, son image parachevée, le Maître, pour finir, de son chantier lui-même, par elle illuminé, s’éloigne, le Dieu silencieux du temps, et où la seule loi d’amour, Splendide également, règne d’ici au ciel. » (G. Jallet, 1985, p. 158). Mais si le vrai poète est le philosophe dans la mesure où il parvient à donner une herméneutique vraiment phénoménologique de l’existence et de la vie, comment comprendre que l’approche artistique du divin ou encore que l’élucidation de la divinité de l’art requiert une existence qui se veut poétique ?
3. « HABITER LE MONDE EN POÈTE » : DE L’ART DU DIVIN À LA DIVINITÉ DE L’ART
Hölderlin l’a évoqué (Poème). Heidegger l’a montré (Essais et Conférences) : « Ce n’est qu’en poète que l’homme habite la terre ». Si l’art est la forme la plus sublime d’expression du divin, lui seul encore fait apparaître le sens de Dieu pour l’être-au-monde. Il revient à celui-ci dont la forme accomplie se dit à l’aune du Dasein heideggérien de vivre en poète sur la terre afin de rester constamment connecté au divin. L’artiste devient le génie, car l’ingéniosité nous rapproche du divin ; lequel est manifeste dans sa lointaine proximité.
Dans son poème, En Bleu adorable, Hölderlin aborde la figure de l’Ether qui s’adonne et s’approche en bleu devenant ainsi adorable. Cette adoration de l’Ether se rapproche de celle des mystères du Père. Le discours poétique s’articule autour de constitutions réciproques qui donnent naissance à une vie calme (ein stiller Leben). Pour Hölderlin, la vie des hommes est une image de la divinité : « Qu’est-ce donc que la vie des hommes ? une image de la divinité ». (Hölderlin cité par G. Jallet, 1985, p. 176). Cette vie provient de la vie calme des dieux. C’est dire que la vie prend figure de ce dont elle résulte. Mais la mise en image de cette figure de vie revient à l’homme. « Lorsque se distingue tant la figure, une mise en image ressort de l’homme. » (J-L. Marion, 1977, p. 111). Hölderlin va indiquer qu’à partir de la figure, une image de l’homme devient possible. Cette possibilité de mettre en image une figure est la propriété de l’homme.
L’art reste une œuvre humaine. L’homme peut apparaître dans et comme une image. Kant l’abordait déjà dans sa doctrine de l’imagination transcendantale qui est le pouvoir qu’a l’homme de mettre en image ou en scène, sans effet ni tromperie, l’essence même de la chose. (Cf. J-L. Marion, 1977, p. 166). Cette dimension de l’art, qui dit l’humain, Hegel l’a bien signifié et Stéphane Vial, parlant du numérique comme Art contemporain, atteste le caractère ontophanique de l’art. Hölderlin y voit l’apparition de l’homme qui, aux yeux de J.-L. Marion (Op. cit., p. 111) « puisse prendre figure en une image comme on prend (ou non) racine en un sol ». Cette mise en image révèle la Beauté qui renvoie à la « puissante, belle divinement, la Nature » (F. Hölderlin, F. 118, 12)
Mais comment l’homme réussit-il à dire la Beauté de la Nature, divinement belle ? Pour Hölderlin, c’est par l’art que l’homme dit la nature. L’art imite la nature. Ainsi, le poète liant la beauté de la nature à la pureté, imite cette nature. Hölderlin pense que cette imitation de la nature par l’art est comme un achèvement de l’œuvre de la nature. « D’un côté, l’art mène à son terme ce que la nature est incapable d’œuvrer, de l’autre, il l’imite. » (Aristote, Physique, II, 8, 199a. 15-16). L’art vient de la nature qui s’avance par l’art. La nature ne devient divine que par sa liaison avec l’art. La nature et l’art comblent réciproquement leur lacune, ce qui leur est nécessaire pour être tout ce qu’ils peuvent être. Le divin est alors entre ces deux achèvements :
Il y va du divin que la pureté puisse achever sur son mode ce que la beauté sur le sien, atteint. La beauté achève “nativement” ce que “culturellement” relève la pureté. Plus précisément, le “retournement natal” délivre culturellement le pouvoir qu’à l’art de relever la nature, en l’établissant dans sa vérité : l’art lui-même nous ouvre le chemin vers ce qui nous reste de plus natal. » (J.-L. Marion, 1977, p. 113).
Dans L’origine de l’œuvre d’art, Heidegger tente de montrer cette réalisation de soi dont l’art seul a la performance et la sensibilité. C’est le renforcement d’une problématique déjà énoncée dans Approche de Hölderlin. L’art poétique pour Hölderlin ouvre le chemin du retour au natal (M. Heidegger, p. 43-61). La pureté, en fait, pour Hölderlin, est cette justesse sûre qui autorise la vision qu’a l’artiste de la nature. Mais la beauté de l’art comme achèvement du naturel est outrepassée par le geste qui désigne la beauté. Ce geste est « le geste d’art, plus natif, “en son retournement natal” que le natal naturellement né. ». Hölderlin ira plus loin en assimilant la nature au dieu grec Saturne et l’art à Jupiter.
En son poème, Saturne et Jupiter, Hölderlin parle du Fils de Saturne comme jouissant de l’art immortel du Souverain qui avait chassé l’Aïeul Sacré, le Père, tandis que Jupiter – et donc l’art -, est traité de maître sage à entendre, “fils comme nous” et de législateur. « Je te connaîtrai là, Jupiter ! et je saurai t’entendre, maître sage, fils comme nous du Temps, toi le législateur, toi qui des ténèbres sacrées dévoiles les mystères. » (In. G. Jallet, 1985, p. 122). Le poète est donc comme Jupiter. L’art poétique fait des dieux et de l’homme, fils de la même race. Le rapport Dieu et art éclaire le fait qu’il s’agit ici du divin de Dieu. Car l’art poétique ne vise pas la représentation, mais le Représenté. C’est pourquoi pour M. Heidegger, dans son texte de 1955 : Das Gewiert ou le Quadriparti, Dieu est l’inobjectivable et seul l’homme habitant sa terre natale comme poète peut rejoindre le Représenté. Retenons donc que le Dieu qui s’octroie en figures diverses, dans la visibilité, c’est aussi ce Dieu qui se met en retrait.
Conclusion
L’homme étant image de Dieu et mettant en image la figure de la nature par l’art, nous comprenons que pour Hölderlin et Heidegger, il y a une coïncidence de la figure et de l’image. Cette coïncidence suscitera l’effroi par le caractère Sacré des images. Cet effroi contredit la description de l’image. Car décrire l’image, c’est dire le surgissement de l’invisible à la visibilité. Mais cet effroi, l’homme doit l’endurer tout en accueillant poétiquement l’image. « L’épreuve de l’image, l’homme doit l’endurer en “imitant” les célestes, puisqu’il tient d’eux son image à l’image de la divinité » (J-L. Marion, 1977, p. 115). L’homme, devant donc imiter les célestes et les divins dans leur joie et leur bonté, se mesure à eux sans infortune. Ainsi les célestes, tout en subvenant à la pureté de l’homme, demeurent à distance. Et ce retrait de l’invisible accueille le visible qu’est l’homme. « Le retrait des dieux devrait peut-être s’entendre d’abord ainsi : discrétion qui laisse venir, “l’attend voir” et donne distance à la chose » (J.-L. Marion, 1977, p. 116).
En somme, pour que l’homme puisse prendre figure dans une image, il a fallu le retrait de la divinité. Ce qui implique, selon Hölderlin, une prise de distance, un retrait de la part de l’homme par rapport à l’invisible. En clair, pour Hölderlin tout comme Heidegger, l’évidence de Dieu est dans ce retrait. Dans son poème, le Vatican, il écrivait : « garder pur et avec discernement, Dieu, c’est ce qui nous est confié » (Hölderlin, 252, 12/13). Et à M. Heidegger de renchérir en ces termes : « ce n’est qu’à partir de la vérité de l’être que se laisse penser le déploiement de l’être du sacré et ce n’est qu’à partir de l’être du sacré que peut être pensé le déploiement de l’être de la déité, à la seule lumière duquel peut être pensé et dire ce que doit nommer le mot Dieu » (M. Heidegger, 1963, p.294). Autrement dit, si Dieu est confié à l’homme, toute l’œuvre de l’homme, ou mieux, tout l’acte de philosopher ou de théologiser doit pouvoir contribuer à dévoiler, voire révéler l’être de toute chose et du tout, dans sa réalité holistique et englobante.
Références bibliographiques
ALLEMANN Beda, 1987, Hölderlin et Heidegger, Paris, PUF.
BERMAN Antoine, 1984, L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard.
BREHIER Emile, 2004, Histoire de la philosophie, art. Schelling et les Romantiques, Paris, PUF.
DASTUR François, 2011, Heidegger et la pensée à venir, Paris, J. Vrin, coll. « Problèmes et controverses ».
DARWICHE Frank, 2009, « Le divin (Göttliche) au cœur du quadriparti (Geviert) », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 3/2009 (tome 134).
DIAGNE Souleymane Bachir, 2007, Léopold Sédar Senghor, L’art africain comme philosophie, Paris, Essai, Riveneuve.
HEIDEGGER Martin, 2001, Approche de Hölderlin, traduction française, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1962, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1988, Les hymnes de Hölderlin : la Germanie et le Rhin, traduction française, Paris, Gallimard.
HEIDEGGER Martin, 1955, Hölderlins Hymnen. “Germanien” und “Der Rhein”, Fribourg, Klostermann.
HEIDEGGER Martin, 1959, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, Neske.
HÖLDERLIN Friedrich, 1977, « En bleu adorable », trad. de André du Bouchet, in Œuvres, Paris, Bibliothèque de la Pléiade.
HÖLDERLIN Friedrich, 2008, Brot und Wein, traduction française de Patrick Guillot, Paris, Pléiade.
GREISCH Jean, 1983, Hölderlin et le chemin vers le sacré, Paris, CAHIER DE L’HERNE.
JALLET Gilles, 1985, Hölderlin, Seghers, Paris.
MARION Jean-Luc, 1977, L’Idole et la distance, Paris, Grasset.
SICHERE Bernard, 2008, L’Être et le Divin, Paris, Gallimard.
ZWEIG Stefan, 1983, Le combat avec le démon, Paris, Belfort.
DÉCHOIR SPIRITUEL DU MONDE ET DÉSIR DIVIN : L’HÉNOLOGIE PLOTINIENNE COMME SORTIE DES CRISES EXISTENTIELLES
Kouakou Marius KOFFI
Université Alassane OUATTARA, (Côte d’Ivoire)
Résumé : Le déchoir spirituel du monde est la résultante des crises qui affectent son bon fonctionnement par la démesure de l’avoir ; ce qui complexifie le rapport Homme-Dieu, par un oubli de celui-ci. Le sens de la crise moderne actuelle met en lumière la rupture d’avec le divin, et sa substitution par l’humain, dans un absolutisme de la rationalité, d’où le déchoir spirituel. Conscients de cette crise spirituelle et scientifique, l’hénologie plotinienne suscite la restauration du divin en soi, pour une existence authentique et un développement, image de la présence divine, pour un équilibre social, moral et spirituel.
Mots-clés : AVOIR, DÉCHOIR SPIRITUEL, DIEU, DÉSIR DIVIN, HÉNOLOGIE.
Abstract : The nowadays world spiritual decay is just the result of the crisis that affects its normalisation by the overestimation of personal gains and that complexifies the relationship Human-God by the oversighting of God. The nowadays modern crisis strength highlights the breaking off with God and his sustitution by human people in an absolutism conception of the reason. Hence, the spiritual decay. Knowing that spiritual and scientific crisis, the plotinian henelogy calls for divine restoration through everyone for authentic existence and personal develloppment, proof of divine existence for social, moral and spiritual balance.
Keywords: SPIRITUAL DECAY, DIVINE DESIRE, GOD, GAIN, HENOLOGY.
Introduction
La question de la quête d’un principe primordial demeure l’une des préoccupations fondamentales du savoir philosophique. À bien y voir, c’est cette exigence qui a attisé la curiosité et l’intellect des philosophes milésiens ou présocratiques, des post-socratiques comme les néoplatoniciens jusqu’à cette époque contemporaine dont l’esprit techno-scientifique semble évaluer l’essence des rapports individuels et collectifs. S’il faut accorder une valeur essentielle au statut du progrès technique par l’entremise des Lumières ou «Aufklärung » (Horkheimer et Adorno, 1974, p. 23), la philosophie se devrait de reconsidérer le sens principiel de son odyssée qui visiblement est détourné de sa vocation primitive, celle d’une quête de l’Un, le Bien, l’Être ; voire la transcendance.
Or, ce détour a malencontreusement confondu le principe spirituel et transcendantal à l’homme dans une apologie démesurée de la rationalité. Ainsi, en lieu et place au divin, l’homme s’est autoproclamé suprême par ses productions dont le fruit est parfois la domination de la nature et l’autre, d’où l’idée des crises existentielles. N’est-ce pas le lieu de s’accorder avec Alain Touraine ? « La modernité a rompu l’unité du monde ancien à la foi rationnelle et sacrée. Elle a chargé la raison de découvrir les lois du monde et la conscience de faire apparaitre un sujet qui n’était plus divin, mais humain » (Touraine, 1992, p. 9). Ce point de vue laisse éclore l’urgence d’une reconfiguration du monde comme fondement, éthique des découvertes et harmonie sociétale pour une vie pacifiée et équilibrée. C’est justement là, toute la substance de l’hénologie plotinienne. Car l’humanité est en proie aux conflits et demeure incapable de contrôler totalement l’outil technique qui initialement fut conçu pour son bien-être. Il y a donc crise en raison des dérives que connaît l’humanité par le mauvais usage de la chose technique :
Il suffit de se souvenir des bombes atomiques lancées en plein XXe siècle, comme du grand déploiement technologique étalé par le nazisme, par le communisme et par d’autres régimes totalitaires au service de l’extermination de millions de personnes, sans oublier, qu’aujourd’hui, la guerre possède des instruments toujours mortifères (François, 2013, n°102).
Ces faits probants témoignent avec insistance que le monde est en dégénérescence culturelle et sociale par la nescience de l’Absolu. En réalité, un recours et retour au divin s’insurge comme une voie rééducative des consciences par rapport à la sacralité de la vie, du bonheur et du bien-être d’autrui.
Toutefois, l’on pourrait se poser la question de savoir ce que vaudrait une métaphysique hénologique dans un péril pareil. C’est le lieu de faire mention de ce que cette hénologie plotinienne est avant tout une conduite morale ouverte à l’autre et le monde sous l’impulsion de l’Un. Dans une telle perspective, la reformulation du sujet revient à ceci : demeurer dans l’ouvert de l’Un transcende les crises existentielles. À ce niveau surgit l’interrogation de savoir l’enjeu de l’hénologie plotinienne dans un monde en déchéance spirituelle. De cette question capitale surviennent les préoccupations suivantes : Quelle est la genèse du déchoir du monde ? Comment appréhender l’éthique plotinienne comme renouvellement du monde ? En quoi l’hénologie plotinienne constitue le socle d’un humanisme social ?
Ces préoccupations animeront le débat sur la valeur d’une réflexion mettant en exergue le bienfondé d’une existence rationnelle basée sur les impératifs de l’hénologie plotinienne.
1. DU DÉCHOIR DU MONDE
Porter à réflexion le « déchoir du monde » est porteuse de préoccupations relatives au bien-être de l’humanité. Si le déchoir en vient à s’ériger en thématique d’envergure, force est de méditer en direction d’un questionnement nouveau. Pour y parvenir, nous mettrons en lumière les exigences spirituelles du déchoir comme oubli du divin premièrement, puis secondairement, l’origine sociale ou matérielle du déchoir du monde. Cette origine est la portée sociale du déchoir comme culte absolutiste de l’avoir dans le monde.
D’un point de vue général, aborder le déchoir du monde comme question immédiate évoquée par le philosopher plotinien poserait problème. En effet, eu égard des différences d’époques, de siècles et de paradigmes qui nous sépare de Plotin, il n’est pas aisé de poser ouvertement le déchoir spirituel, comme une thématique centrale abordée dans la pensée plotinienne. Toutefois, pour aborder la question, et surtout, ce qui nous faciliterait la filiation de son époque à la nôtre est assurément l’oubli du divin et le culte de l’avoir comme sens immédiat de cette déchéance. Aussi faut-il faire mention de ce que l’anachronisme sera un outil favori dans notre démarche. Abordons-le déchoir du monde comme déchéance spirituelle.
Ainsi, l’idée du déchoir spirituel du monde est semblable dans la pensée plotinienne à l’oubli de l’Un dû à la métaphore de l’audace de l’âme. Qu’est-ce donc que l’audace ? L’audace, dans la philosophie plotinienne, est la capacité qu’a l’âme de s’éloigner de Dieu ou l’Un, son père dans un processus d’autonomie : « Le principe du mal pour elles, c’est l’audace, la génération, la différence première, et la volonté d’être à elles-mêmes » (Plotin, 1931, V, 1, 1). Et pourtant, immature, mais dans une nécessité naturelle, l’âme s’éloignera de l’Un. C’est dire que dans leur nature, suite à un souci d’émancipation par rapport à leur patrie, leur état de tutelle, les âmes ont décru par migration vers un autre ailleurs.
Dans une volonté d’autodétermination, les âmes ont émané du principe divin dans une décroissance pour terminer leur chute dans le non-être en se détournant du divin : « L’âme fornique, quand elle se détourne de vous et cherche en dehors de vous ce qu’elle en trouve, pur et sans mélange, qu’en revenant à vous » (Augustin, 2018, Livre II (II, II, 14). Cette pensée augustinienne témoigne de ce qu’en soi, la chute de l’âme est le revers du péché d’un détour du divin. Or, ce détour est l’image visible de son évolution dans la société. Ce qui sous-entend que ce dysfonctionnement interne ou déchoir affaiblit considérablement l’humanité parce qu’elle s’est détachée de Dieu.
Aussi, cette déchéance idée peut trouver un écho favorable dans la pensée de Michel Fattal en ces termes : « C’est cette émancipation de l’Altérité à partir de l’unité primordiale, c’est ce surgissement d’une vie indéterminée qui se verra déterminée par l’Un qui est appelé par Plotin “ audace’’ ». (Fattal, 2016, p. 22). Dans un éloignement de la patrie, l’âme ; mieux les hommes ont rompu avec le divin. Dans cette rupture, ils ont perdu le véritable sens de l’orientation. En fait, l’action séparatrice, niant en soi la valeur et l’enjeu divin deviennent un préalable aux crises dans l’intériorité humaine. Et cette crise interne est aux yeux de Plotin l’ouverture aux crises hors de soi qui pullulent dans les pays, notamment avec le comportement des uns à l’égard des autres: « Le premier fit son choix en allant tout droit vers la tyrannie, et que par manque de sagesse que par cupidité, il n’examina pas suffisamment toutes choses avant de faire son choix ( Platon, 1966, 619 c). Cette migration vers cet ailleurs est l’instant d’une chute dans la matérialité corporelle. N’est-ce pas le souci de cette déchéance spirituelle qui convoqua Heidegger à brandir le retour à l’Être ?
À la suite de Plotin, Heidegger rattache le déchoir du monde à l’oubli de l’Être. Avec lui,
Effondrement et dévastation trouvent l’accomplissement qui leur convient, en ceci que l’homme métaphysique, l’animal rationale, est mis en place (fest-gestellt) comme bête de labeur. Cette mise en place confirme l’extrême aveuglement de l’homme touchant l’oubli de l’Être (Heidegger, 1958, p. 82).
La déchéance humaine est partant du monde est du ressort du déséquilibre en soi, responsable de la perte des valeurs spirituelles susceptible de conduire l’homme à agir avec assez de lucidité. Par conséquent, cette vie déchue ne présage souvent que souffrance en raison d’une faillite de la raison humaine dans le choix libre et volontaire de l’âme de connaître d’accorder plus de valeurs aux réalités mondaines au détriment des plus essentielles la conduisant à la ruine. Michel Charrue soutiendra ce point de vue en affirmant ceci : « On parlera de chute, lorsque cette âme à péché ou s’est laissée entraîner par lui au corps dans cette vision de type religieux ou bien sinon, de la descente » (Charrue, 2014, p. 73).
La chute, symbolique de la déchéance spirituelle est dans une certaine compréhension, le point de la crise qui mine le quotidien dans la mesure où l’essence à fait place à la matérialité dont le corps représente la véritable incarnation visible. Cette chute est le mal ou le péché dans la vision de Charrue, car la descente conduit l’âme dans un corps, ce qui ne lui permet pas toujours de mener à bien son existence, vu que le plaisir des choses d’ici-bas sera sa convoitise. Le monde, sujet de ce déchoir spirituel peut donc vouer un culte à l’avoir. Cela dit, l’avoir, au-delà de l’être semblera caractériser véritablement l’âme déchue. À présent, abordons la déchéance sociale ou problème de l’avoir.
La question de l’avoir est assez souvent pensée dans une relation intime avec celle de l’être, si bien que le rapport de l’avoir et l’être s’assimilerait à une dialectique animant l’existence humaine, quant à sa subsistance matérielle et sa filiation spirituelle. En d’autres termes, le nœud de l’avoir et de l’être contribue à porter avec hauteur, les conditions préalables de la dépendance des biens matériels, comme épanouissement et la nécessité d’un apport spirituel, pour le bien-être de l’être humain dans un monde technicisé. Mais avant, quel contenu attribuons-nous à l’avoir et l’être dans cette activité réflexive ? Disons qu’au-delà d’un verbe, avoir indique dans notre réflexion, l’ensemble des actions, des dépendances et de faits dont l’acquisition procurerait du bonheur à l’homme. Et pourtant, cette acquisition d’avoir rimant avec accumulation matérielle ne serait vraisemblablement pas la solution.
Schopenhauer soutient que « ce monde de créatures misérables, condamnées pour vivre un instant, à passer leur existence dans l’angoisse et le besoin, à endurer souvent d’atroces tortures jusqu’au moment où elles tombent enfin dans les bras de la mort » (Schopenhauer, 2014, p. 381). Cette triste peinture schopenhauerienne du monde et de l’existence, laisse entrevoir un problème fondamental, celui de l’exister. En d’autres termes, quelle est la valeur de l’exister dans un monde de déchirement, d’angoisse et de torture ?
La rationalité semble avoir perdu de sa splendeur, pour légitimer l’irrationalité et le privilège de l’avoir, au détriment de l’être. Cette dépendance incontrôlée et mal orientée de l’avoir met l’humanité en crise par le mauvais usage de la volonté dans l’entendement schopenhauerien et conduit inlassablement le monde, dans les bras de la mort. Cette mort symbolisant la perte des valeurs humaines et existentielles gouverne les sociétés actuelles. En effet, cette gouvernance de la modernité dominée par le progrès techno-scientifique occulte ainsi, la dimension spirituelle, d’où la question du problème de l’avoir comme origine de la déchéance matérielle.
Porter donc une intellection sur le problème de l’avoir mérite quelques éclaircis. En effet, le présent cheminement ne se pose pas comme une critique radicale de l’avoir sous toutes ses formes, mais plutôt, interroge l’accumulation et les dérives de l’avoir mettant en péril le bien-être religieux et social des hommes. Il est subséquemment question des dérives de la raison dans son commerce avec l’avoir favorisant sa déchéance. Avec Plotin à nouveau, il est possible de poser l’une des raisons du privilège de l’avoir et de la perte de la valeur divine par l’idée d’une copie dégradée du monde essentiel, entendu comme le meilleur agir sous le couvert du divin :
La vie actuelle, quand elle est sans dieu, n’est qu’une trace ou image de la vie de là-bas ; cette vie idéale, c’est de l’intelligence, et par cet acte, elle engendre les dieux en restant immobile grâce à son contact avec l’Un ; elle engendre la beauté, la justice et la vertu. L’âme fécondée par Dieu est grosse de tous les biens, et cette fécondation est pour elle le commencement et la fin (Plotin, 1938, VI, 9,9).
Si dans la vie actuelle, sous les exigences plotiniennes, les hommes en viennent à agir de telles sortes qu’ils semblent confondre la beauté, l’ordre, la justice, pour nourrir et exhiber leurs désirs et goûts effrénés pour les choses matérielles dont l’avoir est la pale représentation privilégiée, c’est en raison d’une perte de repère de l’être ou faveur du divin et de ses avantages dans leur vie. Tout se déroule comme si la raison, poussée à son extrême tend à faire disparaître les données spirituelles et divines au profit de sa démesure. Tout comme Plotin et conscient de ces graves dérives du siècle, Antoine Kouakou peut s’initier dans cette critique rationalisée de la décadence existentielle par le problème de l’avoir, en affirmant avec souci, que l’homme « tombe dans une politique de l’avoir rimant avec l’accumulation » (Kouakou, 2007, p. 22). L’enjeu de la déchéance matérielle des existants est l’accumulation des biens sans une intelligence susceptible de les orienter vers l’utile et l’agréable. Cela est d’autant plus capital, lorsque, dans la sphère des gouvernances, l’inégalité de la répartition des richesses demeure une gangrène, si bien qu’une minorité s’accapare l’ensemble des richesses. En effet, l’accumulation des gains pour soi, au détriment du bien-être des autres est un fait constatable et décrit avec loisir, le problème pernicieux de l’homme moderne, celui de l’avoir.
L’homme actuel, loin de se laisser infuser par Dieu afin de gérer minutieusement l’intérêt général, a sombré dans la corruption. C’est pourquoi, en guise d’anticipation à ce fléau lié à l’excès concernant la crise du monde actuel plongé de plain-pied dans la modernité, que Vincent Holzer soutient que
La question de la modernité est une question sotériologique sous un rapport précis : la déconnexion entre la singularité d’un fondement qui porte non seulement une représentation (Vorstellung) mais une effectuation salvifique de l’universel, et un universel qui distend de plus sa relation avec le fondement doctrinal auquel il demeure relié par une recomposition de la fonction qu’exerce ce référent doxique (Holzer, 2017, p. 346).
Holzer assimile la modernité à une sphère dont l’exigence est sotériologique et se devrait de maintenir une consubstantialité avec le fondement doctrinal qui dans le fond semble se poser pour elle comme lanterne. Si s’accorder avec lui est une lumière, cela revient à s’appuyer sur sa théorie pour dépeindre les maux comme rupture d’avec le lien doctrinal qui dans notre entendement est le fruit de la dépendance matérielle ou l’assujettissement de l’âme ou l’être au caprice du corps ou ensemble des réalités matérielles.
Pierre Hadot peut donc dire que « Ce qui nous empêche d’avoir conscience de notre vie spirituelle, ce n’est pas notre vie dans le corps, mais c’est le souci que nous prenons du corps. Nous nous laissons absorber par de vaines préoccupations et des sollicitudes exagérées » (Hadot, 1997, p. 37). S’accorder avec Hadot dans ce contexte revient soutenir que le moi inférieur et le moi supérieur sont décisifs dans la tentative d’épanouissement humain. En effet, le moi supérieur correspond à la prise de conscience de son statut de créature divine, tandis que le moi inférieur est le siège des vices, des mauvaises actions en l’homme.
Par ailleurs, cet état est la symbolique d’une désolation relative à la domination de l’avoir sur l’être et le signe d’une perte des valeurs sociales et même politiques pour évoquer le cas des mauvaises gouvernances. Ce parallélisme de l’impact de l’avoir et la prise de conscience de l’être est une inquiétude du prélat Kä mana qui extériorise en ces termes.
Démunis de toute force de créer, un espace politique solide et cohérent, ils transforment cet espace en domaine privé, en un espace domestique structuré autour du clan et de la tribu du chef. L’État devient un État-tribu et sa parole, une pure idéologie de légitimation d’un pouvoir sans espace politique (Kä mana, 1991, p. 79).
Le problème de fond, dont fait mention Kä mana, est l’incapacité mentale d’une bonne gouvernance humaine, par le piège de l’avoir, obscurcissant la noblesse consciente de l’être, présence du divin en soi. En effet, s’il faut faire advenir à nouveau le penser plotinien. Il sera par la suite indiscutable de faire mention que le déficit de la raison divine est la cause de l’incapacité créatrice humaine. La déficience divine, en guise de rappel, engendre chez les hommes, l’accumulation de biens matériels, pour s’engloutir dans une classe privée.
Aussi, cette situation péjorative intervient pour révéler le manque de lumière divine en l’homme et son assujettissement matériel. Cette absence traduit en filigrane, le goût pour les choses d’ici-bas, parce que l’homme a perdu l’orientation et agit tel un aveugle, dans un monde où les intérêts définissent les relations avec pour fondement, l’avoir. Ce virus présent dans les entrailles humaines met en péril l’harmonie des nations et dénature également les rapports juridico-politiques : « Depuis la pénétration du capitalisme en Afrique, l’argent est devenu une religion et l’idéalisme a disparu. Un africain qui ne cherche pas à s’enrichir est décrié par ses voisins et considéré comme un raté » (Kashamura, 1972, p. 16). Cette dépendance matérielle engloutissant l’idéalisme au profit du matérialisme de l’argent est devenue factuelle pendant que les États s’assombrissent. Tout concourt à montrer que la quête déraisonnable de l’avoir n’est pas sans effets. Il est plus que nécessaire de repenser l’avoir pour sauver le monde qui s’est cruellement égaré de la norme: Dieu. N’est-ce pas en ce sens qu’il faut convier les philosophes allemands ? Dans leurs démarches, pour les philosophes allemands Adorno et Horkheimer, les hommes ont commis un délit envers la nature, expression physique et visible du divin. Ce délit est étroitement lié au problème de l’avoir qui, intuitivement, dévisage la mauvaise action humaine relative au reniement de sa conscience de soi:
Les hommes veulent apprendre de la nature comment l’utiliser, afin de la dominer plus complètement, elle et les hommes. C’est la seule chose qui compte. Sans égard pour elle-même, la raison a anéanti jusqu’à la dernière trace sa conscience de soi (Horkheimer et Adorno, 1974, p. 25).
Les hommes ont donc cultivé, par l’entremise de la domination de la nature, un sentiment de suprématie des uns sur les autres, en spoliant leurs biens, par une soumission dans un climat soutenu par l’avoir. L’homme, par cet acte insoucieux, a procédé au bouleversement de l’ordre immédiat par un absolutisme de la raison dont les séquelles sont à coup sûr, le désastre spirituel du monde. N’est-ce pas dans cette urgence qu’un sursaut d’éthique est capital, surtout dans un monde en proie aux dérives de la raison ?
2. DE L’ÉTHIQUE AU RENOUVELLEMENT DU MONDE
En tant que « science ayant pour objet le jugement d’appréciation en tant qu’il s’applique à la distinction du bien et du mal » (Lalande, 2013, p. 305). L’éthique vise un mieux-être à l’homme dans une conduite exemplaire à l’égard des autres. En effet, comme le soutient Sperber, « le terme éthique est plus souvent employé pour désigner le domaine plus restreint des actions liées à la vie humaine » (Sperber, 2006, p. 6). C’est dire que la dimension éthique se préoccupe des actions dont la finalité vise le bien-être des hommes. Par ce bien-être, les actions éthiques se proposent le renouvellement du monde en lui donnant des voies et moyens pour « devenir semblables à Dieu » (Plotin, Ennéades I (I, 2, 1). Cette ressemblance a pour objectif, une vie harmonieuse entre les hommes. En effet, le monde doit, par l’éducation par exemple, valoriser les traits d’identités et de reconnaissance des autres comme un être semblable à soi.
En outre, suite aux diverses crises liées au déséquilibre de l’humain, un sentier nouveau est envisageable, celui du retour à la raison vraie, subjective dans une ouverture divine. Cette raison quelque peu critique, mais épurée de dérives est ce dont l’éthique dans une perspective de l’école de Francfort conviendrait. Toutefois, cette éthique basée sur la raison responsable est appelée à se surpasser dans les limites réfléchies de l’autre, de la bonne utilisation de l’avoir. Plus clairement, un équilibre de l’avoir et de l’être est envisageable dans une ouverture du divin ; d’où un monde nouveau :
À l’époque actuelle, ce n’est pas dans les sciences de la nature, fondées sur la mathématique présentée comme Logos éternel, que l’homme peut apprendre à se connaître lui-même ; c’est dans une théorie critique de la société telle qu’elle est, inspirée et dominée par le souci d’établir un ordre conforme à la raison » (Horkheimer, 1974, p. 28).
La connaissance de l’homme dans un souci d’une vie authentique est du ressort de la théorie critique, qui à son tour prône une vie rationalisée dont la finalité est l’agir éthique. Désormais, par la puissance d’une raison raisonnante, une vie nouvelle pour un monde nouveau sera de mise. C’est donc à juste titre que Ruwen Ogien soutiendra que « toute l’éthique se résume au souci d’éviter de nuire délibérément à autrui » (Ogien, 2007, p. 12). Par la faculté de de raison, l’homme, mieux le monde par le secours de l’éthique peut prétendre vie en paix, en amour de l’autre dans une relation verticale pour remonter « vers lui [c’est-à-dire l’Un] et se proclame son image » (Plotin, 1931, (V, 3, 8, 2-3). En un mot, par la verticalité du monde, sujet à son ascétisme pour son renouvellement en vue d’une humanité pacifiée et paisible est l’aboutissement de l’éthique, fille du divin et ouverture à l’amour de soi et des autres. N’est-il pas question de cette valeur de l’éthique en tant qu’autre de l’amour chez Levinas ?
Il dit ceci : « Aimer, c’est exister comme si l’aimant et l’aimé étaient seuls au monde (…). L’amour, c’est le moi satisfait par le toi, saisissant en autrui la justification de son être » (Levinas, 1991, p. 30). Autrui incarne dans cette pensée levinassien, la satisfaction et l’aboutissement d’une vie accomplie de l’autre par l’amour. Or, l’amour dans cette perspective est une convocation à l’acte éthique dans son ouvert vers l’autre. Par conséquent, par l’amour de l’autre dans une transcendance des dérives de l’avoir, l’amour devient ici, l’un des points de chute du renouvellement du monde dans les idées de Levinas. Ce renouvellement, conscience des crises nous introduit dans une nouvelle dimension sensée nous conduire vers une vérité utile au monde : la question de l’humanisme.
3. DE L’HÉNOLOGIE À LA MYSTIQUE : FONDEMENT D’UN HUMANISME SOCIAL
La mystique dans l’hénologie plotinienne est semblable à la capacité de connaître une grande élévation intérieure pour fusionner avec le principe unique nommé l’Un. Ainsi, l’élan humain tendant à la bienveillance et le bien-être est une esquisse de la mystique. Toutefois, il importe de se remémorer le fait que la mystique, loin du mysticisme tel que conçu dans des croyances religieuses, connaît une procession relative à des principes de base ou fondamentaux dont la raison est déterminante. L’hénologie plotinienne au détriment d’un culte religieux est une meilleure manière de conduire sa raison jusqu’à son stade le plus élevé qui consiste en une identification avec l’Un. En effet, il s’agit d’une apologie du bien-vivre avec autrui pour s’achever en humanisme empreint de rationalité et spiritualité.
Pour étayer un tel point de vue, familiarisons-nous avec ce bout de phrase plotinien : « L’homme véritable coïncide avec l’âme raisonnable, et quand elle raisonne, c’est nous qui raisonnons, par le fait même que les raisonnements sont des produits de l’activité de l’âme » (Plotin, 1954, I, 1, 8). Ce texte laisse apparaître l’enjeu d’un homme modèle susceptible de prôner les valeurs de la mystique en vue d’une éthique du bien-vivre, par l’âme raisonnable qui demeure son étalon, pour mener une existence de bien-être. Or, cette organisation interne du sujet aura des répercussions externes dont l’un des résultats immédiats est l’accomplissement d’une vie vertueuse comme autre d’une hénologie instaurant l’humanisme, par la mystique.
Pour ce faire, cernée comme une philosophie de la raison contemplative du divin, l’hénologie trouve un grand point d’achèvement dans l’humanisme compris comme valorisation de l’homme. Comme le soutient Maritain, l’humanisme consiste « essentiellement à rendre l’homme plus vraiment humain, et à manifester sa grandeur originelle en le faisant participer à tout ce qui peut l’enrichir dans la nature et dans l’histoire (en concentrant le monde en lui) » (Maritain, 1968, p. 10). Autrement par l’humanisme, l’homme transforme l’histoire et se construit un avenir individuel et collectif en menant une existence vertueuse.
Pour ce faire, Plotin accorde une importance à la vertu, dont l’accomplissement pourrait fonder les principes d’un monde en paix. En effet, Plotin distingue plusieurs types de vertus pouvant aider les hommes. Le point commun de toutes ses vertus est la ressemblance du divin, dans une transfiguration, en vue de voir le divin en l’humain, pour instaurer la véritable éthique du bien vivre. Pour y parvenir, d’abord, Plotin avance l’argument suivant concernant les vertus à partir de l’image de Platon :
Puisque, nécessairement, les maux existent ici-bas et circulent dans cette région du monde, et puisque l’âme veut fuir les maux, il faut nous enfuir d’ici. En quoi consiste cette fuite ? « À devenir semblable à Dieu » dit [Platon] ; et nous y arrivons, si nous atteignons la justice, la piété accompagnée de la prudence, et en général la vertu (Plotin, 1954, I, 2, 1).
Le sens des vertus est l’identification par une unité à Dieu. Or, Dieu dans cette perspective est l’image de l’amour, de l’amitié, de la paix. Par conséquent, pour l’homme, la capacité de s’accaparer ces vertus est essentielle. Dans le fond, que sont-elles ou, à quoi fait-on allusion, lorsqu’il s’agit d’évoquer les vertus plotiniennes ? Il s’agit entre autres des vertus civiles. Pour Plotin, les vertus civiles contribuent à l’ordonnancement de l’intériorité de l’homme afin de parfaire son extériorité, pour une vie paisible :
Les vertus civiles (…) mettent réellement de l’ordre en nous et nous rendent meilleurs ; elles imposent des limites et une mesure à nos désirs et à toutes nos passions, elles nous délivrent de nos erreurs ; car un être devient meilleur parce qu’il se limite et parce que, soumis à la mesure, il sort du domaine des êtres privés de mesure et de limite (Plotin, 1954, I, 2, 2).
La pratique, sinon l’adéquation hommes-vertus civiles, façonne l’homme en citoyen exemplaire, destiné à prôner les valeurs du vivre ensemble. En ce sens, Plotin renchérira pour avancer que les vertus civiles, par l’entremise de l’âme, sont un modèle de vie pour une humanité dont l’éthique s’impose, comme norme de valeur de l’exister :
Les vertus civiles, la prudence relative au raisonnement, le courage qui est une vertu du cœur, la tempérance qui consiste en un accord et une harmonie du désir avec la raison, la justice qui consiste en ce que chaque partie de l’âme accomplit sa fonction propre, en commandant ou en obéissant (Plotin, 1954, I, 1, 1).
De ces caractéristiques fondamentales et fondatrices des vertus civiles, il est capital de souligner que celles-ci se résument aux principaux points suivants à savoir : la prudence, la tempérance, le courage et la justice. L’enjeu de ces points fondamentaux expose leur présence de manière naturelle dans la structure de l’humain, surtout qu’elles s’insurgent en valeurs éducatives et comportementales. Ces valeurs décrivent en réalité, le sens du réalisme existentiel humain par leur facteur dont l’impact immédiat est l’anoblissement des sociétés. Par ailleurs, elles permettent de « toujours [faire] usage de notre intellect » (Plotin, 2007, 30, 15). Les vertus civiles sont une lueur d’espoir pour une promotion réfléchie de l’intelligence humaine.
Également dans le sentier de la vie vertueuse, il convient de faire intervenir Augustin, qui, tout comme Plotin propose une vie vertueuse à dessein de garantir et maintenir l’humanisme : « Il est hors de doute que la vertu rend l’âme parfaite » (Augustin, 2018, Livre I (I, VI, 9). Pour lui, la vertu transforme l’âme qui à son tour, impactera considérablement sur l’homme. Dans son cas, il est question d’une vie réglée selon les exigences de Dieu. Ceci dit, tout homme valorisant Dieu considérera automatiquement son semblable comme soi. Ce respect des normes divines en soi pour l’autre demeure une cause de l’amour de l’autre. Cet esprit de symbiose entre l’élévation spirituelle et la vie authentique par le respect de l’autre se résume dans la pensée Lévi-Strauss, par la progression imbibée de collaboration et d’union collective.
Lévi-Strauss s’exprime en ces termes : « Pour progresser, il faut que les hommes collaborent ; et au cours de cette collaboration, ils voient graduellement s’identifier les apports dont la diversité initiale était précisément ce qui rendait leur collaboration féconde et nécessaire » (Lévi-Strauss, 2007, p. 65). Ce penser de l’ethnologue nous introduit dans le désir divin comme transfiguration humaine. Parallèlement, avant de continuer, il importe d’expliciter ce point de vue de l’ethnologue. Cette explicitation se fera en deux points capitaux.
Premièrement, il pose le principe d’une progression en rapport avec une collaboration humaine. Qu’implique la progression dans cette partie consacrée au désir divin ? Pour répondre, il est important de faire état de ce que, l’idée ou le substrat invisible favorisant et valorisant l’évolution mutuelle humaine, dans une concorde est le désir inéluctable du divin qui modèle l’humain. En effet, lorsque les hommes en viennent à émettre le désir ou la volonté de faire chemin ensemble, c’est relativement au lien invisible qu’ils ont noué secrètement avec le divin. Ce lien invisible favorise le dépassement des distorsions sociales et humaines, parce que la présence du divin rassemble.
Deuxièmement, par le constat humain d’une évolution graduelle dont le résultat est la participation effective de tout un chacun de par sa différence culturelle, les réalités légitimant le bien-être font état à nouveau, de l’unité dans la diversité. Or, l’unité est du ressort du divin, qui contribue à unir tous les hommes dans la mesure où, en lui, la multiplicité et la différence n’existent pas. C’est dans cette continuité que Sartre soutiendra que : « L’homme est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d’être » (Sartre, 1943, p. 639). Ainsi, ce sursaut d’humanisme dans l’hénologie plotinienne à la suite du communautarisme de Strauss suit une logique pouvant s’échelonner de la manière suivante:
D’abord, l’humanité est conviée à mener ce que nous nommons la conversion dans le plotinisme. Que revêt la conversion dans le philosopher plotinien ? La conversion dans le plotinisme est la prise de conscience du soi déchu et sa volonté de s’élever par ascétisme, jusqu’au divin. L’ascétisme faut-il le mentionner est dans l’entendement de Jacqueline Russ à travers son Dictionnaire de philosophie, « un ensemble de mortification permettant d’atteindre la perfection morale » (Russ et Badal, 2004, p. 32). Cette élévation symbolisant dans la perspective plotinienne, la conversion, vise une responsabilité interne et subjective dans le monde, à dessein d’éveiller la spiritualité endormie en soi par le désir du divin. En effet, pour Plotin, dans cette conversion humaine, il s’agira pour l’humanité de surpasser ses manquements et ses crises, par un ascétisme vers le divin. Il faut qu’on « remonte vers lui [l’Un] et se proclame son image » (Plotin, 1931, V, 3, 8). C’est dire que dans la tentative de saisir le divin par le désir, le monde se doit d’opérer un mouvement profond en lui-même par le canal de l’homme, afin de découvrir les splendeurs divines et déteindre sur les rapports interhumains par une transfiguration.
Ensuite, dans le penser plotinien, les hommes doivent faire un nouvel effort pour changer positivement, en intégrant davantage Dieu en eux, par une participation naturelle : « Plus un être participe à la forme, plus il devient semblable à l’être divin, qui est sans forme ; les êtres voisins de Dieu participent davantage à la forme » (Plotin, 1954, I, 2, 1). Le principe participatif du divin en l’humain est la résultante de l’appropriation de la forme ou la réalité intérieure présente en l’existant dont la consistance n’est efficiente, que par Dieu.
Enfin, si l’humanité se laisse absorber par l’éveil de cette conscience intérieure, l’amour des autres et les bases de l’humanisme sauront raffermir les liens universels et garantir une existence transfiguratrice à l’image de Dieu : « Plus l’homme s’élève, répond Plotin, plus il est bienveillant pour ses frères et plus il s’en voudrait de les mépriser » (Gandillac, 1952, p. 45). Le principe humaniste hénologique plotinien suppose une conversion qui favorisera le respect des normes sociales, vertueuses et politiques, en vue d’une extériorisation des valeurs divines dans l’environnement immédiat et le monde. Cet exercice rationnel vise à atteindre la perfection, même si elle est un processus toujours dynamique. Plotin peut donc s’exprimer en ce sens :
Il faut s’efforcer de devenir le meilleur possible. Je vous dirai d’abord, que, meilleur on est, plus on est bienveillant envers tous les êtres, comme envers les hommes, de plus il faut nous estimer à mesure, sans grossièreté, et sans nous élever plus haut que notre nature ne peut nous faire monter ; il faut penser qu’il y a place pour d’autres que nous auprès de Dieu (…) il faut envisager non pas ce qui est agréable à chacun, mais l’univers entier ; de cette manière on honore chacun selon son mérite ; on tend au but que visent tous les êtres, autant qu’ils le peuvent (beaucoup d’êtres visent ce but ; ceux qui l’atteignent sont heureux (Plotin, 1924, II, 9, 9).
L’hénologie plotinienne a pour finalité de prôner la joie de tous et le bien-être de l’humanité dans un climat de fraternité en Dieu. Par cette prise de conscience volontaire et nécessaire pour la survie de l’humanité en Dieu, Plotin exige de donner le meilleur de soi, pour un monde pacifié et équilibré dont les fondements sociopolitiques seront le gage d’une paix véritable. L’enjeu d’un tel effort fera intervenir Saint Augustin en ces termes : « La paix véritable, celle que la créature raisonnable peut seule appeler de ce nom, et qui consiste dans une union très-réglée et très-parfaite pour jouir de Dieu et du prochain en Dieu » (Augustin, 2018, Livre XIX (XIX, XVII). Le divin devient la symbolique de la paix universelle et d’un monde transcendant d’éventuelles crises.
Conclusion
« Le but à atteindre est de promouvoir le bonheur » (Gandhi, 1969, p. 213). Par le bonheur comme sens de la vie illustré ici par Gandhi, la présente réflexion se solde sur l’idée faisant du divin et de sa présence, la véritable clé de l’épanouissement humain et la fin des conflits. Il faut de ce fait, reconvoquer et repositionner le divin dans le monde, en vue d’une transcendance du déchoir spirituel. Pour ce faire, l’humanité devrait reconsidérer les valeurs éthiques, théologiques et rationnelles du penser plotinien, qui vers la fin, posent des principes dont l’application vise un mieux-être. Ainsi, les hommes ou mieux, l’humanité tout entière, pourraient envisager un dépassement de soi, non pas dans une perspective idéelle, mais dans une acceptation de l’autre comme soi, à partir des prémices plotiniennes de la valorisation et de l’équilibre de l’avoir et de l’être par exemple. Par conséquent, comme le rappelle Sœur Gilles Aimée Cissé, « l’homme doit tout faire pour maîtriser sa masse tumultueuse et déraisonnable et c’est seulement après cette maîtrise qu’il revient à la forme de son état ‘’ premier et meilleur’’ (Cissé, 2019, p. 130). Partant de ce principe, une bonne rationalisation et éducation de ses désirs, dans une subordination à la raison et au divin, saurait nous éclairer dans le cheminement vers une sortie véritable de crises mondiales par l’hénologie plotinienne.
Références bibliographiques
AUGUSTIN Saint, 2018, Confessions in Œuvres philosophiques complètes, Tome I, traduction de Pierre de LABRIOLLE, Sous la direction de Jean-Joseph-François POUJOULAT et Jean-Baptiste RAULX, Paris, pp. 33-269.
AUGUSTIN Saint, 2018, Des mœurs de l’église catholique in Œuvres philosophiques complètes, Tome I, Traduction par MM. CITOLIEUX et THÉNARD, Sous la direction de Jean-Joseph-François POUJOULAT et Jean-Baptiste RAULX, Paris, Les Belles Lettres, pp. 825-899.
AUGUSTIN Saint, 2018, La cité de Dieu in Œuvres philosophiques complètes, Tome II, traduction de M. Émile SAISSET, Sous la direction de Jean-Joseph-François POUJOULAT et Jean-Baptiste RAULX, Paris, Les Belles Lettres, pp. 916-1739.
CHARRUE Jean-Michel, 2014, Néoplatonisme de l’existence et de la destinée humaine, Paris, L’Harmattan, 324 p.
CISSÉ Aimée Gilles, 2019, Penser la philosophie de Plotin, Tome I, préface de Placide MANDONNA, Dakar, L’Harmattan, 289 p.
FATTAL Michel, 2016, Du Logos de Plotin au Logos de Saint Jean. Vers la solution d’un problème métaphysique ?, Paris, Les Éditions du Cerf, Paris, 150 p.
FRANÇOIS, 2013, Lettre encyclique Loué sois-tu. Sur la sauvegarde de la maison commune, Abidjan, Pauline, 192 p.
GANDILLAC Maurice, 1966, La sagesse de Plotin, Paris, Vrin, 279 p.
GANDHI, 1969, Tous les hommes sont frères, traduit de l’anglais par Guy VOGELWEITH, Paris, Gallimard, 313 p.
HADOT Pierre, 1997, Plotin ou la simplicité du regard, Paris, Gallimard, 227 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et Conférences, André Préau, Paris, Gallimard, 349 p.
HOLZER, Vincent, 2017, Le Christ devant la raison. La christologie devenue philosophème, Paris, Cerf, 346 p.
HORKHEIMER Max et ADORNO Théodor, 1974, La dialectique de la raison, traduction de Eliane Kaufholz, Paris, Gallimard, 400 p.
HORKHEIMER Max, Théorie traditionnelle et théorie critique, 1974, Paris, 324 p.
KÄ MANA, 1991, L’Afrique va-t-elle mourir ?, Paris, Cerf, 225 p.
KASHAMURA Anicet, 1972, Culture et aliénation en Afrique. Changer le monde, Paris, Cercle, 174 p.
KOUAKOU Antoine, 2007, « Culture et Violence chez Martin Heidegger », in le Korê, Revue ivoirienne de philosophie et de culture, n°39-Abidjan, EDUCI, pp. 20-39.
LALANDE André, 2013, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, P.U.F, 1375 p.
LÉVI-STRAUSS Claude, 2007, Race et histoire, Dossier et notes réalisés par Jean-Baptiste SCHERRER, Lecture d’image par Seloua Luste BOULBINA, Paris, Gallimard, 162 p.
LEVINAS Emmanuel, 1991, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’Autre, Grasset, Paris, 252 p.
MARITAIN Jacques, 1968, Humanisme intégral, Paris, Aubier-Montaigne, 318 p.
OGIEN Ruwen, 2007, L’éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes, Paris, Gallimard, 257 p.
PLATON, 1966, La République, Traduction et Notes. Robert Baccou, Paris, Flammarion.
PLOTIN, 1954, Ennéades I, précédées de la vie de Plotin de Porphyre, trad. Émile Bréhier, Paris, Les Belles Lettres, 1954, 135 p.
PLOTIN, 1924, Ennéades II, trad. Émile Bréhier, Paris, Les Belles Lettres, 141 p.
PLOTIN, 1931, Ennéades V, trad. Émile Bréhier, Paris, Les Belles Lettres, 175 p.
PLOTIN, 1938, Ennéades VI, Trad. Émile BRÉHIER, Paris, Les Belles Lettres, 300 p.
PLOTIN, 2007, Traités 38-41, Traductions sous la direction de Luc BRISSON et Jean-François PRADEAU, Paris, GF-Flammarion, 391 p.
SPERBER CANTO Monique, Éthiques grecques, 2001, Paris, Quadrige/P.U.F, 533 p.
SPERBER CANTO Monique, OGIEN Ruwen, 2006, La philosophie morale, Paris, P.U.F « collection Que sais-je ? », 88 p.
TAZZOLIO Florent, 2002, Du lien de l’Un et de l’Être chez Plotin, préface de Michel Fattal, Paris, L’Harmattan, 301 p.
TOURAINE Alain, 1992, Critique de la modernité, Paris, Gallimard, 238 p.
RUSS Jacqueline et Badal Clotilde, 2004, Dictionnaire de philosophie, Paris, Bordas, 529 p.
SARTRE Jean-Paul, 1943, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, 690 p.
SCHOPENHAUER Arthur, 2014, Le monde comme volonté et représentation, préface de Clément ROSSET, traduction en français par A. Burdeau, Paris, P.U.F., « Quadrige », 4e tirage, 1434 p.
IN-QUIÉTUDE ET APPEL CHEZ GABRIEL MARCEL : LE TOI ABSOLU COMME FONDATION ONTO-THÉOLOGIQUE DU BONHEUR
Moulo Elysée KOUASSI
Université Alassane OUATTARA, (Côte d’Ivoire)
Résumé : La déréliction, la crise voire l’inquiétude constante semble constituer les réalités existentielles de notre époque, si bien que l’humanité de l’avenir inquiète et appelle à de sérieuses réflexions sur la destinée de l’humain et le sens de l’histoire. Selon une lecture marcellienne, tout porte à croire qu’en essayant d’assumer son « pouvoir-être », sa condition de modernité, l’homme moderne vit une certaine impasse du progrès et qu’il aurait même perdu les repères ontologiques et les racines spirituelles qui le maintenaient si divin et humain. Autrement dit, au cœur de notre civilisation contemporaine, l’homme se retrouve défenestré et infortune, requis par une impérieuse exigence de transcendance, ou encore il serait à la recherche de son équilibre, de l’exigence d’être. Ainsi, contre l’espoir fondé par les conceptions scientistes et immanentistes soutenues par l’humanisme athée, G. Marcel procède à une analyse d’essence phénoménologique portant sur la situation fondamentale de l’homme et invite à une dialectique existentielle entre le divin et l’humain, voire à une invocation adoratrice du Toi absolu, afin de fonder la plénitude d’une humanité transfigurée, capable de garantir la sauvegarde de l’être humain et sa dignité existentielle.
Mots-clés : APPEL, EXIGENCE DE TRANSCENDANCE, IN-QUIÉTUDE, INVOCATION, ONTO-PHENOMÉNOLOGIE, TOI ABSOLU.
Abstract: Dereliction, crisis and even constant worry seem to constitute the existential realities of our time, so much so that the humanity of the future worries and needs serious reflection on the destiny of human and the significance of history. According to a Marcellian reading, there is every reason to believe that by trying to assume his “power-to-be”, his condition of modernity, modern human is living a certain impasse of progress and that he has even lost ontological reference points and spiritual roots that kept him so divine and human. In other words, at the heart of our contemporary civilization, human finds himself defenestrated and misfortune, required by an imperious requirement for transcendence, or even that he is in search of his balance, of the requirement of being. Thus, against the hope founded by scientist and immanentist conceptions supported by atheistic humanism, G. Marcel proceeds to an essentially phenomenological analysis bearing on the fundamental situation of human and invites an existential dialectic between the divine and the human, even to an adoring invocation of the absolute You, in order to found the fullness of a transfigured humanity, capable of guaranteeing the protection of the human being and his existential dignity.
Keywords: CALL, TRANSCENDENCE REQUIREMENT, IN-QUIETUDE, INVOCATION, ONTO-PHENOMENOLOGY, ABSOLUTE YOU.
Introduction
Les situations alarmantes telles que les violences urbaines, le terrorisme, les crises économique, politique et sociale, la quantification des rapports sociaux, etc., sont autant d’indices qui dévoilent que l’humanisme technologique et politique n’a pu conduire l’homme au seuil du trône où siège le bonheur. Une telle remarque qui témoigne de l’anfractuosité de notre condition d’existence fait dire à G. Marcel (1951, p. 17) que « l’homme est en agonie », car notre époque vit une certaine cohérence dans l’absurde après avoir congédié Dieu de l’existence. Subséquemment, l’humanité est sur la voie de la déréalisation de soi dans la défectuosité et la détresse ontologique. L’exigence d’être perdue, l’homme contemporain vit une situation tragique et problématique, réduit à la série des fonctions dans une « existence déchue », qui oublie la question de l’être et qui fait disparaitre l’exigence ontologique (Sumiyo Tsukada, 2005, p. 48).
Pour le lecteur de G. Marcel, et pour tout observateur avisé, il y a une véritable mutilation dans le développement de l’homme et de la société, car sous le mode de l’avoir et des possessions qui le dévorent, du règne des techniques, et coupé de ses racines spirituelles, l’homme vit une certaine condition tragique (G. Marcel, 1955, p. 17). Dès lors, se pose la nécessité de sérieuses réflexions sur le sens, l’avenir, ou l’exigence d’une nouvelle sagesse qui rendrait à l’homme sa mémoire spirituelle et éclairerait l’acte d’exister. Par conséquent, convaincu qu’il ne saurait y avoir de philosophie aujourd’hui sans une analyse d’essence phénoménologique portant sur la situation fondamentale de l’homme, cette approche quête en direction de la plénitude d’une humanité transfigurée, sauvée.
Ainsi, la problématique se dégage d’elle-même : Comment conférer un sens nouveau à notre vie, c’est-à-dire comment aider l’homme à réaliser l’exigence de transcendance et l’exigence ontologique ? Ou encore vers quoi doivent tendre les appels de l’homme contemporain ? Mieux, comment sensibiliser l’homme à se réveiller de son sommeil spirituel, à découvrir la conscience tragique et le tragique de sa situation, d’une part, et, d’autre part, à reconnaître la Réalité (Toi absolu) et à s’orienter vers elle ? Dès lors, notre étude s’orientera vers une anthropologie théologique, qui est le « rappel à la conscience de l’élément sacré qui s’attache à une existence humaine, quelle qu’elle soit » (G. Marcel, 1967, p. 189). Le sens de l’ « appel » se dévoilera de lui-même dans une lumière éclairée et éclairante.
1. ONTO-PHÉNOMÉNOLOGIE DU « DÉCHOIR » HUMAIN : L’INQUIÉTUDE HUMAINE EN PROCÈS
Nous vivons « une heure de grande inquiétude » (Buber, 1987, p. 14). Cette remarque bubérienne n’est pas obscure devant l’opulence de l’inquiétude contemporaine et l’impasse du progrès sombre dans lequel nous vivons, et dont les kyrielles de crises interminables, les calamités, la quantification des rapports sociaux, etc., sont des preuves indéniables. Les lectures marcelliennes nous amènent à considérer « l’homme comme une valeur absolue » ; car « les exigences de la vie moderne qui résident essentiellement dans la recherche de l’efficacité et du rendement, dans la recherche effrénée des richesses et du bien-être matériel, ont tendance à introduire la comptabilité dans les rapports humain. Ainsi, la valeur de l’homme tend à se réduire au quantifiable (Taki-Ezoua Roseline, 2016, p. 319). Dès lors, ce qui prévaut pour G. Marcel c’est de permettre à l’homme d’assumer son humanité et sa condition de modernité sans pour autant traiter son prochain comme une chose, « mais comme un être sacré » (Op.cit., p. 319), c’est-à-dire une vie qui consacre la dignité humaine comme le fondement de tout développement intégral. Transparaît clairement que c’est l’homme comme une valeur absolue qui se pose et appelle à la responsabilité si l’homme ne veut pas tomber dans une vue désespérée du monde.
Il va sans dire que l’idée d’une ontologie phénoménologique renvoie à une analyse portant sur le foyer ontologique de l’homme, son lieu d’émergence ainsi que sa manière d’habiter le monde : un monde désormais marqué d’inquiétude, de crise, de dénégation, c’est-à-dire un monde où l’homme perd peu à peu son exigence d’être parce qu’il tombe dans le fonctionnel, se détruit lui-même par sa course vers les possessions matérielles. Il s’ensuit que la phénoménologie en jeu repose sur la description de la crise des valeurs, de la crise éthique, celle de la raison et de l’altérité ou l’érosion de plus en plus alarmant du tissu éthique et social de notre humanité. En effet, la profanation de l’univers par les techniques (Vizguine, 2007, p. 48) et l’enlisement de notre humanité dans le « naturalisme » et « l’objectivisme » (Husserl, 2012, p. 114) témoignent du drame profond que nous vivons, lequel drame entraine aussi une réification de l’existence, c’est-à-dire l’épuisement des valeurs éthique et morale. Cette réification entraine une crise éthique et une crise profonde de la raison dont le corollaire est le dénuement ontologique. Si nous méditons bien la question de la technique, le crépitement des armes, le terrorisme apparaissent comme les réverbérations de cet « arraisonnement » dont parle Heidegger, mais aussi de cette « éclipse de la raison » dont parlent les théoriciens de l’école de Francfort.
Cette déchéance qui doit être entrevue, selon une lecture heideggérienne, comme l’enlisement dans le registre de la mondanité, c’est-à-dire l’oubli de l’« angoisse de la temporalité », du « temps destructeur » aux dire de Sumiyo Tsukada (Op. cit., p. 50), est chez G. Marcel l’impossibilité pour l’homme de se mettre à la disposition de l’Autre – Dieu – qui sauve. Car, face à la défectuosité de l’humanisme technologique et politique entretenue par la conception scientiste et immanentiste du monde (l’humanisme athée, le marxisme, le positivisme, etc.), G. Marcel se refuse à attacher son espérance à cet ordre terrestre qui est celui du déracinement ontologique, de l’aliénation. Ainsi, contre l’humanisme athée qui consacre la mort de Dieu et invite l’homme à se réaliser sans le concours du transcendant ; il estime que la rupture du lien ombilical qui unissait l’homme à Dieu est la principale cause du désenchantement de l’homme moderne. À preuve, il affirme qu’« à l’affirmation proférée par Nietzsche : Dieu est mort, près de trois quarts de siècle plus tard une autre affirmation, moins proférée que murmurée dans l’angoisse, vient aujourd’hui faire écho : l’homme est en agonie » (G. Marcel, 1951, p. 17). Cette agonie de l’homme n’est pas une pensée du catastrophisme, apocalyptique au sens religieux du terme, mais renvoie plutôt à toutes les possibilités d’anéantissement de l’homme. C’est pourquoi le commentant, Duso-Bauduin écrit que « Homo viator indique une démarche de l’âme se dressant explicitement contre la mort et les formes mortifères de la vie : « le désœuvrement », « l’ennui », « l’aimantation nihiliste », « la désertion de la conscience » (2005, p. 34). Cela signifie que l’agonie de l’homme est son empêtrement dans une condition tragique. Pour mieux s’en convaincre, écoutons à nouveau G. Marcel :
Dire que l’homme est en agonie, c’est dire seulement qu’il se trouve mis en présence non pas d’un évènement extérieur, tel que l’anéantissement de notre planète, qui pourrait être la conséquence d’un cataclysme sidéral, par exemple, mais des possibilités de destruction complète de lui-même qui apparaissent aujourd’hui comme résidant en lui, à partir du moment où il fait un mauvais usage, un usage impie des puissances qui le constituent (1951, p. 17-18).
En effet, selon cette lecture marcellienne, et la phénoménologie existentielle, notre époque serait privée d’avenir et marquée par une conflagration générale, c’est-à-dire une aliénation ou une déchéance politique, sociale, éthique et spirituelle. On pourrait ici se rappeler La crise du monde moderne dont parlait René Guemon en 1927. Malheureusement, cette situation tragique et fâcheuse, alarmante de guerre de l’homme contre lui-même, d’autodestruction, constitue pour l’Homme-dieu le terreau d’« une aséité caricaturale » (G. Marcel, Op. cit., p. 54), alors qu’un pessimisme diffus subsiste. Subséquemment, la reconnaissance de la conscience tragique et du tragique éternel dans l’histoire humaine, doit nous faire comprendre que « par le changement brusque et catastrophique de son sort, l’homme est aux mains de puissances ténébreuses et terribles » (Flam, 1964, p. 10).
Une observation rigoureuse de notre manière contemporaine d’habiter le monde nous amène au constat que la quantification des rapports sociaux, l’érosion de plus en plus alarmant du tissu éthique et social de notre monde, le terrorisme planétaire, les génocides, les violences diverses attestent de la porosité d’un espoir que l’homme a placé, enraciné dans les philosophies de l’immanence. En fait, pour la philosophie marxiste, par exemple, l’avenir de l’homme est entre ses propres mains : Le projet-espérance n’est pas référé à un ordre surnaturel, mais plutôt à un ordre terrestre. Telle est la conception que R. Garaudy développe et dont l’écho est aussi chez Sartre. Dans sa célèbre conférence de 1945 – L’existentialisme est un humanisme – Sartre fait de l’homme l’artisan unique et par excellence de son histoire. Ces pensées qui fondent l’humanisme athée n’ont pu conduire l’homme au seuil du trône où siège le bonheur.
Inopportunément, nous devons observer que l’homme moderne est le témoin d’une civilisation entière, fondée sur des principes faux. Comme le précise si bien Berdiaeff (1954, p. 169), « notre civilisation industrielle et technique est ébranlée jusqu’en ses fondements ; elle périt succombant sous les coups de forces qu’elle a créées. L’homme est écrasé par ses propres découvertes et ses propres inventions auxquelles s’adapte mal sa nature, formée à une époque toute différente ». Cela signifie que la condition d’existence de l’homme d’aujourd’hui est celle d’un être dont le pouvoir-être conduit à une autodestruction, une mutilation ontologique, c’est-à-dire que l’être de l’homme n’arrive plus à trouver de la contenance, de la plénitude. C’est ce qui fait dire à François Rahier que, « commentant Ibsen, G. Marcel écrit que la réflexion s’oriente vers une mise en question de l’homme et par-là même de la condition tragique » (2005, p. 15). C’est cette amère observation qui fonde l’idée d’une onto-phénoménologie du déchoir comme expression de la décadence morale, éthique, politique et sociale de la société humaine dont l’inquiétude s’accentue.
Dans l’hypothèse où nous sommes, se creuse un fond de pensée conséquente : en congédiant Dieu, les hommes ont évacué la transcendance et s’empestent dans un ordre incontrôlable et dangereux pour la sauvegarde de l’être et l’existence. Si bien que, face à la perte de « sa mémoire spirituelle » (Vizguine, 2007, p. 72), l’homme marcherait dans la nuit : « Quant à nous – les meurtriers – livrés à la Mort – l’obscurité est notre demeure », note Buber (1987, p. 27). Cette idée angoissante d’obscurité dévoile le sens de l’inquiétude dans la pensée philosophique de G. Marcel, car celle-ci indique clairement que le progrès actuel suit un processus négateur, induit une perte du sens sacral de l’existence. À la lecture de Les hommes contre l’humain, on découvre, avec G. Marcel, qu’il y a « une crise métaphysique » (1951, p. 33), c’est-à-dire que l’être profond de l’homme a perdu son poids d’être et vit un tragique sans nom. Cette crise métaphysique est, pour l’homme, la perte du repère ontologique de l’existence parce qu’il se serait vautré dans une rationalité qui ne le dispense pas d’inquiétude. En se refusant le sacré qui est, pour G. Marcel, le repère ontologique qui devrait guider et orienter la prise des initiatives de l’homme, ce dernier s’est vidé de sa consistance d’être et se rend incapable de mener une existence authentique, c’est-à-dire une vie sans problèmes existentiels. Or, en occultant la transcendance, c’est-à-dire Dieu, l’homme a développé un humanisme technologique et politique qui n’a pas pu le prémunir de la crise éthique, de la crise d’être. Non seulement l’être a perdu ses racines, mais aussi et surtout il n’arrive plus à donner sens à l’histoire. Par conséquent, G. Marcel considère que nous sommes entrés dans « un âge eschatologique » (Idem, p. 59). Il s’explique en ces termes :
Je ne veux pas dire nécessairement par là que ce que nous appelons d’un mot d’ailleurs équivoque la fin du monde soit chronologiquement proche ; il me paraîtrait téméraire et même puéril de se livrer sur ce point à une prophétie quelconque. Mais ce qui importe, c’est que l’homme en tant qu’espèce ne puisse pas ne pas s’apparaître aujourd’hui comme doué, s’il le veut, du pouvoir de mettre fin à son existence terrestre. Il ne s’agit plus seulement d’une possibilité lointaine et vague, évoquée par quelque astronome quinteux du fond de son observatoire – mais d’une possibilité rapprochée, immédiate, et dont le fondement est dans l’homme lui-même (Ibidem).
De cette remarque, nous observons que l’inquiétude marcellienne devant ce « monde cassé », tiendrait au fait que l’homme pourrait se rendre incapable de réaliser une réalité historique et sociale dans laquelle il vivrait quiet. Mais ce qui inquiète plus, c’est qu’à l’âge de la technique où nous en sommes, avec la profanation de l’univers par les techniques, l’homme a perdu la conscience de soi, c’est-à-dire les « régulations transcendantes qui lui permettent de repérer sa conduite ou ses intentions » (Idem, p. 58). Il est devenu « de plus en plus désarmé devant les puissances destructrices autour de lui et devant les complicités que celles-ci rencontrent au fond de lui-même » (Ibidem). On ne devrait nullement occulter les réflexions marcelliennes sur cet âge de la technique, car c’est de ces observations qu’il affirmât que le suicide est devenu possible à l’échelle planétaire. Cette possibilité du nihilisme, de l’auto-flagellation, de l’automutilation de l’homme par lui-même tiendrait au fait que nous tombons dans une perte de l’espoir. Car « quelque espoir que nous gardions et que nous soyons tenus de garder jusqu’au bout, il n’en est pas moins vrai, indiscutablement vrai, que nous avons devant nous la possibilité d’une catastrophe qui risque d’entraîner la disparition de tout ce qui donne à la vie sa valeur et sa justification » ( G. Marcel, 1951, p. 173).
Pour le lecteur de G. Marcel, l’humanisme athée apparaît inconséquent car notre monde s’est profondément désacralisé. Cela signifie que la dimension spirituelle, sacrale de l’existence est tombée totalement en ruine. Cette « véritable autophagie spirituelle » (G. Marcel, 1944, p. 59), en consonance avec le désespoir comme « temps clos » et « prison » (Idem, p. 71), est l’insigne de la fragilité de la puissance et la précarité de l’être. L’homme serait à la recherche de son propre équilibre, et vit de
ces situations extrêmes où toutes les ressources semblent vraiment taries, toutes les chances épuisées – situation du captif seul au fond de son cachot, de l’exil perdu sur une terre étrangère, de l’incurable enfin, qui, jour après jour, sent baisser en lui la flamme et demeure sans voix devant cette désertion de la vie qui continue ailleurs son jeu trêve et sans bruit (G. Marcel, 1944, p. 204).
La genèse des philosophies existentialistes l’explicite mieux :
L’existentialisme, s’est trouvé prodigieusement renforcé par le fait des évènements tragiques de ces dernières années. Le cataclysme effroyable de la guerre mondiale, avec les horreurs dans nom qu’il a comportées, le climat d’insécurité foncière dans lequel l’humanité a vécu, le sentiment d’une sorte d’écroulement de toutes les valeurs jusque-là respectées, l’angoisse qui a étreint les cœurs pendant quelques-unes des années les plus sombres que le monde ait connues (Jolivet, 1948, p. 28).
En observant les crises énumérées par Jolivet, nous réalisons que les conditions d’existence matérielle, le projet-espérance de l’homme contemporain riment avec la défectuosité, le déracinement. Il nous faut dire que l’étoffe et la doublure de notre époque ce sont les crises, les peurs, l’inquiétude constante. Mieux, l’on pourrait même parler de l’idée d’ « une inquiétude facticielle » (Kim Sang Ong-Van-Cung, 2018, p. 27) au sens heideggérien des mots. Il s’ensuit donc que ce que nous avions devant nous, c’est la tragédie d’une humanité qui, dans la crainte et le tremblement, cherche le sens de la vie et réclamant impérieusement des solutions nouvelles. Cette remarque rappelle l’angoisse kierkegaardienne. Pour notre temps qui tangue, gémit devant la terreur mondiale, les crises éruptives, les pandémies sanitaires… l’inquiétude est la réalité. Notre temps rime avec la négation absolue, le paradoxe de l’« Homme-dieu », c’est-à-dire l’échec du projet-espérance porté l’humanisme technologique et politique.
Pour G. Marcel, ces remarques doivent nous éveiller à la responsabilité. N’est-ce pas qu’il y a un désespoir salubre, sauveur ? Convaincu comme Jolivet (1964, p. 143) que « nulle analyse, aucune doctrine, si ingénieuses soient-elles, ne persuaderont à l’homme d’ériger en absolu, comme le veut Heidegger, le néant et l’absurde », G. Marcel pense qu’il nous faudra ordonner l’ordre terrestre à celui de la surnature. « Peut-être un ordre terrestre stable ne peut-il être instauré que si l’homme garde une conscience aiguë de sa condition itinérante », écrit-il (G. Marcel, 1944, Avant-Propos). Et, dans les tréfonds de l’homme retentit un cri, « un appel de détresse » (Idem, p. 42) auquel il ne doit, en aucun cas, faire la « la sourde tragédie d’une âme qui s’enferme de plus en plus dans un exil dont elle tend à perdre la conscience à mesure qu’elle s’y ensevelit davantage » (Op. cit., p. 7-8). D’où cette injonction :
N’oublions pas en effet que la condition générale de l’homme, là même où sa vie paraît normale, demeure toujours celle d’un captif, en raison des servitudes de tous ordres qu’il est appelé à subir, ne serait-ce que du fait de son corps, et plus profondément encore en raison de la nuit qui enveloppe son commencement et sa fin (Idem, p. 78).
Mieux, « moins la vie sera éprouvée comme captivité, moins l’âme sera susceptible de voir briller cette lumière voilée, mystérieuse, qui, nous le sentons avant toute analyse, est au foyer même de l’espérance » (Op.cit., p. 43). Mais il nous faut fonder l’exigence du recours à Dieu, dégager son sens et sa valeur.
2. LES ENJEUX PHILOSOPHIQUES ET THÉOLOGIQUES DE L’« APPEL »
Avant de progresser dans notre étude, clarifions le sens du concept d’« appel ». L’appel est, au regard des conclusions précédentes, un cri de détresse ontologique – silencieux, grave – et vise la recherche de plénitude de l’aséité. L’appel énonce la déréalisation de soi, d’une part, et le besoin de consolation, d’autre part. L’appel est ici percée vers la Lumière éclairée et éclairante… L’appel renvoie à un tâtonnement ponctué par la vision décadente, tragique qui non seulement expose l’homme dans sa fragilité et sa précarité, mais reste tributaire de la déréalisation de l’absolu. L’appel est exigence de transcendance et orienté vers le Dieu–sauveur. Certes, cette analyse se veut non cléricale ou apologétique, mais est aussi un « combat pour Dieu, pour le Concept, pour le Nom » (Buber, 1987, p. 7). Pour poser la nécessité d’un dialogue entre Dieu et l’homme ou un « face-à-face dramatique de l’être limité avec l’Infini » (Idem, p. 23), il est essentiel de dissiper de notre esprit l’idée d’un Dieu « Principe spirituel », conclusion à laquelle tend notre époque avec de plus en plus d’insistance.
Mais de qui Dieu est le Nom ? Pourquoi l’idée d’une invocation aujourd’hui ? Pour poser l’exigence d’une intégration complète et concrète de Dieu dans l’existence humaine, nous devons appréhender « Dieu » comme le « Dieu de la prière », Lui dont l’évocation est inséparable de la foi vivante et de la prière et qui est au-delà de tout schématisme rationnel. Le Dieu auquel fait référence G. Marcel est à coup sûr inséparable de cette vision religieuse qui fait de Dieu le dépositaire de la foi vivante, de la Grâce et du Salut. Osons dire avec Buber (1987, p. 13) que c’est non seulement « Lui auquel songe la multitude torturée en enfer et qui aspire au ciel », mais aussi Lui dont en mettant en lumière « les affinités sécrètes entre la réflexion seconde et la foi » (G. Marcel, 1967, p. 79), nous parvenons à entrer en relation avec, au moyen d’une exigence de transcendance.
Dieu renvoie donc au sacré, au Dieu de la révélation, dépositaire de la foi chez les croyants : Lui qui est au cœur de l’invocation adoratrice. C’est ce qui amène Ange Langrois à dire que « la métaphysique marcellienne est une réflexion sur l’assurance mystérieuse et centrale qui arrache les humains au désespoir, au nihilisme » (2009-2010, p. 33). Autrement dit, l’appel dont il est question renvoie à la correspondance à cette assurance mystérieuse qui peut aider les humains à trouver une vie meilleure. C’est ce qui autorise aussi à dire que « la philosophie marcellienne est celle d’un pèlerinage tragique à la recherche du mystère de l’être sur le chemin éclairé de l’espoir » (Duso-Bauduin, Op. cit., p. 66). Mais ce chemin est un recours à Dieu, car pour sortir des ruines de cet univers encastré, effondré, la pensée marcellienne indique que la destinée de l’homme n’est pas de rester figé dans cette vue désespérée du monde, mais plutôt à s’en soustraire pour s’orienter vers l’être, qui est en apparence le sacré. C’est le Dieu dont l’existence fonde les grandes représentations religieuses du monde et qui ne procède pas de l’imagination, mais plutôt de rencontres vivantes. Ainsi que le témoigne Etienne Gilson (1917, p. 31), « le Dieu vers lequel s’oriente Gabriel Marcel n’est ni une Cause physique, ni une Norme intelligible, mais le Dieu vivant. (…), le Dieu de l’âme religieuse, le Dieu de la prière ».
L’enjeu philosophique de l’appel est cette possibilité offerte à l’homme de prendre conscience du tragique de sa condition, de le transcender, afin de réaliser l’exigence ontologique. La dimension philosophie permet de réaliser que l’appel vaut ici une prise de conscience aiguë, une responsabilité éthique qui signifie un éveil, un dépassement de la conscience tragique pour trouver une réponse ontologique à l’inquiétude de l’homme. Mais dans la métaphysique marcellienne, cette prise de conscience ne se suffit pas à elle seule ; il faut que l’homme opère l’exigence de transcendance pour s’orienter vers le sacré. La souffrance humaine doit cesser d’être un cri silencieux, grave et muet pour devenir un nom, une énergie spirituelle, créatrice de valeurs. C’est pourquoi dans ses moments de grande détresse, de flottements, de dérèglement de sens, quand tout peut s’écrouler, l’être humain devrait s’élever à l’exigence de Dieu comme un appel voire une exigence d’être.
Pour G. Marcel, la prière consacre le relationnel spirituel entre l’homme et Dieu, relation qui profite davantage à l’homme car elle lui permet de parer sa soif d’être. C’est dire que l’exigence métaphysique de la prière ou l’invocation n’implique cependant pas que le non-croyant ne puisse atteindre la transcendance ; elle signifie simplement que l’homme se libère de son inquiétude qui pèse jusque-là sur lui et atteint un certain stade de plénitude. Cette remarque est très pertinente car « réciproquement la prière s’articule à la réflexion, à une réflexion rigoureuse, se concentrant dans une interrogation haletante qui ne s’évanouit pas dans l’agnosticisme, mais se mue en invocation : appel, et accueil d’une lumière transcendante » (Marcel Belay, 2003, p. 56). Dès lors, l’appel est cette quête des racines spirituelle et ontologique dont la réflexion récupératrice permet la possibilité et la réalisation. Celle-ci, à coup sûr, permet à l’homme de recourir à l’appel et la lumière du Toi absolu pour garantir la survie de l’être et le fondement de la liberté véritable. C’est pourquoi la philosophie marcellienne « nous exhorte à garder la conscience en alerte, de façon à ne pas sombrer dans un monde, où la transcendance disparue, toutes valeurs seraient amenées à s’épuiser, et à éviter que la mort comme réalité irréfragable, ne fige l’homme dans ce qu’il n’est pas », écrit Duso-Bauduin (2005, p. 33).
À la vérité, si nous convenons, avec Flam, que « nous vivons actuellement dans la frayeur de la mort collective sous différentes formes, que nous avons créées nous-mêmes » (1964, p. 18), le cri de détresse, le cri qui devient Nom, l’invocation du Toi sauveur prend tout son sens. Si nous nous rappelons les structures de la conscience tragique, si nous reconnaissons le tragique existentiel, le sens de l’appel se dégage de lui-même. L’appel est conscience de la déception profonde de l’espoir suscité par les philosophies de l’immanence, d’une part et conscience d’un éveil qui doit motiver la prise d’initiatives, d’autre part. En effet, si dans l’inquiétude l’âme doit s’attendre au pire ; si l’inquiétude est perpétuellement désespoir probable, alors l’appel se saisit comme nécessité et exigence de poussée vers un éveil, vers un sursaut qui est ici l’aide du Toi absolu. Si du moins nous admettons que le fondement de la conciliation entre bonheur et vertu est Dieu, alors G. Marcel souligne, dans Foi et Réalité, que « la réflexion, toujours là où elle est positive, c’est-à-dire récupératrice, est tenue de reconnaître qu’un être véritablement habité par la foi trouverait sans doute, non pas en lui, certes, non pas dans ses seules ressources, mais dans l’assistance même de Dieu, la force de repousser cette tentation » (1968, p. 162). L’appel se veut être une espérance éternelle, car « l’espérance a pour mission de répondre à un appel de détresse » (1944, p. 42).
À partir d’une lecture de Homo viator, nous découvrons que l’activité réflexive aboutit à l’observation suivante : « Toujours, l’âme se tourne vers une lumière qu’elle ne voit pas encore, vers une lumière à naître dans l’espoir d’être tirée de sa nuit présente, nuit d’attente, nuit qui ne peut se prolonger sans la livrer à tout ce qui l’entraîne en quelque sorte organiquement vers la dissolution » (Op. cit., p. 42). Comme il le précise si bien, l’espérance vise au contraire à la réunion, à la recollection, à la réconciliation. Cela signifie que l’espérance, non seulement rétablit le lien ontologique entre l’homme et Dieu, mais assure et proclame une espérance susurrée, rétablit l’exigence d’être que l’homme a perdu en se désolidarisant de Dieu. Pour le lecteur de Marcel, le recours à la communion avec le Toi absolu est la condition de la véritable participation à l’esprit comme foyer d’intelligence, d’amour, de création, garant de l’exigence ontologique et la de liberté véritable. C’est pourquoi la seule et authentique transcendance consiste en l’invocation adoratrice du Toi absolu. Et c’est ce qui fait dire à Zdenek Kouřím que « l’espérance relie l’homme à la réalité ontologique ; elle n’est peut-être pas à l’initiative de l’homme, elle plutôt la réponse qui surgit en l’homme lorsque la réalité l’y invite, lorsque l’existant le sollicite, quand l’être est déjà là qui l’atteint » (2011, p. 45).
Mais comment réaliser cette exigence de transcendance qu’est l’appel ? Avec quoi appeler ? Nous évoquions plus haut l’idée d’une poussée intérieure, cela signifie que l’appel a lieu dans les tréfonds obscurs de l’âme. C’est dans un tact silencieux, un recueillement que s’opère cet appel déterminant pour la survie de l’être. L’appel est donc une invocation, une prière. Pierre Colin l’exprime en ces termes : « Sois avec moi, afin de m’éclairer et de me guider », ou encore « Je crois en Toi qui es mon Recours unique » (E. Gilson, 1917, p. 102). L’expression « avec » est significative : elle désigne la communion, l’interrelation, la participation et l’engagement ontologiques, sans quoi aucun appel, aucun recours n’est possible. Alors « si le Toi absolu venait à me manquer – ou plutôt si je me refusais à lui – mon exigence de transcendance resterait insatisfaite et mon âme, qui n’est que par l’espérance, serait ruinée » (Op. cit., pp. 102-103). Toutefois, la réalisation de cette exigence de transcendance requiert la Prière et l’Humilité. C’est ce qui aurait manqué aux philosophies de l’immanence. Mais l’appel est avant tout un « appel souverainement libre et gratuit », un « consentement libre et libérateur » (G. Marcel, 1967, pp. 112, 113), quoique la saisie de cet appel s’opère sur le mystère. C’est dire que c’est en présence du mystère que la réflexion récupératrice se change en « appel vers une lumière capable d’éclairer le sens de l’existentiel » (Idem). Dans une perspective heideggérienne, on observera que c’est le Dasein qui est interpellé, mais la banalité quotidienne lui fait écran. Or, chez G. Marcel, l’appel est dialectique : soit l’homme s’éveille de lui-même à la conscience du Sacré, soit c’est le Toi absolu lui-même qui lance l’appel, un appel dont l’écho se retrouve dans les religions révélées : Judaïsme, Christianisme, Islam.
On aboutit à la remarque suivante : de l’inquiétude à l’appel, le lien connexe est la fragilité et la précarité de l’être humain. L’échec des philosophies de l’immanence, la conscience tragique et le tragique lui-même sont autant d’éléments qui posent l’exigence de transcendance, qui se mue en une exigence du Toi absolu chez Marcel. Il est à noter cependant que cette invocation adoratrice écumante dans la philosophie marcellienne n’annihile nullement la Liberté humaine ; bien au contraire elle la renforce par le concourt de la Prière et la Grâce. C’est pourquoi E. Gilson (1944, p. 18) souligne qu’« à la conjonction de l’appel gratuit et du libre hommage de l’homme, la foi est l’union de deux libertés ; le regard d’amour qu’échangent deux êtres personnels ». On comprend aisément qu’il y va d’un plus-être pour la liberté sinon l’âme humaine. Conséquemment, l’ontologie marcellienne nous amène à reconnaître la dimension surnaturelle et à réaliser que « la félicité de notre âme consiste précisément à n’opposer aucune résistance à ce sourd appel qui monte des tréfonds de notre être » (G. Marcel, 1967, p. 94). L’ontologie marcellienne est finalement une philosophie qui souligne la « pleine liberté d’une humanité unie à Dieu » (Claire Guyot, 2001, p. 97). Ainsi, elle se place à « la jointure de l’histoire et du transhistorique » (G. Marcel, 2003, p. 9). Le secret intime que distille la philosophie marcellienne est l’exigence ontologique qui requiert l’invocation à Dieu comme un appel de détresse et une réponse positive à l’inquiétude humaine. C’est l’inquiétude métaphysique créatrice de valeur qui est ici visée dans l’idée d’appel. Mais, si nous dévons réaliser Dieu, ou veiller à « la pensée et la garde de l’être » (Heidegger, 1964, p. 9), vers quelle transfiguration tendons-nous ? Si l’appel signifie responsabilité et éveil vers Dieu, vers quelle aurore ?
3. LE TOI-ABSOLU COMME FONDATION DE L’INTER-SUBJECTIVITÉ ET DU SALUT
Nous proscrivons d’emblée tout moralisme vociférant, toute recette de préceptes et lois – comme c’est le cas dans la pensée ecclésiastique. Il s’agit de montrer comment l’intégration complète du Toi absolu, ou Dieu, dans l’acte d’exister, contribue au rétablissement de l’exigence ontologique et confère un sens à notre existence. Pour montrer par quels chemins la présence au Toi absolu humanise l’homme, trois chemins s’offrent à nous : la Prière, la Grâce et enfin, l’idée d’Immortalité.
S’agissant de la Prière, il est fondamental de dédouaner de l’esprit cette vision dégradée, dégradante et figée de la prière comme une simple demande, un simple supplice, voire une immolation de soi devant la Réalité. Dans la philosophie marcellienne, la prière est un acte de « re-lation », de « co-être », de « présence » voire de « co-présence », dans lequel les êtres en présence communient, interagissent, se mutualisent. À propos, F. Mittl (2011, p. 45) souligne que « la prière ne calcule pas et elle est garante d’un co-esse authentique ancré dans la disponibilité ». L’idée de mutualité, de communion est révélatrice car elle donne à la prière une vocation fondamentale : une alliance éternelle, un voyage éternel, dans lequel l’âme humaine dans la présence présentifiante du Toi absolu se sait en sécurité. L’idée de dévotion, de croyance tire sa raison d’être de cette exigence même. Ainsi que le reprécise F. Mittl, « la prière est ontologique dans le sens qu’elle lie action et recueillement. (…) un acte communicatif qui intègre le créateur et les créatures, l’absolu et le contingent » (Op.cit., p. 45).
La prière est donc un acte de reconnaissance, mais aussi d’adoration, de révérence, de déférence au Créateur, parce qu’IL nous a créés. Elle rappelle à l’homme l’exigence de Dieu, mais bien plus réalise l’accord avec le Toi et tout ce que cela induit comme conséquence. Croire ici ne signifie pas le rattachement à une utopie, à une opinion, mais plutôt reconnaissance et obéissance. Or, le Toi est Lui-même Amour ; Il est le fondement et la finalité de l’acte d’aimer au cœur de la vision religieuse du monde : « Aimer Dieu » et Aimer le Prochain » (Mathieu 22 : 37-39). Si donc il ne peut y avoir de Prière que par et dans l’Amour, donnée capitale de la croyance en Dieu, alors elle humanise. G. Marcel (1967, pp. 114-115) note à propos que : « Même si je prie seul dans ma chambre, on peut et on doit sans doute maintenir que par cette prière ou dans cette prière je me relie à une communauté qui n’appartient pas exclusivement, ou même principalement, au monde invisible. » Cette communauté est d’essence ontologique, parce qu’elle s’opère dans la vie intérieure où l’âme viatique se relie au monde, aux êtres, à l’Être.
Quiconque n’aime pas Dieu et son Prochain ne saurait espérer bénéficier de la légèreté espérante dont seul est capable le Toi absolu. En vérité, seule la prière rend possible l’espérance métaphysique dans la philosophie marcellienne, puisque celle-ci porte les valeurs d’Amour, de Charité, de Service des autres Hommes, d’Hospitalité, de Solidarité. C’est en ce sens que se dégage la contribution de l’appel de Dieu et l’appel à Dieu. Celui qui ne sait pas aimer ne saurait en retour bénéficier de la Grâce, c’est-à-dire « une assistance ou un influx » (G. Marcel, 1944, p. 255). Cela signifie que la grâce prend le caractère d’une assistance spirituelle qui aide l’homme à améliorer son existence.
La Grâce intervient comme une donnée indispensable et fondamentale de l’espérance. La prière rend la Grâce possible, non pas parce qu’elle se réduit à la présence du Toi et à sa reconnaissance, mais parce qu’elle met la Charité au cœur de son ordre. L’ordre de la Grâce est celui de l’Amour. Or, nulle créature ne saurait se refuser l’exigence de l’Amour et espérer en retour, comme par enchantement, la Grâce. Ici, il ne s’agit en aucune manière de la grâce permissive, celle dont toutes les créatures, y compris ceux-là mêmes qui congédient Dieu bénéficient ; mais plutôt de la Grâce du Salut : l’Espérance absolue. Si donc la prière rend la Grâce et l’espérance possible, il faut avoir le courage de dire qu’elle possibilise l’intersubjectivité, la réalise et l’entretient. On pourrait même dire qu’il s’agit ici de la quête des racines célestes, car comme le dit Sylvie Courtine-Denamy (2009, p.94), « le réenracinement passe donc, nous en avons donné des aperçus, par la redécouverte du sacré à tous les niveaux de l’existence ». Il va sans dire que seule la lumière qui tombe continuellement du ciel pourrait fournir à la réalité humaine l’énergie qui renforce les liens fraternels. L’humanité de l’homme ne se possibilise qu’en étant enracinée dans le sacré ou Dieu.
L’idée d’immortalité, thème majeur de la philosophie marcellienne, est aux antipodes de deux mondes : d’une part, elle signifie communion absolue, présence absolue dans et par la Présence présentifiante du Créateur, et, d’autre part, elle relie les êtres entre eux par-delà même la mort. C’est tout le sens de cette parole magique : « Aimer un être, c’est dire, toi, tu ne mourras pas » (G. Marcel, 1971, p. 194). Cette incommensurabilité impondérable de l’Amour qui jaillit et effleure toute conscience qui s’élève à cette vision, est la racine de la morale de la pérennité fraternelle recherchée par Marcel. Si cette vérité parvient à se poser comme l’Universel, la transfiguration de l’humanité tout entière se réalise. Que la détresse ontologique et le besoin de consolation aient amenés l’être humain à souscrire au breuvage du divin ; que soit donc posée, par conséquent, l’idée d’une intégration complète et concrète de Dieu dans l’existence humaine, c’est justement pour fonder solidement une société juste et fraternelle.
À la faveur de ces remarques, On pourrait oser parler de l‘espérance en une « unité spirituelle authentique » (G. Marcel, 1951, p. 165), c’est-à-dire la formation d’une communauté rattachée aux valeurs métaphysiques que seules sont capables de bénéficier ceux qui réussiront à sortir de l’étau de cette civilisation étouffante. Cette idée d’une unité spirituelle ne doit en aucun cas être objectivée ou située comme réalité tangible ; seule la communion des cœurs et des esprits engagés pour la pérennité fraternelle la rendrait possible. C’est ici que l’affirmation de la réalité du Prochain se trouve consacrée. À ce propos, G. Marcel (1951, p. 200) écrit que « nous avons à restaurer dans leur plénitude le sens et l’affirmation du prochain : et nulle part plus qu’ici l’accord de l’Évangile et de la réflexion ne révèle sa fécondité ». G. Marcel insiste sur l’exigence de l’altérité car, pour lui, la notion d’« inter-subjectivité » suppose une ouverture réciproque sans laquelle aucune spiritualité n’est concevable. C’est tout le sens cette remarque singulière :
Si j’ai tant insisté sur l’inter-subjectivité, c’est justement pour mettre l’accent sur la présence d’un tréfonds senti, d’une communauté profondément enracinée dans l’ontologique sans laquelle les liens humains réels seraient inintelligibles ou plus exactement devraient être regardés comme exclusivement mythiques (1967, p. 28).
La plénitude que recherche Marcel est « une plénitude qui s’oppose au vide interne d’un monde fonctionnalisé ainsi qu’à l’accablante monotonie d’une société où les êtres se présentent de plus en plus comme de simples spécimens de moins en moins discernables dans les autres » (1967, pp. 56-57). Malheureusement, la société moderne tend à empêcher l’homme de prêter une oreille attentive à cette voix intérieure, cet appel adressé au plus profond intime de nous-mêmes. « La vie moderne tend à encourager cette inattention, presque à l’imposer, dans la mesure où elle déshumanise l’homme, où elle le coupe de son centre, parce qu’elle le réduit à un ensemble de fonctions qui ne communiquent pas entre elles », écrit-il (1968, pp. 66-67).
Ces remarques témoignent d’une philosophie nourrie, vécue et promue dans « le vacillement de la pensée et du cœur » (1971, p. 195). C’est à juste titre que Gilson affirmât qu’ « en son œuvre l’homme parle directement à l’homme » (1917, p. 2). Cette étude s’apparente à un éveil, à une interpellation proclamée, soit murmurée par Marcel et qui s’étend le long des siècles. Cet appel reste valable aussi longtemps que l’homme déréalisera l’Absolu pour porter son espérance dans les bornes du relatif. C’est pourquoi devant le nihilisme intellectuel et moral de notre temps, G. Marcel s’interroge : « Quelle sorte d’humanité est-on en train de préparer et dans quelle mesure se pose-t-on même cette question ? » (2004, p. 32). Or, dit-il (Idem, p. 33) :
L’humanisme aujourd’hui doit être à la fois une interrogation et un appel. L’interrogation porte sur les conditions dans lesquelles ce que l’on me permettra d’appeler l’humain dans l’homme peut être sauvegardé au cours d’une mutation dont l’ampleur et la rapidité sont propres à créer en nous l’angoisse. Mais l’appel est entendu au cœur de cette interrogation. Il consiste selon moi beaucoup moins dans un ensemble d’énoncés abstraites que dans une méditation qui s’exercera peut-être avant tout sur les hommes qui ont non seulement servi, mais incarné l’humanité et dont l’exemple peut encore nous stimuler aujourd’hui.
Cet appel comme exigence éthique devient donc une exigence de transcendance par laquelle nous pourrions juguler « la dégradation de l’humain dans l’homme » (Z. Kourim, 2004, p. 45), c’est-à-dire à nous rendre capables de fonder une éthique fondatrice de la « parenté spirituelle entre nous » (G. Marcel, 1944, p. 138). Cela voudrait dire que l’appel est ici renoncement à l’autolâtrie pour faire place à une altérité transcendantale, capable de fonder la solidarité. Cette interprétation corrobore bien avec celle qu’il énonça déjà dans Pour une sagesse tragique et son au-delà, où le rôle qui incombe au philosophe est l’éveil et la veille. Z. Kourim (2004, p. 45) explique que ce rôle
signifie dans le domaine spirituel, « faire mûrir, promouvoir et transformer », sans oublier la solidarité et la responsabilité à l’égard des autres. Car « une philosophie digne de ce nom ne peut… se développer et même se définir que sous le signe de la fraternité.
On pourrait ici se rappeler l’appel aux mystiques, aux héros chez Bergson. Sans orgueil ni prétention aucune, sans les objectiver, Bergson a regardé la vie des mystiques de l’extérieur et a découvert qu’ils irradient la morale de la pérennité fraternelle et contribuent éternellement à la création continue de l’Humanité. Ainsi que le dit Bergson (1995, pp. 29-30) :
De tout temps ont surgi des hommes exceptionnels en lesquels cette morale s’incarnait. (…) C’est à eux que l’on s’est toujours reporté pour avoir cette moralité complète. (…) Ils n’ont pas besoin d’exhorter ; ils n’ont qu’à exister ; leur existence est un appel.
Peut-être l’appel des héros réalisera l’avènement de « l’homme transcendantal » ou « l’homme humanisé » (Berdiaeff, 1954, pp. 16, 17), celui qui est au fondement de tout ce que notre humanité aurait réalisé comme progrès dans le domaine moral. On aboutit à l’idée d’une métaphysique de la fraternité comme enjeu de l’appel à Dieu. La métaphysique de la pérennité fraternelle est donc enracinée par la recherche de la pacification totale de l’existence, sans laquelle le tissu éthique et social de notre existence tombe en ruine. Il y va même de la sauvegarde de la dignité humaine et ses assises existentielles, c’est-à-dire de la Liberté qu’on croirait annihiler par l’appel, mais qui est promue et garantie par la communion spirituelle. Il en découle que « les êtres ne peuvent être effectivement reliés les uns aux autres que parce que dans l’autre dimension ils sont reliés à quelque chose qui les dépasse et qui les comprend en soi » (1951, p. 196). Par-là la philosophie marcellienne est une sorte d’anthropologique philosophique et théologique, qui s’éclaire à la lumière de la Foi vivante et la Grâce. Car « seule la transcendance authentique peut laisser subsister la liberté humaine » (Op. cit., p. 183).
Conclusion
Face à la mortelle inquiétude infligée à l’homme par ses propres puissances, la dégradation de l’humain en l’homme, la détresse ontologique, l’inattention à l’autre, la philosophie marcellienne invite à une exigence de transcendance, voire une exigence de Dieu. G. Marcel nous amène à la nécessité d’une exigence ontologique infléchie à l’invocation adoratrice du Toi absolu pour parer à l’inquiétude de l’homme qui vit dans une société marquée par la quantification des rapports sociaux, les crises multiformes. En effet, pour passer à une dimension historique nouvelle, pour restaurer la plénitude d’être de l’homme, pour sauvegarder l’homme et son essentielle dignité, le recours éperdu au Toi absolu est la meilleure option pour G. Marcel. La transfiguration de l’habitat humain ainsi que l’édification d’une société juste et fraternelle reposent sur l’accessibilité à cet éveil qui signifie dans la philosophie marcellienne la responsabilité. Celle-ci apparaît comme la seule capable d’assurer, pour l’humanité, les fondements d’une morale de la pérennité fraternelle. Ainsi que le témoigne Zdenek Kourim (2004, p. 48) :
Si les fondements métaphysiques d’une morale de la fraternité qu’elle nous offre dépassent la contingence temporelle tout en évitant les abstractions de l’absolu, c’est parce qu’ils sont construits pour servir à une vie concrète dans sa quête d’une existence plus humaine, authentique, parce qu’ils émanent d’une vie concrète toujours à l’écoute d’autrui.
En définitive, les lectures marcelliennes indiquent que l’homme contemporain vit une existence déchue, car privé de Dieu – source de la vie et repère ontologique de l’existence. C’est pourquoi G. Marcel invite à un retour au sacré, sinon à Dieu afin de fonder le sens et l’exigence ontologique. Seul le recours et le secours de Dieu est une aide précieuse, car seule la lumière qui vient du ciel peut donner à une existence humaine l’énergie profonde pour être enracinée. La métaphysique marcellienne devient donc celle de la communion : communion à soi, à Dieu afin de bâtir le sens, une existence authentique, meilleure et fraternelle. C’est en ceci qu’on qualifie G. Marcel d’être habité par « une disponibilité intellectuelle en éveil » (Guyot, 2001, p. 93) qui fait de lui un intellectuel en son siècle, un penseur de notre temps.
Références bibliographiques
BERDIAEFF Nicolas, 1954, Vérité et Révélation, Traduit du Russe par Alexandre Constantin, « Collection Civilisation », Neuchâtel, Délachaux et Niestlé S.A, 183 p.
BUBER Martin, 1987, L’éclipse de Dieu, traduit de l’allemand et annoté par Éric Thézé avec la collaboration de Chantal Vérin et Pascalle Seillier, Paris, Nouvelle Cité, 90 p.
COURTINE-DENAMY Sylvie, 2009, Simone Weil, la quête des racines célestes, Paris, Cerf, 151p.
DUSO-BAUDUIN Geneviève, 2005, « L’« Homo Viator » : l’homme de l’espérance », in Diaspora marcellienne, Paris, Présence de Gabriel marcel, pp. 31-46.
GUYOT Claire, 2001, « Une disponibilité intellectuelle en éveil : Gabriel Marcel au CCIF (1947-1972), in Un intellectuel en son siècle, Paris, Présence de Gabriel Marcel, pp. 93-108.
HEIDEGGER Martin, 1964, Lettre sur l’Humanisme, Traduit et présenté par Roger Meunier Paris, Aubier-Montaigne, 193 p.
HUSSERL Edmund, 2012, La crise de l’humanité européenne et la philosophie, Introduction, commentaire et traduction par Natalie DEPRAZ, La Gaya Scientia, 121p.
FLAM Léopold, 1964, L’homme et la conscience tragique, Paris, PUF, 237 p.
KOUASSI-EZOUA Roseline Taki, 2016, « L’homme, une valeur absolue chez Gabriel Marcel », in Politiques de la dignité, Actes du colloque international UFHB, 31 mai – 4juin 2016, (Sous la direction de), Abidjan, NEB, pp. 319-330.
KOURIM Zdenĕk, 2004, « Rencontre avec Gabriel Marcel », in Fraternité Philosophique, Paris, Présence de Gabriel Marcel, p. 35-54.
MARCEL Gabriel, 1968, Être et avoir. II. Réflexion sur l’irréligion et la foi, 1968, Paris, Aubier-Montaigne, 219 p.
MARCEL Gabriel, 1955, L’homme problématique, Paris, Aubier-Montaigne, 192 p.
MARCEL Gabriel, 1944, Homo Viator. Prolégomènes à une Métaphysique de l’Espérance, Paris, Aubier- Montaigne, 357 p.
MARCEL Gabriel, 1951, Les hommes contre l’humain, Paris, A. Fayard, 208 p.
MARCEL Gabriel, 1971, En chemin vers quel éveil ?, Paris, NRF/ Gallimard, 302 p.
MITTL Florian, 2011, « La catégorie de la « présence » comme grille de lecture », in Philosophe de l’espérance, Paris, Présence de Gabriel Marcel, pp. 35-50.
ONG-VAN-CUNG Kim Sang, 2018, « Certitude et inquiétude du sujet. Foucault et Heidegger lecteurs de Descartes, in Methodos, vol.18. Mis en ligne le 24 janvier 2018, consulté le 5 septembre 2021 à 16h50mn. URL : http : // journals.openedition.org/Methodos/1983.
TSUKADA Sumiyo, 2005, « La réflexion sur l’existence et l’être chez Heidegger et Gabriel Marcel », in Diaspora marcellienne, Paris, Présence de Gabriel Marcel, pp. 47-55.
VIZGUINE Victor, 2007, « Une proximité lointaine. Nicolas Berdiaeff et Gabriel Marcel », in Don et Liberté, Paris, Présence de Gabriel Marcel, pp. 45-65.
« SEUL UN DIEU PEUT ENCORE NOUS SAUVER » DÉCRYPTAGE ET LECTURE ANALYTIQUE D’UNE EXPRESSION ÉNIGMATIQUE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ET DE CORONAVIRUS
- Gervais KISSEZOUNON
Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
- Roland TECHOU
Ecole Normale Supérieure (Bénin)
Résumé : « Seul un dieu peut encore nous sauver » sonne le glas de l’arraisonnement du monde. Il ouvre la voie à une perception renouvelée de l’être humain voire de sa capacité à « donner sens et existence au monde ». A l’ère de « l’insuffisance de la raison suffisante » (Jean-Luc Marion, Etant donné), le mot de Heidegger retrouve son sens. Il ne s’agissait pas pour le philosophe d’entériner le nihilisme nietzschéen encore moins de saper les bases de l’humanisme traditionnel. Mais le penseur du sens de l’être cherche à faire écouter « la Nouvelle tonalité affective de l’être humain » dont la technique contemporaine fait entendre l’écho. Pour l’avoir ainsi analysé afin de saisir le sens du numérique contemporain (ontophanique et techno-transcendantal), il nous a paru nécessaire d’y associer l’herméneutique philosophique de la situation pandémique actuelle du monde pour rechercher l’issue du divin encore possible dans notre monde.
Mots-clés : DIEU, TECHNIQUE, NUMERIQUE, HEIDEGGER, ONTOPHANIQUE, SENS.
Abstract : “Only a god can still save us” is the death knell for the arrest of the world. It paves the way for a renewed perception of the human being and even of his ability to “give meaning and existence to the world”. In the age of “the inadequacy of sufficient reason” (Jean-Luc Marion, Given), Heidegger’s word regains its meaning. It was not for the philosopher to endorse Nietzschean nihilism, much less to undermine the foundations of traditional humanism. But the thinker of the sense of being seeks to make listen to “the New Emotional Tone of the Human Being” whose contemporary technique echoes. To have thus analysed it in order to grasp the meaning of contemporary digital (ontophanic and techno-transcendental), it seemed necessary to associate it with the philosophical hermeneutics of the current pandemic situation of the world in order to seek the outcome of the divine still possible in our world.
Keywords: GOD, TECHNICAL, DIGITAL, HEIDEGGER, ONTOPHANIQUE, SENSE..
Introduction
Le texte ici considéré est dans sa version originale : « Nur noch ein Gott kann uns retten ». Il est initialement paru dans le journal der Spiegel le 31 Mai 1976 à la suite d’un entretien réalisé le 23 Septembre 1966. Pour restituer le contexte général de l’entretien, il faut dire qu’il est structuré en deux temps. Le premier temps : retour sur les rapports troubles de Heidegger avec le Nazisme et le deuxième temps : le rôle de la pensée et de la philosophie à l’époque déterminée par la technique.
Nous nous donnons pour tâche à travers les présentes réflexions, d’analyser l’énigmatique réponse de Martin Heidegger à l’une des questions qui lui furent posées et qui va servir de titre à tout l’entretien. Le journal « der Spiegel » demande en effet au philosophe Heidegger si « l’individu peut encore influencer d’une quelconque manière sur ce tissu de fatalité, ou bien la philosophie le peut-elle, ou les deux ensemble peuvent-ils y parvenir dans la mesure où cette philosophie conduirait l’action d’un ou plusieurs individus ». Et Heidegger de répondre : « […] La philosophie ne sera pas en mesure d’apporter un changement direct de l’état actuel du monde. Ceci est vrai non seulement de la philosophie, mais de toutes les méditations et entreprises purement humaines. Seul un dieu peut encore nous sauver » (M. Heidegger, Entretien avec der Spiegel, 23 septembre 1966, trad. P ; Krajewski).
La question soulevée et qui mérite analyse est de savoir si à l’âge technique qui est le nôtre et dont le numérique est le paroxysme, « la voix de Dieu » reste encore audible. Ou serait-elle recouverte par le « vacarme des machines » voire le silence irradiant du numérique absorbant actuel en provocation de la dispersion de l’être humain (GA 13, 89) ? De quel dieu parlons-nous alors ? Le « saut de la pensée » (Salut) est-il assez salutaire pour provoquer l’autre commencement, celui de l’avènement du dieu sauveur, du « dernier dieu » ? La crise sanitaire actuelle qui livre l’incertitude de toutes nos certitudes n’est-elle pas aussi révélatrice de l’attente d’un dieu aussi divin tant attendu des humains ?
Pour répondre à ces préoccupations, nous nous reportons sur le terrain herméneutique où le rapprochement avec la situation actuelle du monde marquée par la pandémie du coronavirus annonce l’apologie du numérique dématérialisé. Peut-on oser dire que le penseur de Fribourg fut le prophète des temps postmodernes ? En quoi consisterait cette prophétie ? La tâche de la pensée à laquelle éveilla ainsi le penseur du sens de l’être s’accomplirait-elle maintenant seulement ? L’approche sera tripartite, c’est-à-dire à la fois généalogique (contexte d’émergence du texte) problématique (notre propre hypothèse de travail) et analytique (rapprochement avec l’actualité). L’objectif pour nous est de faire comprendre pour l’aujourd’hui de la situation du monde, marqué à la fois par l’émergence du numérique et l’avènement de coronavirus, l’énigmatique phrase lancée au regard de la dévastation du monde.
1. CONTEXTE HISTORIQUE POLÉMIQUE : L’ENGAGEMENT NAZI DE HEIDEGGER
1.1. Contexte d’énonciation de l’énigmatique déclaration : l’échec du nazi
L’Allemagne est toujours troublée. Son plus grand héritage philosophique du 20ème siècle est détenu par un philosophe nazi. Le journal Der Spiegel décide d’interroger le penseur lui- même sur ce qu’aura été ce sombre passé. Martin Heidegger se prête au jeu de questions-réponses et enfonce dramatiquement le clou comme on devrait s’y attendre. Il rappelle que face au déferlement technique du matérialisme américain et soviétique, plus aucune issue ne provient de l’humanisme. Le salut doit venir d’ailleurs et non plus de l’homme. Qu’en est-il du salut et de cet « ailleurs » ?
L’entretien tenu en septembre 1966, a été publié 10 ans plus tard, notamment le 31 mai 1976 soit cinq jours après le décès de Heidegger. En effet, le journal Spiegel voudrait comprendre et faire comprendre les liens gênants de Heidegger avec les Nazis. La toute première question posée au professeur en témoigne :
Professeur Heidegger, nous pouvons noter que votre travail philosophique n’a eu de cesse d’être quelque peu assombri par des incidents de votre vie qui, même s’ils ont été assez brefs, n’ont jamais été clarifiés, soit que vous fûtes trop fier soit que vous n’ayez pas jugé opportun de les commenter (M. Heidegger, Entretien avec der Spiegel, 23 septembre 1966, trad. P. Krajewski).
Ce fut-là le fil conducteur des questions de la première partie de l’entretien. Elles tournaient autour du rectorat de l’Université de Fribourg entre Mai 1933 et Mai 1934. Cette période trouble que va marquer un discours-programme énonçant l’engagement de l’université allemande à soutenir le Führer concerne également les rapports troubles de Heidegger avec ses amis notamment Karl Jaspers et Husserl. La conception de l’autodétermination de l’université allemande embrasse également les préoccupations relatives à la fin de la deuxième guerre mondiale et le rôle que y joua l’Allemagne. Entre autres réponses, le philosophe (Heidegger, 1966) affirme :
Dès 1929, dans ma leçon inaugurale donnée à Fribourg qui sera publiée sous le titre « Qu’est-ce que la métaphysique ? », j’avais expliqué la raison essentielle qui allait me décider à prendre la charge du rectorat : « les domaines des sciences se trouvent éloignées. Les façons dont ils traitent leur sujet sont fondamentalement différentes. Cette multitude éparpillée des disciplines ne concerne aujourd’hui sa cohérence que par l’action de l’organisation technique des universités et de ses facultés et elle ne conserve un sens qu’en raison des buts pratiques poursuivis par les départements. En revanche, l’enracinement des sciences dans leur essentiel fondement est mort ». Ce que j’ai essayé de faire au cours de mon mandat eu égard à cet état des universités (qui s’est, jusqu’à aujourd’hui extrêmement détérioré) est expliqué dans mon discours du rectorat. (M. Heidegger, Entretien avec der Spiegel, 23 septembre 1966, trad. P. Krajewski).
Quant à la deuxième partie de l’entretien, il porte sur le rôle de la pensée et de la philosophie à l’époque déterminée par la technique. Une conception planétaire de la technique s’est imposée, constate le penseur : « La technique est par essence quelque chose que l’homme ne peut pas maîtriser de son propre chef ». Elle est devenue déterminante du vécu de l’Homme à telle enseigne qu’elle installa l’arraisonnement du monde :
Tout fonctionne. C’est exactement ce qui est étrange. Tout fonctionne et le fonctionnement nous pousse toujours plus loin vers toujours plus de fonctionnement, et la technique déchire les gens et les arrache de plus en plus à leur terre…. Nous n’avons pas du tout besoin d’une bombe atomique ; le déracinement de l’homme est déjà en cours. Nos conditions de vie sont devenues purement techniques ». (M. Heidegger, Entretient avec der Spiegel, 23 septembre 1966, trad. P ; Krajewski).
La philosophie elle-même perd son rôle de guide au cœur de cet arraisonnement du monde. Devenue innommable la philosophie occidentale rationnelle de même que les courants orientaux sont délaissés au profit de la cybernétique. Et c’est là que le philosophe n’hésite pas à indiquer la voix de recours :
Si je peux répondre rapidement et peut-être un peu hardiment, mais c’est là le fruit d’une longue réflexion, je dirais : la philosophie ne sera pas en mesure d’apporter un changement direct de l’état actuel du monde. Ceci est vrai non seulement de la philosophie, mais de toutes les méditations et entreprises purement humaines. Seul un dieu peut encore nous sauver. Je pense que la seule possibilité de salut qu’il nous reste est de nous préparer à être disponible, par la pensée et par la poésie, à l’apparition du dieu ou à son absence durant le déclin ; et ainsi, pour le dire simplement, nous ne mourons pas des morts vides de sens, mais en déclinant, nous déclinons devant le visage du dieu absent ». (M. Heidegger, Entretient avec der Spiegel, 23 septembre 1966, trad. P. Krajewski).
Pour Heidegger « une autre forme de pensée, poétique, peut nous aider à nous préparer à nous rendre disponible à l’arrivée ou à l’absence d’un dieu, seul sauveur possible » (Idem). De ce contexte restitué où fut prononcée l’énigmatique phrase, on peut en mesurer les conséquences pour la pensée philosophique en général. C’est l’enjeu du décryptage auquel nous allons maintenant procéder.
1.2. « Seul un dieu peut encore nous sauver » : recours éthique contre le nihilisme technologique
Il s’agit pour nous de décrypter une phrase énigmatique et d’entrevoir le sens de l’énigme à l’aune de la double situation du monde présent : l’avènement du numérique et l’évènement de Covid 19. A l’âge technique qui est le nôtre et dont le numérique est le paroxysme, « la voix de Dieu » reste-t-elle encore audible ? Ne serait-elle pas recouverte par le « vacarme des machines » ou le silence irradiant du numérique ? Se demander, au travers d’un essai de décryptage herméneutique de l’expression énigmatique de Heidegger, si la voix/e de Dieu est encore audible dans ce monde hautement technicisé et numérisé est tout l’intérêt de ce décryptage.
Considérons d’entrée de jeu le contexte de l’entretien que nous venons de restituer avec pour cible le nihilisme provoqué par le nazisme. Heidegger s’indigne du rôle que la philosophie notamment la pensée philosophique en tant que méditation sur la condition humaine pourrait encore jouer au cœur de ce désastre. Il s’agit ici pour nous, afin de réussir notre jeu de décryptage, voire de dévoilement et de déchiffrement de considérer ce qui aura provoqué ce désastre et par la suite les conséquences de son avènement. Ce syllogisme entre ‘’l’avant et l’après’’ se situe dans l’horizon technocritique, éthique et politique que vise la déclaration.
La préoccupation de Heidegger est de faire percevoir le devenir global de l’humanité assujetti par la domination technique du monde. Heidegger n’est pas technophile. Il éprouve cependant un sentiment de « déclin » en face de la domination technique du monde. C’est à ses ouvrages précédents et notamment aux commentateurs fidèles qu’ils soient détracteurs ou non qu’il nous faut nous référer pour percevoir ce sentiment que le philosophe voudrait aiguiser en chacun au regard de la dévastation annoncée du monde. L’Introduction à la métaphysique de 1935 en soulignant « la décadence spirituelle de la terre » telle qu’elle se manifeste à travers le règne planétaire de la technique, confirme bien cet état des choses.
En un temps où le dernier petit coin du globe terrestre a été soumis à la domination technique et est devenu exploitable économiquement, où toute occurrence qu’on voudra, en tout lieu qu’on voudra, à tout moment qu’on voudra, est devenu accessible aussi vite qu’on voudra, et où l’on peut vivre simultanément un attentat contre un roi en France et un concert symphonique à Tokyo…. alors à une telle époque, la question pour quel but ? où allons-nous ? Et quoi ensuite ? Est toujours présente et à la façon d’un spectre traverse toute cette sorcellerie. La décadence spirituelle de la terre est déjà si avancée que les peuples sont menacées de perdre la dernière force spirituelle, celle qui leur permettrait du moins de voir et d’estimer comme telle cette dé-cadence. Cette simple constatation n’a rien à voir avec un pessimisme concernant la civilisation, rien non plus, bien sûr, avec un optimisme ; car l’obscurcissement du monde, la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l’homme, la suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre tout cela a déjà atteint sur toute la terre de telles proportions que des catégories aussi enfantines que pessimisme et optimisme sont depuis longtemps devenus ridicules. Nous sommes pris dans l’étau (M. Heidegger, 1935, p.49-50).
Mais, la puissance planétaire du mouvement de la technique est-elle si dominante que l’homme doit s’avouer incapable de lui opposer une réponse appropriée en laissant le soin de cette tâche à une transcendance ? Quelle serait la figure originaire du « Dieu » auquel Heidegger invite à recourir ? Dans le même texte, il énonce que « si l’on ne veut pas que la grande décision concernant l’Europe se produise sur le chemin de l’anéantissement, c’est précisément par le déploiement de nouvelles forces, spirituelles en tant que proventuelles, issues de ce centre qu’elle doit se produire » (Idem, p. 50). La technique n’est pas cependant le seul pôle d’inquiétude. La politique dont le nazisme constitue le déclin est aussi interpelée.
Aux yeux de Heidegger, même la démocratie, expression la plus élevée de la vision politique du monde moderne, ne peut être une réponse à cette domination. C’est donc à tort que les modernes s’acharnent sur une forme de gouvernance pensant y trouver la voie royale du salut du seul fait qu’il est question du « pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ». Les réponses de Heidegger sont pessimistes il faut se l’avouer. Dans l’interview, le philosophe juge les valeurs de la démocratie modernes inopérantes face à la montée totalitaire du règne planétaire de la technique. « La démocratie, l’expression politique de la vision du monde, l’État de droit, je les appellerais des demi-mesures parce que je ne vois dans tout cela aucune véritable mise en question du monde technique » (M. Heidegger, Ecrits politiques).
Mais, pourquoi la démocratie est-elle traitée par Heidegger comme une demi-mesure? Le philosophe de Messkirch, à travers la critique de la modernité, souhaite certainement se livrer à la phénoménologie d’une voie qui lui semble plus appropriée pour faire barrage à la domination technique. Heidegger pense que c’est par la domination que l’humanité pourra venir à bout de la domination technique. C’est à juste titre que des études aujourd’hui telles Ferry Luc et Renaut Alain, Heidegger et les modernes, paris, grasset et fasquelle, 1988 ; Palmier Jean.-Michel Les écrits politiques de Heidegger, Paris, L’Herne, 2016, montrent que « le nazisme n’est pas un accident survenu au peuple allemand, mais doit être compris dans la logique de son histoire. Il a été préparé dans un contexte qui n’est pas autre que celui dans lequel s’est forgée la pensée de Heidegger. La cohérence de l’évènement historique doit être mise en rapport avec la cohérence de la production philosophique » (J. Quillien, 1990, Germanica, 8, p.103-42)
La pensée de Heidegger aura donc contribué à l’avènement de l’État totalitaire, à la fois comme conséquence et comme réponse nécessaires au déploiement de la technique. Selon cette perspective, la correspondance avec la technique requiert, pour traduire et exprimer politiquement ses exigences, un totalitarisme. Dans cette logique, le modèle politique fondé sur l’autonomie du sujet, c’est-à-dire la démocratie, doit se laisser transcender par un système politique plus apte à accomplir les exigences de la modernité. Et le modèle politique le mieux en phase avec la planétarisation de la technique, c’est le nazisme. Ce choix scientifique qui a eu, au niveau du penseur, un répondant politique, a soulevé des polémiques très nourries entre heideggériens d’obédience orthodoxe et dissidents sur la question de l’engagement du philosophe de la forêt noire. Emmanuel Faye n’hésite pas aujourd’hui à dénoncer cette dérive totalitaire dont regorge la pensée du penseur de la forêt noire. (Heidegger à plus forte raison et Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie).
La domination que l’homme subit de sa situation dans le monde technicisé n’est pas une malédiction à laquelle il ne peut échapper. Il lui faut simplement s’investir dans l’établissement d’une relation satisfaisante avec la technique. Et, déclare Heidegger dans der Spiegel, « le national-socialisme est bien allé dans cette direction ». (M. Heidegger, Ecrits politiques). Ce mouvement, malgré son insuffisance de fait, était, dans sa vérité inaugurale, pour lui, sur la bonne voie : celle de l’élaboration d’une libre relation avec le monde technique capable de faire face à l’américanisme, c’est-à-dire à ce déferlement de produits de la technique sur l’ensemble de la terre. Le national-socialisme qui constitue, aux yeux de Heidegger, ce que L. Dumont a appelé « singulier mélange de traditionalisme et d’hypermodernisme » s’est révélé, contre toute attente, incapable de pleinement correspondre à l’époque de la technique, au point où Heidegger, comme s’il était au bord du pessimisme, abdiquait en ces termes :
La technique dans son être est quelque chose que l’homme, de lui- même, ne maîtrise pas….Si vous me permettez une réponse et peut-être un peu massive, mais issue d’une longue réflexion : la philosophie ne pourra pas produire d’effet immédiat qui change l’état présent du monde. Cela ne vaut pas seulement pour la philosophie, mais pour tout ce qui n’est que préoccupations et aspirations du côté de l’homme. Seulement un Dieu peut encore nous sauver. Il nous reste pour seule possibilité de préparer dans la poésie une disponibilité pour l’apparition de ce Dieu ». (M. Heidegger, Ecrits politiques, p. 260).
1.3. De l’écoute attentive de la Parole poétique
La poésie se trouve être l’ultime alternative à la déréliction nihiliste de la technique moderne. Procédant de la métaphysique, le nihilisme, pour être jugulé, demande que soit dépassée la source dont elle procède. La décadence, Nietzsche, comme Heidegger, la pensent à la fois comme conséquence et avènement du nihilisme. En tant que tel, elle ne peut rien produire d’autre que la détresse. Comment alors transfigurer l’abime et l’indigence de cette détresse ? C’est ici qu’intervient, dans l’œuvre de Heidegger, la poésie au sens originaire du mot. En référence à Hölderlin qui s’interrogeait dans son Élégie : wozu Dichter in dürftiger Zeit : « pourquoi des poètes en temps de détresse ? » Heidegger, à l’occasion du vingtième anniversaire de la mort du poète Rainer Maria Rilke, s’interrogeait en ces termes : wozu Dichter : pourquoi des poètes ?
La poésie en effet dans l’œuvre de Heidegger occupe une place de choix. C’est elle Das Andere Denken, l’Autre Pensée, qui doit délivrer de la situation présente. Le rapprochement de la poésie avec la question de Dieu se situe dans le sillage d’une pensée méditante voire méditative pour retrouver l’originaire de toute pensée entre temps assujetti par le dévoilement technologique. Le numérique contemporain ainsi que Coronavirus conduisent non pas à l’achèvement du monde mais à l’offrande de la voie de méditation capable de faire percevoir l’horizon de dématérialisation (numérique) et de spiritualité (Coronavirus). Seule une posture de poète permet d’envisager ainsi ces forces de dévastations apparentes qui adviennent. Dans « l’homme habite en poète », conférence de 1951, qui reprend un titre de Hölderlin, on lit : « nous nous trouvons ainsi en face d’une double exigence ; d’abord penser ce qu’on appelle l’existence de l’homme en partant de l’habitation ; ensuite comme un « bâtir » (Bauen), peut-être comme le « bâtir », par excellence. Si nous cherchons dans cette direction l’être de la poésie, nous parviendrons à l’être de l’habitation ».
Avec Heidegger, nous entrons donc dans une ère philosophique qui institue un dialogue entre pensée et poésie, une ère où la pensée n’est plus considérée comme simple activité de la raison et la poésie comme une activité simplement imaginative et sensible. Ce dialogue ainsi institué par Heidegger entre poésie et pensée n’est tel que parce que l’être humain est pensé à partir de la mise en résonance de la parole : « Plein de mérites, mais en poètes, l’homme habite sur cette terre » (Hölderlin) . Tel est le poème dont Heidegger fait le commentaire (Cf. R. Matar-Pierre, 2011). C’est dans le rapport à la parole que poésie et pensée se rencontrent. Autrement dit, c’est à partir de l’écoute de la parole que s’ouvre l’entente proprement heideggérienne de la poésie.
La poésie, entendue de la sorte, non comme un genre littéraire, mais comme Dichtung, est un dire en général, une manière de montrer la dimension au sein de laquelle va pouvoir habiter l’être humain sur terre. Ici se retrouve le sens profond de la Parole autour de laquelle les humains façonnent le vivre ensemble. Jacob Agossou, philosophe et théologien béninois soulignait à juste titre « O xo man gni mindé gbè » (la parole n’est l’égale de personne). Rejoignant ainsi le Prologue de Saint Jean : « Au commencement était la parole » ou encore : « Le verbe s’est fait chair ». On perçoit combien le langage poétique rend favorable le séjour de l’humain sur la terre, obligé d’adresser des paroles (Prières) aux dieux pour subsister. La poésie du langage où la langue poétique prouve ainsi l’aspect fondamentalement éthique de la pensée de Heidegger. Le philosophe, soulignons-le, abandonne le terme éthique trop marqué par la modernité, selon lui, en faveur de l’ethos grec qu’il rattache au sens, tout particulier, de Wohnen “habitation”. Dans la mesure où l’éthique évoque le comportement « Verhaltnis », « Habiter la terre en poète » c’est retrouver à travers le comportement l’éthique de l’existence humaine.
Si l’être humain se dispose à habiter en poète, à écouter la parole poétique, cette parole qui parle, alors il pourra entrer dans une nouvelle relation avec la technique et la politique. Les poètes sont ceux qui, au milieu du temps de la détresse et de la fuite des dieux, caractéristiques des Temps Modernes, recherchent les traces du sacré. Être poète en temps de détresse, c’est, dit Heidegger, être attentif à la trace des dieux enfuis. Autrement dit, c’est séjourner ou demeurer dans le Quadriparti unissant le Ciel et la Terre, les Divins et les Mortels. « Les poètes sont ceux des mortels qui, chantant le dieu du vin, ressentent la trace des dieux enfouis, restent sur cette trace, et tracent ainsi aux mortels, le chemin du revirement ».
Le salut de l’humanité en face du déferlement technique qui s’impose doit être recherché du côté de l’idée grecque du divin. Qu’y a-t-il de divin dans la pensée grecque pour qu’elle serve de paradigme à toute vision divine du monde ? La philosophie se substitue-t-elle ainsi à la pensée ? Qu’est-ce que pensée et penser Dieu à l’ère de la technique ?
2. LECTURE ANALYTIQUE DE LA DÉCLARATION : ESSENCE DE LA TECHNIQUE À L’ÈRE DE CORONAVIRUS
Dans l’attente du dieu sauveur tel que Heidegger l’envisage hors contexte métaphysique, la pensée ne peut rien, disions-nous, « mais la philosophie, elle, est à bout ». Face à la mort déclarée de la philosophie à pouvoir servir encore efficacement l’ordre du monde, malgré les grandes glorioles qu’elle a connues, Heidegger suggère « un autre type de pensée ». C’est cette autre pensée, celle poétique, Das andere Denken « qui sera en mesure d’affronter le règne de l’arraisonnement » déclare-t-il. Il nous faut saisir l’essence de la technique pour en mesurer la portée problématique et surtout sa contribution à penser extrêmement le divin.
2.1. La question de l’essence de la technique
Pour Heidegger, la technique moderne est la manifestation ultime de la volonté de puissance. Et là se note le danger le plus grand de l’époque. Car souligne Dominique Janicaud (D. Janicaud, 1987, p. 220) : « Nul ne peut contester qu’en un laps de temps relativement court (en comparaison de l’histoire et surtout de la préhistoire de l’humanité) les sciences et les techniques ont transformé notre planète au point d’ébranler des équilibres écologiques et ethnologiques immémoriaux, au point surtout de faire douter l’homme du sens de son existence et de ses travaux, jusqu’à faire vaciller sa propre identité ».
Ainsi « Plus l’homme se prend pour le « seigneur de la terre », plus il devient une simple pièce du « dispositif technique ». L’essence de la technique diffère donc de sa disponibilité comme instrument. Elle apparaît comme la figure ultime de la métaphysique. Dans Essais et conférences recueil de textes parus en 1954, Heidegger qui, entre autres, y publie « la question de la technique », intitule l’ensemble des conférences : « Regard dans ce qui est ». Ce n’est plus seulement comme un assemblage de matériaux et d’outils qu’il faut voir la technique, mais il urge, en remontant au grec, de l’envisager véritablement comme la techné (τέχνη ) : « la (τέχνη ) « qui désigne l’une des cinq manières, selon Aristote dans l’Ethique à Nicomaque d’avérer, c’est-à-dire de dévoiler la vérité » (Dominique Saatdjian, dictionnaire Heidegger, art. Technique, p.1274, 2013).
La technè, originellement, n’était pas un matériel à usage, mais un savoir, « un savoir, un tour de main, dans le sens où l’artisan sait comment s’y prendre pour « faire apparaître » : c’est un mode, parmi beaucoup d’autres, de l’alètheuein, du déceler, ou capacité de dévoilement de l’« homo faber » ». (Idem). Le concept de dévoilement reste à la fois intrinsèque et approprié à la technique y compris dans son versant moderne à l’exception cependant du fait que le dévoilement au sens moderne est devenu « une provocation », « une mise en demeure adressée à toutes choses d’apparaître comme un fonds ou un stock disponible » (Idem). C’est le règne de l’arraisonnement encore appelé « dispositif » (Das-Gestell). Le drame provient du constat « déconcertant » selon lequel « le basculement soudain, qui voit tout d’un coup « les choses présentes, par exemple : la nature, l’homme, l’histoire, le langage se mettent en évidence, séparément, en tant que réelles dans leur « objectivité » »[4] (Dreyfus, 1986, p. 292). Renversant la perception ordinaire des relations entre la technique et la science, le penseur de Fribourg montre que c’est « la science qui est au service de la technique et non l’inverse » : « L’agriculture moderne met la nature en demeure de produire les fruits qu’elle porte en elle » (Idem). Le drame devient phénoménal. Car, « le monde de la technique, avec sa géométrisation et sa mathématisation, demande un espace neutre, uniforme et universel.
Les lieux traditionnels, qui manifestaient historiquement la capacité des choses à rassembler (à l’exemple souvent choisi du vieux pont qui fonde une ville), disparaissent dans l’espace uniformisé, note « Michel Haar » (1986, p. 347). Il en résulte que c’est derrière des représentations instrumentales que se dissimule l’essence de la technique laissant croire que l’homme est « maitre et possesseur ». C’est de là qu’il faut retrouver le sens métaphysique et non technologique de la métaphysique. Car, la technique, sous sa forme heideggérienne, est un « mode de dévoilement de l’étant » voire un « moment de la vérité de l’être ». D’où l’affirmation de La Question de la technique (1953) : « L’essence de la technique n’est rien de technique ».
Le danger, si danger il y a, se retrouve dans « La « calculabilité intégrale » [qui] consomme l’indifférence de l’objet mais aussi du sujet ; cette calculabilité constitue le déploiement de l’être de la technique moderne, das Wesen der Technik (F. Dastur, 2011, p. 123): « Commencé avec Descartes, ce danger va atteindre le sujet lui-même au point de lui faire perdre son caractère de « Vivant » (Dilthey) cette Lebendigkeit , autrement dit cette capacité de vivre par eux-mêmes et qu’ils étaient devenus des hommes sans histoire, geschichtslos“ dans la mesure où leur vie se trouvait dominée par le « mécanisme » (Ibidem). « Le propre du « mécanisme », qui accompagne la technique, c’est d’expliquer toute vie, y compris la vie psychique, en partant d’éléments isolés et non pas de la cohésion du sens du vécu » (Ibidem).
2.2. La pensée de Dieu à l’extrême
On le voit bien, Heidegger n’est ni technophile, ni technophobe, mais technocritique. Sa vision des choses s’inscrit à l’encontre de celle du commun des mortels. Ce serait en ce sens oublier qu’il s’agit là d’une pensée qui aura opéré le « retour au commencement ». Nous sommes avec Heidegger dorénavant en « Ontologie fondamentale » dont il ne sortira jamais d’ailleurs et ce, au détriment de l’ontologie métaphysique ou de la subjectivité. On le voit d’ailleurs, à l’ère de la technicité du monde, le Gestell place l’homme lui-même comme fond pour la technique et modifie son rapport avec tous les domaines du savoir. C’est donc à tort qu’on parle d’une technophobie de la philosophie de Heidegger car :
Méditer sur le danger du Gestell ne revient pas à le dénoncer, au contraire fait-il aussi de la techné un prodigieux éloge comme appartenant à l’essence de l’homme ». La technique a réduit l’essence de l’homme en termes de « chose disponible » laissant à l’homme l’illusion qu’il la maitrise. D’où : « Le règne du Gestell signifie ceci : l’homme subit le contrôle, la demande et l’injonction d’une puissance qui se manifeste dans l’essence de la technique et qu’il ne domine pas lui-même […]. Seul un dieu peut encore nous sauver (M. Heidegger, 1958, p. 9 à 48)
Il y a là une alerte lancée par le penseur du sens de l’être quant à l’assurance de notre être-au-monde. Toutefois il garde l’espoir que face à ce Gestell : « le déferlement et les excès de la technique, la perte du sens des choses, l’exode de la vérité, la fuite des dieux, la disparition de la nature, enclenchera une réaction salutaire du Dasein » (J. Grondin, 1987, p. 103). Pour lui « là où est le péril, croît aussi ce qui sauve. » (Hölderlin, Patmos, en Question IV). Ainsi, « C’est précisément dans l’extrême danger du « Gestell » que se manifeste l’appartenance la plus intime, indestructible de l’homme à « ce qui accorde ». Contrairement à toute attente, l’être de la technique recèle en lui la possibilité que « ce qui sauve » se lève à notre horizon », écrit Emilio Brito». (1999, p. 83). L’homme devra se remettre en méditation sur « ce qui dans la technique est l’essentiel à savoir le sens originaire de la techné, τέχνη , grecque qui désignait aussi la production du vrai dans le beau, et par quoi il est nécessaire » de revenir à « l’art qui portait l’humble nom de techné, τέχνη , en tant que dévoilement producteur faisant partie de la ποίησις (poésie») (M. Heidegger, La question de la technique, p. 83).
Cependant, « Plus nous questionnons en considérant l’essence de la technique et plus l’essence de l’art devient mystérieuse » (Idem). Ce mystère se dévoile à nouveau au cœur du numérique contemporain, cette forme accomplie de la technologie que l’art tend à porter à son paroxysme. Serait-ce la figure esthétique du dernier Dieu, der lezte Gott ? Ou le numérique en dévoilant l’essence ontophanique de la technique, replace l’humain en face de son propre salut comme tente de le réinterpréter aujourd’hui Stéphane Vial, à travers la notion de « techno-transcendance ? »
3. LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE COMME OUVERTURE SUR LE DIVIN À L’ÈRE DE CORONAVIRUS
En quel sens Heidegger est ou non prophète de la révolution numérique ? Le prophète annonce, il indique (Hinweiser). Et la prophétie ne s’accomplit jamais du temps du prophète. L’énigmatique déclaration de Heidegger : « Seul un dieu peut encore nous sauver » dont on a tenté vainement de retrouver l’herméneutique du côté du Dieu de la foi, trouve plutôt son orientation du côté du sens de la technique et de son avènement. Le rapport de Heidegger avec le dieu de son origine, le christianisme est d’autant plus complexé que c’est du côté de la technique qu’il nous a paru nécessaire d’orienter notre approche de manière à maintenir la voie du Sacré que toute action humaine envisage. La technique contemporaine dispose-t-elle encore d’un espace pour la sacralité de l’être et notamment de l’être humain ?
3.1. Le numérique ontophanique
La technique n’est pas le dieu mais la dévastation de l’essence humaine qu’elle provoque doit inciter le Dasein (l’homme en situation existentielle) à trouver en lui-même et part lui-même la voie de non-dispersion, voire de non-anéantissement. La littérature philosophique contemporaine avec les travaux de Stéphane Vial après ceux des premiers commentateurs de Heidegger sur la technique à savoir Anders Gûnters, Jacques Ellul, offrent des issues relatives à la question de l’art et de sa numérisation contemporaine. L’art, depuis Hegel, est « l’expression de la spiritualité et de la religion ». L’analyse de l’œuvre d’art de Heidegger maintient cette dimension et permet au philosophe contemporain Stéphane Vial de faire comprendre l’enjeu transcendantal du numérique ontophanique.
Lors d’une interview, comme ce fut le cas pour Heidegger, Vial répond : (Echappées Revue d’art et de design de l’École supérieure d’art des Pyrénées, n° 2, Pau-Tarbes, 2013)
La révolution numérique correspond à un double bouleversement. Sur le plan de l’histoire, elle est l’avènement d’un nouveau système technique. C’est ce que j’ai appelé le système technique numérique, fondé sur la trilogie de l’électronique, de l’informatique et du réseau Internet. Sur le plan de la philosophie, elle renouvelle en profondeur les structures techniques de notre perception, autant qu’elle nous révèle l’existence même de ces structures, que j’ai appelées techno-transcendantales, et dont j’ai essayé de montrer qu’elles ont toujours existé, sous des formes variables, aux différentes époques historiques. C’est en cela que la révolution numérique est un événement philosophique : elle modifie l’acte phénoménologique de percevoir.
La techno-transcendantale devient le point d’ancrage de la réflexion de Vial comme sens au numérique. Ceci « vise à souligner le fait que, notre perception du monde est affectée par les techniques et les appareils avec lesquels nous vivons » (Stéphane Vial « L’être et l’écran, comment le numérique change la perception », préface de Pierre Lévy, PUF, Paris, septembre 2013, p. 111). Ainsi, « chaque génération réapprend le monde et renégocie son rapport au réel à l’aide de dispositifs techniques dont elle dispose dans le contexte socioculturel qui est le sien » (Ibidem). Cette approche historique de l’ontophanie numérique permet à l’auteur de déconstruire la fracture intergénérationnelle souvent avancée : si chaque génération apprend à percevoir au travers des techniques existantes, alors plusieurs matrices ontophaniques historiquement datées se superposent et coexistent dans notre expérience quotidienne. L’ontophanie numérique va alors jouer un rôle réconciliateur et de stabilisateur. Elle permettra de déconstruire l’opposition entre « réel et virtuel ». Elle invite ainsi à dépasser « la croyance dans la métaphysique platonicienne de l’image qui enferme le virtuel dans l’illusion, le simulacre et la tromperie. Réel et virtuel ne s’opposent pas, et le virtuel n’est pas irréel, parce qu’il est une manière d’être sans se manifester » (L’être et l’écran, 2013, récession de Marie-Julie Catoir-Brisson).
A ce titre, « cette révolution n’est pas seulement technique mais aussi philosophique. La technique n’est pas une chose indépendante du sujet ; elle fait partie du sujet. La question de la relation entre l’être et la technique est abordée à la croisée de l’ontologie (philosophie de l’être) et de l’anthropologie » précise Marie-Julie Catoir-Brisson dans sa récession. Une telle approche permet, en envisageant tout l’engagement de Vial à faire comprendre le sens et l’essence du numérique, de concevoir que « les dispositifs techniques donnent accès au réel et génèrent aussi des réalités, comprises comme des expériences du réel » (Marie-Julie Catoir-Brisson). Dès lors, le numérique nous met en face de « matrices ontophaniques », c’est-à-dire des « structures de la perception, historiquement datées et culturellement variables. » (S. Vial, 2013, p. 19-20).
Au nombre de ces catégories, Vial propose onze pour la saisie du phénomène numérique qui est programmable, instable, réticulaire, « autrui-phanique », copiable, annulable, destructible, thaumaturgique et jouable. Le phénomène numérique se caractérise aussi par l’interaction et la simulation. L’hyper-présence caractérise l’ontophanie numérique mais les modalités d’interactions sociales avec autrui via les appareils numériques ne remplacent pas les précédentes. Enfin, le numérique est ludique et il renforce notre capacité à jouer avec notre environnement. (L’être et l’écran, 2013, récession de Marie-Julie Catoir-Brisson).
Ainsi, la pensée de la technique contemporaine en termes de philosophie du numérique ne se passe guère d’approche anthropologique et sémiotique. Ce qui est visé en anthropologie philosophique est de faire « observer finement comment chacun des nouveaux dispositifs numériques reconfigurent notre rapport au monde, en tenant compte de l’interaction entre le dispositif, l’usager et son environnement » (L’être et l’écran, 2013, récession de Marie-Julie Catoir-Brisson). Nous nous y attelons dans nos travaux personnels où l’humanité de l’être humain doit aujourd’hui être repensée en fonction de son être-au-monde voire de sa finitude originaire : « Tout être humain est caractérisé par l’évidence de la naissance et la certitude de la mort » (R. Techou, Philosophât, 2019, n°2). C’est d’ailleurs pour se maintenir dans cette finitude ontologique que Heidegger préconise en face de la dévastation du monde et pour assurer le salut de l’être humain, une attitude anthropologique à intégrer : La sérénité qu’exige l’attitude de l’humain à l’ère de Coronavirus.
3.2. La sérénité en face de la dévastation du monde : Coronavirus en question
Le dieu qui doit sauver est-il ainsi apparu ? De quoi nous sauverait-il donc ? La pensée aurait-elle été ainsi assujettie ? Ou c’est un nouvel horizon de possibilité qui s’est ainsi rendu manifeste ? La saisie du numérique contemporain comme sens de notre être-au-monde exige le développement de nouveaux concepts pour penser l’expérience phénoménologique que propose le numérique lui-même. Auguste Comte n’était pas moins vigilant sur la question et sa contribution au dévoilement de l’humanité de l’être humain le montre davantage. C’est, de toute évidence, ce qui fut perçu et analysé dans « Quel Humanisme pour le 21ème siècle » où, sur les traces du philosophe des sciences, le Professeur Kissèzounon affirmait : « malgré la pertinence des catégories contemporaines pour repenser l’essence humaine en vue de refonder l’humanisme contemporain, il faut aussi rechercher dans notre passé surtout dans la tradition philosophique, d’autres catégories ou d’autres repères qui pouvaient encore bien nous être utiles aujourd’hui, du moins qui méritent encore aujourd’hui notre attention » (G. Kissèzounon, 2017, p. 123).
« Seul un dieu peut encore nous sauver » ouvre ainsi la voie à une perception renouvelée de l’être humain voire de sa capacité à « donner sens et existence au monde ». A l’ère de « l’insuffisance de la raison suffisante » (Jean-Luc Marion, Etant donné), le mot de Heidegger retrouve son sens. Il ne s’agissait pas pour le philosophe d’entériner le nihilisme nietzschéen encore moins de saper les bases de l’humanisme traditionnel. Mais le penseur du sens de l’être chercher à faire écouter « la Nouvelle tonalité affective de l’être humain » (Téchou, 2019) dont la technique contemporaine faire entendre l’écho.
La sérénité de l’être humain ne se manifeste que dans la prise au sérieux de notre finitude originaire laquelle caractérise l’humain que nous sommes et dont Coronavirus révèle toute la vérité. Dans une chronique adressée au journal La Croix du Bénin n° 1553 du 24 avril 2020, en réponse à la situation pandémique notre analyse philosophique soulignait :
Le Coronavirus nous donne de repenser les questions de justice, d’égalité, le sens de l’histoire et les questions morales et éthiques. Mais c’est surtout à une ouverture culturelle et à un dialogue culturel que nous appelle cette crise du Covid 19. Tout en dévoilant la faiblesse et l’individualisme suicidaire des plus grandes puissances et leur effondrement, on tire des leçons selon lesquelles aucun pays n’est la règle à imposer aux autres. La règle n’est donc plus ni occidentale ni africaine. Elle incite à repartir du commencement de toute pensée, la finitude qui contraint l’existence à être sereinement vécue.
En effet, dans un contexte sociopolitique et économico-religieux subitement bouleversé par une crise sanitaire qui prend l’enjeu d’une pandémie, il faut retrouver le sens de l’humain. La situation inédite de l’existence humaine actuellement apparaît pour les habitués de la logique mercantile et du capitalisme consumériste un saut dans l’inconnu. C’est dans cette angoisse qui reste existentielle qu’il faut trouver le sens de l’abîme :
Pour Roger-Pol, nous en apprenons philosophiquement en même temps que la philosophie nous en apprend : « Cette situation dit de nous que nous n’arrêtons pas de bouger d’abord dans nos têtes. Que nous n’arrêtons pas de nous divertir, de nous occuper à l’écran, avec des jeux vidéo, avec des séries. Mais cela change aussi nos cartes mentales. Autrement dit, c’est une sorte d’expérience philosophique absolument gigantesque où notre vie quotidienne change. Cela nous oblige à réfléchir à des choses que, d’habitudes, nous ne voulions pas voir : le hasard qui peut tout bouleverser, la vulnérabilité de nos vies et de nos corps, le rapport étrange que nous avons entre notre solitude dans le confinement et la solidarité. Tout ça aussi doit faire réfléchir. Il y a énormément de choses qui sont en train de bouger dans les têtes alors que nous ne bougeons plus dans la réalité » (P. NEXEUX, Roger-Pol Droit, France culture du 30 Mars, 2020).
Dès lors, coronavirus enseigne à entretenir avec le numérique non plus seulement un rapport utilitariste ou mécanique mais une proximité existentielle. Il faut s’en tenir désormais à cette connexion entre la « matière et la non-matière » en sachant que la structure humaine l’emporte sur les infrastructures de l’homme. Grâce au Coronavirus, le numérique, signe de l’ingéniosité humaine va ré-concilier l’humain avec lui-même en lui faisant redécouvrir la phénoménalité de la relation avec la transcendance hors de toute artificialité. Mais de quelle transcendance est-elle question ? Se rapproche-t-elle du dieu traditionnellement ainsi connu ? Toute réponse doit sortir de la tentation de représentation.
La thérapie philosophique en face du Coronavirus est de repartir de notre finitude originaire ; autrement dit, il s’agit d’Être soi chez soi. Rester chez soi, c’est habiter le monde en lieu-tenant du Rien. L’homme n’est rien, on le dit mais on ne l’a jamais intégré. Justement parce qu’il n’est pas rien du tout mais le tout de Rien (J Greisch). Le Coronavirus rappelle que nous sommes-là en face du néant non anéantissant, cette vulnérabilité originaire. C’est la tâche de la pensée. Elle est méditation sur la condition humaine et ne commence vraiment « que lorsque nous avons éprouvé que la raison tant magnifiée depuis des siècles, est l’adversaire la plus opiniâtre de la pensée » (M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nul part. p. 322). Car la philosophie n’est qu’un moyen pour accéder à la pensée de ce que nous sommes.
Conclusion
Après avoir présenté le décryptage en amont et en avant de l’énigmatique déclaration heideggérienne, nous en sommes arrivés à l’herméneutique du numérique et de coronavirus pour mesure la possibilité toujours possible du divin à l’ère de la dévastation de l’humain. Pour le percevoir, il faut s’ouvrir à la finitude originaire de l’être humain qui impose la sérénité en face de la dévastation du monde : « La rupture avec la raison suffisante nous mettra sur de nouvelles pistes de la pensée, ébranlant nos anciennes certitudes, cause de notre folie actuelle car « ce n’est pas le doute qui rend fou, c’est la certitude » (F. Nietzsche, 1992, p. 1228).
Heidegger n’a pas pour intention de faire advenir un nouveau dieu. Au regard du constat de l’absence de Dieu, il cherche à combler le fossé creusé par la métaphysique et à surmonter l’apparent nihilisme dont il n’est aucunement le protagoniste si ce n’est une conséquence de la métaphysique. « Seul un dieu peut encore nous sauver » sonne dès lors comme un appel à écouter dieu, à laisser dieu être dieu :
Il croyait dans la possibilité d’une authentique conversion philosophique à travers le retour à la pensée ontologique grecque présocratique. Le dieu qui peut encore nous sauver est incontestablement un dieu grec, mais un dieu qui parle allemand. Car, pour Heidegger, c’est la langue allemande qui est la digne héritière de la langue grecque, d’où son allusion provocatrice selon laquelle tout intellectuel français serait obligé de parler l’Allemand dès lors qu’il commence à penser… (J.-L. Berlet, 2007).
Dans Acheminement vers la parole (1981, GA 12), où le philosophe évoque de « grands poètes Allemands comme Hölderlin, Trackl ou Stefan Georg qui auraient saisi par voie poétique la vérité fondamentale de l’Etre qui consiste à se dévoiler en se voilant », on perçoit mieux sa préoccupation de maintenir la figure grecque du divin au cœur des bouleversements présents. La dissolution de la philosophie dans les sciences particulières est ce qui, selon Heidegger, lui arrache également son rôle d’avant-gardiste. Le « Dieu est mort » de Nietzsche a sonné le glas de la pensée occidentale et ouvert la voie au nihilisme. En réalité, ni l’un ni l’autre des traits attribués à Nietzsche ne furent réels. Et, c’est Heidegger qui va le révéler à travers justement la possibilité du salut et le retour de Dieu qu’il annonce.
Dans le contexte des développements scientifiques et techniques de son temps, en considération des hallucinants progrès de la technoscience au regard desquels nous pourrions trivialement dire que Heidegger n’avait encore rien vu, « Seul un dieu peut encore nous sauver » semble répondre en échos à la vision comtienne (A. Comte, 1970, p. 10) que malgré tous ses progrès, « l’homme devient de plus en plus religieux ». Nous sommes ainsi en face non du mystère mais du mystique qu’est Heidegger lui-même. Le mystère de l’être qu’il aura réussi à arracher à la métaphysique dit toute « l’évidente spiritualité grecque à travers les notions de dévoilement (aletheia) de l’Etre, d’éclaircie de l’Etre ou encore de berger de l’Etre ou de demeure de l’Etre » que nous lui connaissons et qui refait surface : « Les Dieux de la Grèce étaient nommés non sans raison les immortels. Le « Dieu » d’Israël est invoqué sous un nom imprononçable- celui du Tétragramme. Notre pensée sera-t-elle assez libre un jour, assez ouverte- en un mot assez extrême pour accueillir Dieu là où de préférence il se trouve : à l’extrême ? » (François Fédier, Dictionnaire Heidegger, art. Dieu à l’extrême (x), p. 344, 2013).
Références bibliographiques
ARJAKOVSKY Philippe, FEDIER et FRANCE-LANORD Hadrien (Ss. dir.), 2013, Le Dictionnaire Martin Heidegger : Vocabulaire polyphonique de sa pensée, Paris, Éd. du Cerf, 1400 p.
ELLUL Jacques, 2004, Le système technicien, Paris, Le Cherche Midi, (première édition Calmann-Lévy, 1977), 386 p.
FERRY Luc et RENAUT Alain, 1988, Heidegger et les modernes, Paris, Grasset et Fasquelle, 192 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, « Dépassement de la métaphysique », Essais et conférences, Paris, Gallimard, trad. André Préau.
HEIDEGGER Martin, 1958, « La question de la technique » [1954] Extraits d’Essais et conférences trad. André Préau, Paris, Gallimard, 349 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et conférences, Trad. A.Préau, Paris, Gallimard. 349 p.
HEIDEGGER Martin, 1964, Introduction à la métaphysique, Trad. Gilbet, Kahn, Paris, Gallimard. 226 p.
HEIDEGGER Martin, 1967, Lettre sur l’humanisme, Trad. Roger Munier, Paris, Aubier. 249, p.
HEIDEGGER Martin, 1995, Écrits politiques, Trad. François Fédier, Paris, Gallimard, 358 p.
HEIDEGGER Martin, 2016, Chemins qui ne mènent nulle part, Trad. Wolfgang Brokmeier, Paris, Gallimard. 461 p.
JANICAUD Dominique, 1985, Power of the rational, Indiana University Press, 385 p.
KISSEZOUNON Gervais, 2018, « Perspectives d’humanisme d’un philosophe des sciences : le nécessaire passage religieux chez A. Comte » dans Quel humanisme pour le 21ème siècle, Collectif, Academia, Bruxelles, 134 p.
MILAD Doueihi, 2008, La grande conversion numérique, Paris, Seuil, 271 p.
PALMIER Jean.-Michel, 2016, Les écrits politiques de Heidegger, Paris, L’Herne
VIAL Stéphane, 2017, L’être et l’écran, Paris, Puf, 336 p.
WAYSAND Georges 1987, Les pouvoirs de la science, textes recueillis par D. Janicaud, Paris, Vrin, 182 p.
Ô POÈTES ! Ô DIEUX ! VÉRITÉ(S) D’UN HUMANISME FONDAMENTAL
Yves Laurent GOULEI
Université Alassane OUATTARA, (Côte d’Ivoire)
Résumé : La substantialité de l’ontologie heideggérienne, en dépassant la métaphysique pour poser l’Être, dans sa démarche différenciée comme la vérité de l’étant, saisit cette même vérité de l’Être comme poème : un-se-mettre-en-œuvre-de-la-vérité. Ce dévoilement qui prend le nom de poème est la conséquence logique de la phénoménologie qui se donne comme le mode d’accès par excellence à la vérité des choses. Or, la poésie et la phénoménologie ont ceci de commun qu’elles visent l’être des choses. Chez Heidegger, poésie et phénoménologie, ayant une vocation ontologique, permettent de concevoir l’humanisme en sa vérité fondamentale. En ces temps périlleux, de détresse, où il convient, dans une perspective hölderlinienne, d’être en direction de ce qui sauve, la poésie se pose comme l’activité par excellence pour ré-apprendre à penser afin d’habiter dans la proximité des dieux, ce qui signifie aussi dans le lieu-ouvert.
Mots-clés : DIEUX, HABITER, HUMANISME, PENSER, PHÉNOMÉNOLOGIE, POÉSIE.
Abstract : The substantiality of Heideggerian ontology, by going beyond metaphysics to pose Being, in the differentiated approach as the truth of being, grasps this same truth of Being as a poem: a-truth’s-deployment. This unveiling which takes the name of poem is the logical consequence of phenomenology given as truth of things’excellent mode of access. But, poetry and phenomenology have this in common that they aim at the being of things. With Heidegger, poetry and phenomenology, having an ontological vocation allow us to understand humanism in its fundamental truth. In those perilous times and distress, where it is advisable, by a Hölderlian perspective, to be in the direction of what saves, poetry arises as an excellent activity to re-learn thinking in order to live in the proximity of gods, that also means in the opened-way.
Keywords: GODS, LIVING, HUMANISM, THINKING, PHENOMENOLOGY, POETRY.
Introduction
La situation d’urgence ou encore d’emergency dans laquelle vit notre monde, montre à quel point le niveau de rationalité de l’homme a atteint le seuil de la désobéissance envers lui-même et envers la nature. L’incertitude des effets de nos sciences et inventions, tout en soulevant les problèmes épistémologiques popperiens quant à la relativité de la vérité scientifique, rappelle l’incontournable phénoménologie heideggérienne de laisser les choses se dévoiler elles-mêmes à partir de leurs vérités profondes. En clair, la relativité de la vérité scientifique indique qu’elle n’est pas la vérité, mais plutôt une vérité. Si cela se pose de toute évidence avec le lot de crises que connait notre monde, c’est bien parce que l’homme croit tout savoir et tout comprendre par le seul mode opératoire de la raison.
Et pourtant, certaines réalités gisent dans l’in-visible en retenant leur vérité essentielle. Cette manière de manquer de saisir la vérité de certaines choses, en mettant en crise l’humanité, fait aussi perdre de vue la logique divine, le pays des dieux qui entretient un commerce naturel avec notre espace vital. Vidant les dieux de leurs espaces, nous nous vidons, par cet acte même, de notre propre essence. C’est pourquoi, dans un apport de sens à la méditation en temps de crise et de détresse, le philosopher heideggérien, qui a encore en souvenir le monde des poètes et des dieux grecs, s’invite au dialogue dans les pratiques de notre temps qui suscite la fuite, l’exil et le dé-paysement des dieux.
Penser ainsi, c’est donc engager la métaphysique dans sa contribution à re-orienter notre monde en perte de sens et de bonnes pratiques. C’est aussi et surtout actualiser le rôle prépondérant de la métaphysique à nous rappeler qu’en dehors de ce monde-ci ou encore de ce qui est physique, il y a le monde invisible, le monde de l’Essentiel. Si, en période de détresse, l’on s’en remet au spirituel, n’est-ce pas suffisamment là, une preuve de ce que l’homme s’en remet toujours et continuellement à la transcendance, à la méta-physique ? Chez Heidegger, le poète, qui a souvenance des dieux, sait et voit cet invisible, le sacré. Cette expérience du poète dans le voir, dans le savoir est un voir abstrait, un sa-voir abstrait qui exige une écoute ententive Ce sacré, en temps de détresse et de crise, doit pouvoir trouver son effectivité aujourd’hui. C’est bien là tout le sens d’une réflexion autour du thème général “Seul un dieu peut encore nous sauver” ; De cette façon, la formulation du sujet, « Ô poètes ! Ô dieux : Vérité(s) d’un humanisme fondamental », se présente comme un appel des poètes au secours, en vertu de leur sens du sacré apte à révéler la ou les vérité (s) de ce que c’est qu’être humain. Car l’appel au secours signifie qu’il y a péril en la demeure. Mieux, s’il y a appel au secours, c’est bien sûrement parce que l’homme manque d’être humain ou est « trop humain ». Ce « devenir trop humain », qui met en péril l’humanisme, est signe de ce que l’homme manque de re-trouver sa vérité fondamentale sinon que : la pensée.
Cette analyse s’articulera autour de trois axes principaux à savoir :
- Heidegger et la nature : nostalgie du paysage natal comme quête de sens ou simple nostalgie d’un paysage natal ?
- De l’humanité « trop humaine » au péril de l’ethos
- De l’ontologie poétique à l’ontologie politique : l’habiter en question
1. HEIDEGGER ET LA NATURE : NOSTALGIE DU PAYSAGE NATAL COMME QUÊTE DE SENS OU SIMPLE NOSTALGIE D’UN PAYSAGE NATAL ?
Le vécu humain est sens ou encore quête de sens de ce qui est. De ce fait, la vie en sa révélabilité fondamentale est élan de com-préhension de ce qui se donne doublement comme existant et comme non-existant dans sa phénoménalité. La constitution des sciences, dans leur dimension physico-chimique, métaphysique, théologique, psycho-psychanalytique, socio-anthropologique, juridico-économique, etc., est la forme expressive de cette quête de sens en vue d’éclairer l’agir humain, tout en permettant la com-préhension du phénomène. Com-prendre est donc fondamental pour le vécu, car c’est prendre avec soi et aller avec. Ce prendre avec soi et l’aller avec, supposent une disposition à accueillir ce qui vient à nous comme présence ou comme non-présence des choses.
La philosophie elle-même, en son matin grec, traduit bien l’idée de la com-préhension des choses dans l’étonnement devant le phénomène et devant son sens qu’il révèle. Cette quête de sens habite bien le philosopher heideggérien qui, dans son cheminement, se donne à être comme un com-prendre fondamental dans la conceptualisation de l’ontologie. Comprendre, c’est tenter d’appréhender le phénomène dans sa duplicité (être et non être). En tant que tel, cette philosophie de la compréhension de ce qui est dans sa monstration et non- monstration, est une ontologie comprise comme quête de sens. Dans un monde en crise des valeurs et d’inflation des sens, comment ne pas être fondamentalement, c’est-à-dire se dis-poser fondamentalement ou habiter fondamentalement pour comprendre les choses dans leur essentialité ? Le dire ainsi, c’est donc entrevoir une réception de la philosophie heideggérienne comme philosopher qui nous parle et nous interpelle encore.
Dans le corpus heideggérien, la quête du sens se lit à travers la figure du Dasein pour qui Heidegger cherche un mode de vie qui, loin de la publicité mondaine, est rempli d’un sens fondamental d’habitation authentique, créateur de sens et de valeurs. S’il est vrai que sa philosophie est traversée par une telle quête de sens, ne faut-il pas pour comprendre cet aspect des choses, revenir à la figure du philosophe lui-même pour cerner l’origine et le pour-quoi d’une telle philosophie qui sait se rappeler du paysage natal pour un rapport de proximité et de co-appropriation du sens spirituel de la vie ? Cette démarche se pose ainsi comme une herméneutique qui cherche à expliciter la figure du Dasein qu’est Heidegger, pour comprendre le sens originaire de sa philosophie. Cela est nécessaire dans la mesure où toute philosophie est traversée de part en part par la psychologie ou encore par la réalité « proprement philosophique comme posture et espace mental appropriés à cet espace social » (Bourdieu, 1988, p. 46). Une telle démarche nous permettra de comprendre Heidegger à partir de son paysage natal qu’est l’Allemagne et de son paysage historico-nostalgique qu’est la Grèce antique, la Grèce des dieux.
Il est bien connu de la pensée marxiste que toute philosophie est fille de son temps. La naissance d’une philosophie qui en serait alors fille ou témoin de son temps traduit le fait que les circonstances de l’époque concourent à la naissance de la pensée de celui qui s’exerce à penser son temps. C’est bien le cas de Martin Heidegger. En effet, l’époque du Fribourgeois est celle des deux guerres mondiales. La résurgence de la violence issue d’un mode du percevoir socio-politique et économique, dans le fond vide de contenu, ne permettant pas au citoyen de se prendre en charge lui-même par la pensée et par ses facultés intellectuelles concourt à l’avènement d’une forme de pensée de l’être-homme. Les courants politico-économiques, dans leur vision antagoniste et séparatiste du monde, aliènent le citoyen qui manque de trouver en eux une assise revitalisante. Les sciences qui, elles-mêmes, dans leur fin, devraient favoriser l’épanouissement de l’homme, passent par un procès suite au chaos socio-politique dans lequel le monde entier a été entrainé. Le corps social étant sous le joug de la perdition, soutenu par une crise des sciences modernes, le besoin de compréhension et d’intellection, en temps de crise, de détresse et d’angoisse, se posait avec évidence. Comment, à partir du haut savoir constitué en matière de science et de culture, l’humanité est-elle parvenue à s’entredéchirer, remettant les humanités en cause ? D’où viendrait l’échec ? La crise est-elle ontologiquement liée à l’être de l’homme ou à la nature des sciences ? Comment l’humanité est-elle arrivée à ce « point critique » ?
De 1914 à 1945, puisqu’il s’agit là de la période phare où la pensée heideggérienne se nourrit essentiellement des sujets du monde pour se projeter au-delà de 1945, il apparait que cette époque est celle où le monde se meut dans une crise profonde qui bouleverse les modes de vie ainsi que la vision symbolique du monde. La crise des sciences modernes, à l’épreuve de la confrontation des idéologies politiques qui se disputent la gouvernance et les principes directeurs du monde, suscite chez le philosophe allemand une nostalgie d’une époque historique où l’homme entretenait un commerce cordial avec la nature. Si cette époque a existé, Heidegger en se rappelant, n’a pas l’intention de la faire revenir par une sorte de baguette magique, mais il veut y tirer, par un saut, toute la quintessence spirituelle, l’exemplarité du mode de vie pour que l’homme se remémore le rapport intime qu’il doit entretenir avec lui-même, à partir de la méditation, et ensuite le rapport avec la nature qui, de la sorte, le fera revenir à l’Essentiel. Cet Essentiel, loin de l’arraisonnement technique, suppose une re-conversion du regard sur l’étant qui n’est pas qu’un simple objet d’inspection, car il est traversé par la vie, sinon il est ce qui concourt, dans un sens fondamental, à la vie elle-même. Le regard heideggérien est un regard phénoménologique qui sait se rappeler et qui sait voir, derrière toute chose, une réalité invisible qui donne sens à ce qui se montre.
C’est pourquoi, de la technique à l’étant, de l’art au plaisir du goût, l’œil phénoménologique perçoit toujours la vérité voilée de l’étant. En clair, Heidegger, de son expérience, conçoit la vie comme manifestation d’une duplicité qui sait appréhender la dynamique physique et métaphysique de toute chose. Aboutir ainsi à un tel point dans la logique de l’analyse externaliste, n’est-ce pas faire signe à celle internaliste pour indiquer plus clairement les concepts sous-jacents qui fondent, à travers le texte, la convocation silencieuse de martin Heidegger par l’Essentiel qui se déploie dans le natal ? En quoi Heidegger serait-il proche de la nature ? Mieux, qu’est-ce qui fonde le rapprochement de Martin Heidegger au paysage natal pour qu’une analyse puisse y voir l’espace mental et social qui se joue dans ses textes ?
Les espaces géographiques de références, que Heidegger prend essentiellement en exemple, sont le monde grec et allemand. Des dieux et poètes grecs au paysage natal et poètes allemands, il ressort une analyse du Même : la manière d’être. Cette manière d’être est celle qui, par la communion intime avec les dieux, sait habiter poétiquement la terre. Or, qu’est-ce qu’habiter la terre sans un regard vers le ciel, vers les dieux ? C’est bien ce mode d’être qui fait séjourner essentiellement Heidegger dans le monde gréco-allemand, à travers presque toute sa pensée. Né à Messkirch, le pays de Bade est « la terre qui s’étend du lac de Constance jusqu’au confluent du Neckar, la Forêt-Noire, Fribourg, Messkirch et Todnauberg, un paysage agricole et une région marquée par un catholicisme rural qui ont été, sa vie entière, l’objet de toutes les attentions et sollicitudes de Martin Heidegger » (P. Dulau, 2009, p. 177). Heidegger a toujours eu, de ce fait, un attachement pour la campagne et la tradition. Il dit ceci : « D’après notre expérience et notre histoire humaines, pour autant que je sois au courant, je sais que toute chose essentielle et grande a pu seulement naitre du fait que l’homme avait une patrie (Heimat) et qu’il était enraciné dans une tradition. » (1995, p.259). C’est seulement ainsi que l’homme peut croitre en s’ouvrant à l’immensité de la hauteur du ciel, en poussant des racines dans l’obscurité de la terre. Mais cette croissance entre ciel et terre se réalise si et seulement « si l’homme est disponible à l’appel du ciel le plus haut, mais demeure en même temps sous la protection de la terre qui porte et produit. » (Heidegger, 1966, p. 12).
La terre natale, lieu d’expérience profonde avec la nature, le paysage rural, produit une sensation pure de vitalité. Loin du commerce ahurissant de la technique, des artéfacts, la campagne est, pour Heidegger, le lieu où l’homme revient en lui-même, s’appartient à lui-même comme en un retour à soi et chez soi. M. Heidegger (1995, p. 150-151), confirme ce qui précède en ces termes :
Quand, à l’heure où cesse le travail, le soir, je suis assis avec les paysans sur la banquette du poêle, ou bien à la table, au coin du Bon Dieu, la plupart du temps nous n’échangeons pas un seul mot. Nous fumons en silence nos pipes (…) Sentir ainsi son travail intimement lié à la Forêt-Noire et à ceux qui l’habitent ne peut venir que d’un enracinement séculaire dont rien ne peut tenir lieu, l’enracinement souabe et alémanique.
Cet extrait intitulé « Pourquoi restons-nous en province ? » après son refus de la chaire de Berlin, montre la relation de proximité qui lie Heidegger à la campagne, à la province, à son terroir. L’image du paysan ou encore l’amitié avec le paysan ou le paysage ne relève pas d’une simple coïncidence existentielle. Le paysan est celui qui, pour Heidegger, sait patienter, demeurer dans le site de l’Être où les choses croissent et grandissent avec lenteur. Banal à l’image du four au pain d’Héraclite, le paysan est celui qui a encore l’expérience de la patience dans la culture de la terre, et qui demeure dans l’attente des dieux du ciel après avoir enfoui le grain dans le sol. Réalisant cette expérience qui ne peut se faire en ville, là où l’homme ne pense plus, n’entend plus et n’attend plus les dieux et n’a plus l’expérience de la patience, la vie en province se présente comme le lieu où l’homme peut continuer de penser, de philosopher, de se recréer. C’est donc dans un tel recueillement en province que la philosophie peut être élevée à sa chaire magistrale. M. Heidegger (1995, p. 150) dira : « Et le travail philosophique a lieu non pas comme l’occupation marginale d’un drôle d’individu. Il vient prendre toute sa place en plein milieu du travail des paysans. (…) L’homme de la ville est persuadé qu’il vient « se mêler au peuple » sitôt qu’il s’abaisse à s’entretenir un peu longuement avec un paysan ». C’est bien pour cette raison que Heidegger séjourne chez les dieux grecs et chez les poètes pour y découvrir l’expérience de la pensée encore présente dans leur manière de penser et d’habiter.
« Du chemin de campagne » in Questions III à « Pourquoi restons-nous en province ? » in Écrits politiques, en passant par Les hymnes de Hölderlin : La Germanie et le Rhin, il est frappant de constater le vif intérêt du philosophe à ce qui donne sens dans le paysage. Tout est sens. Le paysan, le berger, le fermier, le chemin, le chemin de campagne, les vieux souliers de Van Gogh, le vieux four à moulin, les bûcherons, les laboureurs, les menuisiers, les forgerons, les tonneliers, dans leurs travaux, inspirent Martin Heidegger. « Eh bien, mon propre travail est tout à fait du même genre. C’est là que prend racine, par rapport aux paysans, le sentiment très direct d’être des leurs. » (Heidegger, 1995, p. 150).
Pour Pierre Dulau, ce monde paysan recrée chez le spectateur un ensemble de comportement et d’attitude qui, face au réel, à la dureté et à l’impermanence de la vie, suscite une com-préhension dans le soin, dans la lenteur dans le travail, de l’âpreté et le sérieux dans le métier de la pensée, de la prudence dans les comportements, de la patience dans la vie.
Heidegger évoque et exalte, même si ce n’est pas toujours immédiatement repérable dans ses propos, les supposées « vertus » de la paysannerie, vertus de prévoyance et de parcimonie, d’humilité et d’attention reconnaissante aux cycles du réel. Dans ces vertus, Heidegger veut reconnaître des dispositions fondamentales du Dasein comme être pour et par lequel le monde s’ordonne et se donne en une configuration sacrée originelle qui est excellemment mise en jeu, et mise en œuvre (dans tous les sens de l’expression), par la poésie. Car l’évocation de ces territoires ruraux n’est jamais complètement dissociable (ce que nous allons rappeler en détail) d’une réflexion sur la langue allemande et sur sa supposée « charge métaphysique » (P. Dulau, 2009, p. 178).
L’intérêt porté sur la proximité de Martin Heidegger à la paysannerie dans une réflexion sur les dieux et les poètes, afin de mettre en lumière toute la charge de l’humanisme, vise à déceler, par une explicitation du Dasein de Heidegger, son-être-ayant-été pour comprendre son regard suspect jeté sur notre monde en perdition. Cette analyse se pose donc comme un signe vers l’origine hébergeant en vue de dégager la symbolique lumière qui doit habiter en nous, dans ce monde d’utilisabilité des artefacts. Par les vertus de la paysannerie, en termes de prévoyance, de parcimonie, d’humilité, d’attention, de courage, de patience, d’endurance, Heidegger nous indique, à travers son être-là, ce qu’est penser, philosopher, habiter dans ce monde qui n’a d’yeux que pour le superficiel aux conséquences désastreuses pour notre humanité. C’est donc, à l’ère de l’arraisonnement technique, un appel à la ré-appropriation de notre être comme territoire ontologique qui se saisit comme lieu d’effectuation d’une méditation qui sait re-voir, de façon désintéressée, l’étant comme espace ontique de notre être ontologique, lesquels entretiennent un rapport de co-appartenance.
Heidegger sait que les dieux grecs organisent le cosmos, font venir la pluie, arrosent et font croitre la culture du paysan, désamorcent les sorts lancés aux hommes, etc. Avoir donc un tel rapport aux dieux et à la nature n’est pas mauvais en soi. Cela permet de se rappeler continuellement la finitude et la fragilité humaines qui invitent tout Dasein à habiter humblement et poétiquement la terre. Le philosopher heideggérien est donc quête de sens à partir de la nostalgie du paysage natal mis en exergue par le dieu du poète. Voilà ce à quoi nous invite la sagesse grecque à travers les textes heideggériens. Avons-nous encore ce rapport aux dieux et à la nature ? À quoi ressemblerait aujourd’hui notre humanité ?
2. DE L’HUMANITÉ « TROP HUMAINE » AU PÉRIL DE L’ETHOS
À quoi peut renvoyer une humanité « trop humaine » ? N’y a-t- il pas là une double lecture à faire ? Plus explicitement, la formulation de l’expression ‘’l’humanité trop humaine’’, ne pourrait-elle pas renvoyer à ce qui suit : une humanité comblée, heureuse, une humanité de bien et du bien, exemptée de tout problème, une humanité angélique ? De prime abord, elle pourrait signifier cela. Mais pendant que nous nous limitions à cette expression, un péril est signifié : le péril de l’ethos. De ce fait, l’humanité ‘’trop humaine’’ ne serait plus cette humanité trop angélique ; elle serait cette humanité qui, se surestimant, au point de perdre le contrôle de ses inventions, est tombée dans la déchéance existentielle.
De ce fait, l’intitulé, en lui-même, est annonciateur d’une crise, disons-le, une crise ontologique ou encore il est l’expression d’une « pauvreté de l’Être et habitation de la terre » (Kouakou, 2011, p. 155). Par ailleurs, en examinant encore l’énoncé, fait signe un horizon nietzschéen de « l’humain trop humain ». Disons que l’examen auquel correspond cet énoncé est l’exposition d’une déchéance de l’être-homme comme signe d’un péril. Dans la première partie, nous avons mis en exergue le rapport intime qui lie l’homme à la nature à travers la figure de la paysannerie et des dieux, creuset sacré d’un monde en retrait de la technique motorisée.
De cette campagne différente de l’espace technicisé, les habitudes changent. Du temps de Heidegger jusqu’à nos jours, le monde a profondément changé. Il n’est nullement question de dire que la technique est sur-caractérisée par un négatif absolu. Ce qui importe, c’est de cerner les effets du bouleversement du monde techniquement administré sur le mode d’être de l’homme dans son rapport à ce qui l’entoure. La dynamique enclenchée de la technique moderne, qui instrumentalise, inspecte, arraisonne tout le réel, ne manque pas de chosifier les rapports de l’homme à l’altérité ainsi qu’à tout ce qui l’entoure. L’ontologie heideggérienne, qui suspecte l’utilité du monde comme affairement autour de l’utile, en se donnant comme manière d’être dans le monde contemporain, soulève l’inquiétude du territoire du Dasein qui ploie sous le joug d’une domination technique annihilant toute responsabilité par la mise en congé de l’idée de liberté de penser, d’agir.
Cette réalité du Dasein dans cet univers de la sûreté, de l’agir guidé, de la pensée dictée, tout en activant l’efficacité d’une certaine production et communication de masse, crée un vide ontologique constatable dans le monde moderne au niveau de l’éducation, de la culture, de la tradition. C’est pourquoi, à bien lire Heidegger, il est évident qu’en plus d’opérer un dépassement de la métaphysique, son ontologie vise un mode d’être authentique. Le Dasein de Être et Temps, qui s’explicite au départ par la phénoménologie, pour se donner comme ontologie à l’arrivée, vise l’habiter authentique de la patrie qui sait se souvenir de la vérité de l’étant. Ce regard phénoménologique, dans sa détermination ontologique, réalise l’aliénation du sujet par la techno-science au cœur de l’espace mondialisé de la culture de la rentabilité, de l’efficacité, et du conditionné.
Ce devenir du monde, bien pris en charge par la Théorie Critique à partir d’une certaine lecture du corpus heideggérien, découvre la sur-puissance de la raison. Or, la vérité phénoménologique a ceci de vrai qu’elle émet de la rétention, de la réserve quant au phénomène qui se donne dans la présence. Elle fait l’expérience de la rébellion du réel qui, dans sa manifestation, ne se donne pas en entier. Heidegger dit que les Grecs ont l’expérience de cette présence des choses :
Les Grecs l’appellent (…) le mode de vie de celui qui contemple, qui regarde le pur paraitre de la chose présente. (…) La vie contemplative, surtout sous sa forme la plus pure, la pensée, est l’activité la plus haute. (…) La forme accomplie de l’existence humaine, elle l’est en elle-même et non pas seulement par l’effet d’une utilité adventice. Car la théorie est la pure relation aux aspects de la chose présente, lesquels concernent l’homme par leur paraitre, en ce qu’ils font briller la présence des dieux (Heidegger, 1658, p. 58).
Le recours que fait Martin Heidegger à l’espace grec, au-delà d’une curiosité historique, repose sur la réelle nécessité de savoir observer le réel qui se retire à chaque fois comme les Grecs en ont fait l’expérience. Les Grecs savent qu’une chose, dès qu’elle apparait à nous autres mortels, est déjà dans son soir comme un retrait. De ce fait, la forme accomplie de l’existence humaine, qui trouve son essence dans la contemplation ou encore dans la pensée, permet de réaliser que la vérité de l’étant ne peut être connue dans une exploitation, dans une inspection, dans un arraisonnement de celui-ci ; car il aime à se cacher, à demeurer dans le retrait. Ce lieu du retrait, en tant que lieu des dieux, est la révélabilité de la forme de la contemplation qui se veut et se dit silence en face de l’innommable. L’expérience heideggérienne d’une telle vérité du réel est une invite à re-convertir notre regard sur le monde à partir de l’univers historique grec. N’y a-t-il pas nécessité à le faire aujourd’hui, dans ce monde où la parole libératrice et la pensée se font rares ? « La représentation scientifique ne peut jamais encercler l’être de la nature, parce que l’objectivité de la nature n’est, dès le début, qu’une manière dont la nature se met en évidence. (…) La nature ne se dérobe pas plutôt qu’elle ne fait apparaitre la plénitude cachée de son être. » (Heidegger, 1958, p. 70).
Il y a donc là ce que Martin Heidegger appelle l’« Incontournabilité » de la nature, du réel en tant que l’autour de quoi on ne peut faire le tour, le détour. Le réel est refus en son être profond. Comment alors, l’homme moderne a-t-il fait pour manquer de vigilance quant à cette vigilance du regard grec ? L’oubli de l’Être en ce sens, n’est-il pas l’errance dans le percevoir, dans l’habiter ? Assurément ! De cet univers grec de la pure contemplation, l’évidence se pose entre la théorie grecque d’une harmonie avec la nature à un univers moderne de « la pratique » hyper-technicisée et exploratrice. Cet univers de la pratique, en humanisant l’homme, le rend « trop humain ». Ce « devenir trop humain », loin d’enrichir l’homme, l’appauvrit ontologiquement, au point de ne pouvoir plus penser fondamentalement. Or, qu’est-ce qu’être sans pouvoir penser ? N’est-il pas, ici, fait signe, à partir de cet être sans penser, à la crise de l’habiter et donc de l’ethos ?
Dans « la question de la technique », où il est donné de voir la différence entre le mode opératoire du faire-venir comme un créer, un dévoilement pro-ducteur et du faire-produire comme un dévoilement pro-vocateur, respectivement propre aux domaines de l’art et de la technique, il est possible de constater toute la charge différentielle entre le créer, en lequel habite encore la pensée créatrice et libératrice, et entre le produire de la technique qui arrache l’homme à lui-même en terme de liberté. Dans la mesure où dans l’être de l’homme, c’est le penser qui donne toute la substance et contenance existentielle, une fois que ce penser se vide ou n’opère plus comme penser, c’est aussi et surtout l’être qui s’en trouve déchu. Or, quand l’être de l’homme se trouve dans l’impossibilité de penser, c’est aussi sa liberté qui n’est plus. En clair, il ne peut pas aménager, bâtir, prendre soin de la croissance de ce qui vit et grandit. N’ayant plus en charge sa propre charge, il ne peut prendre en charge ce qui est dans l’errance pour le ré-orienter.
Et pourtant, celui à qui est arraché la liberté, est déchu spirituellement, et donc s’appauvrit ontologiquement. Quiconque est appauvrit ontologiquement, ipso facto, met l’habitation en péril. Or la liberté, chez Heidegger, est une liberté qui se découvre à partir de la situation de facticité du Dasein qui réalise le rien angoissant, depuis son être-jeté jusqu’à son être dans le monde, et qui, changeant de par la prise de décision résolue, décide de changer de trajectoire pour se poser comme sujet se choisissant son avenir. La liberté, comme on le voit, est, chez Heidegger, ontologique. Elle est issue du rien angoissant qui propulse. La liberté est liée au projet du Dasein de se surpasser, de se poser dans le monde comme celui qui guide et oriente, à partir de ses possibilités dans l’angoisse, le devenir du monde.
Elle est directement liée à l’être, elle n’est possible comme libre-arbitre que par l’espace dégagé et laissé libre par l’être. Elle est fondamentalement cet espace même, qui nous permet de dépasser l’étant présent vers d’autres possibilités, qui nous donne de projeter quelque chose, de découvrir tel aspect .de l’étant et d’en faire le principe de notre désir, ce que Heidegger évoque en rapprochant les verbes mögen et vermögen, pouvoir et aimer (désirer) (Maxence, 2005, p. 50)
La liberté n’est pas un rien, mais elle sort du rien. Du rien, elle nous con-cerne, nous pro-voque (sortir hors de soi). Ce rien qui est néant, en tant que non-étant, dit la figure de l’Être comme son mode d’être. C’est du néant et de ce néant dont jaillit l’étant. C’est donc de ce néant dont jaillit l’angoisse que la liberté se conquiert comme pro-jet, un se-choisir, un se-saisir. C’est pourquoi la liberté est ontologique. De son être-jeté qui se reconquiert comme pro-jet dans l’angoisse, l’homme se jette dans le monde comme liberté et, en elle, il trouve ses possibilités. Du néant qui néantise, l’homme devient liberté et en elle, il est pro-jeté à se réaliser.
Nous pouvons donc dire que le projet du Dasein de se réaliser, qui trouve son plein accomplissement dans la liberté, est une preuve que devant la situation angoissante du monde et de la peur que suscitent nos inventions et agirs en politique, en science et technique, une lueur d’espoir est encore possible. Le poète Hölderlin nous dira que “là où croit le danger, là aussi croit ce qui sauve’’. L’angoisse devant le monde peut nous permettre de prendre conscience de notre finitude et de notre étrange fragilité. En ces temps sombres où la menace de nos inventions plane sur notre vécu, l’homme devra faire l’expérience de l’angoisse pensante. Car en elle et avec elle, nous réalisons la solitude de notre être. « Ce « solipsisme » existential transporte si peu un sujet à l’état de chose isolée dans le vide aseptisé où il apparait en dehors de tout monde qu’il met justement le Dasein, dans toute la rigueur des termes, devant son monde comme monde et le met lui-même, du même coup, devant lui-même comme être-au-monde » (Heidegger, 1986, p. 237).
Cette solitude, différente de l’être-homme solitaire, qui trouve son plein sens dans la manière d’être du Dasein de Heidegger dans la campagne, dans la province, comme développé précédemment, est un face-à-face de l’homme avec lui-même comme expérience de la pensée. C’est ce dont a besoin l’homme d’aujourd’hui pour se découvrir et écouter la voix intérieure qui parle sans cesse en lui. Il a besoin d’un solipsisme existential qui le transporte dans un vide aseptisé, désinfecté de toute inauthenticité, pour qu’il découvre le monde et son monde. Ce solipsisme se pose comme une catharsis pour penser notre rapport au monde, à l’étant. Pour Heidegger (Idem, p. 238), cela « fait voir « comment on se sent ». Dans l’angoisse on se sent “étranger” ». Se sentir étranger et savoir comment on se sent après l’expérience de l’angoisse, c’est repartir sur de nouvelles bases comme ouverture sur le monde, sur l’avenir afin de construire une polis authentique. Voilà comment dans le schématisme heideggérien, être, néant, penser, liberté, habiter, politique, disent le même dans une forme de co-appartenance.
N’est-ce pas là reconnaître que l’expérience poétique prend tout son sens comme expérience de la pensée dans la pensée ? Le poète qui expérimente l’angoisse du danger en tant que là , en tant que moment, lieu, topos, ne fait-il pas ainsi signe à la temporalité, au moment venu de la vérité de l’être-homme, au lieu comme territoire, polis, où peut se déployer toute la vérité de l’être-homme ? S’interroger de la sorte, n’est-ce pas annoncer l’ontologie poétique comme la vérité ontologique de la politique ? En son fond ontologique, poétiser, n’est-ce pas faire l’expérience avec les dieux ?
3. DE L’ONTOLOGIE POÉTIQUE À L’ONTOLOGIE POLITIQUE : L’HABITER EN QUESTION
Dans ce qui précède et qui annonce ce moment de l’analyse, il a été ainsi questionné, en dernier ressort, qu’en son fond ontologique, poétiser, n’est-ce pas faire l’expérience avec les dieux ? On pourrait même se demander : pourquoi poétiser ? Mieux encore, pourquoi poétiser en temps de crise, en temps de détresse, au cœur de la polis ? En temps de crise, ne faut-il pas plutôt convoquer les stratégies matérielles et techniques – le dispositif infra-structurel – pour mieux endiguer la catastrophe, plutôt que de s’orienter vers le spéculatif poétique ? Quel intérêt, y a-t-il donc à poétiser en temps de crise ?
La portée ou la charge métaphysique, décelable chez Heidegger quant à son attachement pour la terre natale, découle essentiellement de son admiration du paysage alémanique. Son pays, ce sont ses forêts, ses cours d’eau, ses montagnes, ses traditions. La Souabe, c’est aussi ce monde paysan attaché à la terre et à sa tradition. C’est un monde qui, cultivant la terre et attendant la faveur du ciel, a l’expérience des dieux. Ce natal de Martin Heidegger, c’est aussi, en plus de son espace, sa langue qui totalise son espace et fait être. L’intérêt philosophique d’un tel paysage explique fondamentalement son ontologie qui ne cesse de recourir au monde grec et à ses dieux, au regard des liens historiques entre la civilisation gréco-romaine et l’Allemagne.
L’ontologie se révélant dans la poésie, ou encore saisissant la poésie, y trouve la manifestation de la vérité de l’Être ; vérité qui est elle-même aletheia, dévoilement. En effet, si la poésie devient une constituante de l’ontologie comme sa vérité même, c’est bien par sa capacité de révélabilité, de créativité, à saisir le réel comme vérité à ex-poser. Ainsi, on peut comprendre la saisie de la figure du poète comme celui qui, révélant la vérité, dit l’Être, dit la parole, pense, disserte sur les dieux et donc philosophe. Une telle compréhension a, de ce fait, une double conséquence du point de vue ontologique et politique.
D’abord, ontologiquement, la poésie devient la vérité de l’art et se pose comme le type d’art qui a un rapport étroit à l’être. Or, l’ontologie, qui a tenté de comprendre l’être avant de découvrir la poésie comme telle, tout en restant philosophique, révèle la philosophie par la poésie. En effet, cette approche de l’ontologie de la création poétique dans son rapport à l’habiter, à l’exister humain est propre à la philosophie dans son être originel en tant que pensée sur les principes premiers des choses. La philosophie dans son matin grec se donne elle-même comme poème. Cet aspect poématique de la philosophie est à saisir comme intellection de ce qui est et qui donne à penser : l’Être. C’est ce qui fait du dire poétique, un dire dévoilant, aletheia. Désormais, si philosopher, c’est penser, la poésie, de par son étroitesse ou encore de par sa mêmeté à l’Être, il devient le penser en son fond décelant chez Heidegger. On pourrait dire alors que, chez Heidegger, la poésie est l’ontologie, disons-le, poétiser, c’est déceler l’Être, c’est donc penser fondamentalement. Si cela est vrai, c’est bien parce que le poète est celui qui se rappelle du terroir, du natal, de la terre, des dieux. Se rappelant, il poétise le pays, il invite au ressourcement spirituel du Dasein qui doit construire et diriger la polis. Le poète invite le Dasein à aimer sa patrie (Heimat).
L’ontologie poétique nourrit donc, implicitement, là est la deuxième conséquence, une vocation politique dans la mesure où saisissant le Dasein dans son être, elle veut lui indiquer une manière d’être qui consiste à habiter en harmonie avec sa terre, sa patrie à travers son paysage, sa tradition. L’exemple de Hölderlin dissertant sur la « Germanie et le Rhin », sur les dieux, démontre bien cette proximité entre le poète et la patrie. Le fleuve du Rhin chargé d’histoire dans la puissance politique de la Germanie ou de l’Allemagne, en suscitant de l’intérêt pour le poète, appelle au patriotisme, à la pensée. C’est bien pourquoi, Heidegger élève Hölderlin au même titre qu’un Hegel, qu’un Nietzsche du point de vue de la pensée. On se rappellera donc du lien entre penser et poétiser : le penseur poétise, le poète pense. L’être de la poésie est donc en vue de l’être du Dasein, de son habiter, de l’État.
La mission de la poésie dans le corpus heideggérien est d’apprendre à habiter la terre. Or, habiter la terre, c’est aménager l’espace pour bâtir, pour laisser croitre ce qui a besoin de vivre et de grandir dans la tolérance de la diversité. Une telle mission de la poésie a donc implicitement une vocation politique, car dans l’aménagement aménageant, elle cherche la co-existence au cœur de la polis. L’espace politique, de ce fait, étant le lieu de la théâtralisation du Dasein, devient un espace qui a besoin d’être dans la mesure mesurante des quadras (la terre, le ciel, les mortels et les divins), car « les mortels habitent alors qu’ils attendent les divins comme tels. » (Heidegger, 1958, p. 178.) C’est pourquoi, pour Aoun Mouchir[5], la poésie permet de réconcilier l’ontologie et la politique. Ontologie en tant qu’être de l’être et politique en tant qu’organisation de la cité par le Dasein à la recherche d’un mode d’être authentique pour le bonheur des citoyens.
Le philosopher heideggérien, en ce sens, en se rappelant les dieux grecs et des poètes, espace historico-géographique et modèles d’homme par excellence qui signe « l’acte de naissance de l’homme occidental, le surgissement véritable de l’esprit, avec les valeurs que nous reconnaissons à ce terme. », n’a rien d’une spéculation creuse, vermoulue, démodée ou encore obsolète (J.-P. Vernant, 1994, p. 11). Pour Bourdieu, par exemple, la philosophie de Heidegger a des surdéterminations et des visées politiques dans son élaboration.
L’habitus de ce « professeur ordinaire » issu de la toute petite bourgeoisie rurale qui ne peut pas penser et parler politique autrement que selon les schèmes de pensée et les mots de l’ontologie –au point de faire d’un discours de recteur nazi une profession de foi métaphysique –est l’opérateur pratique de l’homologie qui s’établit entre une position philosophique et une position politique sur la base de l’homologie entre le champ philosophique et le champ politique. (Bourdieu, 1988, pp.57-58).
Cela peut se lire à travers la période où se fait cette philosophie, dans un monde en pleine crise, dans une Allemagne qui cherche à se reconquérir en bâtissant un nouveau type de citoyen, après sa défaite devant ses adversaires lors de la seconde guerre ; mais aussi et surtout dans sa logique scientifique qui révolutionne la métaphysique en tant qu’ontologie fondamentale.
Après avoir montré l’ontologie poétique qui se politise en tant que recherche d’une manière d’être poétique du Dasein, il faut montrer le rapport entre poésie et les dieux qui, dans leur proximité, fondent l’habiter. Cela est une exigence éthique dans la mesure où « en mobilisant l’ensemble de la matière terrestre, l’homme s’est mobilisé lui-même comme être territorial et s’est en quelque sorte objectivé lui-même dans un système technique au sein duquel il semble toujours pressentir l’imminence de son anéantissement » (Dulau, 2009, p. 98). L’imminence de cet anéantissement, qui pointe à l’horizon comme le produit de nos pensées, doit, pour pouvoir être surmonté, être compris comme une pensée revenant sur elle-même. Une telle pensée redéfinit l’habiter.
L’habiter n’est pas un simple aménagement de l’espace pour y être simplement. L’homme, dans l’habiter, dompte l’espace pour bâtir. Dans ce bâtir, il s’organise rationnellement en y mettant sa dimension d’être historico-temporel. L’homme est, en effet, le seul qui habite, plus encore, il est le seul qui habite en poète. L’habiter poétique, en le distinguant des autres êtres, fait être l’espace pour que l’homme s’y aménage. (Heidegger, 1958, p. 188), dira que « le rapport de l’homme à des lieux et, par des lieux, à des espaces réside dans l’habitation. La relation de l’homme et de l’espace n’est rien d’autre que l’habitation pensée dans son être. » En tant que celui qui possède la parole, l’homme fait être les choses. Cette parole qui fait être, dans sa constitution fondamentalement ontologique, singularise l’habitation, poétiquement, dans la mesure où faisant apparaitre les choses, elle les ex-pose dans la mesure. Cette mesure, dans l’apparition comme ex-position, pose l’étant dans la présence, de sorte à le spatialiser.
Or, cette spatialisation n’est pas un simple espace se spatialisant. Elle est la manifestation des quadras. La compréhension de cette spatialisation étant le propre du Dasein, le fait être dans la mesure de la terre, du ciel, des mortels et des divins. Demeurant dans une telle centralité mesurante non géométrique spatialisant ontologiquement, l’homme est celui qui habite en poète. En clair, l’homme qui habite en poète est celui qui a une compréhension des quadras et qui comprenant, est dans leur juste mesure. Mais d’où vient-il qu’habitant poétiquement, il y a crise de l’habiter, dans l’habitation ? Cette question invite une autre : Est-ce que tous habitent en poète ?
En effet, dans la mesure où dans sa constitution ontologique, l’homme est apparition entre le ciel, la terre, les mortels et les divins et qu’il y mène, sa vie durant, toute son histoire, dans une lecture heideggérienne, l’homme chargé d’histoire, de façon générale, habite en poète. Mais tout le monde n’a pas, et c’est là toute l’originalité de Heidegger, cette compréhension poétique de l’habitation : et pourtant l’homme habite en poète. D’où la crise de l’habitation.
L’habiter, c’est l’intériorisation de l’espace par la position spirituelle de limites. Si Heidegger tient tant à sa fameuse configuration poétique et mythique sacrée du monde, s’il ne cesse d’affirmer que l’homme ne fait l’expérience de la présence au monde que parce qu’il est toujours déjà inscrit en un territoire qui relève d’une topographie sacrée (le « Geviert » ), c’est justement parce qu’il veut signaler ce phénomène d’appropriation toujours déjà spirituelle de l’extériorité. (P. Dulau, 2009, p. 193).
De ce fait, l’habitation n’est pas une simple configuration de l’espace. L’habitation ne relève pas de la souveraineté de l’homme, mais plutôt se fait sur l’injonction de l’Être. Elle est, en son fond, essentiel appropriation spirituelle d’un intérieur qui s’extériorise pour dompter l’espace. « C’est pour mieux faire sentir maintenant que ce que l’on entend couramment par « territoire », c’est un fait spirituel où s’exerce l’autorité de l’Être sur l’homme et de l’homme sur l’étant ; jeu d’autorité qui seul rend possible à la dimension de la présence de devenir un « chez soi » de la pensée, elle qui sans cela demeurerait dans l’indétermination et l’errance. » (P. Dulau, Op. cit., p. 194).
Cette habitation de l’espace, du point de vue de l’ontologie, redéfinit alors l’espace, mais aussi et surtout le territoire. Car, l’homme ne fait véritablement l’expérience de l’espace et du territoire qu’à partir d’une expérience du sacré, des quadras (Gewiert). C’est pourquoi aux dires de Dulau, l’habitation dans l’espace est un fait spirituel où l’autorité de l’Être s’exerce sur l’homme et l’homme sur l’étant. C’est ce jeu d’autorité qui possibilise, par le biais de la pensée, le chez soi. De ce fait, sans la pensée l’homme demeurerait dans l’indétermination et dans l’errance. Cette lecture heideggérienne est lourde de conséquence. En effet, si l’habitation se donne comme mesure dans les quadras, c’est dire qu’un individu ou communauté ne peut découvrir fondamentalement son autorité qu’à partir du moment où, étant dans une configuration qui le rattache à un lieu, ce lieu doit être un repère sacré, chargé symboliquement, pour pasticher Dulau.
« Les lieux étant essentiellement des repères sacrés, chargés symboliquement, qui ont tous pour propriété de manifester d’une manière ou d’une autre le Quadriparti, disons d’en dessiner les contours. » (Idem, p. 192), c’est pourquoi l’espace est le résultat de la configuration du sacré et non l’inverse. Chez Heidegger, l’éthique étant une manière d’habiter, la parole doit se dire dans la mesure éthique, c’est-à-dire nommer essentiellement pour l’apparition de la vérité des choses en vue d’un habiter authentique. C’est donc à partir de cette injonction éthique que l’homme habite et ek-siste. Chez Heidegger, seul l’homme a une telle compréhension de l’être des choses et peut en être ainsi. De ce fait,
l’ek-sistence ainsi comprise est non seulement le fondement de la possibilité de la raison, ratio, elle est cela même en quoi l’essence de l’homme garde la provenance de sa détermination. L’ek-sistence ne peut se dire que de l’essence de l’homme, c’est-à-dire de la manière humaine d’ « être » ; car l’homme seul est, pour autant que nous en ayons l’expérience, engagé dans le destin de l’ek-sistence. (Heidegger, 1964, p. 57)
C’est ce qui explique le fondement ontologique de l’habitation en tant que séjour auprès des dieux, ethos. On peut donc comprendre tout l’attachement de Martin Heidegger à son terroir, à sa tradition comme analysé précédemment.
Cette terre, qui fait penser, réconcilie l’homme à l’espace dans une forme de co-appartenance et de co-appropraition en orientant le regard de l’homme vers les dieux. C’est pourquoi, la poésie se rappelle continuellement des dieux afin de penser le séjour de l’homme dans la vérité de l’Être à l’image d’un Héraclite invitant ses visiteurs à le rejoindre près du four au pain, car là aussi y habitent les dieux. En ces temps de crise et de déchéance humaine, notre recours à la grécité qui doit se faire impérativement pour un ressourcement spirituel, n’est pas un saut spatial en arrière. Mais plutôt, il se saisit comme un saut qui sait se rappeler et qui sait se tourner comme le calao qui, par voie de prudence, regarde l’arrière pour garantir le devenir à partir d’une avancée dans la vigilance. C’est donc un saut dans la tridimensionnalité du temps afin d’habiter poétiquement dans l’espace des dieux avec les dieux. Cette manière d’être est une philosophie ou une pensée qui sait se rappeler de la vie en cherchant à la re-créer, la façonner éthiquement, car « exister signifie aller d’une découverte à une autre, passer d’un évènement à un autre, en un mot, créer. Cette créativité fondamentale que révèle Philosophie et existence recèle la justification de la créativité imminente, artistique, scientifique ou sociale. » (Savadogo, 2016, p. 48). Cette création imminente au cœur de l’art, des sciences et du social doit être, en un temps de crises de valeur, promue afin que l’homme et surtout le politique soient de plus en plus créateurs « par ricochet un « artiste » qui produit dans une certaine mesure l’œuvre politique. » comme le poète, (Koffi, 2013, p. 70). N’est-ce pas là faire un signe vers « l’esth/éthique » de Paul Audi[6]?
Conclusion
Cette réflexion, qui jusque-là, a pris en charge la poésie ainsi que sa vocation politique et les dieux pour expliquer le sens de l’habiter, se veut comme un appel éthique à la reconversion du regard de l’homme sur l’étant. En clair, dans le vouloir technique de transformer le monde, avec son lot de succès et d’atrocités, il importe d’adopter l’attitude phénoménologique du poète pour comprendre le réel dans sa double monstration à partir du voir et de l’écoute abstraits. C’est aussi et surtout re-considérer l’espace des dieux qui, dans leurs concours, rappellent l’espace du sacré. Ce rappel du sacré est un signe fait vers l’humain dans ce qu’il a de sacré. De la sorte, le sacré, bien médité, fait penser à la condition fragile de l’homme en révélant sa vérité profonde : le besoin d’humanisme et d’humanité en tout. C’est pourquoi, de la technique qui courbe l’humanité, le poète peut élever le regard vers les dieux en libérant l’homme pour qu’il re-fasse à nouveau l’expérience de la pensée dans ce monde où tout est prêt-à-porter, où tout est programmé sans l’homme.
Références bibliographiques
AOUN Mouchir Basile, 2016, La cité humaine dans la pensée de martin Heidegger – lieu de réconciliation de l’être et du politique, Paris, L’Harmattan, 570 p.
AUDI Paul, 2007, Supériorité de l’éthique, Paris, Flammarion, 344 p.
BOURDIEU Pierre, 1988, L’ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Les éditions de minuit, 129 p.
DULAU Pierre, 2009, « Martin Heidegger, La parole et la terre », in Thierry Paquot et Chris Younès, Le territoire des philosophes, La Découverte, Recherches, 23 p.
HUSSERL Edmund, 1989, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, traduit par Gérard Granel, La Haye, Gallimard, 587 p.
HEIDEGGER Martin, 1995, Écrits politiques (1933- 1966), présentation, traduction et notes par François Fédier, Paris, Gallimard, 327 p.
HEIDEGGER Martin, 1964, Lettre sur l’humanisme, traduit de l’allemand par Roger Munier, Paris, Aubier Montaigne, 194 p.
HEIDEGGER Martin, 1966, Questions III et IV, traduit de l’Allemand par Jean Beaufret, François Fédier, Julien Hervier, Jean Lauxerois, Roger Munier, André Préau et Claude Roels, Paris, Gallimard, 497 p.
HEIDEGGER Martin, 1988, Les hymnes de Hölderlin : la Germanie et le Rhin, Texte établi par Suzanne Ziegler, Traduit de l’Allemand par François Fédier et Julien Hervier, Paris, Editions Gallimard, 289 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et conférences, traduit de l’Allemand par André Préau, Paris, Gallimard, 357 p.
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et Temps, Traduit par François Vezin, Paris, Gallimard, 597 p.
KOFFI Koffi Alexis, 2013, Herméneutique de l’« homo politicus », Essai d’une politique fondamentale, Noῦς, CERPHIS, No 011-Décembre, 17 p.
KOUAKOU Antoine, 2011, « Pauvreté de l’Être et habitation de la terre, Hommage à un Maitre, Augustin Dibi, une figure vivante de la pensée pensante », in Annales philosophiques de l’UCAO, No 6, 15 p.
MAXENCE Jean Caron, 2005, Introduction à Heidegger, Paris, Ellipses, 95 p.
SAVADOGO Mahamadé, 2016, Théorie de la création, philosophie et créativité, Paris, L’Harmattan, 154 p.
VERNANT Jean Pierre, 1994, Mythe et pensée chez les Grecs, Textes à l’appui, Histoire Classique, Série dirigée par Pierre Vidal-Naquet, Editions la Découverte, Paris, 433 p.
[1] Comme La Monadologie est composée en 90 paragraphes, c’est ce critère qui sera utilisé pour citer les sources extraites de cet ouvrage.
[2] Sans cette provenance théologique, je ne serais jamais parvenu sur le chemin de la pensée. Mais provenance, à qui va plus loin, demeure toujours avenir.
[3] Le Christ est la visibilité du Dieu invisible, il est le Connu de l’Inconnu. Mais cette connaissance du Père et du Fils ne portera son fruit en l’homme que quand « dans le silence, l’esprit alentour fleurit. ».
[4] Cf. Hubert Dreyfus citant Heidegger donne un exemple parlant de ce dévoilement : « L’artisan doit être compris comme correspondant à ses matériaux, ainsi un vrai menuisier s’efforce de se mettre en correspondance avec les différentes espèces de bois, les formes y dormant, le bois lui-même, tel qu’il pénètre la demeure des hommes. C’est cette relation au bois qui fait tout le métier sans lui cette occupation ne serait plus déterminée que par le seul profit. »
[5] Voir Mouchir Basile AOUN, La cité humaine dans la pensée de martin Heidegger – lieu de réconciliation de l’être et du politique, Paris, L’Harmattan, 2016.
[6] Voir Paul AUDI, Supériorité de l’éthique, Paris, Flammarion, 2007.