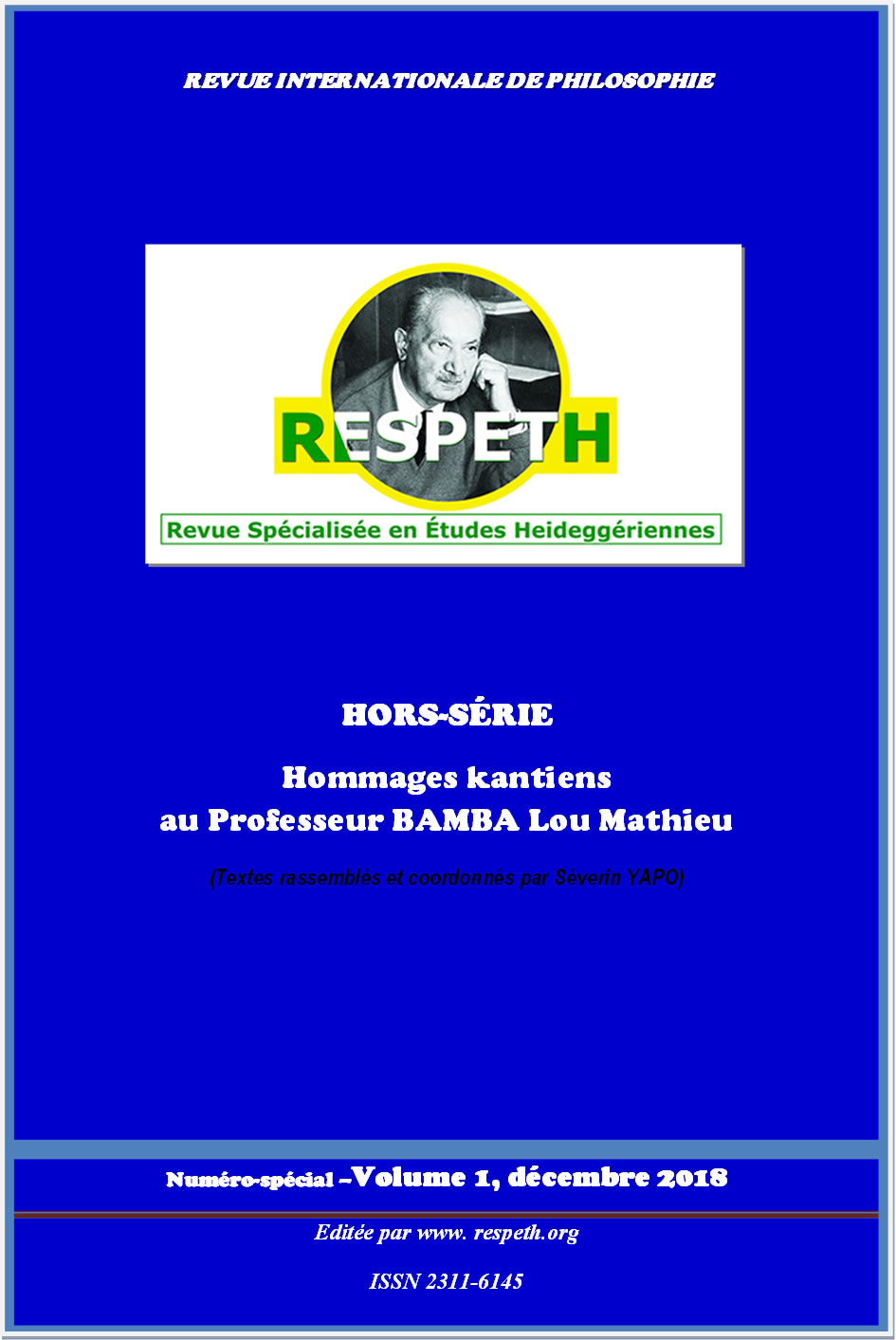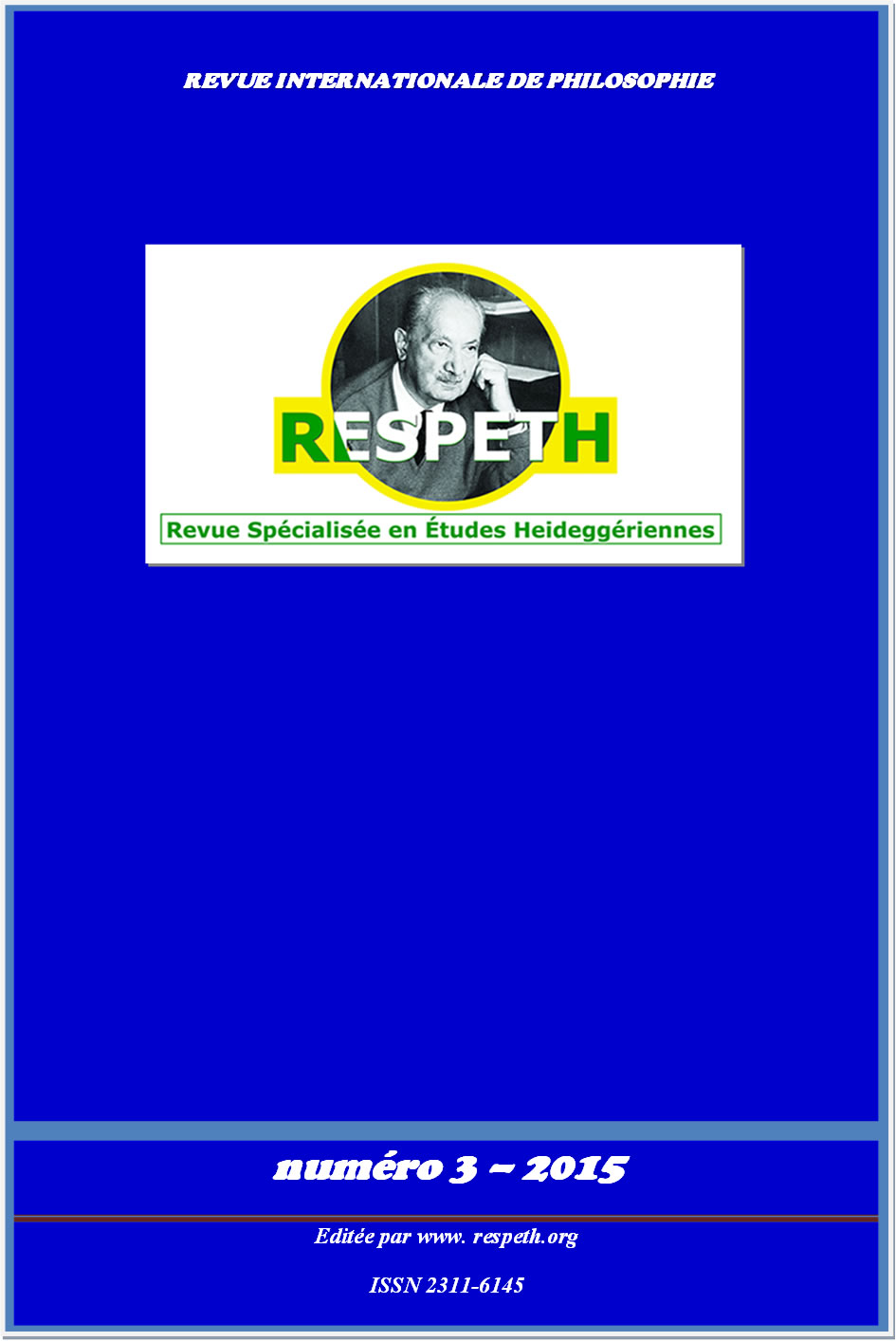RESPETH6-2018
SOMMAIRE
Pourquoi Heidegger ? .…………………………………………………………………..9
ILBOUDO (Albert), Ontologie et finitude chez Martin Heidegger...55
Présentation et Sommaire N°6 > Résumés des articles N°6
www.respeth.org, 2018
22 BP 1266 Abidjan 22 (Côte d’Ivoire)
Email : publications@respeth.org
Tél. : 00225 09 62 61 29 00225 40 39 26 95 00225 09 08 20 94
ORIENTATIONS DE LA REVUE
RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches sur Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody (Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C’est une revue internationale à caractère philosophique qui paraît une fois l’an (en édition régulière). En dehors de cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée du philosophe Martin HEIDEGGER.
La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, novatrices ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions d’ordre théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se rapportant à la pensée du philosophe :
* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les thèmes liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ;
* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ;
* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou moins heideggérien, les textes philosophiques ;
* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de Martin HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes non-occidentaux.
* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons ;
* Des comptes rendus d’ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER.
RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du concours pour le Prix d’Excellence DIBI Kouadio Augustin.
Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue RESPETH se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, les professeurs et étudiants qui s’intéressent au devenir de la philosophie d’influence heideggérienne.
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Andrius Darius VALEVICIUS, Université de Sherkrooke, Québec, Canada
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Augustin DIBI Kouadio, Prof. Titulaire, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Jacques NANÉMA, Prof. Titulaire, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Jean-Luc AKA-EVY, Prof. Titulaire, Université Marien NGOUABI, Congo-Brazaville
Sophie-Jan ARRIEN, Prof. Titulaire, Université de Laval, Canada
COMITÉ DE LECTURE
Andrius Darius VALEVICIUS, Université de Sherkrooke, Québec, Canada
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Raoul KOUASSI Kpa Yao, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Augustin DIBI Kouadio, Prof. Titulaire, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Jacques NANÉMA, Prof. Titulaire, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Jean-Luc AKA-EVY, Prof. Titulaire, Université Marien NGOUABI, Congo-Brazaville
Sophie-Jan ARRIEN, Prof. Titulaire, Université de Laval, Canada
COMITÉ DE RÉDACTION
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
REDACTEUR EN CHEF :
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
Séverin YAPO, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Léonard KOUASSI Kouadio, Institut National du Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle, Côte d’Ivoire
MEMBRES :
Alexis KOFFI Koffi, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Christophe PERRIN, Université Paris-Sorbonne, France
Élysée PAUQUOUD Konan, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire
Oscar KONAN Kouadio, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Pascal ROY-EMA, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Sylvain CAMILLERI, Université Catholique de Louvain, Belgique
RESPONSABLE TECHNIQUE :
Raoul KOUASSI Kpa Yao, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
SOMMAIRE
Pourquoi Heidegger ? .…………………………………………………………………..9
AKANOKABIA (Akanis Maxime), La question nietzschéenne de l’événement et son interprétation par Martin Heidegger .……………………………………………………………………………………11
NDÉNÉ (Mbodji), La communication de groupe chez Nietzsche : un culte initiatique manqué ? .…………………………………………35
ILBOUDO (Albert), Ontologie et finitude chez Martin Heidegger...55
NDOUA (Kouassi Clément), Être et visage : proximité et distance entre Levinas et Heidegger………………………………………72
KONÉ (Ange Allassane), L’humanisme platonicien : une solution à la crise migratoire.……………………………………………………….90
POURQUOI HEIDEGGER ?
Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, en terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante qu’il faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, avec Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont l’histoire consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire de beaucoup de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit nullement dans un conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise plutôt à scruter un implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport de la conscience aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun prétexte, pour autant que l’homme, quelle que soit sa particularité individuelle ou collective, ne peut pas ne pas comprendre que le point de départ de l’histoire s’inscrit nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-delà de tout ce qui nous préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de divergences ou même de conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous détermine tous : nous sommes des consciences devant les déterminités. Et la conscience ne parvient à sa vérité que dans une appartenance essentielle au Concept, comme expression d’une pensée substantielle de son rapport aux choses. De ce point de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si complexe qu’une complaisance à son égard influence négativement la marche dans l’histoire de tout peuple. La qualité de cette marche est donc déterminée par le sérieux et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans la présence des choses. Husserl, dont la philosophie est une réappropriation de la conscience, dans son essentialité, nous permet de bien comprendre qu’une pensée rigoureuse ne peut se dispenser de la vérité de la conscience dans son rapport aux choses, d’où la nécessité fondamentale de l’époché, pour accéder au moi transcendantal ; car une conscience encombrée de psychologisme rend impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son intentionnalité. C’est la réduction transcendantale pour désobstruer le rapport de la conscience aux choses. Le retour aux choses ou “droit aux choses mêmes”, comme idée substantielle de la phénoménologie husserlienne, est le retour de la conscience dans sa pureté originelle, seul gage pour rendre la philosophie, c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, comme science rigoureuse. Le célèbre article de Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, paru en 1911, en donne la pleine mesure. La conscience, étant le fondement premier de toute science, y compris la philosophie en premier, exige d’être pensée en soi, comme conscience transcendantale, pour donner au Concept toute la rigueur de son sens. La rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la réduction phénoménologique, chez Husserl, traverse toute la pensée de Heidegger, qui l’enracine dans une expérience plus originaire et plus originelle, celle avec l’Être.
Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même que celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du Népal sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la réalité non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le chien comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde sur le non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-présent. Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation constante d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité.
Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver de l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement “jeune”, qui implique, sans aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans laquelle, de toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour donner à l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une question d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, dans la mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui structure, de manière universelle, son existence.
Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige une méditation sur le rapport de l’étant à l’être. Un rapport dans lequel l’étant est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une articulation nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la métaphysique de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières pages de Être et Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est aujourd’hui tombée dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au préalable, il n’a pas manqué de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer tout l’enjeu de sa pensée : « Avons-nous une réponse à la question de savoir ce que nous voulons dire exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. Dans ces conditions, il faut poser en termes tout à fait neufs la question du sens de l’être. Sommes-nous donc seulement aujourd’hui encore dans l’aporie de ne pas entendre l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces conditions, le plus urgent, c’est de réveiller une entente pour le sens de cette question » (Idem, p. 21). Il s’agit, alors, de pousser à fond le rapport de l’homme au savoir pour qu’advienne et se maintienne, sans prétention et de manière définitive, son essence pensante, si tant est que rien ne peut possibiliser son existence, s’il n’est radicalement établi dans cette essence. Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde pensante de la garde de l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans laquelle l’homme accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à aucune race et à aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait pas le propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde de la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et poursuit sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est pleinement chez soi. Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux peuples, qu’elle soit embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut l’accueillir, avec grande sérénité et lui permettre de croître dans le secret de sa puissance, qui rend puissants les peuples qui savent la contempler dans la splendeur de sa vérité. Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin de liberté, parce qu’est libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où sont brisées les idoles de nos excessifs particularismes et de nos primitivités, dénuées du saut qualitatif, nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de cette idée heideggérienne : Là où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. Ce qui suppose qu’il faut, dès la départ, écarter, avec une violence salutaire, l’idée d’une rationalité multiple, comme si “un plus un” feraient, ailleurs, autre chose que deux. La logique n’est ni culturelle, ni géographique, c’est le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, selon Hegel, réside dans la conscience de soi, conscience parvenant à son contenu comme Concept. Ce Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi dire, des Grecs. Serait-il scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il pas revendiquer autre chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est menacée de faillite, en raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, pourrions-nous ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur fondement ultime dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, aujourd’hui, honneur à défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, pas pour des raisons de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut pas avoir un ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire “nous sommes des Grecs ?” Heidegger nous donne l’excellente réponse : « Grec, cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les différents modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée par lui, sans pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405).
Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore suffisante des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité sociale et politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se construit tout peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève dans l’horizon de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais nécessaire. Bien qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la pensée des valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas moins la question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme fondamental, comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance tout humanisme classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à sauvegarder. Il serait, alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre donnerait des directives à l’action de l’homme ; une telle orientation est, simplement, aux antipodes de la pensée de Martin Heidegger, pour qui la pensée est en soi une action radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue au rang d’action du seul fait qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à La pensée agit en tant qu’elle pense. (…) Cet agir est probablement le plus simple en même que le plus haut, parce qu’il concerne la relation de l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, p. 68). Pourquoi ? Parce que là où existent des distorsions sociales et des horizons historiques confus, la pensée ne s’est pas suffisamment accomplie, c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec vigueur et rigueur, porté son essence dans la seule relation, qui lui donne tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il pas alors bien étonnant de montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel Faye, que Heidegger est un théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait injuste d’enfermer le grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa vie (Six mois rectorat sous le régime des nazis), alors même que la commission de « Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu lieu depuis le courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe de la Forêt Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le rectorat sous le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être discrédité par son son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les accointances avec le nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de pensée du dernier des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas Dieu ; et la grande intelligence n’est pas canonisation.
« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). Apprendre à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine l’humanité de l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait écrire : « Plein de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ». Puissent nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de l’Être, pour qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant.
Jean Gobert TANOH
LA QUESTION NIETZSCHÉENNE DE L’ÉVÉNEMENT ET SON INTERPRÉTATION PAR MARTIN HEIDEGGER
Akanis Maxime AKANOKABIA
Université Marien NGOUABI de Brazzaville
Résumé : Cette réflexion consiste à repenser le statut de l’événement dans l’univers métaphysique nietzschéen. Pour la meilleure compréhension de la question, nous avons fait le choix d’élire un corpus, c’est-à-dire de créer les modes d’accès à la compréhension nietzschéenne du concept à partir de l’herméneutique heideggérienne. Il s’agit par-là de revisiter un concept qui, à en croire l’interprétation heideggérienne, constitue l’essence même de l’histoire de l’Occident. C’est à partir de l’expression « Dieu est mort » qui constitue d’ailleurs la nature même du nihilisme, que se donne à voir la dimension nietzschéenne de l’événement. Cette expression signifie que le monde suprasensible n’existe plus, et tous ceux qui croyaient en son existence doivent désormais apprendre à vivre sans ce fantasme, et qu’il revient à l’homme, d’inventer un nouveau monde. L’expression « Dieu est mort » est un événement parce qu’elle est instauratrice de monde, et qu’à la place de l’effondrement du suprasensible, se crée un nouveau monde avec de nouvelles valeurs. Par conséquent, le nouveau monde qui advient ne sera pas construit par le même type d’homme, mais plutôt par et avec un nouveau type d’homme à savoir le surhomme, considéré aussi à son tour comme événement. Ce qui signifie en d’autres termes que, la « mort de Dieu » est un événement qui engendre en son sein un nouvel événement qui est celui de la naissance d’une nouvelle humanité, car depuis l’écroulement des valeurs anciennes, le monde n’est plus le même, et notre manière d’être au monde a aussi changé.
Mots-clés : ÉVENEMENT, HOMME, INTERPRETATION, METAPHYSIQUE, MORT DE DIEU, SURHOMME.
Abstract : This reflection consists in rethinking the status of the event in the Nietzschean metaphysical universe. For the better understanding of the question, we chose to elect a corpus, that is to say, creating the modes of access to the Nietzschean understanding of the concept from Heideggerian hermeneutics. This is to revisit a concept that, according to the Heideggerian interpretation, is the essence of the history of the West. It is from the expression “God is dead” which constitutes besides the very nature of nihilism, that gives itself to see the Nietzschean dimension of the event. This expression means that the supersensible world no longer exists, and all those who believed in its existence must henceforth learn to live without this fantasy, and that it is up to man to invent a new world. The phrase “God is dead” is an event because it is the creator of the world, and instead of the collapse of the suprasensible, creates a new world with new values. Therefore, the new world that will come will not be built by the same type of man, but rather by and with a new type of man namely the superman, also considered in turn as an event. Which means in other words that, the “death of God” is an event that engenders within it a new event which is that of the birth of a new humanity, since the collapse of ancient values, the world is no longer the same, and our way of being in the world has also changed.
Keywords: EVENT, MAN, INTERPRETATION, METAPHYSICS, DEATH OF GOD, SUPERMAN.
Introduction
Dans les Cahiers Congolais de Métaphysique, on peut lire :
« Il faut reprendre à Marx et Engels la métaphore du spectre pour penser la place de la métaphysique dans la philosophie et déterminer son rapport aux autres disciplines philosophiques. Car une chose est sûre : la métaphysique est un spectre qui hante la philosophie. Nombreux sont en effet les courants philosophiques qui travaillent à ruiner la métaphysique. Ainsi, les deux courants majeurs de la philosophie contemporaine – la phénoménologie et la philosophie analytique – ne l’évoquent-ils que pour en proclamer la fin, à tout le moins le dépassement. Et pourtant, la métaphysique ne cesse de renaître de ses cendres, à rebours de la chronique de sa fin annoncée et de réapparaître plus vivante que jamais de son prétendu dépassement ». (C. T. Kounkou, 2015, p. 5)
Ces propos clarifient, à nouveaux frais, la place majeure qu’occupe la métaphysique dans l’édifice philosophique occidental, car certains ont tenté de la dépasser ; et d’autres, par contre, ont même proclamé sa mort, mais en vain. La métaphysique, en tant que telle, demeure toujours la veine essentielle du dispositif philosophique. C’est à ce titre, que Jean-Marc Narbonne et Luc Langlois (1999) disaient : « L’on peut en effet établir sans trop de peine que, de l’ensemble entier des termes et des concepts dont s’est nourri le discours philosophique jusqu’à aujourd’hui, il n’en est aucun qui, dans sa capacité à désigner ce qu’il y a d’essentiel, d’englobant et de décisif dans la démarche philosophique, puisse espérer rivaliser avec celui-ci ». Nietzsche est, d’ailleurs, parmi ceux-là mêmes qui ont annoncé sa fin, occasionnant par conséquent ce qu’il qualifie lui-même d’inversion de la métaphysique. Une inversion qui annonce la fin de la décadence au profit d’une philosophie qui privilégie d’abord et avant tout le vivant. L’objet de notre réflexion est de savoir comment comprendre le fond même d’une œuvre aussi dense que celle de Nietzsche, si l’on n’a pas pris le soin de bien le lire ? Bien lire Nietzsche, signifie aussi savoir écouter et savoir aussi s’aligner derrière ceux-là mêmes qui ont consacré toutes leurs carrières à le lire, à l’enseigner et à l’interpréter. Or, interpréter Nietzsche signifie qu’on l’a lu et compris, alors que comprendre Nietzsche, cela suppose que l’on soit en parfaite harmonie avec son corpus. Un corpus dense et énigmatique qui nécessite une certaine habitude. C’est dans cette perspective que Martin Heidegger, en lecteur et interprète attentif du philosophe de l’éternel retour et du même, figure parmi ces grands métaphysiciens qui ont ouvert la voie à une meilleure connaissance de la pensée de Nietzsche. Notre recherche consiste à clarifier, à partir de certaines occurrences précises, la manière dont se donne à voir l’interprétation nietzschéenne de l’événement par Martin Heidegger. Comment appréhender le fameux Holzwege heideggérien comme l’une des voies d’accès à la compréhension de la question nietzschéenne de l’événement ? Le philosophe fribourgeois serait-il l’interprète fidèle de la pensée de Nietzsche ? Si tel est le cas, en quoi réside la pertinence d’une telle interprétation ? Autrement dit, quel rapport pourrait-on établir entre l’annonce de la mort de Dieu (entendue comme événement) et le projet nietzschéen qui se trame derrière un tel événement ? Une telle recherche reste complexe, certes mais précise ; car nous essayerons de montrer en quoi l’interprétation heideggérienne sur la question de l’événement chez Nietzsche apparaît comme le fil conducteur à partir duquel se donne à voir l’horizon métaphysique. Autrement dit, comment se donne à lire, à partir du corpus heideggérien, le concept nietzschéen de l’événement dans son rapport à l’avènement ?
1. DE L’ÉVÉNEMENT COMME CONCEPT MÉTAPHYSIQUE
La philosophie n’est pas une discipline repliée sur elle-même d’autant plus qu’elle s’ouvre sans cesse vers le monde extérieur. Autrement dit, loin de s’enfermer sur elle-même, la philosophie s’intéresse toujours à l’être dans sa diversité. Elle fait partie de ces rares disciplines qui n’ont pas d’objet précis, parce que l’objet de la philosophie c’est l’être dans son éclatement, c’est-à-dire, l’être dans sa globalité et sa diversité. Elle est la science de l’être dans sa pure apparition et sa pure donation. C’est ainsi, qu’il n’est pas étonnant de constater qu’en s’intéressant à tout ce qui est, la philosophie s’intéresse aussi à ce qui relève de l’inattendu, c’est-à-dire, de ce que l’on n’attend pas, mais finit par arriver et surprendre tout le monde : cela ça s’appelle événement. Autrement dit, la question « qu’est-ce que l’événement », et en quoi celle-ci relève d’une question à portée métaphysique, a toujours été une préoccupation essentielle du discours philosophique. Mais, ce qui est plus intéressant, c’est toute l’attention particulière que le questionnement philosophique contemporain porte sur le concept d’événement. Concept qui occupe actuellement une place majeure dans le corpus métaphysique et phénoménologique contemporain. La philosophie française contemporaine qui accorde une place essentielle au concept en a d’ailleurs élaboré tout un corpus qui, aujourd’hui, fait la gloire de la phénoménologie française. On peut à cet effet, citer la littérature philosophique abondante à ce sujet : l’être et l’événement (1988) d’Alain Badiou, l’événement et le monde (1998) et l’événement et le temps (1999) de Claude Romano, sans oublier bien sûr les travaux de Gilles Deleuze, Paul Ricœur, Jean-Luc Marion, Jean Greisch, François Dosse, etc., qui ont aussi, selon l’orientation de tout un chacun, problématisé le concept à leur manière. Cela signifie, en termes clairs, que le concept d’« événement » occupe sérieusement l’espace philosophique de notre temps, et la richesse de certains travaux actuels n’est que le prolongement de cette riche tradition. Ainsi que le fait remarquer S. Vinolo (2013, p. 51),
« néanmoins, cet intérêt pour l’événement est aussi le fait de la philosophie, et tout particulièrement des œuvres des philosophes français les plus importants de la deuxième moitié du vingtième siècle. Que ce soit Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Alain Badiou, Jacques Rancière ou encore Jean-Luc Marion, tous ont placé au cœur de leur philosophie une pensée de l’événement. L’herméneutique événementielle que propose Claude Romano s’inscrit donc dans le prolongement de cette longue tradition et doit être située eu égard à ces pensées de l’événement, se lire non seulement en prolongement mais aussi en dépassement ou en déplacement de celle-ci. »
Si la philosophie française contemporaine s’intéresse au concept d’événement, et que celui-ci fait partie de sa nomenclature métaphysique et phénoménologique, alors, il est maintenant intéressant de chercher à saisir ce que nous renvoie le concept d’événement au sens philosophique du terme. Autrement dit, qu’entendons-nous par événement et comment se donne à voir cette notion dans l’édifice philosophique nietzschéen ?
Il serait quelque peu absurde de procéder à la clarification nietzschéenne du concept « d’événement » sans pour autant circonscrire le plus précisément possible, ce que nous entendons, nous-mêmes, par événement dans son corpus philosophique. La définition que dégage le langage ordinaire du concept n’est pas la même que lui confère le discours philosophique, parce que l’événement en tant que tel ne désigne pas la même chose lorsqu’il est question de l’interroger en Histoire, en Littérature ou en art… C’est pour cette raison que le questionnement philosophique sur l’événement revêt une connotation toute particulière. Une particularité qui se justifie par le fait que notre temps est essentiellement celui de l’événement : « Comme le rappelle François Dosse, de même qu’il y eut un moment intellectuel de la structure ou un autre de l’invariant, notre moment est celui de l’événement. Il suffit d’écouter la langue de tous pour entendre à quel point les événements foisonnent. » (S. Vinolo, 2013, p. 51).
En partant d’une lecture issue de son article intitulé Ce que l’événement donne à penser, J. Greisch (2014, p. 41) définit le concept en ces termes :
« L’événement est d’abord tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, « a lieu » ou « arrive » : l’apparition d’une comète dans le ciel nocturne, une éclipse solaire, la pluie et le beau temps, un tsunami, une naissance, un accident, une mort subite. Pris au sens le plus faible du mot, l’événement est un « fait divers » qu’on peut désigner en allemand par les termes de Vorfall (« incident »), ou de Vorkommnis (l’occurrence, l’avoir lieu). Pour cerner la nature de tels évé-nements, les philosophes anciens se servaient de la distinction de l’accidentel et de l’essentiel. Là où il y a des « incidents », les « accidents » ne sont jamais bien loin ! Le « monde de la vie » ne se laisse pas fractionner en objets, faits et états de choses. Il se présente d’emblée comme un « monde événementiel » où se produisent et arrivent toutes sortes de choses à divers moments, favorables ou défavorables (kairos), sans qu’on les ait prévues ou programmées. Même si nous pouvons avoir l’impression que dans le monde, il n’y a jamais rien de nouveau sous le soleil, nous sommes soumis à la contingence, aux éventualités et au hasard. Les surprises que nous réservent les événements nous affectent et nous stupéfient à des degrés variables, allant de la simple attention jusqu’à la modification radicale de l’idée que nous nous faisons du monde ou de nous-mêmes ».
Il ressort de ces propos, que l’événement désigne quelque chose d’inattendu, donc de surprenant. C’est quelque chose qui arrive sans que l’on ne s’y attende. L’événement nous renvoie finalement au hasard, à la contingence, à ce qui n’est pas prévu d’avance tout en créant un effet de surprise. C’est ce qu’il qualifie d’ailleurs de « trouble-fête qui dérange et même là où il ne le fait pas, il met en question notre prétention à vouloir tout garder sous contrôle ». J. Greisch (2014, p. 41). Ici l’événement n’obéit pas au parce que, à une cause qui expliquerait sa raison d’être, il est ²an-archique² disait Romano. Lorsque l’événement apparaît, il n’a pas de cause qui explique sa venue ou son apparition. Aucune raison ne justifie l’apparition de tel ou tel événement, il est sans pourquoi, c’est-à-dire qu’il est sans fond, sans justification. L’origine de l’événement est comparable à la réalité du jeu chez Heidegger. Un jeu sans fond, sans parce que et sans pourquoi, car il s’agit par là d’une caractéristique fondamentale du jeu, c’est-à-dire du fait qu’il soit d’abord avant tout injustifiable, et il y a en lui aucune raison ou aucune cause qui expliquerait sa raison d’être. C’est pareil pour l’événement. Autrement dit, l’événement est sans parce que, sans pourquoi, il n’admet aucune justification. Dès que l’événement apparaît, il apparaît sans explication, sans justification. Rien ne peut justifier l’apparition de tel ou tel événement. C’est ce qui fait d’ailleurs sa spécificité. Si l’événement en tant que tel n’a pas besoin de justification et d’explication, c’est parce qu’on ne peut expliquer son « pourquoi ». L’exemple que prend Claude Romano sur l’éclair est édifiant : l’apparition de l’éclair est toujours une apparition surprise et personne ne s’attend à ce qu’il apparaisse, quand il apparaît, personne ne peut justifier son apparition, c’est-à-dire aucune cause ne peut causer la cause de l’éclair, qui, en réalité est sa propre cause. « Pur commencement à partir de rien, l’événement, dans son surgissement an-archique, s’ab-sout de toute causalité antécédente » (C. Romano, 1998, p. 58).
À en croire Romano, l’on peut dire que l’événement n’est rien d’autre que sa propre cause. Il est la cause causante qui cause sa propre cause, et c’est à ce titre qu’il est même qualifié d’événement. Il est par analogie à l’image du Dieu d’Aristote qui, n’a pas besoin d’être causé par une cause extérieure qui causerait sa propre cause, sinon que lui-même est la cause causante non causée. Comme nous le clarifie Stéphane Vinolo en citant d’ailleurs le bel exemple d’Alain Badiou au sujet de la Révolution française et des événements de mai 68 :
« Prenons l’exemple d’Alain Badiou. Nul ne peut expliquer les causes ayant mené à la révolution française. Certes nous pouvons toujours essayer de l’expliquer par des causes sociales, économiques, intellectuelles et même climatiques ; pourtant, aucune d’entre elles ne nous permettra de comprendre le surgissement de la Révolution… Prenons l’exemple de Mai 1968 cher à Badiou. Toutes les causes que nous pouvons trouver à Mai 1968 sont probablement aujourd’hui décuplées dans la société française. En mai 1968, le chômage était contenu, la voix de la France portait dans le monde, notre politique étrangère était presque indépendante, les inégalités étaient moins criantes qu’elles le sont aujourd’hui. Pourtant, malgré le contexte aggravé que nous vivons, la France ne connaît rien de comparable à Mai 1968. Tout se passe comme si les causes qui ont porté Mai 1968 étaient encore plus présentes en 2013 qu’elles ne le furent en mai 1968, pourtant rien de tel n’a lieu. L’événement n’est donc pas provoqué par des causes que nous trouverions dans le monde pré-événementiel, causes que nous devrions pouvoir reproduire. L’événement se suffit à lui-même, il surgit en lui-même, à partir de lui-même. Il a ses causes en lui-même, autre façon de dire qu’il n’a pas de cause. » (S. Vinolo, 2013, p. 55).
Loin de consacrer un cours à la question de l’événement chez Badiou et Romano, mais il était aussi important de clarifier le concept en faisant recours aux philosophes français de l’événement. Les lectures de Badiou et de Romano sur l’événement nous ont permis de circonscrire le concept dans sa dimension philosophique tout en dégageant sa spécificité. Une spécificité qui se donne à voir comme l’une des voies d’accès au sens nietzschéen du terme.
En définissant l’événement comme ce qui arrive de manière inattendue, c’est-à-dire, ce qui fait l’objet d’effet surprise, alors, il n’est pas étonnant de constater l’omniprésence de la question dans le corpus philosophique de Nietzsche. Autrement dit, la pensée philosophique de Nietzsche est aussi une philosophie de l’événement. La lecture la plus fluide à ce sujet est celle de Martin Heidegger qui, à en croire son interprétation, crée les modes d’accès pour une meilleure compréhension du moment philosophique de l’événement chez Nietzsche. Il s’agit par-là de clarifier à nouveaux frais, à partir des Chemins qui ne mènent nulle part, la question nietzschéenne de la mort de Dieu (entendue comme événement) telle qu’interprété par le philosophe fribourgeois. Il s’agit ici d’un nouveau chemin, qui en réalité nous échappe, un chemin dont nous ne connaissons pas encore le point d’arrivée, parce qu’il s’agit d’un chemin nouveau, pour ne pas dire, un chemin qui nous mène nulle part ; et il nous serait très difficile de comprendre ce chemin qui risque de nous conduire à une impasse, car
« Nombreux sont les chemins encore inconnus qui y mènent. Mais un seul chemin est réservé à chaque penseur : le sien, dans les traces duquel il lui faudra errer en incessant va- et-vient, jusqu’à ce qu’enfin il le maintienne comme sien – sans pourtant qu’il lui appartienne jamais – et qu’il dise ce qui s’appréhende par ce chemin. Peut-être le titre Sein und Zeit est-il l’indicateur d’un tel chemin. » (M. Heidegger, 1962, p. 255).
La difficulté d’emprunter un tel chemin est dû au fait que nous ne le connaissons pas encore, et même si nous connaissons déjà ce chemin, mais nous ne connaissons pas les conséquences qui surgiront en empruntant ce chemin. Ce fameux chemin c’est bien l’événement qui s’empare de l’Europe, c’est-à-dire le nihilisme, parce que « Nietzsche lui-même interprète métaphysiquement la marche de l’Histoire occidentale, lorsqu’il la saisit comme avènement et déploiement du nihilisme. » (M. Heidegger, 1962, p. 254). Le nihilisme dont parle Nietzsche n’est rien d’autre que la mort de Dieu, une mort annoncée comme le plus grand événement de notre temps.
2. LA FIGURE NIETZSCHÉENNE DE L’ÉVÉNEMENT
Heidegger disait dans le Nietzsche I (1971, p.40) que « le grand penseur est grand du fait de sa capacité de discerner dans l’œuvre d’autres « grands », ce qu’ils ont de plus grand et de le transformer ainsi originellement. » Ces propos clarifient à nouveaux frais notre propos de départ, car nous avons pris le soin de souligner dès le début de notre réflexion que certains penseurs ont consacré toute leur vie à lire, enseigner et interpréter les grands penseurs, et parmi ceux-là Martin Heidegger ne fait pas exception. Le philosophe fribourgeois a consacré nombreux de ses ouvrages à commenter et interpréter la pensée de son maître, c’est-à-dire l’œuvre de Nietzsche. Et quand Heidegger interprète Nietzsche, son interprétation tourne autour des questions métaphysiques à l’instar de la question nietzschéenne de l’événement. C’est ici toute l’harmonie qui s’entrevoit entre les propos du Nietzsche I consacrés à la capacité dont dispose un grand penseur à pouvoir discerner dans la pensée de l’autre ce qu’il y a de plus essentiel et de plus captivant, et ce qui se traduit déjà dans les Chemins comme interprétation de l’événement.
En interprète attentif, Martin Heidegger va consacrer de 1936 à 1953 la plupart de ses cours et conférences y compris, au fils de Röcken. Mais, la question relative à l’événement fait partie de ces questions essentielles qui traversent ses cours et conférences, et dominent de part en part son corpus. Cela dit, qu’entend-il par événement dans le corpus nietzschéen ? Autrement dit, comment se donne à voir la dimension philosophique de l’événement dans la pensée de Nietzsche ? Quelles sont les occurrences heideggériennes qui clarifient à nouveaux frais la dimension événementiale dans l’œuvre du philosophe ? A ce propos, relisons le Nietzsche II :
« La vérité concernant l’étant dans sa totalité porte le nom de « métaphysique » depuis la nuit des temps. Chaque époque, chaque humanité se voit portée par une métaphysique qui la situe dans un rapport déterminé à l’étant dans sa totalité comme aussi à l’égard d’elle-même. La fin de la métaphysique se dévoile en tant que ruine de la souveraineté du suprasensible et des « idéaux » qui en procèdent. Semblable fin ne signifie cependant nullement la cessation de l’histoire. C’est le début d’un état d’esprit qui prend au sérieux l’événement « Dieu est mort. » Ce début est d’ores et déjà en marche. Nietzsche lui-même conçoit sa philosophie comme introduction au début d’une nouvelle époque. Le siècle qui vient, c’est-à-dire l’actuel CCè siècle, il le prévoit comme le début d’une époque dont les bouleversements ne se peuvent comparer à ceux connus jusqu’alors. » (M. Heidegger, 1971, II, p. 33.)
Le propos heideggérien montre clairement l’omniprésence du concept d’événement dans la nomenclature philosophique nietzschéenne, et l’événement en tant que tel n’est rien d’autre que « la mort de Dieu ». Autrement dit, l’expression « Dieu est mort » constitue l’événement même de la marche de l’histoire de l’occident, c’est le caractère fondamental de l’histoire occidentale. Mais, avant toute chose, essayons de relire l’aphorisme 125 du Gai savoir consacré à ²l’insensé². La relecture de cet aphorisme est certes riche en interrogations, mais elle nous permettra de comprendre jusqu’à quel point le geste de l’insensé est révélateur, car il s’agit par là d’une nouvelle vie qui s’annonce, de la naissance d’une nouvelle époque et de l’avenir de l’homme sans cet Être supérieur. Comment peut-on parler de la mort de Dieu du moment où, c’est bien lui qui crée le monde et donne du sens à tout ce qui est ? Comment accueillir l’annonce d’un tel événement, et que deviendra désormais la vie des hommes sans leur créateur ? Ce qu’il sied de faire, c’est le fait de chercher d’abord et avant tout à comprendre le comment et le pourquoi d’un tel événement. Autrement dit, comment en arriver là, lorsqu’on sait pertinemment que c’est Dieu le maître du monde ? A ce propos, relisons les moments forts du texte intégral de l’aphorisme 125 du Gai Savoir intitulé le forcené :
« N’avez-vous pas entendu parler de ce forcené, qui, en plein jour, avait allumé une lanterne et s’était mis à courir sur la place publique en criant sans cesse : « je cherche Dieu ! Je cherche Dieu ! » Comme il se trouvait là beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité. « L’as-tu donc perdu ? » disait l’un. « S’est-il égaré comme un enfant ? » demandait l’autre. « Ou bien s’est-il caché ? A-t-il peur de nous ? S’est-il embarqué ? A-t-il émigré ? » – ainsi criaient et riaient-ils tous à tort et à travers. Le forcené sauta au milieu d’eux et les transperça de son regard. « Où est allé Dieu ? S’écria-t-il, je vais vous le dire. Nous l’avons tué – vous et moi ! Nous tous, nous sommes ses assassins ! »
Si le forcené nous annonce que Dieu a été assassiné, et que c’est bien nous qui l’avons tué, alors, pourquoi l’avoir fait ? Dans quel but avons-nous tué Dieu ? Mais en tuant Dieu, que reste-t-il encore à l’homme sur terre ? Si le créateur de la terre et du ciel n’existe plus, que deviendra finalement le monde en tant que tel ? Quel sera l’avenir de l’Etant en tant que tel après avoir été informé d’un tel meurtre ? Qui nous a donné ce courage pour effacer l’horizon ? À ce propos relisons encore l’aphorisme 125 du Gai Savoir :
« Qui nous a donné l’éponge pour effacer tout l’horizon[1] Que faisons-nous lorsque nous détachions cette terre de son soleil ? Vers où se meut-elle à présent ? (…) y a-t-il encore un en-haut et un en-bas ? N’errons-nous pas comme à travers un néant infini ? Le souffle du vide ne nous effleure-t-il pas de toutes parts ? (…) Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! Comment nous consolerons-nous, les meurtriers des meurtriers ? Ce que le monde a possédé jusqu’à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous nos couteaux – qui effacera de nous ce sang ? Avec quelle eau nous purifierons-nous ? (…) La grandeur de cet acte n’est-elle pas trop grande pour nous ? (…) Cet événement énorme est encore en route- il n’est pas encore parvenu jusqu’aux oreilles des hommes. Il faut du temps à l’éclair et au tonnerre, il faut du temps à la lumière des astres (…) On raconte encore que le forcené aurait pénétré le même jour dans différentes églises et aurait entonné son requiem… « Mais que sont donc encore les églises, sinon les tombes et les monuments funéraires de Dieu.»
Finalement, la question relative à la mort de Dieu est un événement. Evénement, non seulement parce qu’il surprend et devient comme un fait accompli, mais aussi et surtout parce qu’il marque la fin d’une époque et annonce le début d’une nouvelle. Nous sommes actuellement confrontés à une situation imprévisible, car le monde vient de vivre un tournant. Nous allons désormais nous habituer à vivre sans cet Être-là.[2] La dimension historiale de l’événement s’explique aussi par le fait que le monde vient de basculer, et en basculant, toutes les anciennes valeurs basculent aussi. L’horizon s’est obscurci et l’avenir devient illisible parce que cet Être qui nous guidait n’est plus, nous sommes devenus orphelins et sans appui. Présenté ainsi, « la mort de Dieu » est un événement, le plus important des événements de notre temps parce qu’il constitue comme disait Heidegger (1971, I, p. 32), « le caractère fondamental de l’événement dans l’histoire occidentale.» Cette expression qui marque l’histoire même de l’Occident est selon l’expression du Gai Savoir (§ 343), « Le plus important des événements récents, – le fait que « Dieu est mort », que la croyance au Dieu chrétien a été ébranlée – commence déjà à se projeter sur l’Europe ses premières ombres. »
Si « Dieu est mort », et que sa mort devient la figure même de l’événement, essayons alors, de circonscrire le plus précisément possible, ce que Nietzsche entend-il par l’expression « Dieu est mort »[3]. Serait-il assassiné physiquement ou bien l’expression relève-t-elle essentiellement d’une simple plaisanterie ? À ce sujet, la lecture la plus fine est toujours celle de Martin Heidegger, parce qu’elle nous permet de circonscrire le plus précisément possible l’objet du propos nietzschéen. Autrement dit, Heidegger est la meilleure porte d’entrée d’une herméneutique nietzschéenne de l’événement, tout en disposant d’un flair herméneutique singulier, capable de distinguer le spectaculaire de l’extraordinaire. Le Nietzsche I et II, y compris les chemins qui ne mènent nulle part, constituent ici la meilleure voie d’accès à la compréhension exhaustive du concept d’événement dans le corpus nietzschéen. C’est pour cette raison qu’Heidegger apparaît à notre entendement comme l’un des meilleurs interprètes de la pensée de Nietzsche[4].
La question de l’événement dans le corpus nietzschéen, tel qu’interprété par Martin Heidegger, nous a permis de comprendre en quoi la question du nihilisme qui traduit le statut du monde, constitue l’un des moments privilégiés de la philosophie de l’événement. La question de la mort de Dieu constitue ici le socle même de la philosophie de l’avenir parce qu’elle annonce les signes d’apparition d’un nouveau monde. Ce n’est pas tant l’annonce en tant que telle qui nous déstabilise, mais plutôt la disparition d’un monde car, on était déjà habitué à ce monde, c’est-à-dire à croire en l’existence d’un monde supérieur qui était le lieu par excellence du Bien, mais nous allons désormais pouvoir faire sans ce monde. Autrement dit, le monde auquel on s’était habitué n’est plus, il disparaît au profit d’un autre monde plus supérieur parce qu’il incarne une nouvelle table des valeurs. La question de la mort de Dieu comme événement s’identifie à ce que Romano qualifie d’une perte de monde, d’un monde qui s’efface et disparaît.
Avant de signifier ou de dégager la portée philosophique de l’expression « Dieu est mort », essayons d’abord de comprendre avec Heidegger l’interprétation qu’il fait à ce propos. A cet effet, nous ne sommes pas loin des préoccupations du philosophe fribourgeois, puisqu’il dit d’ailleurs lui-même qu’« avant de prendre hâtivement une position quelconque, essayons de penser le mot « Dieu est mort » tel qu’il est entendu. C’est pourquoi nous ferons bien d’écarter toute opinion hâtive s’offrant si prestement à l’esprit dès que nous entendons ce mot terrible. » (M. Heidegger, 1962, p. 258). C’est dans cette perspective que son ouvrage intitulé : Chemins qui ne mènent nulle part nous est incontournable, car c’est dans le fameux « mot de Nietzsche : ²Dieu est mort² » que s’illustre la meilleure compréhension de cette expression métaphysique. Comme on peut le constater d’ailleurs :
« ²Dieu² est le nom pour le domaine des Idées et des Idéaux. Depuis Platon, et plus exactement depuis l’interprétation hellénistique et chrétienne de la philosophie platonicienne, ce monde suprasensible est considéré comme le vrai monde, le monde proprement réel. Le monde sensible, au contraire, n’est qu’un ici-bas, un monde changeant, donc purement apparent et irréel. L’Ici-bas est la vallée de larmes, par opposition au mont de félicité éternelle dans l’au-delà. Si nous appelons, comme le fait Kant, le monde sensible ²monde physique², au sens large du mot, alors le monde supra sensible est le monde métaphysique. Ainsi le mot « Dieu est mort » signifie : le monde suprasensible est sans pouvoir efficient. Il ne prodigue aucune vie. La métaphysique, c’est-à-dire pour Nietzsche la philosophie occidentale comprise platonisme, est à son terme. Quant à Nietzsche, il conçoit lui-même sa philosophie comme un mouvement anti-métaphysique, c’est-à-dire pour lui, anti platonicien. » (M. Heidegger, 1962, p. 261-262).
Il ressort de ces propos heideggériens que l’expression « Dieu est mort » ne signifie pas que Dieu n’existe pas. Il s’agit bien au contraire selon l’expression de Nietzsche, de la fin du platonisme, de l’écroulement du monde supposé intelligible et qui serait le lieu par excellence du Bien, du Vrai et de la Félicité[5]. Ce supposé monde, en réalité n’existe pas, car il s’agit par-là de simple fantasme ou d’une pure fabrication de l’esprit. Du coup, tous ceux qui croyaient en ce monde se trouvent orphelins ; eux qui croyaient en l’existence d’un monde supérieur qui serait le guide et le garant de leur vie. Ce monde qui est en train de s’effondrer s’appelle Dieu. Voilà toute l’explication ou le contenu réel de l’expression « Dieu est mort » qui bouleverse désormais la nouvelle manière de voir le monde : c’est du nihilisme entendu comme caractère même de l’histoire de l’Occident. Même si cette expression ne signifie pas la mort réelle de Dieu ou sa négation pure et simple, il faut noter que cette expression est belle et bien un événement, et qu’elle symbolise selon Heidegger la dimension métaphysique de l’événement chez Nietzsche, puisqu’elle fait déjà partie du tournant même de l’histoire de l’Occident. Comme le note si bien Heidegger :
« Il n’y a plus qu’à prendre la définition nietzschéenne du nihilisme au pied de la lettre, à savoir comme dévalorisation des valeurs les plus élevées, pour en arriver à la conception courante de l’essence du nihilisme – et dont le fait d’être courante est précisément favorisé par l’appellation de « nihilisme » – suivant laquelle la dévalorisation des valeurs suprêmes, c’est manifestement la décadence générale. Cependant, pour Nietzsche, le nihilisme n’est nullement un pur phénomène de décadence : il est en même temps et surtout, en tant que processus fondamental de l’histoire occidentale, la loi même de cette histoire. » (M. Heidegger, 1962, p. 269.)
L’interprétation heideggérienne à propos de la dimension métaphysique du concept d’événement montre à suffisance qu’en expliquant, non seulement ce que signifie « Dieu est mort » tout en dégageant le fond de son contenu réel, Heidegger, nous a permis de comprendre le fameux mot de Nietzsche, tout en épinglant la dimension historiale du nihilisme comme événement. Autrement dit, l’omniprésence de la portée philosophique du concept d’événement chez Nietzsche s’illustre avec précision dans l’interprétation que fait Martin Heidegger. Il s’agit ici, de voir comment à partir du nihilisme comme mouvement fondamental de l’histoire de l’Occident, l’homme arrive à instituer de nouvelles valeurs. Un mouvement historial qui se particularise grâce à la naissance d’une nouvelle table des valeurs au détriment des valeurs anciennes : « Le nihilisme par lequel la dévalorisation s’achève en une nouvelle institution de valeurs désormais seule valable. » (Ibid., p. 270).
Si l’événement en tant que tel reste au centre des préoccupations métaphysiques de Nietzsche, il faut se dire que la figure majeure de l’événement se donne à voir à partir de l’expression « Dieu est mort ». Une annonce trouble et troublante parce qu’elle crée le déséquilibre et la perte de confiance en la vie, parce que le monde suprasensible qui leur servait d’appui n’est plus[6], et qu’avec l’avènement du nihilisme entendu comme événement, nous assistons aussi à la naissance d’une nouvelle humanité. Il s’agit par-là de l’avènement de l’événement à partir de l’événement. Comme disait Claude Romano (1998, p. 95), « l’événement est cette métamorphose du monde en laquelle le sens du monde se joue. Métamorphose par laquelle, dans l’effondrement du monde comme contexte, luit le monde comme événemential. » Ce qui signifie que, dès le surgissement de la mort de Dieu, ce n’est pas cette mort en tant que telle qui déstabilise davantage, mais le fait que cette mort de Dieu en tant qu’événement soit instauratrice de monde, parce que l’événement pris au sens strict du terme, est instaurateur de monde[7], c’est-à-dire institution d’une nouvelle humanité. C’est toute la différence qui existe entre l’événement et les faits. L’événement ne connaît pas de contexte préalable, parce que personne aujourd’hui, même le ²forcené², ne connaît le contexte préalable de la mort de Dieu, contrairement aux faits qui jouissent toujours d’un contexte préalable. Les faits sont une modification des choses du monde, alors que l’événement est instaurateur, créateur d’un monde.[8] Si tel est le cas, comment advient le possible à partir de l’événement ? En d’autres termes, comment rendre possible l’avènement de l’événement à partir de l’événement ?
3. L’ÉVÉNEMENT ET LE POSSIBLE
De la même manière que le festival de Bayreuth constitue un événement artistique, de la même manière que la mort de Dieu constitue un événement métaphysique[9]. C’est pour cette raison qu’il n’est pas étonnant de constater que la notion d’événement domine de part en part la pensée du philosophe de la volonté de puissance. La mort de Dieu qui constitue l’événement du siècle, reste un moment privilégié dans l’édifice métaphysique nietzschéen, parce qu’il est d’abord et avant tout instaurateur, c’est-à-dire créateur de monde. Ce nouveau monde qu’instaure l’événement nietzschéen, c’est le monde de la nouvelle culture, c’est le monde de la création et d’une nouvelle institution des valeurs. C’est ce qui fait d’ailleurs sa particularité car, dès qu’un événement apparaît le monde n’est plus pareil, quelque chose change, c’est-à-dire, qu’il y a dans le monde un nouveau monde avec son nouveau type d’homme. Autrement dit, le propre de tout grand événement, c’est de rendre possible la possibilité d’une nouvelle humanité, c’est d’apprendre à vivre avec ce que l’on ²sait²[10], c’est la manifestation d’un commencement qui se précise. Comme disait Heidegger (1962, p. 311) :
« Qu’est ce qui est à présent, en cet âge où le règne absolu de la volonté de puissance a manifestement commencé, et où cette évidence, et l’éclat propre à cette évidence devient lui-même une fonction de cette volonté ? Qu’est-ce qui est ? Notre question ne vise pas des faits, pour chacun desquels, dans la sphère de la volonté de puissance, des preuves se laisseraient à volonté produire ou réfuter. (…) Qu’en est-il de l’être à l’époque du règne commençant de la volonté de puissance ? L’être est devenu valeur. S’assurer la permanence de l’effectif est une condition nécessaire, posée par la volonté de puissance elle-même, de l’assurance de soi-même. »
Patrick Wotling n’est pas loin du philosophe fribourgeois lorsqu’il nous rappelle déjà que la culture chez Nietzsche ne nous renvoie pas au savoir, mais plutôt à un type d’organisation de la vie humaine, et c’est à ce titre que Nietzsche lui-même qualifie le philosophe de médecin de la culture. Cela dit, qu’entend-il par culture et comment s’adosse ce concept à celui de l’événement ? La culture dont parle Nietzsche n’est-elle pas l’expression d’un nouveau mode d’organisation du monde ? Mais comment envisager une nouvelle structuration du monde lorsqu’on sait que l’homme est encore un être en chantier ? Se serait-il avec ce même type d’homme qu’il conviendrait de construire la nouvelle humanité ? La question nietzschéenne de l’événement n’a-t-elle pas pour objectif fondamental la transformation de l’homme ? Que peut-être ce nouveau type d’homme qui serait le produit ou la conséquence de cet événement qui s’empare de l’Occident ? Comment pourrait-il instaurer un nouveau monde avec les valeurs qui l’accompagnent ? Si l’événement est instaurateur de monde, créateur de possibilités, alors, en quoi peut-il être annonciateur du possible ? À ce propos, relisons Martin Heidegger (1958, p. 122-123.) :
« Mais d’où vient le cri d’alarme vers le surhomme ? Pourquoi l’homme d’autrefois et d’aujourd’hui n’est-il plus suffisant ? Parce que Nietzsche reconnaît l’instant historique où l’homme se prépare à accéder à la domination complète de la terre… La question est la suivante : l’homme en tant qu’homme, dans son être tel qu’il s’est révélé jusqu’ici, est-il préparé à assumer la domination de la terre ? Sinon, comment le transformer, pour qu’il puisse « se soumettre » la terre et ainsi accomplir la parole d’un Ancien Testament ? L’homme d’aujourd’hui ne doit-il pas être conduit au-delà de lui-même pour être à la hauteur de cette mission ? S’il en est bien ainsi, le surhomme correctement pensé ne peut être le produit d’une imagination dégénérée, sans frein et s’enfuyant dans le vide. »
En présentant l’événement nietzschéen comme le lieu par excellence où s’érigent des possibilités, tout en épinglant le surhomme comme étant cet être-là qui constitue l’avenir même de l’événement, Heidegger clarifie à nouveaux frais, la place du surhomme dans la philosophie de Nietzsche. Cela dit, qu’entend-il par surhomme ? En quoi le surhomme serait-il l’avenir de l’événement ? Suivons ces lignes :
« ²Le surhomme² n’est pas un idéal suprasensible : il n’est pas davantage un personnage se signalant à un quelconque moment ni surgissant quelque part. Il est en tant que le suprême sujet de la subjectivité accomplie le pur exercice de la volonté de puissance… Le surhomme vit du fait que la nouvelle humanité veut l’être de l’étant en tant que volonté de puissance. Elle veut cet être parce qu’elle-même est voulue par cet être, c’est-à-dire se voit en tant qu’humanité inconditionnellement abandonnée à elle-même. » (M. Heidegger, 1971, II, p. 244).
À en croire le propos heideggérien, le surhomme[11] n’est pas un être qui serait différent physiquement de l’homme d’aujourd’hui, car ce qui les différencie fondamentalement, c’est le fait qu’il soit doté d’une nouvelle humanité et qu’il est instaurateur de nouvelles valeurs. Il incarne et représente en son sein une nouvelle forme de vie. Ce qui signifie en d’autres termes que, Le surhomme ne désigne pas un individu ou un être plus fort que les autres, mais tout simplement une métamorphose du sujet capable d’inventer ou de créer : c’est l’homme du surpassement et du dépassement de soi-même. C’est l’homme de la volonté de puissance entendu comme le véritable accomplissement du sujet. Il est celui-là qui va toujours au-delà de l’homme d’aujourd’hui, parce que « Le ²sur²dans le nom de ²surhomme²contient une négation et signifie le fait d’aller par-delà et au-delà de l’homme tel qu’il a été jusqu’alors. » (M. Heidegger, 1971, II, p. 234). Autrement dit, vivre en sachant que Dieu est mort, tout en se demandant comment vivre sans cet Être-là, telle n’est pas la mission de l’homme d’aujourd’hui, mais plus précisément celle du surhomme, c’est-à-dire de l’homme de demain qui est le sens même de la terre.
« La grandeur du surhomme qui ne connaît pas le stérile isolement de la simple exception, consiste en ce qu’il place la volonté de puissance dans la volonté d’une humanité laquelle dans semblable volonté se veut elle-même en tant que le Maître de la Terre. Dans le surhomme réside « une propre juridiction laquelle n’a aucune instance au-dessus d’elle…le surhomme est l’empreinte d’une humanité laquelle pour la première fois se veut elle-même en tant qu’empreinte et s’en empreint elle-même. » (M. Heidegger, Op. cit., p. 249-250).
Si la mort de Dieu est un événement et que le surhomme devient la conséquence de l’événement car l’humanité en a besoin[12], nous pouvons alors dire que, la métaphysique de Nietzsche est essentiellement une philosophie de l’événement, pour la simple raison qu’elle privilégie de part en part le caractère événemential de l’étant. Autrement dit, l’effacement de l’événementiel au profit de l’événemential traduit fondamentalement la volonté du philosophe à vouloir instaurer un nouveau monde : le monde de la volonté de puissance structurant le surhomme avec sa nouvelle table des valeurs. C’est le monde de la vie qui valorise le sensible tout en accordant une primauté ontologique à tout ce qui fait du devenir le caractère même de l’étant, c’est-à-dire de l’avènement de l’événement. Le devenir est le caractère fondamental de l’être de l’étant, entendu d’ailleurs comme la plus haute volonté de puissance[13]. L’on constate aisément, que la volonté de puissance reste inséparable du vivant, et que,
« La plus haute volonté de puissance, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus vivant dans toute vie, revient à se représenter le passé comme devenir permanent dans le Retour éternel de l’Identique et à le rendre ainsi stable et permanent. Cette représentation est une pensée qui, comme Nietzsche le remarque et le souligne, ²imprime² à l’étant le caractère de son être (Sein). Cette pensée prend sous sa garde, sous sa protection, le devenir, auquel un heurt continuel, la souffrance est, inhérent. » (M. Heidegger, 1958, p.140).
Ces propos heideggériens montrent jusqu’à quel point la volonté de puissance est strictement liée à la notion de vie, car la vie est volonté de puissance, comme il n’y a pas de volonté de puissance sans vie. Ce qui revient à dire qu’on ne peut parler de volonté de puissance sans évoquer la notion de vie parce que les deux vont ensemble. Dans cette relation intime qui existe entre la vie et la volonté de puissance, il y a bel et bien le concept du devenir qui demeure au centre de tout. Ce qui signifie en d’autres termes qu’il n’y a pas de vie sans devenir, et que le devenir constitue le caractère même de tout ce qui est. Comme Heidegger le note d’ailleurs,
« ²devenir² signifie la transition de quelque chose à une chose … les changements naturels et qui traversent en le régissant…Ce qui déploie ainsi son règne, Nietzsche le pense comme le trait fondamental de tout ce qui est effectif, c’est-à-dire, en un sens plus large, de l’étant. Ce qui détermine ainsi l’étant dans son essence (essentia), il le comprend comme volonté de puissance » (M. Heidegger, 1962, p. 277).
Dans le corpus métaphysique occidental, la question de la mort de Dieu est un événement, et derrière cet événement surgissent d’autres événements à l’instar du surhomme, entendu comme la conséquence de l’événement car, après la « mort de Dieu », il faut que les gens se créent les conditions d’une nouvelle forme de vie, d’une nouvelle humanité. Il faut pouvoir désormais apprendre à vivre sans cet Etre-là qui était l’incarnation du Bien. Ainsi, l’écroulement de ce monde n’est-il pas sans conséquence, parce qu’en s’écroulant, les anciennes valeurs s’écroulent en même temps, et que la naissance du surhomme apparaît comme la conséquence logique de l’événement, tout en étant lui-même aussi un événement, parce qu’étant au cœur du tournant métaphysique.
Conclusion
Nous pouvons dire, au terme de notre réflexion, que la métaphysique contemporaine est essentiellement une métaphysique de l’événement, et que la tradition philosophique n’a pas démérité en faisant de ce concept l’une de ses préoccupations. C’est ainsi que l’on doit saluer tout le travail entrepris ces dernières années par les philosophes français de notre temps, qui, en faisant de l’événement un concept au cœur de la pensée, ont réussi à entretenir toute la richesse d’une notion qui avait déjà fait objet de débats. C’est dans cette perspective qu’il n’est pas étonnant de constater l’omniprésence du concept d’événement dans la pensée de Nietzsche. D’où, l’objet de notre analyse, car en nous interrogeant sur la dimension métaphysique du concept d’événement dans l’édifice métaphysique nietzschéen, nous avons voulu comprendre en quoi ce concept est instaurateur de monde. Autrement dit, comment, à partir de la notion d’événement, l’on arrive à la construction d’une nouvelle humanité ? En nous interrogeant ainsi, nous avons fait le choix d’un corpus métaphysique dans le but de créer de véritables modes d’accès à la compréhension du concept dans le dispositif nietzschéen. Le corpus élu est bel et bien celui de Martin Heidegger, car le philosophe de Fribourg a consacré plusieurs de ses cours, conférences et séminaires à la pensée de Nietzsche. En commentant et en interprétant Nietzsche, le concept d’événement revient de façon récurrente.
Des Essais et Conférences, en passant par les Chemins qui ne mènent nulle part, jusqu’au Nietzsche I et II, sans oublier bien d’autres textes, Heidegger a placé le concept d’événement au centre de son herméneutique. Son flair herméneutique permet de comprendre en quoi l’expression relative à « la mort de Dieu » demeure au centre du corpus nietzschéen. C’est bien un concept central, parce qu’il détermine l’ensemble de son corpus métaphysique : le nihilisme, la volonté de puissance, le surhomme… sont autant d’événements qui structurent de part en part l’œuvre de Nietzsche. C’est la raison qui explique tout le choix porté sur l’interprétation heideggérienne du concept nietzschéen de l’événement. Ainsi, Martin Heidegger demeure-t-il, à notre avis, l’un des rares interprètes à s’être soucié précisément de la cohérence de la philosophie de Nietzsche, à s’être interrogé sur le mode de structuration interne de sa pensée. C’est ici que se tient, à coup sûr, l’un de ses grands mérites en sa qualité d’interprète de l’histoire de la pensée, singulièrement celle de Nietzsche. C’est sur ce plan, qu’il était précieux à notre avis, d’engager le dialogue avec lui, lorsqu’il s’agissait de comprendre la question de l’événement dans l’univers métaphysique nietzschéen. Cette question accorde une place centrale à la transformation de l’homme. L’homme doit désormais s’auto-construire et s’auto-surmonter afin de devenir un homme nouveau au sein du nouveau monde, car notre façon de penser le monde et notre place en son sein subissent des changements.
Références bibliographiques
BADIOU Alain, 1988, L’être et l’événement, Paris, Seuil, 560 p.
BADIOU Alain, 2006, Logique des mondes, L’Être et l’Événement, 2, Paris, Seuil, 638 p.
DOSSE François, 2010, Renaissance de l’événement, un défi pour l’historien : entre sphinx et phénix, Paris, PUF, 352 p.
GUERY François, 1999, Ainsi parla Zarathoustra (volonté, vérité, puissance – 9 chapitres du livre II), Paris, Ellipses, 79 p.
GUERY François, 1995, Heidegger rediscuté (Nature, technique et philosophie), Descartes & Cie, 155 p.
GRANIER Jean, 1997, Nietzsche, ‘Que sais-je ? ’ Paris, PUF, 127 p.
GRANIER Jean, 1966, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris, Seuil, 643 p.
GREISCH Jean, 2014, « Ce que l’événement donne à penser », Recherches de Science Religieuse (Tome 102), Centre Sèvres, pp. 39-62.
HAAR Michel, 1993, Nietzsche et la métaphysique, Paris, Tel Gallimard, 293 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et conférences, Trad. fr, André Préau, préface de Jean Beaufret, Paris, Gallimard, 349 p.
HEIDEGGER Martin, 1962, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. fr, Wolfgang Brokmeier, Paris, Gallimard, 461 p.
HEIDEGGER Martin, 1971, Nietzsche I, trad. fr, Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 512 p.
HEIDEGGER Martin, 1971, Nietzsche II, trad. fr, Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 402 p.
KOUNKOU Charles Thomas, 2015, Cahiers congolais de métaphysique, Paris, Paari, 126 p.
MARION Jean-Luc, 1997, L’idole et la Distance, Paris, Grasset, 313 p.
MARION Jean-Luc, 1997, Étant donné. Essa²i d’une phénoménologie de la donation, Paris, PUF, 533 p.
MARION Jean-Luc, 2001, De surcroît. Études sur les phénomènes saturés. Paris, PUF, 216 p.
MARION Jean-Luc, 2010, Certitudes négatives, Paris, Grasset, 324 p.
NARBONNE Jean-Marc et LANGLOIS Luc (dir), 1999, La métaphysique : son histoire, sa critique, ses enjeux, Paris, Vrin, 256 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1993, Œuvres tome 1, Collection ‘Bouquins’, pour la traduction française des textes du professeur Pütz, pour l’appareil critique et la révision des traductions par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Robert Laffont, 1365 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1993, Œuvres tome 2, Collection ‘Bouquins’, pour la traduction française des textes du professeur Pütz, pour l’appareil critique et la révision des traductions par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Robert Laffont, 1750 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1995, La volonté de puissance I. Texte établi par Friedrich Würzbach et traduit de l’Allemand par Geneviève Bianquis, Paris, Gallimard, 435 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1995, La volonté de puissance II. Texte établi par Friedrich Würzbach et traduit de l’Allemand par Geneviève Bianquis, Paris, Gallimard, 498 p.
RANCIERE Jacques, 1989, « A propos de l’Etre et l’Evénement d’Alain Badiou », in Cahier du Collège international de philosophie », Paris, Horlieu, pp 2-8.
ROMANO Claude, 1998, L’événement et le monde, Paris, PUF, 304 p.
ROMANO Claude, 2012, L’événement et le temps, Paris, PUF, 336 p.
VINOLO Stéphane, 2013, ²L’apostrophe de l’événement. Romano à la lumière de Badiou et Marion,² in Revue de la philosophie française et de langue française, Vol XXI, No 2, pp. 51-57.
WOLF Francis, 1997, Dire le monde, Paris, PUF, 218 p.
WOTLING Patrick, 1995, Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, 386 p.
WOTLING Patrick, 2008, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, 463 p.
WOTLING Patrick, 2016, ‘Oui, l’homme fut un essai’. La philosophie de l’avenir selon Nietzsche, Paris, PUF, 324 p.
WUNENBURGER Jean-Jacques, 1990, La Raison contradictoire, Paris, Albin Michel, 288 p.
WUNENBURGER Jean-Jacques, 1991, L’imaginaire, Paris, PUF, 127 p.
WUNENBURGER Jean-Jacques, 1997, Philosophie des images, Paris, PUF, 322 p.
LA COMMUNICATION DE GROUPE CHEZ NIETZSCHE : UN CULTE INITIATIQUE MANQUÉ ?
Mbodji NDÉNÉ
telanoumotenolaye@yahoo.fr
Résumé : La communication de groupe existe dans les écrits de F. Nietzsche. Différents groupes sociaux y dialoguent. Nous avons un exemple à travers les échanges entre le personnage principal Zarathoustra et sept soi-disant hommes supérieurs. Ces personnages ou interlocuteurs ont beaucoup échangé dans une forêt. La montagne, qui leur a finalement servi d’agora, ressemblait à un lieu d’initiations. Malheureusement, cette forme de délibération scénarisée n’a pas connu de succès. Elle a été plutôt riche en informations et en leçons. Elle a surtout permis de comprendre certaines causes de l’incommunication.
Mots-clés : COMMUNICATION, ÉCHEC, FÊTE, GROUPE, INITIATION, PARADOXE.
Abstract : Group communication exists in F. Nietzsche’s writings. Different social groups interact with it. We have an example through the exchanges between the main character Zarathustra and seven so-called superior men. These characters or interlocutors exchanged a lot in a forest. The mountain, that finally served them as agora, looked like a place of initiation. Unfortunately, this form of scripted deliberation has not been successful. She was rather rich in information and lessons. Above all, it helped to understand some of the causes of incommunication.
Keywords: COMMUNICATION, FAILURE, GROUP, INITIATION, PART, PARADOX.
Introduction
Chez F. Nietzsche, la parole est abondante. Ses écrits bruissent de paroles. Tout y parle. Tout y donne l’impression d’un grand dialogue. C’est le cas de toutes les rencontres scénarisées dans ses livres. Elles donnent l’air d’une délibération publique. La rencontre mémorable entre Zarathoustra et les hommes supérieurs ressemble à une communication de groupe programmée et bien structurée. À tour de rôle, chaque personnage s’exprimera librement. Au départ, tout avait l’air d’une discussion libre. Mais, à force d’analyser les paroles de chaque intervenant et d’interpréter les symboles liés à ce rendez-vous, ces interactions laisseront paraître des énigmes et deviendront inappropriées. Ce qui semblait être une réunion d’aristocrates se transformera en scène d’interrogations et d’insuccès. Combien d’hommes supérieurs ont croisé le chemin de Zarathoustra ? Que se sont-ils dits ? Parlent-ils le même langage ? Comment comprendre les arrière-plans de cette communication de groupe qui semblait vouloir réparer certains méfaits initiaux d’une communication défectueuse pour établir une nouvelle communication élitiste ? Expliquons le déroulement de ces rencontres et ne perdons surtout pas de vue que ce sont des sectateurs que F. Nietzsche (2001, p. 96) a attendus en vain.
1. ZARATHOUSTRA ET LES HOMMES SUPÉRIEURS : UNE COMMUNICATION DE GROUPE RATÉE
Successivement et sur un chemin qui conduit sur la montagne d’une forêt, Zarathoustra a rencontré deux rois, un scrupuleux de l’esprit, un enchanteur, un saint père, un des plus hideux, un mendiant volontaire et une ombre. Il a donné ces noms à ces sept personnages qu’il qualifie précipitamment d’hommes supérieurs. Ces hommes ne devaient pas être qualifiés de supérieurs. Leur élitisme restait un mystère. Les vraies raisons de leur départ de la société étaient méconnues. Ils n’avaient pas encore pris la parole pour s’expliquer. Ils ont juste porté le titre d’hommes supérieurs parce que Zarathoustra a constaté qu’ils s’étaient démarqués des masses populaires. Les développements suivants montrent qu’un préjugé est à l’origine de cette nomination erronée. Les incompréhensions dans ces interactions sont manifestes. Commençons par le décryptage de la rencontre avec les deux rois.
1.1. Amalgames et dérives royales
Sept hommes dits supérieurs avaient quitté leur société pour suivre les pas de Zarathoustra. Un grand cri venait déjà des bois. Zarathoustra s’était levé pour s’enquérir de ce bruit. Il rencontre deux rois bariolés comme des Flamands. Ils ont un âne. Cette information affaiblit l’originalité du récit et sème le doute sur la crédibilité de ces deux législateurs. Des rois, en général, nous savons que leur déplacement se fait au milieu d’une incroyable ménagerie. Surtout lorsqu’ils sont deux. Cette image est équivoque. Favorisant le roi de droite, le récit renseigne qu’ils ne tiennent pas le même discours politique. Comment réussiront-ils à partager le même âne ? Ce récit suivrait l’impénétrable instinct de leur auteur et deviendrait trop beau pour correspondre à la réalité.
Quelle serait cette raison suffisante pouvant justifier que des rois quittent leurs sujets et abandonnent leurs richesses pour se réfugier auprès d’un inconnu nommé Zarathoustra ? Une mise en scène ne peut suffire pour que soit oublié « l’amour presque religieux pour la personne du roi »[14], pour que soit méprisé l’histoire de ces rois pour qui des religieux sacrifièrent volontairement leur bien et leur sang, leur état et leur patrie. Les rois rassemblaient dans leur cour des élites et des ermites. Le grand nombre communiquait selon les édits royaux. Puissant et confiant, le règne du roi Viçvamitra[15], qui « entreprit de bâtir un nouveau ciel », dura mille ans. Le génie et les traits dominant de Frédéric le Grand influencèrent l’esprit allemand. Ici, le récit des deux rois met fin à cette vision du roi qui était, selon F. Nietzsche (2001, p. 37), bon soldat et juge sévère. Cette fiction mêlant utopie et contradiction intègre ces propos des rois résumant de manière confuse les raisons de leur départ de la société : « mieux vaut vivre avec des ermites et des chevriers qu’avec cette plèbe dorée, fausse et outrageusement fardée ». F. Nietzsche (2006, pp. 301-302).
En écoutant ces paroles, l’insaisissable Zarathoustra était médusé et attentif. Mais si ces rois semblent aimer la liberté, nous soupçonnons que F. Nietzsche fasse passer ses propres propos à l’aide de ces personnages. Les rois sont des despotes et non des démocrates. Ce qui est plus frustrant dans cette déclaration est dans la confusion liée à la nouvelle vision de la populace. Les prolétaires ont été le poumon du peuple. Et entre les ermites et les robustes prolétaires, nous ne saisissons pas lequel des camps a été choisi. Les rois se trompent en croyant être en phase avec leur interlocuteur pris pour un homme supérieur et un serviteur de Dieu. Devant « Zarathoustra le sans-dieu » qui enseigne parfois l’irréligion, ils finissent par se prosterner. Selon Nietzsche (1982, pp. 70-98), ce transfert d’autorité les éloigne de « l’ordre du jour pour le roi » et met fin au règne des rois. S’il faut faire des élites philosophes de nouveaux rois, il faudra cacher l’image du roi de Macédoine qui était venu au chevet d’un philosophe méprisé de tous. Le paradoxe caractérise cette communication de groupe bouleversante. Cette élection de l’élite philosophique est imaginaire. F. Nietzsche (2001, p. 103) lui-même rappelle qu’il s’appelle Frédéric-Guillaume parce qu’il est né le jour anniversaire de la naissance du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV. Ce n’est donc pas la fin des rois. Parlons du crépuscule des rois puisque ces interactions groupées sont absurdes dans ce qu’elles condamnent ou acceptent. Quel est le comportement du deuxième homme supérieur ?
1.2. Violence et inauthenticité autour du Scrupuleux de l’esprit
C’est la fin de la première scène et les rois se taisaient. Le grand cri ne venait pas des deux rois. Il avait repris. Zarathoustra était reparti à la découverte de celui qui émettait ce signe vocal. Il rencontre un interlocuteur nommé le Scrupuleux de l’esprit. Tout s’est emballé dans leur face-à-face. L’image séduisante qu’on avait du tendre Zarathoustra sera écornée. Son comportement n’est plus celui d’une élite lucide. Oubliant sa candeur, il se servit d’un bâton pour corriger le Scrupuleux de l’esprit. Il manifeste là une violence gratuite, utilise des mots durs en le foulant au pied, en le traitant de chien. Cette agression physique et verbale est incompréhensible. Non seulement tout parle différemment chez F. Nietzsche (2001, p. 95), mais tout « est aussi différemment ». Ces mutations ne facilitent pas la compréhension de ses paroles et de ses attitudes. Il serait anachronique et manquerait de lucidité en pensant que pour influencer il faut violenter.
Les remarques de L. Jaffro (1998, p. 96) sur la communication en philosophie cessent d’être des paroles d’Évangile. Toutes les philosophies ne promeuvent pas la civilité. Elles ne proposent pas toutes non plus une bonne éducation portée à un degré plus élevé. Le fil du dialogue sera renoué entre Zarathoustra et le Scrupuleux de l’esprit. Après la mésentente, le Scrupuleux de l’esprit reconnaît son interlocuteur qui s’est présenté. Pris de panique et de remord, dans ses paroles pieuses suivantes, il regrette d’avoir failli en découdre avec une figure respectée et adorée des hommes supérieurs. Entendre le nom « Zarathoustra » a suffi pour qu’il se comportât en disciple de ce dernier : « ô miracle ! Béni soit Zarathoustra ». (F. Nietzsche, 2006, p. 306).
Le malaise avec le second homme supérieur n’est pas lié au fait qu’il ait avancé auparavant être le meilleur dans la connaissance du cerveau de la sangsue. E. Fink (1965, p. 146) n’avait pas à le traiter d’esprit trop prétentieux et trop borné. Il a manqué sa cible. F. Nietzsche lui-même souffre de ces étroitesses qu’il réprime. Le problème est que le Scrupuleux de l’esprit est dans la détresse. Or derrière le grand cri des bois, on espère voir une élite qui ne compte que sur elle-même. Le mystère du cri est loin d’être maîtrisé. Que révèle le troisième homme supérieur ?
1.3. Enchanteur et diabolique
Le crieur des bois n’est ni identifié ni localisé. Zarathoustra avait continué sa route. Il avait croisé quelqu’un qui avait tout d’un dément immaîtrisable. Cette personne qui passait pour un énergumène n’était qu’un imposteur. Son nom était : l’enchanteur. Les signes qui correspondaient à sa personnalité décrivaient que tout ce qu’il disait ou faisait était à double, triple, quadruple et quintuple sens. Ce qui caractérise le discours de F. Nietzsche (2006, p. 314) pouvait être décrit comme tel et c’est cette similitude qu’oublie H. Roeschl (1958, p. 38). D’ailleurs, s’en tenir à cette ressemblance serait un manque d’information. Finalement, le manipulateur pense que son interlocuteur qu’il prenait pour son double est plus digne que lui. Ces paroles peu convaincantes le relèguent au rang des figures, vénérant et honorant, rencontrées jusqu’ici. Pour nous, ce qui est paradoxal est dans cette stratégie élitiste et possessive utilisée dans cette mise en scène qui fait du porte-parole de F. Nietzsche le seul roi et le seul homme pur. Il y a échec puisque c’est une pensée élitiste libre qui était formulée au départ. Dans les faits, nous découvrons une tendance canonique même si cette idolâtrie manquée n’est pas assumée. La relation avec le quatrième homme supérieur suivant sera sous le signe de l’échec.
1.4. Naïveté et irresponsabilité d’un personnage pieux
Après s’être débarrassé d’un talentueux menteur, le cri reprenait. Zarathoustra avait aperçu un quatrième homme assis au bord d’une route. Seul avec ses pensées, il communiqua des heures avant de découvrir, et nous ne savons pas comment, qu’il s’agissait du dernier pape. La réaction du saint père est contraire à toute volonté élitiste. Ses paroles ne reflètent pas les exigences d’un vrai pape. Nous le trouvons naïf et irresponsable. Il s’est laissé manipuler par une rumeur annonçant que Dieu n’était plus. Il ne devait pas non plus déclarer au premier venu qu’il était incapable d’être libre et qu’il fallait à sa fragile vie un nouveau maître.
Pour des raisons que nous ignorons, cette quatrième scène force son pape à déballer. F. Nietzsche (2006, p. 316) est d’habitude derrière ces idées obscures qui le tentent. E. Fink (1965, p. 146) ne devait pas seulement voir que ce pape était incapable de se métamorphoser et de s’exprimer en homme libéré de Dieu. Ce religieux a perdu aussi tout sens de la sainteté en se rabaissant pour mieux élever au rang d’un dieu un personnage presque inconnu nommé : Zarathoustra. Il se tromperait en croyant que cette élite, à laquelle il transfère toute sa foi, ne croyait pas en Dieu. Une telle négation totale n’a jamais été assumée dans les paroles de ce dernier. C’est vrai que le pape est victime de la duplicité de Zarathoustra qui ne se prononce pas clairement sur ses intentions réelles. Nous ne comprenons pas pourquoi il laisse ces interlocuteurs le confondre à un dieu par exemple. Cet énigmatique laisser-aller ne facilite aucune intersubjectivité. Il n’y a pas de réussite avec le cinquième homme supérieur suivant.
1.5. Incohérence d’une figure hideuse
La situation est devenue plus complexe. Le grand cri retentit. Se dissimule de plus en plus dans les forêts et par-dessus les monts. Après une longue marche et apparemment de façon inattendue, Zarathoustra arriva dans une vallée, évitée même des bêtes et surnommée la « Mort aux Serpents ». Il y retrouve Le plus hideux des hommes. Mais les arguments qu’avance ce dernier pour expliquer pourquoi, et non comment, il a tué Dieu sont fallacieux et ne sont possibles que sur une mise en scène. Certains signes aristocratiques interviennent dans la communication du soi-disant teigneux et plus hideux des hommes. Mais ils n’en constituent pas la partie essentielle, d’après F. Nietzsche (2006, p. 222). À l’image de toutes les figures décadentes qui se sont exprimées jusque-là, le cinquième homme supérieur est communicatif, mais il n’est pas libre en considérant Zarathoustra comme son sauveur. Quel serait l’intérêt de tuer Dieu pour en choisir un dieu trop humain, trop capricieux ? Cette incohérence caractérise cette communication avec le groupe des hommes supérieurs. Voyons ce qu’il en est de l’avant-dernier personnage.
1.6. Gaucherie d’un mendiant volontaire
Zarathoustra s’était séparé du cinquième homme supérieur. Il continue à croire que le cri l’appelle en hâte. Errant par monts et par vaux, il tombe sur une scène insolite. Des vaches paraissaient écouter quelqu’un qui a fait don de son abondance. F. Nietzsche (2006, p. 327) présente ce mendiant volontaire. Pour nous, il y a trop d’images qui assombrissent la communication. Toutes ces paroles doublées de scènes annonciatrices sont ambivalentes. Que faut-il comprendre derrière la présence des vaches, dans le geste peu ordinaire d’un riche qui accepte librement de devenir pauvre ? En cédant sa fortune, il passe des élites à la populace. On accepte que la liberté ne se contemple pas. Mais elle ne se vivra pas non plus dans la misère. Tout peut être envisagé dans ce don, sauf la lucidité. Ce gauche mendiant volontaire sera trahi par la suite de ses paroles. Il prône la suppression de tout discours élitiste. Cet appel disqualifie ses compétences élitistes. Il lui manque tout d’un créateur. Quel serait le comportement du dernier homme supérieur dont parle F. Nietzsche (2006, p. 330) ?
1.7. Réputation des élites gâtée par une ombre
Le sixième homme supérieur s’est éloigné. Cette nouvelle voix interpellatrice est entendue : « C’est moi, ô Zarathoustra, moi, ton ombre ». Celui qui vient d’être hélé répond par le silence. Nous n’attendons pas ce refus de communiquer d’une élite nietzschéenne (2004, p. 1164) qui conseille l’accessibilité, la courtoisie dans la communication en société. Après de nombreux détours et des gestes déplacés, Zarathoustra, qui est exposé aux vagues de la détresse et qui ne souhaite pas que l’homonymie gâte sa réputation, revient à de meilleurs sentiments. Il se met à la disposition de celui qui se présente comme sa propre ombre et son serviteur. Nous supposons qu’ils ont fréquenté ensemble les régions les plus lointaines et les plus glacées. Mais, incapable de persévérer dans ces activités élitistes, l’ombre servante sera dissuadée par la lassitude des aventures. Pour F. Nietzsche (2006, p. 332), ses fausses notes sortent de sa communication : « ai-je moi encore un but ? Que me reste-t-il ? Un cœur las plein d’impiété ». Puisque d’après M. Diagne (2005, p. 475) « les similitudes formelles ne doivent pas dissimuler les dissemblances essentielles », alors écrivons que cette ombre servante a désormais choisi un immobilisme, étroitement borné, qui s’oppose à l’ouverture d’esprit, à la manière d’être dans l’espace. Ce choix est contraire aux goûts des élites qui évitent ce discours à sens unique.
Globalement et à l’exception des deux rois, on constate que le groupe des hommes supérieurs a l’habitude de recevoir des ordres et de parler une langue qu’il maîtrise. Il n’imagine pas le sens de sa vie sans un guide qui lui est supérieur et à qui il doit quotidiennement rendre hommage. Il n’a rien de semblable avec celui qu’on espérait retrouver derrière le cri des bois : un destructeur et détracteur des valeurs grégaires. Ils se sont tous confessés. Paradoxalement, contre la parole nietzschéenne (2006, p. 60) qui menaçait de bondir par-dessus les retardataires, ces désespérés ne seront pas repoussés. Ils acceptent d’être invités à une fête dans la montagne. Un lieu de culte semble accueillir le groupe. Cette stratégie ne relance pas la chance de tirer ce groupe à la hauteur de leur interlocuteur. L’enjeu était de former une élite qui suivra Zarathoustra. Même si nous nous délecterons du contraste entre la susceptibilité d’un solitaire et le sens de la socialisation qu’il manifeste ici, ces scènes aux allures initiatiques échoueront. Peut-être cet échec justifie-t-il le fait que F. Nietzsche ait déclaré, sous une forme de défaut de communication avec lui-même, qu’il ne voulait ni troupeau ni fidèle. Mettons en exergue les dissemblances dans cette communication de groupe manquée.
2. ACCORD APPARENT ET AMBIVALENCE D’UN POLYCENTRISME DISCURSIF
Après ces confessions qui se sont substituées aux dialogues performatifs qu’on attendait, l’invitation dans la montagne n’a laissé personne indifférente. À peine que tous arrivèrent-ils sur les lieux, sans dire le chemin qu’ils ont emprunté, sans révéler la distance qui relie les bois à la montagne, sans raconter l’état d’esprit, voire le malaise, qui a prévalu en cours de route, le cri de détresse retentit. Ce communicatif et traumatisant cri est omniprésent. Les hommes supérieurs semblent l’émettre. Tel n’est pas le cas. L’intuition appréciatrice de Zarathoustra est faillible. F. Nietzsche aurait exagéré sur les capacités divinatoires de son personnage-fétiche. Ce cri n’est ni celui de ses compagnons ni celui du surhomme. Selon J. Rousselot (1969, p. 15), cette écoute manquée est née d’un mariage phonétique ou d’une paronomase. Après la populace, les élites, qui sont censées être critiques, s’exposent aux erreurs auditives.
2.1. Le mystérieux cri jusqu’au bout des scènes du texte
Ce cri fluctuant et évanescent, qui ne livre jamais ses ultimes secrets, ne continue pas à divertir. Il contredit les écrits nietzschéens qui le portent et qui prétendent communiquer toutes leurs pensées et toutes leurs aspirations. Contrairement à ce qui était annoncé, il renseigne que les écrits de F. Nietzsche (2005 p. 20) n’apprennent pas « à penser jusqu’au bout ». Il peut être aussi un stratagème qui transmet les émotions d’un metteur en scène à des lecteurs passionnés de pensées chaudes. Il prolongerait le rôle des aphorismes qui ont besoin de rythme pour devenir autre chose qu’un assemblage de mots sans vie. Ce langage de signes et de mimiques, cette pantomime silencieuse, bref tout ce comportement qui semble être hors du texte écrit est de l’art, une forme de protestation contre la dictature exclusive de la parole imprimée. C’est une approche cultuelle pour retenir les lecteurs jusqu’au bout des scènes d’un texte sans dénouement qui se moule, qui se dilate, se projette pour davantage qu’on se colle à lui, qu’on l’adopte, qu’il nous malmène et finalement nous avale.
Le charme des écrits de F. Nietzsche est dans cette attraction théâtrale qui pose d’habitude des problèmes à une communication d’une philosophie discursive qui systématise ses pensées. Il est capable de communiquer sans opinion, sans idéal et sans conviction, ce qui fait de lui un penseur et un intellectuel. Mais, toutes les élites ne se délectent pas de spectacle et de mystère. Il pouvait choisir une de ces facettes de la communication pour mieux dévoiler ses pensées. Malgré le sens de la distinction qu’il avoue détenir, il a fréquemment un problème de choix. Ce défaut est un manque d’expérience dans les relations humaines. Son expérience de la solitude domine largement son sens de la sociabilité. Donnons un exemple.
Tout ce temps sacrifié au décodage du cri pouvait être accordé à une communication rationnelle au sujet de toutes les caractéristiques concernant la volonté des élites et surtout la figure du surhomme. Cette stratégie de communication limpide, que F. Nietzsche devait appliquer, était l’arme fatale du roi de Navarre dont parle J. Verdon (2010, p. 17). Le roi était conscient de l’importance de l’art de transmettre ses informations. Il faisait crier ses décisions quatre jeudis de suite sur les marchés, quatre vendredis dans les mosquées, quatre samedis dans les synagogues, quatre dimanches dans les églises, les rues et les carrefours. Chez F. Nietzsche se dégage l’allure d’un roi sans couronne, sans sujet, sans plan de communication. Il va à la rencontre des populations mais il n’est pas assez explicite dans ses informations. Cette dissimulation fait échouer les grands projets secrets qu’il tenait à partager avec les sept hommes supérieurs accueillis avec tous les honneurs dans sa montagne.
Avec cette invitation-regroupement, il dit indirectement que les penseurs doivent influencer l’opinion publique et s’occuper de la formation des élites. Il pense avoir réussi à détourner du peuple de fortes personnalités susceptibles d’être initiées aux valeurs aristocratiques. C’est vrai qu’une invitation ne suffit jamais, mais P.-J. Maarek (1992, pp. 38-102) écrit que si nous parvenons à inviter quelqu’un, nous avons l’opportunité de lui parler, de l’attirer. L’image du marketing politique est une réalité chez F. Nietzsche. Bien avant A. Mucchielli (2005, p. 159), il savait que « toute communication constitue une tentative d’influence » et que l’influence est consubstantielle à la communication. Si nous comprenons bien aussi la position de J.-B. P. Ndavaro (2008, p. 40), rectifions en avouant qu’avant M. Weber, Horkheimer, Adorno et Habermas, F. Nietzsche (2004, p. 274) tenait à cette politique de formation élitiste. Il pensait à la formation d’une élite capable de renouveler le savoir culturel. Il avait cette communication pédagogique à faire passer : « l’égoïsme des individus, des groupes et des masses a été de tout temps le levier des mouvements historiques ».
2.2. La montagne : un lieu pour encadrer la communication de groupe
L’espace de la montagne devient symbolique. Il n’est pas habituellement le milieu des activités communicationnelles publiques. Nous doutons même qu’une montagne puisse être définie comme un espace. Le langage allégorique qui la présente connote plutôt l’idée d’un recul, d’un isolement avec un groupe d’individus à initier, d’un culte. Elle est dans ce cas une propriété commune aux hommes supérieurs et à Zarathoustra. Dans les écrits de F. Laroussi (2006, p. 61), « c’est dans ce partage d’un lieu commun que siège la seule voie de communication, puisque la langue, elle, accrédite des identités spécifiques (qui s’exprime ?) avec une prétention universelle (qui écoute ?) ».
Évidemment, l’enjeu n’est pas ici l’universalité. Avec les hommes supérieurs, les attentes de F. Nietzsche sont plus proches de ce que M. Diagne appelle « la libération de leurs énergies créatrices »[16]. Son optimisme va au-delà des observations politiques de V. Jouve (1992, p. 102) qui voyait que c’est dans les relations qu’ils entretiennent avec le monde et avec les autres que les personnages affirment leur système de valeurs. Dans cette forme de communication de groupe, encadrée par Zarathoustra, il est convaincu que les personnages peuvent transcender leurs habitudes et se laisser imposer des valeurs grégaires. Seulement, vouloir attirer dans une communauté et avoir la volonté d’influencer dépendent de plusieurs autres principes. Partager un lieu commun n’est pas s’accorder sur les mêmes valeurs. D’ailleurs, la scène suivante est une preuve qui indique que ceux qui sont réunis dans la montagne ont des identités antagonistes.
Un surprenant événement est apparu au cours de la fête. Contre les principes des valeurs élitistes de F. Nietzsche (2006), tous les hommes supérieurs étaient tous prosternés sur leurs genoux, comme des enfants et des vieilles femmes fidèles, ils étaient prosternés en adorant l’âne. Ces désespérés ne seront pas remis d’aplomb sur leurs jambes. Beaucoup d’efforts ont été mobilisés pour en arriver encore aux sinistres conclusions de Feuerbach rapportées par G. Deleuze (1983, p. 182) : « celui qui est Homme n’a pas changé : l’homme réactif – machine à fabriquer le divin ». La machine à fabriquer le divin se développe. Une société élitiste s’éloigne, répond peu.
Pour notre part, la communication avec les hommes supérieurs ne pouvait être qu’un échec. Leurs énergies créatrices ne pouvaient pas se libérer. Peu de temps leur a été accordé. Leur mutation est brusque. Ils ne sont pas habitués à une vie de montagne. Ils sont habitués à une langue maîtrisable. Or, dans la montagne tout est dissimulé. Leur initiation a été codée. Ils n’ont entendu parler que de fête. Pourtant, la fête n’était qu’une technique d’amorçage. Elle était une sorte de pieds dans la porte. P. Rubise (2012, p. 14) connaît cette technique consistant à « demander quelque chose d’anodin qui, en général ne sera pas refusé, pour glisser ensuite une requête plus importante », du genre : parler directement des élites en général et du surhomme en particulier. Le paradoxe est que la fête a été en l’honneur des élites sans portrait d’élite visible, encore moins de discours expliqué à propos de ces élites. Ce scénario montre sept hommes qui rendent hommage à un âne pour effacer leur détresse. Puisque tout est démariage avec les valeurs aristocratiques ici, une chose est au moins sûre, nous ne sommes pas dans la perspective jubilatoire et globale de M. Heidegger (1973, p. 131) : « la fête – ce sont les fiançailles des hommes et des dieux ».
D’autres échecs traverseraient ces paroles et ces images. Il y a une contradiction si F. Nietzsche veut que la montagne soit aussi digne que l’espace public et les foyers. Sa condamnation des mausolées, des maisons serait arbitraire parce que, de part et d’autre, nous avons des espaces fermés de socialisation, ce qui ne signifie pas qu’il lui sera reproché d’avoir préconisé la création d’espaces élargis propres à la communication élitiste. Mais il lui sera reproché d’avoir poussé ses lecteurs dans l’interprétation de ses mystérieuses scènes d’apparence cultuelle. Les hommes supérieurs sont au nombre de sept. Le choix de ce nombre ne laisse pas indifférent. Pourquoi ne sont-ils pas au nombre de cinq ou de dix ? Ce nombre est chez lui un autre excédent non aristocratique qui s’exprime.
2.3. Le polycentrisme discursif autour de l’identité des sept hommes supérieurs
Une tradition mystique et religieuse, dont le philosophe ne se sépare jamais, influence ses pensées. Dans la Genèse 1, 2, nous lisons ceci : « Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout son travail. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé »[17]. Paradoxalement, les écrits de F. Nietzsche (2006, p. 86) semblent s’attribuer les mérites de ce récit. Les sept hommes supérieurs qui finissent malheureusement en « sept diables » avaient pour mission de « créer un dieu ». Dans l’introduction à L’Antéchrist, Peter Pütz présente le surhomme comme un jeune Dieu. Nous ne savons pas comment la transposition est possible, mais nous lisons, dans le paragraphe 2 du chapitre « Pourquoi j’écris de si bons livres » de Ecce Homo que la voix de Dieu parle en F. Nietzsche. Un débat autour de ces prétentions mégalomaniaques, servant les apories, peut être évité, même si les symboles du Dieu monothéiste, par exemple, sont plus expressifs que ceux des nouveaux dieux inaudibles qui sont annoncés. En revanche, ce serait un illogisme que F. Nietzsche revendiquât une œuvre achevée avec des discours déchirés. Sa personne ne peut pas non plus être présentée comme un accomplissement. Ses propos sont excessifs quand il déclare (2001, p. 128) : « absolument jeune », il savait déjà à sept ans que jamais nul mot humain ne l’atteindrait.
Une thèse sur l’aboutissement, voire la perfection, n’est pas défendable avec des paroles de F. Nietzsche (1982, p. 210) qui sont fragmentaires et insaisissables. La preuve est que le « fond de sa septième solitude » n’est qu’une séance de travail ardu avec ses pensées étourdissantes et semi-ouvrées. Zarathoustra (2006, p. 310), qui reprend périodiquement ses idées, n’était pas convalescent sept jours. Cette estivation n’était qu’apparente. Toutes ses facultés vitales étaient mobilisées sept jours pour venir à bout de ses intuitions au sujet de la pensée obscure du retour éternel. S. Botet (2011, p. 41) le comprend bien en soutenant qu’au cours de ces instants, F. Nietzsche ne s’abandonnait plus au discours déferlant qui l’emportait, il prenait un recul face à cette urgence du parler, il n’est plus possédé par le temps de la parole ; mais, angoissé par l’avenir, il « se met à réfléchir à ce discours » qui, pour nous, n’apprend pas de ses erreurs pour s’amender afin d’être plus communicable aux masses qu’il aborde sans les mêler effectivement au discours élitiste. Puisque toute sa pensée dissimule son fond, le nombre sept, employé ici, est ouvert à toutes les interprétations. F. Nietzsche (2004, p. 856) ironise en faisant du « septième jour de la création » un beau sujet pour les poètes créateurs de sens. Le nombre sept est agité par un polycentrisme discursif qu’illumine cette intervention des élites poétiques dont le travail d’interprétation est ouvert à l’infini. Ce mirage du mouvement empêche de défendre toute idée de repos ou d’aboutissement. F. Nietzsche ne serait que le symbole du paradoxe et des opinions semi-ouvrées que rend possible la duplicité de son discours et de son comportement.
Au-delà de l’énigme du nombre sept, peu d’information existe à propos de l’identité réelle des hommes supérieurs. Seul F. Nietzsche connaît leur passé et il le tait. Après la rencontre dans la montagne, ce qu’ils sont devenus est aussi obscur que les écrits herméneutiques qui les avaient annoncés. S. Botet (2011, p. 41) se demande qu’est Zarathoustra lui-même sinon qu’une « figure jusque-là diaphane, ethos vide, traversée par un flux de paroles, [et qui] semble devenir moins inconsistant ».
Ce que nous ne comprenons pas est encore dans le sens réel donné à l’expression « homme supérieur ». En pensant aux écrits de L. Sfez (2004, p. 53), on a le sentiment qu’ici existe « des hiérarchies peut-être, mais enchevêtrées les unes dans les autres, si bien qu’on ne sait plus distinguer ce qui est base et ce qui est sommet ». Il y a un esprit supérieur parce que des élus ont étalé, selon F. Nietzsche (2004, p. 785), au grand jour « tout ce qu’ils ont vu, après l’avoir vécu et se l’être assimilé ». Ils sont supérieurs à la populace dans la mesure où ils désirent et provoquent la contradiction. Mais il y a une ambivalence du sens du mot « supérieur » lorsque sont considérés le statut des deux rois et celui du mendiant volontaire. Là, le sens d’homme supérieur renvoie au « progrès ». En sélectionnant ces deux personnages, F. Nietzsche (1981, p. 81) serait victime de son propre système de valeur. Il a longtemps critiqué les évaluations acquises dans l’opposition entre le bien et le mal. C’est au cœur de cette communication sociale qu’était retenu que les hommes supérieurs désignaient les hommes de distinction, les puissants, ceux qui sont supérieurs par leur situation, leur élévation d’âme. C’est un paradoxe de voir F. Nietzsche (1982, p.76) choisir une race supérieure et régnante selon des critères populaciers. Les signes extérieurs chez ces élus, qu’il s’est choisis, n’ont aucune correspondance avec le « désir des hauteurs » inconnues. En vérité, il s’est trompé de choix, d’intuition et d’attente.
Le portrait des hommes supérieurs, qu’il a imaginé, n’est pas celui qu’il a lui-même nommé et présenté grâce à sept mystérieuses figures. Avec ses élus idéels et supérieurs, les instincts naturels priment sur tout. Ils sont grands, nouveaux, étonnants et suprêmes. Leur goût supérieur porte sur des exceptions, sur des objets qui d’ordinaire laissent indifférent. Ils ont un singulier jugement de valeur. Ils voient et entendent indiciblement. Ce supérieur connote le suprême, contrairement aux sept prototypes qui ressembleraient à des avortons.
Ces sept avortons n’ont pas l’habileté d’engager une interaction de groupe élitiste appropriée et effective. Ils se contentent de peu. Leur instinct de conservation prime. C’est spontanément qu’ils prennent un de leur état comme terme et expression définitive, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de limites dans leur pouvoir contredire. Or, c’est la durée qui fait les vrais hommes supérieurs. Ce comportement des sept hommes supérieurs ressemble à celui de la populace.
2.4. Les fils d’hommes innommables et leur insaisissable metteur en scène
Ayant constaté qu’ils n’étaient pas loin de l’image d’un monstre à deux têtes, dans le malaise, F. Nietzsche (2006, p. 374) (à travers Zarathoustra) finit par traiter ses hommes de fils d’hommes innommables. Suivant ses humeurs et pensant que le groupe avec lequel il communiquait n’était plus fréquentable, il (2001, p. 192) accusa et ferma toutes ses portes : « j’ai deviné que vous appelleriez Démon mon Surhomme ». Ce déni est une trahison puisque c’est lui-même qui avait déclaré avoir vu chez ces personnages les signes d’hommes supérieurs, ce qui était un regard électif gratuit et inhabituel.
Il n’a jamais entrepris sérieusement un travail de socialisation créant des compétences pour les choses suprêmes. L’ambivalence dans ses discours ne permet pas de saisir ce qui est communiqué concernant des esprits suprêmes. Comment peut-il bannir l’instinct de conservation, contester le mérite de toutes les grandes élites et tenir (dans le paragraphe 322 de La volonté de puissance, II) du coup une parole du genre : « on réalise bien des types supérieurs, mais ils ne se conservent pas ». Mais n’oublions pas que tout cela n’est qu’un hyper-réel et n’existe que dans un hyperespace d’un discours écrit. Au-delà des livres, seule une lecture allusive et audacieuse permet de transférer son discours aux âmes vivantes, ce qui fait de ses initiatives une communication inclassable.
Il y aurait derrière tous ces problèmes un lourd défaut d’appréciation de F. Nietzsche. Si autant d’espoirs ont fondu avec le groupe des hommes supérieurs, c’est parce que le meilleur contact possible n’a pas été établi. Ces soi-disant hommes supérieurs n’ont été ni intéressés ni favorablement disposés. Leur attention n’a pas été assez éveillée, voire captée. En faisant allusion aux hommes supérieurs, K. Jaspers (1950, p. 169) a bien vu en retenant qu’il y a eu une désillusion intime, mais il désinforme en écrivant que F. Nietzsche a fait « don à chacun de son amour, comme si quelque chose allait vers lui qui soit de la même espèce que lui ».
Dans l’ensemble, si la communication avec le groupe des sept hommes supérieurs était une opération psychologique pour influer sur les avis, elle aurait échoué à cause d’un ensemble de maladresses qui la parasitent. Les hommes supérieurs sont attirés mais Zarathoustra n’assume pas son rôle de guide suprême, de communicateur réel. Au groupe, il ne parle pas assez de son projet élitiste. Il le laisse bavarder. Il dérobe toutes les possibilités pour une vie suprême. « Je leur montrerai l’arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au Surhumain », avait-il (2006, pp. 58-60) décidé au départ, mais il n’a pas tenu parole dans le déroulement des actes de paroles.
Cette forme d’incommunication est lourde de conséquences. Selon J.-P. Esquenazi (1997, p. 130), le contenu d’un message ne peut être compris hors d’une problématique d’influence. Il devait clairement dire que pour qu’il y ait communication et compréhension dans ce groupe, il fallait qu’il existât une communauté. Or, il n’y a aucune valeur commune que ces différents élus partageraient avec le goût supérieur portant sur des exceptions. Mieux, et sans le partager avec le groupe, sur cette scène des hommes supérieurs, le scénariste F. Nietzsche veut que chacun s’assume et ne trouve sa finalité qu’en lui-même et non dans le groupe, ce qui est contraire à tout agir communicationnel habituel.
Il y a des limites dans les compétences d’influence « sélective et éducative » de F. Nietzsche (2000, p. 144). Il ne participe pas pleinement à l’harmonisation du polycentrisme discursif qu’il met en place. Il ne se réjouit que du bruit des discours. La vraie discussion délibérative est inexistante. Toutefois, que cette remarque de J.-M. Ferry (1994, p. 107) ne soit pas omise : « même une discussion libre – ne garantit nullement – une même conception. C’est d’ailleurs le contraire qui est le plus probable ».
Finalement, J.-B. P. Ndavaro (2008, p. 175) exprime mieux ce que nous ressentons à travers cette communication de groupe : « le processus de communication dans cet espace n’est pas fondé sur une démarche de discussion dialogique, mais plutôt sur celle de l’aiguille hypodermique ». On s’enfermerait dans le schéma carcéral de L’aveuglement de Janus de Gina Stoiciu. Encore pris dans les filets de ses visions réductrices ou même mystiques, F. Nietzsche (2000, p. 163 ; 1982, p. 31) prétendrait à un monocentrisme discursif dont il serait le seul acteur principal. En initiateur, il s’exprimerait comme une instance annonciatrice suprême et accaparante. Cette posture de l’éternel formateur rejoindrait l’éternel jeu de sa duplicité. Car nous ne voyons pas comment quelqu’un qui n’est pas parvenu « à six ou sept grands hommes » pourrait influencer le monde. Peut-être même ses lecteurs sont-ils leurrés continuellement par ses inconnues « sept vieilles recettes » qui lui inspirent autant d’audaces nouvelles.
Conclusion
- Nietzsche s’est livré à une véritable communication descriptive. Il s’est méticuleusement occupé d’indices interprétables. Dans ces rencontres de son porte-parole Zarathoustra, tout est parti d’un attractif cri qui venait des bois. La réaction et l’intérêt que ce personnage portait à ce cri ont rappelé une préoccupation : « le murmure initial ou le silence originel d’où naît toute parole ». Successivement, il est allé à la rencontre de deux rois, d’un scrupuleux de l’esprit, d’un enchanteur, d’un homme pieux, du plus hideux, d’un mendiant volontaire et d’une ombre. Malheureusement, la face cachée des soi-disant hommes supérieurs est dévoilée en plein jour. Ils n’assumeront ni leur prise de parole ni leur énergie créatrice. Ils ne savent que recevoir des ordres. Le metteur en scène et son porte-parole sont aussi responsables de cette incommunication. Ils n’ont pas clairement formulé leur attente lors de ces entretiens d’allure cultuelle.
Références bibliographiques
BOTET Serge, 2011, La « performance » philosophique de Nietzsche, Strasbourg, PUS, 86 p.
DELEUZE Gilles, 1983, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF., 6ème éd., 312 p.
DIAGNE Mamoussé, 2005, Critique de la raison orale, Paris, Karthala, 600 p.
ESQUENAZI Jean Pierre dir., 1997, La communication de l’information, Paris, Harmattan, 302 p.
FERRY Jean-Marc, 1994, Philosophie de la communication, 2, Paris, Cerf, 128 p.
FINK Eugen, 1965, La philosophie de Nietzsche, Paris, Minuit, 248 p.
HEIDEGGER Martin, 1973, Approche de Hölderlin, Paris, Gallimard, 264 p.
JAFFRO Laurent, 1998, Éthique de la communication et art d’écrire, Paris, PUF, 378 p.
JASPERS Karl, 1950, Nietzsche, introduction à sa philosophie, Paris, Gallimard, 192 p.
JOUVE Vincent, 1992, L’effet-personnage dans le roman, Paris, PUF, 272 p.
LAROUSSI Farid, 2006, Écritures du sujet, Belgique, Sils Maria asbl., 184 p.
MAAREK Jean Philippe, 1992, Communication et marketing de l’homme politique, Paris, Litec, 306 p.
MUCCHIELLI Alex, 2005, L’art d’influencer, Paris, Armand Colin, 174 p.
NDAVARO Jean-Baptiste Paluku, 2008, La communication et l’exercice de la démocratie en Afrique, Paris, L’Harmattan, 254 p.
NIETZSCHE Frédéric, 1981, La Généalogie de la morale, Paris, Fernand Nathan, 288 p.
NIETZSCHE Frédéric, 1982, Le gai savoir, Paris, Gallimard, 384 p.
NIETZSCHE Frédéric, 2000, Par-delà le bien et le mal, Paris, LGF, 385 p.
NIETZSCHE Frédéric, 2001, L’Antéchrist/Ecce Homo, Paris, Gallimard, 338 p.
NIETZSCHE Frédéric, 2004, Œuvres complètes, Paris, Éditions Robert Laffont, 1365 p.
NIETZSCHE Frédéric, 2006, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, Flammarion, 477 p.
ROUSSELOT Jean, 1969, Mort ou survie du langage ?, Paris et Bruxelles, Éditions Sodi, 277 p.
RUBISE Patrick, 2012, Manipulations, rumeurs, désinformations, Paris, L’Harmattan, 336 p.
SFEZ Lucien, 2004, La communication, 6ème édition, Paris, PUF, 128 p.
VERDON Jean, 2010, Information et désinformation au Moyen Age, Paris, Perrin-Le Grand, 288 p.
ONTOLOGIE ET FINITUDE CHEZ MARTIN HEIDEGGER
Albert ILBOUDO
Doctorant, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo (Burkina-Faso)
Résumé : Au cours de l’histoire de la pensée, la tradition religieuse et philosophique a pensé négativement la finitude humaine. Par un effort commun, elle a toujours cherché à surmonter ce « défaut » qui limite l’accès de l’homme au réel absolu. Le véritable sens de l’être ne peut être pourtant saisi que dans les limites d’une métaphysique qui se déploie sur le sol de la finitude humaine. Tel est le point de vue de Heidegger. Partant de la critique kantienne de l’ontologie traditionnelle, Heidegger ramène finalement la finitude au centre de toute réflexion soucieuse de dégager le sens de l’être.
Mots-clés : ABSOLU, CHRISTIANISME, ÊTRE, EREIGNIS, FINITUDE, METAPHYSIQUE, ONTOLOGIE.
Abstract : During the history thought, religious and philosophical tradition has thought negatively human finiteness. By a common effort, it has always seek to overcome that « flaw » that limit human access to absolute reality. The Really being’s meaning not be able nevertheless grasp that over the limits of the metaphysics that be imagined on the soil of the human finiteness. That is Heidegger’s point of view. He takes Kant’s critic of traditional ontology into account and he reduces finally finiteness to a centre of all reflection to be concerned to bring out being’s meaning.
Keywords: ABSOLUTE, BEING, CHRISTIANITY, EREIGNIS, FINITENESS, METAPHYSICS, ONTOLOGY.
Introduction
La constitution d’un savoir qui porte sur le réel absolu pose des difficultés non seulement en raison de son étendue mais également et surtout en raison de la finitude interne à l’homme, l’étant qui s’en fait une préoccupation. Dans l’histoire de la pensée, la conscience de la finitude a le plus souvent conduit philosophes, scientifiques et théologiens à se poser la question de savoir jusqu’à quel point peut s’étendre la connaissance humaine sur le réel. Le réel dont il est question dans ce propos est celui qui va au-delà du monde physique, objet d’étude des sciences positives auquel s’applique bien la réflexion épistémologique. Il s’agit plus précisément de cerner la possibilité d’appréhender le réel absolu que d’aucuns qualifient de suprasensible, objet sur lequel la métaphysique porte essentiellement son interrogation. Ce réel absolu, comment l’homme parvient-il à le penser, à le définir ? Il y réussit, répondent à la fois la théologie et l’ontologie traditionnelle, en se dépouillant d’abord de la finitude qui le caractérise. La notion de finitude est dans ce contexte négativement perçue, car au fond, elle est pensée en rapport avec la perfection divine qu’aucune limitation ne vient relativiser, ainsi que le souligne Luc Ferry dans sa préface à la Critique de la raison pure de Kant. Heidegger observait pour sa part dans son Kant et le problème de la métaphysique qu’avant l’avènement de la Critique de la raison pure de Kant, la notion de finitude n’était pas thématisée à sa juste valeur par la tradition ontologique occidentale. C’est l’une des raisons qui justifient à ses yeux la reprise de la question de l’être sur la base d’une analytique préalable de l’essence finie de l’homme, tâche à laquelle Kant a consacré à sa manière une partie de son œuvre.
C’est justement à partir de l’avènement de la Critique de la raison pure que se développe une autre approche de la finitude humaine qui semble se présenter aux antipodes de la conception jusque-là admise. Heidegger reconnaîtra après Kant que c’est la finitude en l’homme qui rend possible le développement d’une interrogation comme celle ayant pour objet l’être. Il prolonge et approfondit l’intuition kantienne selon laquelle l’interrogation métaphysique ne se pose qu’à un être fini, à qui le monde peut s’offrir comme horizon d’interrogation. Le problème philosophique se pose alors en ces termes : Comment la finitude inhérente à l’homme peut-elle en même temps signifier la révélation de l’être ? Partant du fait de notre finitude l’être lui-même ne se rapporte-il pas à nous de façon finie ? Si tel est le cas, sous quelle figure se présente cette finitude de l’être qui semble relever du paradoxe aux yeux des métaphysiques qui prétendent le penser dans son absoluité ? Pour répondre à ces interrogations nous partirons d’abord d’une approche générale de la notion de finitude dans la tradition religieuse et ontologique afin de préciser par la suite la modification qui affecte ce concept dans le questionner kantien. Questionner sur lequel s’appuie manifestement Heidegger pour penser plus radicalement la finitude humaine autant que la finitude de l’être.
1. LA NOTION TRADITIONNELLE DE FINITUDE ET LE PROBLÈME DE L’ÊTRE
Dans son acception traditionnelle, la finitude est généralement considérée comme une marque de l’imperfection de l’être humain, celle qui relativise sa position par rapport à la divinité dont la puissance n’est limitée par aucune borne. Dans l’anthropologie chrétienne par exemple, il est reconnu qu’en dépit de la position privilégiée dont l’homme bénéficie au sein de la création du fait de ses attributs divins tels l’esprit, l’âme, la raison, la frontière demeure immense entre la créature et le créateur à qui il est reconnu omniscience, intemporalité et perfection absolue. Le péché, la faute, l’erreur et surtout la mort, sont entre autres, les signes qui définissent la nature des êtres finis. Tel semble être également le point de vue de la tradition philosophique. Pour s’en convaincre, nous pouvons nous référer à la conception platonicienne de la sagesse, définie comme la perfection absolue réservée aux dieux et à laquelle les humains qui s’y destinent se doivent de se convertir à la philosophie afin d’éliminer leurs défauts imputables avant tout à leur nature finie. En dépit de cet effort, la sagesse humaine reste relative comme le souligne Pierre Hadot (1995, p.81) en ces termes : « Le philosophe n’atteindra jamais la sagesse, mais il peut progresser dans sa direction. La philosophie donc, selon le Banquet, n’est pas la sagesse, mais un mode de vie et un discours déterminés par l’idée de sagesse ».
C’est chez Descartes (1956, pp. 68-69) que la notion de finitude est rapportée clairement à la divinité chrétienne comme il le laisse clairement entendre dans ses Méditations : « Par le nom de Dieu j’entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute puissante, et par laquelle moi-même, et toutes les autres choses qui sont (s’il est vrai qu’il y en ait qui existent) ont été créés et produits »
Il découle de là que religion et philosophie s’accordent pour décrire la finitude en termes de manque d’être. La finitude telle qu’elle est expérimentée dans cette conception, doit conduire l’homme à la surmonter ou à la réduire autant que possible si tant est que les hommes, comme l’observait Aristote, désirent naturellement connaître. Si la finitude n’entache pas vraiment le rapport de l’homme à la réalité sensible, elle n’en diminue pas moins sa capacité d’accéder au savoir absolu, domaine a priori réservé aux êtres divins.
Dans la perspective du christianisme et du platonisme en effet, la réduction de la finitude pour atteindre à la perfection passe par une conversion qui prend çà et là des modalités spécifiques et dont le but est de transfigurer, pour ainsi dire, la nature déchue de l’homme. A des exercices spirituels s’associe une initiation théorique dont l’objectif concourt à élever l’esprit de la matière vers les réalités immatérielles et incorruptibles. La visée du paradis et de l’éternité pour le christianisme et celle de la sagesse pour le platonisme, constituent la preuve que la finitude qui est assimilable à une chute est surmontable. Dans le livre VII de la République, après avoir relevé la similarité qu’il y a entre le séjour ici-bas de l’homme à une prison où celui-ci est enchaîné par son ignorance, Platon en vient à conclure que l’homme possède potentiellement la perfection, perfection réalisable par le biais de l’éducation. De la bouche de Socrate, il déclara :
« L’éducation est donc l’art qui se propose ce but, la conversion de l’âme, et qui recherche les moyens les plus aisés et les plus efficaces de l’opérer ; elle ne consiste pas à donner la vue à l’organe de l’âme, puisqu’il l’a déjà ; mais comme il est mal tourné et ne regarde pas où il faudrait, elle s’efforce de l’amener dans la bonne direction » (Platon, 1966, p.277).
Par ailleurs dans le cartésianisme, c’est la conception négative de la finitude qui explique que dans sa théorie de la connaissance, Descartes démontre la nécessité de l’existence de Dieu comme caution de l’objectivité de la subjectivité pensante. En fait pour lui, ce qui nous fait toucher à la vérité dans notre quête de la connaissance tient au fait que nous ayons part à l’infinité de la toute perfection divine. C’est de là qu’il affirme dans la quatrième partie du Discours de la méthode (1966, p.64) que
« nos idées ou notions étant des choses réelles, et qui viennent de Dieu, en tout ce en quoi elles sont claires et distincte, ne peuvent en cela être que vraies. En sorte que, si nous en avons assez souvent qui contiennent de la fausseté, ce ne peut etre que celles qui ont quelque chose de confus et obscur, à cause qu’en cela elles participent du néant, c’est-à-dire, qu’elles ne sont en nous ainsi confuses, qu’à cause que nous ne sommes pas tout parfaits » (Descartes, p. 64).
Cette considération synoptique de la notion traditionnelle de finitude, en plus de révéler l’imperfectibilité qui la caractérise, fait également observer qu’elle n’est pas suffisamment problématisée. En aucun moment on ne se demande si la possibilité pour l’humain de se distancer de soi pour s’interroger sur le monde ne serait pas le fait même qu’il est traversé de part en part par la finitude. Bien au contraire, philosophie et religion s’accordent pour reconnaître que la finitude est le lot des hommes fermés de prime abord au savoir véritable, point de vue que ne partage pas tout à fait Kant, qui dans sa remise en question de la notion traditionnelle de finitude, annonce Heidegger.
2. LA REMISE EN CAUSE DE LA NOTION TRADITIONNELLE DE FINITUDE DANS LA THÉORIE KANTIENNE DE LA CONNAISSANCE
Comme il a été montré dans le développement précédent, la finitude humaine était pensée par rapport à la situation dont jouirait un être au pouvoir infini. D’où s’imposait la conclusion que la finitude est l’indice d’une tare et d’une imperfection propres aux espèces créées, notamment l’homme. Cette conception de la finitude subira une modification essentielle avec la publication de la Critique de la raison pure de Kant, ouvrage qui eut une portée révolutionnaire dans l’histoire de la pensée.
Comme le rappelle fort clairement Luc Ferry dans sa préface à la Critique de la Raison pure, la rupture kantienne vis-à-vis de l’approche philosophico-chrétienne de la finitude consiste en ceci :
« Kant pense d’abord la finitude, ensuite l’Absolu ou la divinité. En d’autres termes : la finitude, le simple fait que notre conscience soit toujours déjà limitée par un monde extérieur à elle, par un monde qu’elle n’a pas produit elle-même est le fait premier, celui dont il faut partir pour aborder toutes les autres questions de la philosophie » (Kant, Critique de la raison pure, Préface de Luc Ferry, p. II).
Dans cette perspective, tout savoir véritable ne doit pas excéder le champ de possibilité assigné à cet être fini qu’est l’homme. C’est pourquoi chez Kant, la constitution d’une connaissance véritable exige avant tout une analyse de notre pouvoir de connaître. Pouvons-nous avoir connaissance de l’absolu ou des réalités suprasensibles ? Avant d’affronter cette question, Kant s’interroge sur les conditions auxquelles doivent se soumettre nos connaissances pour avoir valeur de science. C’est ce qui amène Heidegger à voir dans la Critique de la raison pure de Kant un questionnement sur la possibilité interne de l’ontologie, c’est-à-dire de la métaphysique générale qui porte sur l’être de l’étant de façon générale comme préparation à la métaphysique spéciale qui elle s’intéresse des étant particulier comme Dieu (la théologie), l’homme (la psychologie) et le monde (la cosmologie).
Selon Kant, toutes nos connaissances dérivent de deux sources principales, à savoir l’intuition et l’entendement. Partant du fait premier que nous sommes des êtres finis, Kant établit que nous ne pouvons avoir accès qu’à ce qui nous est livré dans l’intuition par la sensibilité dont les formes a priori ou pures sont le temps et l’espace grâce auxquels le divers saisi par la sensibilité commence à s’in-former. Quant à l’entendement, il se limite à appliquer ses catégories ou ses concepts aux données de l’intuition. C’est cela qu’exprime Kant (1987, p.81) à travers ces mots qui débutent l’Esthétique transcendantale : « De quelque manière et par quelque moyen qu’une connaissance puisse se rapporter à des objets, le mode par lequel elle se rapporte immédiatement à eux et que toute pensée prend comme moyen (pour les atteindre) est l’intuition ». C’est parce que nous ne pouvons connaître que ce qui nous est livré dans l’intuition, c’est-à-dire les phénomènes, que Kant dénonce comme illusoire ce sur quoi se fondait la métaphysique pour affirmer sa prétention à atteindre les réalités suprasensibles, à savoir connaître les choses par le fait du simple concept en les réduisant à leur être logique. N’est-ce pas sur la base d’un tel présupposé qu’on tient pour vrai un argument comme celui ontologique qui consiste à déduire l’existence de Dieu du concept ou de l’idée de Dieu, comme le faisait Descartes. En affirmant que toute connaissance véritable est celle qui étend notre connaissance de l’objet, donc celle qui résulte d’une synthèse des données de l’intuition et des catégories de l’entendement, Kant affirme clairement que notre connaissance sur le réel ne saurait excéder les données spatio-temporelles offertes dans l’intuition.
Même si le but de la Critique de la raison pure semble consister à montrer en quoi des jugements synthétiques a priori (qui résument la connaissance transcendantale telle qu’elle est élaborée l’être fini) sont possibles, et si Kant ruine les prétentions spéculatives de la métaphysique qui la conduit à vouloir connaitre rationnellement des réalités qui ne relèvent pas des données de l’intuition, il réussit pourtant grâce à ce travail à faire ressortir la valeur pratique de la raison métaphysique dans l’existence pratique ou morale de l’homme.
Considérant ce qui précède, il se dessine chez Kant une conception déjà valorisante de la notion de finitude. Premièrement il se trouve que si notre intuition et notre entendement sont finis en ceci qu’ils reçoivent le monde dont ils ne sont pas les créateurs, c’est ce fait même qui rend possible le développement de la connaissance et du progrès à quelque niveau que ce soit car des êtres parfaits ne se donneraient jamais pour préoccupation l’acquisition du savoir, chose qu’il possède déjà dans toute sa plénitude. Par ailleurs, Kant relève le rôle tout de même créateur de l’entendement humain qui, par le moyen des concepts, subsume les données de l’expérience sensible pour en constituer la connaissance. En ce sens il accorde une fonction créatrice à la finitude car la connaissance est en dernier ressort l’affaire de l’être pour qui le monde peut s’offrir comme objet. Dès lors, même si notre connaissance se limite celui phénoménal, il n’est rien moins que l’être tel que celui-ci pourrait se révéler à l’humain dans l’entendement de Kant. Mais cet être qui se livre à l’être fini que nous sommes est dans une certaine mesure distincte de la chose en soi, la chose en soi étant conçue par Kant non pas comme ce qui se cacherait derrière le phénomène mais une autre relation à l’objet, celle qu’entretiendrait par exemple le créateur. C’est ce point fondamental de la conception kantienne de l’être que résume ce propos de Heidegger dans son Kantbuch :
« La chose en soit n’est pas un autre objet mais une autre relation (respectus) de la représentation à l’égard du même objet. (…)
Cet « au-delà du phénomène ne peut pas vouloir dire que la chose en soi se poserait malgré tout comme objet pour la connaissance finie comme telle et encore qu’elle ne soit saisie « parfaitement » par celle-ci, existerait tout de même fantomatiquement et se manifesterait parfois indirectement. Cet « au-delà du phénomène » exprime au contraire, que la connaissance finie est ; en tant que finie, nécessairement dissimulatrice, et dissimule, d’emblée, de telle façon que la « chose en soi », non seulement ne lui est pas accessible d’une manière parfaite, mais ne l’est par essence d’aucune manière ». (Heidegger, 1953, Kant et le problème de la métaphysique, pp. 93-94.)
Mais cette mise au point ne saurait pour autant signifier le désintérêt de Kant à l’endroit de cette tendance humaine à vouloir élaborer une connaissance qui porte au-delà de la réalité phénoménale. Loin s’en faut, la métaphysique chez Kant est un besoin naturel de la raison finie de l’homme et c’est ce besoin qui est à l’origine de cette envolée de la raison qui se croit pouvoir élaborer un savoir qui passe les bornes du terrain phénoménal. L’homme ne peut, sans cesser de perde de sa dignité ontologique, de renoncer à la quête de l’absolu, mais seulement cela ne peut plus se laisser appréhender comme objet, c’est-à-dire comme réalités phénoménales ainsi que nous a habitué à croire la métaphysique théorique traditionnelle. C’est plutôt l’usage pratique de la raison qui nécessite pour son exercice des concepts métaphysiques tels que celui de Dieu, de l’immortalité de l’âme, de la liberté entre autres. Il se passe chez Kant une nouvelle approche de la notion finitude en ceci qu’au lieu de la supprimer il ramène toute la possibilité de la connaissance humaine relativement aux limitations qu’implique la finitude et par quoi il réaffirme finalement la dignité morale de l’homme et cela sur des fondements nouveaux. En d’autres mots, comme le note Luc Langlois :
« C’est l’accomplissement de la métaphysique dans le bios theoretikos, dans la contemplation des protai archai kai aitiai, que Kant vient en effet littéralement réduire à néant dans la CRP[18], en substituant à cette visée théorétique une métaphysique de l’usage pratique de la raison. Il importe cependant de comprendre que cette transformation de la métaphysique, son redéploiement dans l’élément de la morale plutôt que du savoir transcendant, n’est pas imposé de l’extérieur à la raison théorique, mais procède intérieurement de son autocorrection critique. Le constat de Kant est que le dogmatisme de la métaphysique (c’est-à-dire la prétention à une connaissance rationnelle des objets intelligibles qui ne s’est pas préalablement assurée de la légitimité de ses concepts) est à la source d’un détournement de sens en philosophie, qui éloigne celle-ci de son concept cosmique et de la teleologia rationalis humanae qu’elle est censée éclairer. Aussi la philosophie ne pourra-t-elle aspirer à servir l’intérêt de l’homme, et par là à « porter au concept » sa destination véritable, qu’en assoyant sa propre activité théorique sur une autoréflexion préalable de la raison, scrutant les possibilités et les limites de son propre pouvoir de connaitre ». Luc Langlois, Kant et la métaphysique de la liberté, extrait de Y’a-t-il une histoire de la métaphysique ?, publié sous la direction de Yves Charles Zarka et Bruno Pinchard, p. 187.
Ainsi le questionnement philosophique part d’une enquête sur l’homme lui-même, mieux, sur sa nature finie comme vient de nous instruire Kant. Cependant, dans son effort de dégager l’informulé dans la pensée de Kant, Heidegger finira par relever que ce philosophe se rattache à la tradition ontologique classique d’obédience cartésienne en ceci qu’il continue de penser le moi ou le sujet transcendantal comme une chose qui accompagne toutes nos représentations et l’être comme présence permanente. Mais quoi qu’il en soit il n’en demeure pas moins que la conception kantienne de la finitude humaine dans son refus d’étendre notre connaissance de la réalité phénoménale alimentera la réflexion heideggérienne sur la vérité de l’être.
3. LA FINITUDE COMME OUVERTURE À L’ÊTRE CHEZ HEIDEGGER
La singularité de Kant dans l’histoire de la pensée a consisté à réhabiliter la notion de finitude. La Critique de la raison examine la structure finie de la connaissance humaine, la limite de sa portée sur le réel. Elle parviendra à montrer que le comportement métaphysique naturel de l’homme procède de la finitude inhérente à son être. N’en conclut-il pas de là qu’elle est d’un intérêt suprême pour la conduite humaine ? De toute façon Kant, refuse tout fondement à la métaphysique spéculative en raison du caractère finie de la connaissance humaine. On retrouve ici encore finalement une conception de la finitude qui semble se rapprocher de celle traditionnelle même si Kant tient malgré toute la finitude comme un absolu à jamais indépassable limitant par là même le déploiement de la connaissance dans le domaine spéculatif.
De façon presqu’analogue, mis à part le fait qu’il ne manifeste pas apparemment de préoccupations morales dans son questionnement, Heidegger admet dans Etre et Temps que de par sa manière d’être, l’homme dispose d’une compréhension préontologique de l’être et que c’est de là que vient sa tendance à vouloir découvrir le sens explicite de celui-ci. Il souscrit rétrospectivement dans son Kantbuch à l’idée kantienne que la métaphysique est consubstantielle à la nature du Dasein et que les problèmes relatifs à la connaissance du réel ne se posent qu’à un être qui se reconnaît comme fini. Mais chez Heidegger, souligne Françoise Dastur (2011, p.86),
« le problème ne consiste pas seulement dans la démonstration de la finitude humaine, mais dans la détermination de son essence. Ce qu’il s’agit par conséquent de montrer, c’est qu’il existe une relation intime entre la fondation de la métaphysique et la question de la finitude en l’homme. Or la finitude, si elle est comprise seulement au sens d’une dépendance à l’égard de la pré-donation des étants, ce qui correspond au concept kantien de finitude n’est pas ce qui est le plus radicalement fini en l’homme. Kant a élaboré le concept de finitude en le déterminant de manière externe comme intuitus derivativus, par opposition à l’intuitus originarius de l’être divin, en continuant à voir dans l’être humain un ens creatum, une créature ».
Heidegger a donc pour souci de fonder plus originairement la finitude en ce sens qu’il l’enracine dans l’existence de l’homme entendu comme Dasein. Même s’il reconnaît avec Kant que c’est la finitude qui déclenche en l’homme le besoin de comprendre la réalité, ce processus s’explique plus profondément par le fait que l’homme étant l’étant qui jouit de l’existence, il est déjà la zone dévoilante de l’être. Sur ce point Françoise Dastur (2011, p. 86) rappelle que l’existence doit être comprise chez Heidegger « non pas seulement comme le privilège que posséderait l’homme d’être ouvert à l’être, mais aussi comme impliquant pour l’être humain la nécessité d’assumer sa dépendance à l’égard de la pré-donation des étants ». Heidegger (1953, p. 285) ajoute en effet dans son Kantbuch que « c’est seulement parce que la compréhension de l’être est ce qu’il y a de plus fini dans le fini, qu’elle est en mesure de rendre possible même les facultés « créatrices » de l’être humain fini ». L’existence humaine, remarquait Heidegger dans ses premiers cours consacrés à l’herméneutique de la facticité, se déploie toujours déjà comme sens car elle est projection transcendantale rendant ainsi la rencontre a priori de tout étant. En effet, note Otto Pӧggeler (1967, p.35), « ce qui est énoncé au sujet de cette vie facticielle, c’est son « autosuffisance » ; la vie ne donne de réponse à ses questions que dans sa propre langue ; elle se comprend elle-même ; expression, manifestation, révélation lui appartiennent » (Pӧggeler (O), p.35). C’est pourquoi l’ontologie fondamentale projetée dans Être et Temps quelques années plus tard était fondée sur l’analyse phénoménologique de la facticité ou de l’effectivité de l’existence quotidienne et banale, domaine généralement négligé par la tradition ontologique mais d’où part, selon Heidegger, tout véritable questionner sur le sens de l’être. Mais d’où vient le fait que le sens de l’être ne soit pas livré immédiatement à l’existence même du Dasein que Heidegger considère comme ouverture à l’être ?
La réponse que Heidegger donne dans Être et Temps au sujet de cette question est que l’existence bien qu’elle soit projet configurateur du monde est avant tout projet jeté et en tant que tel elle est d’ores et déjà jetée à des possibilités dont elle n’est pas responsable mais qu’elle est pourtant appelée à assumer. Mais le plus souvent l’existence du Dasein a tendance à succomber dans des possibilités d’ententes secondaires de l’être, possibilités secondaires rendues possibles par les possibilités d’entente primaire et authentique. Cette tendance de l’existence à déchoir est favorisée d’ailleurs par notre dépendance de la tradition qui transmet ses notions sur l’être tout en voilant généralement leur source ou lieu de jaillissement. Tout cela s’explique par le fait que le Dasein vogue dans une certaine déchéance que Heidegger nomme la chute, chute dont il faudrait éloigner toute référence à un état moral qui aurait existé dans un âge d’or. La chute ici c’est le fait que le Dasein se laisse accaparer par le monde, par cet être impersonnel dénommé le On qui inculque à tous une compréhension faussée de son soi-même au point que le Dasein s’oublie comme ouverture à l’être ou comme l’étant à qui il revient de penser la vérité de l’être. Le phénomène de la chute peut être comparé à une fuite du Dasein vis-à-vis de sa finitude, à un refus d’assumer son statut vis-vis de l’être. Mais le Dasein est appelé à assumer la compréhension de l’être, étant « l’étant pour qui il y va en son être de cet être même » (M. Heidegger, Être et Temps,1986, p.74), il est quelques fois secoué dans sa fuite par des disposiblités (sentiments de la situation) comme l’angoisse qui l’extirpe de sa perte dans le On et le ramène à comprendre son rôle ontologique mais aussi par l’angoisse devant la possibilité de sa propre mort dont l’approche ontologique révèle qu’elle constitue une ouverture à son être soi-même. La mort découvre au Dasein sa différence d’avec les étants seulement là-devant. En effet écrit Heidegger dans Être et Temps (1986, pp. 305-306) : « l’angoisse devant la mort est angoisse « devant » le pouvoir-être le plus propre, sans relation et indépassable. Ce devant quoi s’éveille cette angoisse est l’être-au-monde lui-même. L’enjeu par excellence est le pouvoir-être du Dasein ». Le pouvoir-être du Dasein dans ce contexte, c’est le fait de se comprendre comme un étant doué de transcendance, livré à une possibilité qui ne se réalise pas mais qui est plus réelle que la réalité étante. Cette possibilité amène le Dasein à s’entendre comme le néant qui se doit de trouver un sens à l’être. La mort apparaît alors comme un signe de la finitude du Dasein, donc comme l’une des voies qui mènent à la compréhension de l’être.
La compréhension de l’être qui équivaut à la transcendance du Dasein est la base de la finitude de ce dernier. C’est dans ce sens que nous devons comprendre ce propos de Heidegger (1953, p. 285) : « plus originelle que l’homme est en lui la finitude du Dasein ». Finitude elle-même qui doit à l’existence son ouverture à l’être. Nous entrevoyons déjà par-là que l’être dans la compréhension que nous livre Heidegger est aussi finie qu’est fini le Dasein. Mais en quoi consiste finalement cette finitude qui caractérise l’être même dans sa manifestation au Dasein que nous sommes ?
4. LA QUESTION DE LA FINITUDE DE L’ÊTRE DANS L’ONTOLOGIE HEIDEGGÉRIENNE
Le dévoilement du sens de l’être chez Heidegger est conditionné par l’existence du Dasein, existence qui vaut ouverture, donc compréhension de l’être. Si l’homme n’est homme que grâce à la relation qui le lie à l’être. Ce dernier ne saurait non plus se montrer que grâce à la présence dévoilante de l’homme. De là il se profile déjà l’idée que l’être dont il nous revient la possibilité de dévoiler est lui-même fini dans sa nature. « Il n’y a d’être que là où la finitude s’est faite existence » soulignait Heidegger dans son Kant et le problème de la métaphysique. Or il n’est pas dans le pouvoir de la finitude humaine de remonter à la source de l’être car toute source conceptualisable relève en réalité du domaine de l’étant. La vérité comprise comme vérité de l’être et non pas seulement comme celle de l’étant ne livre pas son fondement au Da-sein auquel il se destine pourtant. Il se dégage de là une certaine transformation de la pensée heideggérienne en ce sens que le cadre de son ontologie fondamentale de 1927 il se donnait lui-même pour tâche de livrer dans la clarté du concept le sens de l’être.
Suite au tournant intervenu dans sa pensée dans les années 30, tournant consécutif à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de livrer enfin le sens temporel de l’être dans le cadre d’une ontologie du Dasein marquée malgré elle par une certaine tendance à vouloir réifier l’être, Heidegger est amené désormais dans sa deuxième philosophie à penser plus originairement le rapport de l’être désigné comme l’éclaircie qui se déploie à partir d’une occultation fondamentale à l’être du Dasein. L’être ne se découvre plus à l’horizon fini de l’homme, écrit F. Dastur (2011, p. 62), qui ne se comprend plus :
« comme le fondement jeté de cette éclaircie, mais comme celui qui se tient en elle et qui lui est redevable de son propre être, Dasein sera alors constamment écrit Da-sein, cette nouvelle graphie montrant que le « là » de l’être ne peut plus être compris comme le résultat de la projection de l’être de l’homme, mais comme l’événement d’une adresse (Anspruch) de l’être lui-même à l’homme à laquelle celui-ci répond (ent-spricht) par la pensée ».
De là, l’être lui-même sera pensé comme fini en ce sens que la présence du Da-sein dont il est pourtant la source apparaît comme indispensable à sa manifestation. Cette conception de l’être fini s’annonçait déjà dans la conférence intitulée Qu’est-ce que la métaphysique ?, où nous pouvons lire ceci : « L’être et le néant s’appartiennent (…) parce que l’être lui-même est fini dans son essence et ne se révèle que dans la transcendance du Dasein qui est maintenu dans le néant » (Grondin, 1987, p. 115). À propos de cette finitude Jean Grondin (Ibid., p. 115) ajoute :
« La finitude constitue le fond ultime de la fusion de l’être et du néant. Il ne faut pas perdre de vue la visée anthropologique du seul fait que la finitude se trouve assignée à l’être. L’être lui-même ne consiste (« ne se révèle ») que dans son rapport au Da-sein, donc dans son tournant vers l’homme. C’est ce rapport qui porte la marque de la finitude ».
En effet sur le fondement de la finitude de l’être, le concept de vérité se trouve corrigé. Elle ne renvoie plus à une connaissance qui en adéquation avec son objet. C’est désormais à la conception pré-platonicienne de la vérité entendue comme l’Aletheia que Heidegger recourt pour penser plus fondamentalement la vérité de l’être accessible à l’ouverture finie de l’homme. L’Aletheia qui nomme traditionnellement la vérité chez les Grecs signifie désoccultation, mise à découvert. La lethè (l’occultation) à partir de laquelle l’aletheia s’arrache constitue sa source inépuisable. Nous sommes bien là éloignés des ontologies infinitistes comme celle de Hegel qui en pensant surmonter la finitude humaine postule l’égalité de l’être et de la pensée, c’est-à-dire le pouvoir de la subjectivité à se soumettre la vérité de l’être. En effet, l’homme n’est-il pas, chez Hegel, « le lieu de l’advenir à soi de l’absolu » ? (Protocole d’un séminaire sur la conférence « Temps et Être », 1976, p. 86.)
C’est de l‘approfondissement de la conception grecque de la vérité que Heidegger finira par désigner plus originairement l’essence de l’être sous le nom d’Ereignis (l’événement d’appropriation) qui traduit le rapport autre qui se trouve ficelé entre l’homme et l’être. L’Ereignis révèle la co-appartenance de l’homme et de l’être. A propos du sens de ce concept fondamental de la philosophie du deuxième Heidegger, F. Dastur (2011, p. 64) écrit :
« Ce que Heidegger entend sous ce terme, c’est cette réciproque propriation de l’être et de l’homme par laquelle ils sont mis en rapport. (…) Sur cette base, il est alors possible de dire que l’Ereignis en rendant visible dans l’éclaircie le déploiement de l’être de l’homme comme Da-sein, lieu de l’être, amène à leur propre les mortels en les rendant propres (vereignen) à l’être qui de son côté est approprié (zugeeignet), c’est-à-dire dédié à l’être de l’homme ».
Dans cette mise en rapport, l’être tout en découvrant à l’homme dans son horizon fini le domaine limité de l’étant lui refuse sa source. L’Ereignis, explique toujours F. Dastur (Ibid.) est donc un destiner « c’est-à-dire un donner qui ne donne que sa donation et qui en se donnant ainsi se retient lui-même et se retire ; il est en même temps Enteignis, c’est-à-dire qu’il est le fondement sans fond de l’être, son Ab-grund, son abîme ». L’être en se couvrant de ce voile de mystère qu’est l’abîme de l’Ereignis se montre encore une fois dans son rapport à l’homme comme fini. Fini au sens cette fois-ci où son ouverture à laquelle nous avons accès est limitée et ne révèle pas son véritable secret.
L’essence de l’être, que Heidegger désigne comme la vérité de l’essence n’est pas accessible au mode de pensée métaphysique résolument centré à découvrir l’être de l’étant sans se soucier de l’être lui-même. Mais la métaphysique définie ainsi à en croire Heidegger n’est pas le fait d’une erreur imputable uniquement aux carences d’une quelconque philosophie car de la même manière que l’existence quotidienne oublie sa finitude pour se laisser accaparer par la présence des étants intramondain, l’histoire de la métaphysique est celle d’une errance car obsédée à conquérir de façon infinie l’étant dans son être. Cela se révèle plus évident surtout quand on saisit la métaphysique sous la figure de la technique entendue par Heidegger comme la métaphysique achevée. C’est pourquoi dans l’entendement de Heidegger (1958, p. 90), « dépasser la métaphysique, c’est la livrer et la remettre à sa propre vérité ». Ce qui revient à la prendre au sérieux afin de pouvoir dégager son impensé.
Conclusion
Parvenu au terme de notre réflexion, il apparaît que l’approche métaphysique visant à surmonter la finitude humaine afin de livrer l’être dans toute sa totalité au regard humain repose en fait sur une erreur sûrement involontaire qui entraîne une conséquence doublement préjudiciable à l’interrogation relative à la vérité de l’être. Par conséquent l’essence de l’homme autant que celle de l’être sont manquées. Chez Hegel par exemple, figure de proue de l’ontologie classique, l’être trouve toute la plénitude de son concept dans la subjectivité pensante. Par là on peut comprendre pourquoi Heidegger affirme qu’en régime métaphysique il est toujours question de l’être de l’étant et non de l’être lui-même, réduit généralement soit à l’étant, soit au néant vide. Dans la perspective heideggérienne la finitude est pensée comme la base de la compréhension de l’être en ce qu’elle signifie transcendance, ouverture par laquelle l’être dans sa nature finie nous ouvre l’horizon de l’étant pour enfin s’auréoler lui-même du voile du néant, gardant ainsi son fond sans fond loin de l’horizon fini de l’homme. La conquête infinie de l’étant révèle en réalité l’indigence ontologique de l’homme et contraste avec sa nature finie dont le besoin authentique reste la méditation de l’être. Dans ce sens, le dépassement de la métaphysique auquel prépare la méditation heideggérienne de l’être s’éprouve dans notre capacité à ressentir la finitude comme l’unique fondement de notre être-là.
Références bibliographiques
DASTUR Françoise, 2011, Heidegger et la pensée à venir, Éditions Vrin, Paris, 253 p.
DESCARTES René, 1966, Le discours de la méthode, Éditions Garnier-Flammarion, Paris, 252 p.
DESCARTES René, 1956, Méditations métaphysiques, trad. Florence Khodoss, Éditions Pesses Universitaires de France, Paris, 316 p.
GRONDIN Jean, 1987, Le tournant dans la pensée de Martin Heidegger, Éditions Presses Universitaires de France, Paris, 137 p.
HADOT Pierre, 1995, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Éditions Gallimard, Paris, 463 p.
HEIDEGGER Martin, 1986, Etre et Temps, trad. François Vezin, Éditions Gallimard, Paris, 594 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et conférences, trad. André Préau, Éditions Gallimard, Paris. 354 p.
HEIDEGGER Martin, 1953, Kant et le problème de la métaphysique, trad. Alphonse de Waelhens et Walter Biemel, Éditions Gallimard, Paris, 308 p.
HEIDEGGER Martin, 1985, Qu’est-ce que la métaphysique ?, trad. Henri Corbin, Éditions Nathan, Paris, 112 p.
HEIDEGGER Martin, Temps et Être, extrait de Questions IV, trad. François Fedier, Éditions Gallimard, Paris, 1967, 343 p.
KANT Emmanuel, 1987, La Critique de la raison pure, trad. Jules Barni, revue par P. Archambault, Éditions Flammarion, Paris, 725 p.
PLATON, 1966, La République, trad. Robert Baccou, Éditions Garnier-Flammarion, Paris, 512 p.
PӦGGELER Otto, La pensée de Heidegger, trad. Marianna Simon, Éditions Aubier-Montaigne, Paris, 1967, 412 p.
ZARKA Yves Charles, Pinchard Bruno et compagnie, 2005, Y a-t-il une histoire de la métaphysique ?, Éditions Presses Universitaires de France, Paris, 407 p.
ÊTRE ET VISAGE : PROXIMITÉ ET DISTANCE ENTRE LEVINAS ET HEIDEGGER
Clément Kouassi N’DOUA
Université Alassane OUATTARA, Bouaké (Côte d’Ivoire)
clemkouassi@yahoo.fr
Résumé : Levinas a développé, notamment par rapport à Heidegger, une pensée critique de l’ontologie comme totalité, où l’altérité est niée au profit de la question de l’Être. D’une certaine manière, cette critique acerbe, à l’encontre de l’ontologie fondamentale comme la science de l’Être qui subordonne la relation à l’Autre à l’interrogation sur l’Être, a creusé un fossé entre Levinas et Heidegger. Cette critique, qui s’ouvre sur l’érection d’une pensée éthique de grande envergure, pense le sujet dans une passivité radicale recevant autrui comme vocation à la responsabilité. Le présent article tente, à partir des concepts d’Être et de Visage, de saisir, au-delà de l’opposition apparente entre Heidegger et Levinas, une certaine proximité, sinon une proximité certaine entre ces deux penseurs.
Mots-clés : ALTERITÉ, DÉVOILEMENT, ÊTRE, ÉTHIQUE, PHÉNOMÉNOLOGIE, VISAGE.
Abstract : Levinas has developed, especially in relation to Heidegger, a critical thought of ontology as totality, where otherness is denied in favor of the question of Being. In a certain way, this sharp criticism, against the fundamental ontology as the science of the Being which subordinates the relationship to the Other to the questioning of the Being, has widened a gap between Levinas and Heidegger. This criticism, which opens up to the erection of a large-scale ethical thought, thinks the subject in a radical passivity receiving others as a vocation to responsibility. The present article attempts, from the concepts of Being and Face, to grasp, beyond the apparent opposition between Heidegger and Levinas, a certain proximity, if not a proximity certain, between these two thinkers.
Keywords: ALTERITY, BE, ETHICS, FACE, PHENOMENOLOGY, UNVEILING.
Introduction
Quand on ouvre l’œuvre de Levinas, on est tout de suite confronté à une critique acerbe qu’il fait à l’endroit de Heidegger. Même s’il apprécie l’aspect fondamental de la pensée heideggérienne, Levinas ne manque pas, quelque fois, de ramer à contre courant de celle-ci. En fait, le chemin de pensée de l’un semble parfois s’écarter de celui de l’autre. Car là où Heidegger a révélé le sens de l’Être voilé par la métaphysique traditionnelle, Levinas (2009, p. 77) lui, s’évertue à restaurer la dignité « de l’alter englouti dans les rets du subjectivisme moderne » produisant ainsi un véritable renversement. Visiblement, Levinas désire se soustraire de l’emprise de l’Être heideggérien ; il veut se tenir en dehors de l’Ontos qui, pour lui, consacre, d’une certaine façon, l’oubli de l’autre en tant qu’oubli de l’essentiel. Heidegger reprochait à la philosophie, notamment à la métaphysique traditionnelle, d’occulter la question de l’Être, Levinas, quant à lui, voit dans la pensée moderne, y compris celle de Martin Heidegger, un oubli de l’Autre dans sa transcendance.
N’y a-t-il pas là, entre les deux, une convergence de vue sur les motivations de leur philosophie ? Oubli de l’être chez l’un et oubli du visage chez l’autre ne présentent-ils pas, Être et Visage comme le point d’ancrage de la philosophie selon qu’on soit heideggérien ou lévinassien ? Mais par quelle méthode Heidegger est-il arrivé à instituer l’Être comme concept fondamental de sa philosophie et, par quel geste méthodologique Levinas a-t-il découvert le Visage comme concept clé de la sienne ? Voulant chacun, de son côté, faire droit à ce qui lui paraît être le noyau de la philosophie, les deux penseurs, semblablement, n’ont-ils pas eu à faire usage de la même méthode, phénoménologique, dont la tâche est de faire « droit aux choses elles-mêmes » ? Ces questions, dont l’objectif est de montrer qu’au-delà de la divergence qu’on leur reconnaît, subsiste, entre Levinas et Heidegger, une convergence de vue. Aussi, seront-elles analysées, à travers les méthodes critique, phénoménologique et herméneutique, selon une argumentation à trois temps dont le premier consistera à présenter le fond commun phénoménologique qui a présidé à la naissance de ces deux philosophies. La saisie de ce fond commun permettra, dans un deuxième temps, de comprendre qu’il y a bien, dans l’ontologie heideggérienne, une dimension éthique, soucieuse de la question de l’Autre, et en dernière instance, il sera question de l’originalité de l’éthique lévinassienne.
1. LEVINAS OU LA PENSÉE HEIDEGGÉRIENNE EN PROCÈS
Comment comprendre une telle formulation ? Levinas est anti heideggérien, car toute son œuvre a consisté à mettre en procès certains pans de la pensée heideggérienne. Même si Levinas a été énormément influencé par Heidegger, il se situe, malgré tout, en rupture avec lui. Fondamentalement, avec Heidegger, il va se nouer un lien ambigu d’estime et de rupture. Comme le souligne L. Fèvre (2006, p. 96), « Levinas a toujours subi une sorte de fascination pour Heidegger », une fascination qui a toujours été contrebalancée par son judaïsme avéré et son pressentiment de l’horreur nazie. Cette fascination est encore plus plausible à travers cette affirmation que Fèvre nous livre avec une certaine profondeur :
Malgré toute l’horreur qui vint un jour s’associer au nom de Heidegger-et que rien n’arrivera à dissiper-rien n’a pu défaire dans [son] esprit la conviction que Sein und Zeit de 1927 est imprescriptible, au même titre que les quelques autres livres éternels de l’histoire de la philosophie » (L. Fèvre, 2006, p. 35)
Si Levinas ne suit pas Heidegger dans sa philosophie qu’il considère pourtant comme incontournable, il va tout de même se situer contre cette philosophie qui l’amène à prendre ses distances avec Heidegger. Plus encore, c’est contre Heidegger ou plutôt pour sortir de Heidegger que Levinas va penser et approfondir ses intuitions premières. Levinas conçoit Heidegger comme le mal du monde moderne. C’est l’une des raisons pour lesquelles Levinas s’est mis à équidistant de Heidegger. Dès lors, la distance philosophique qui sépare ces deux penseurs est fondamentale, car là où Heidegger cherche à éclaircir l’Être voilé par la métaphysique, Levinas produit un véritable renversement. De cette façon, Levinas cherche à s’évader de l’Être, à sortir hors de l’ontologie qu’il considère comme la science de l’Être mais aussi comme la science du « je » dont le divers se ramène à lui. Or, l’essentiel, ce n’est pas le « je » mais le « tu » qui trouve toute sa plénitude dans l’éthique. Car, l’ontologie, de par sa nature même pour Levinas, porte à un oubli de l’autre homme.
De même, Levinas critique la conception d’un retour de l’homme au monde dans le philosopher heideggérien. Or, selon lui, ce retour au monde conduit à un oubli de l’Autre. Car il identifie la notion d’être-là, et d’être au monde, chez Heidegger, à une liquidation de la présentielle de l’Autre, puisque chez Heidegger, « aucune extériorité n’est alors possible pour le sujet » (A. Zielinski, 2004, p. 24.), dans la mesure où le sujet est appelé à être sans recours à une extériorité. De cette manière, on assiste à un oubli de l’Autre. À l’analyser attentivement, la neutralité du monde heideggérien, la neutralité de l’Être constitue, pour Levinas, un danger dans le sens où elle ouvre à une sorte de sacralisation du monde. Or, cela dissimule potentiellement un monde inhumain parce que privé de l’Autre, qui est le fondement même de la morale et du sujet levinassien. Ainsi, E. Levinas (2001, p. 236) analyse la philosophie de Heidegger en ces termes :
L’ontologie heideggérienne subordonne le rapport avec l’Autre à la relation avec le Neutre qui est l’Être et, par-là, elle continue à exalter la volonté de la puissance dont Autrui seul peut ébranler la légitimer et troubler la bonne conscience […] l’Être l’ordonne (le Dasein) bâtisseur et cultivateur, au sein d’un paysage familier, sur une terre maternelle. Anonyme, Neutre, il l’ordonne éthiquement indifférent et comme une liberté héroïque, étrangère à toute culpabilité à l’égard d’autrui.
On remarque bien ici ce qui creuse un gouffre entre Levinas et Heidegger. Fondamentalement, dans sa pensée, Heidegger nie l’existence de l’homme en le posant comme un être-là, destiné foncièrement au rapport avec le monde, le vidant ainsi de toute préoccupation de l’Autre. Et cet être-là ne doit son existence qu’à la compréhension de l’Être. Au fait, l’indifférence que Levinas constate, chez Heidegger, sur la question de l’autre, est le contraire du mouvement éthique chez Levinas. Pour lui, une telle pensée est un soubassement philosophique de la guerre telle qu’il l’analyse dans la première partie de Totalité et Infini. Le refus de l’Autre tel qu’il se déploie dans cette « maternité de la terre », chez Heidegger, est synonyme de violence et « détermine toute la civilisation occidentale de propriété, d’exploitation, de tyrannie politique et de guerre » (E. Levinas, 2001, p. 237).
Il demeure que le rapport au monde est un élément fondamental dans la pensée du philosophe de Fribourg, alors que, pour Levinas, cette préoccupation du monde est un axe non fondamental ; en ce sens qu’il estime que Heidegger trompe la philosophie et déconstruit le sens même du monde qui est un espace où l’on séjourne avec l’altérité. Pour lui, le monde sera toujours plus ou moins perçu comme « le lieu d’absorption par le Même », comme le rapporte A. Zielinski, (2004, p. 30). En fait, l’Autre est précisément cet étranger que je rencontre dans le monde mais qui n’est pas du monde. Dire qu’il n’est pas du monde donne à penser que l’Autre ne peut être appréhendé comme un objet mondain mais comme un être infini, car en lui le divin se lit. Là où Heidegger pense la familiarité du Dasein avec le monde, Levinas lui pense l’étrangeté de l’autre au-delà du monde. Car l’autre est transcendant. Cependant, il conviendra de voir qu’il y a bien un rapport au monde chez Levinas mais qui est soumis au rapport éthique avec autrui.
Tout bien considéré, l’Être se donne à entendre comme totalité, comme Même. En effet, pour Levinas, toute la modernité est philosophie du Moi compris comme totalité. Que faut-il entendre par cette assertion ? En d’autres termes, l’Être, dans l’entendement de Levinas, est volonté d’identification dans une totalité. L’Être a tendance à s’identifier dans le monde, non point dans une forme tautologique telle que A = A mais dans une « relation concrète entre moi et le monde » (E. Levinas, 2006, p. 26). « La manière du moi contre l’autre consiste à séjourner, à s’identifier en y existant chez soi » (Ibid.). À en croire Levinas, l’être-moi existe dans le monde réduisant tout ce qui est autre à un chez soi. L’être-moi apprivoise l’autre. C’est pourquoi, le Moi est conçu comme philosophie du pouvoir. Cela veut dire que le Moi s’accapare de tout, domine tout ce qui est autre. Car aucune extériorité ne peut s’appréhender en dehors du Moi, si bien que cette attitude du Moi ne peut pas conduire à une attitude éthique. C’est dans cette optique qu’il énonce ceci :
La possibilité de posséder, c’est-à-dire de suspendre l’altérité même de ce qui n’est autre que de prime abord et autre par rapport à moi, est la manière du Même […] L’identification du Même n’est pas le vide d’une tautologie ni une opposition dialectique à l’Autre mais le concret de l’égoïsme » (Ibid., p. 27).
Ce serait un truisme que de dire, qu’il n’est pas de la nature du Moi de lutter contre l’Autre ; il est dans sa nature de faire que tout ce qui est autre rentre dans sa sphère. Véritablement, si le Même ne s’identifiait que par opposition ou par relation conflictuelle avec l’Autre, il s’engloberait au même titre que l’autre dans une totalité qui le dépasse. Or, pour Levinas, c’est le Même qui représente la totalité.
En outre, cette identification du Même se déploie en plusieurs moments ou en plusieurs aspects. Le sujet vivant existant est, d’abord, ce sujet isolé qui vit de « nourritures terrestres », entendues dans le philosopher levinassien comme « jouissances par lesquelles le sujet trouve sa solitude » (E. Levinas, 1986b, p. 52). Le rapport au monde du sujet se définit comme satisfactions de besoins, recherche de nourritures. Maison, travail, possession économie, jouissance et représentation sont les moments auxquels le Moi laisse entrevoir son égoïsme. En un mot, c’est le lieu où le Moi s’accapare de tout et affame l’Autre. Dans ce sens, le sujet est seul et isolé dans son exister. Cependant, il peut y avoir une rupture de cette vie heureuse du Moi avec l’apparition de l’Autre, qui vient rompre cette attitude égoïste du Moi. Car la présence d’autrui va troubler son attitude. Et, cette présence troublante qui trouble l’attitude du sujet le ramène à comprendre qu’il n’est pas seul au monde.
Ainsi, le monde du sujet fondé sur la jouissance est bouleversé, mis en difficulté par la présence de cet Autre qui, apparaissant dans le monde, n’est pas un objet du monde. Du coup, l’Autre n’est pas une nourriture et de ce fait résiste à l’identification. Cette relation du sujet à l’Autre ne peut être que métaphysique, dans le sens où l’Autre échappe à la représentation. Cette relation sort de la logique du Même qui a cette tendance d’enfermer l’Autre dans sa sphère. Pour ce faire, « le pouvoir du Moi ne franchira pas la distance qu’indique l’altérité de l’Autre » nous dit Zielinski (2004, p. 2). Alors, dans un monde où le Moi ne vit que dans une relation de soi à soi, l’Autre se présente comme en rupture avec ce monde. Alors, une telle relation, qui se déroule dans un tel monde, ne peut être que poreuse.
Notons, par ailleurs, que l’Autre est présent au monde face au Moi. Il est, en même temps, séparé par un espace irréductible, dans la mesure où il est abordé dans une dimension de hauteur. Car, en lui, la transcendance vient à se lire par son visage. Dès lors, l’Autre demeure irréductible dans l’espace auquel on tenterait de le réduire. S’il est transcendant comme le sont « les Idées de Platon […] qui ne sont pas dans un lieu » (Ibid., 28.), alors dans cette configuration, l’Autre apparaît comme celui que je ne peux réduire ou absorber. Il se présente, dans ces conditions, comme ne me laissant pas l’initiative. C’est dire qu’en présence de l’Autre, le Moi est sommé de le servir. Par voie de conséquence, l’Autre fait surgir dans le Moi une passivité fondamentale qui renvoie à une responsabilité envers l’autre. La présence de l’Autre vient, ainsi, rompre le projet de l’Être de réduire toute extériorité au Même. Il y a une possibilité pour l’Être de s’ouvrir devant l’Autre et cette ouverture à l’Autre par l’Être donne le sens véritable de l’éthique chez Levinas. Ce chemin en question se fait précisément par l’Autre. Au fond, c’est dans la rencontre avec l’Autre qu’est questionnée la radicale impéritie du sujet que Levinas décrit dans ses premiers écrits. Le disant, face au Visage de l’Autre, le sujet se retrouve dans l’incapacité de l’identifier, de le connaître, de franchir la distance qu’il a pu abolir avec les choses du monde.
Autrui échappe à la neutralité parce qu’il est autre dans un sens éthique. Il précède ou échappe à ma liberté. Fort de cela, l’Autre est concrètement entre mes mains, à mon pouvoir. Je peux l’anéantir ou l’esclavagiser si on demeure dans le domaine de l’Être ; on peut en disposer : même il s’oppose à moi éthiquement. Dès lors, ce qui empêche l’Autre d’être irréductible au Même, c’est qu’il est infini, transcendant. Ainsi, Levinas va produire une rupture et ouvrir l’Être à autre chose qui lui manquait. Autrui est donc la raison fondamentale du renversement métaphysique que Levinas opère dans son philosopher. Face à ce tiraillement éthique dû à la présence de l’Autre et que le sujet ne rencontre que de face, Levinas veut trouver une voie permettant de sortir de la domination de l’Être. Sortir de l’Être consiste à s’évader de son être-soi afin de rencontrer une extériorité autre que soi. L’élan de Levinas, qui est un mouvement pour l’Autre, est de montrer que la philosophie n’est pas condamnée à un éternel dilemme entre liberté qui fait “violence“ à l’Autre, et l’Autre qui fait violence à la liberté du Même. Or, pour Levinas, une telle optique reprend, malgré tout, le projet de la philosophie comme science de l’Être, comme ontologie, ontologie à laquelle Levinas veut échapper. Tout l’effort de Levinas sera ainsi de tirer la phénoménologie vers l’éthique, avec en point de mire, un dépassement de Heidegger.
Laissant de côté le nécessaire questionnement des conséquences et des enjeux de cette critique adressée à Heidegger ; on pourrait trouver une proximité certaine entre Levinas et Heidegger. Quelle que soit la torsion ou la déformation à laquelle Levinas soumet la pensée de Heidegger, lorsqu’il emploie explicitement le mot être, il n’en reste pas moins que l’Être et le Visage présentent une certaine similitude phénoménologiquement. En ce sens, on pourrait dire que l’opposition qui existe entre Heidegger et Levinas n’est qu’une opposition apparente. Derrière cette apparente opposition, on pourrait déceler un fond commun phénoménologique entre ces deux auteurs. Que peut bien être ces points de convergences ? Dans toute opposition, n’y a-t-il pas un point de rencontre ?
2. ÊTRE HEIDEGGÉRIEN ET VISAGE LEVINASSIEN : UN FOND COMMUN PHÉNOMÉNOLOGIQUE
Être et Visage relèvent du même fond phénoménologique. La phénoménologie, en tant qu’elle laisse les choses nous imprégner, est la source dans laquelle Heidegger et Levinas ont puisé les concepts fondamentaux de leurs pensées respectives. En effet, tous les Concepts qui entrent ordinairement dans le langage philosophique, sont loin d’être des inventions creuses. Avec les linguistes, il est primordialement reconnu que le signifiant (en l’occurrence le mot) renvoie à un signifié (l’idée qu’on se fait du mot en question), en sorte que tout mot traduit, dans le vécu, se rapporte soit à une réalité soit à une attitude précise. C’est, sans nul doute, dans cette optique qu’il nous faut saisir cette définition de la phénoménologie : « Le terme phénoménologie exprime une maxime qu’on peut ainsi formuler : droit aux choses mêmes » (M. Heidegger, 1986, p. 54). Ainsi, la phénoménologie nous conduit droit aux choses, sans détour. Elle laisse les choses elles-mêmes nous imprégner, en étant à l’écoute de leur mouvement. De cette manière, notre jugement est mis entre épochè pour permettre aux choses elles-mêmes de nous dire ce qu’elles sont originellement.
Aller droit aux choses est, pour ainsi dire, laisser les choses se révéler à nous. En ce sens, la phénoménologie vise à expliciter la manière dont une chose apparaît pour un humain. Si les choses-mêmes ne se révèlent pas à nous, comment serions-nous disposés à les connaître véritablement, étant donné que notre perception subjective tente toujours de prévaloir sur l’analyse objective des choses ? Pour Heidegger, les choses elles- mêmes doivent pouvoir nous révéler leur être. À ce propos, Hervé Pasqua note ce qui suit : « La méthode phénoménologique consiste à faire voir ce que le phénomène est en soi-même dans son être. Le mot lui-même, d’origine, est expressif à cet égard : il signifie ce qui se montre à la lumière du jour » (Pasqua, 1993, p. 8). Faire voir ce que le phénomène est en son être, c’est le saisir dans sa vérité. Dans cette optique, le penseur doit être attentif et ouvert aux choses pour pouvoir les décrire telles qu’elles se manifestent.
Ainsi, Heidegger va nous conduire, à travers la phénoménologie, à entendre le dévoilement de l’Être comme ce qui se montre, ce qui se tient en retrait, ce qui est occulté. Cela voudrait dire, que l’Être s’oublie toujours, non pas que nous l’ayons perdu en un quelconque tiroir et qu’il s’agisse de le retrouver mais bien parce que l’Être, de par son essence même, s’oublie, se retire à toute prise. En ce sens, le retrait fait partie de la caractéristique de l’Être. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce que semble dire Bernard Mabille (2004, p.104) en ces termes : « L’Être n’est pas un étant qui, après avoir été présent, se retire ou s’absente ; l’Être n’est pas une chose que n’importe qui puisse nous l’enlever et faire disparaître, au contraire, le retrait est la façon dont l’Être déploie son essence ». Autrement, le retrait est la manière dont l’Être se dispense. Il fait partie de la caractéristique de l’Être. Comme tel, on pourrait même dire qu’on ne saurait parler de l’Être sans envisager [le] retrait.
Dans cette configuration, on peut faire une analogie entre l’Être du philosophe de la forêt noire et le Visage lévinassien. Le visage, attestant l’humanité de l’homme, se présente comme infiniment autre, comme une « présence vivante qui défait à tout instant la forme qu’il offre », indique Bernayoro (2016, p. 220). Comme tel, le visage donne de la présence. On pourrait même dire que le visage suppose l’apparition d’une personne avec son individualité. Le visage renvoie à la présence vivante d’une altérité devant un sujet. De cette façon, le visage va au-delà de toute perception sensible. Il constitue la fragilité. En un mot, c’est l’humain en l’homme, car il échappe à toute idée de représentation. Il n’est pas saisissable. Il est encore l’irreprésentable concret. En effet, pour caractériser l’apparition du Visage, Levinas utilise la méthode phénoménologique comme Heidegger l’a fait pour l’Être. Lorsque certains commentateurs ont voulu réduire sa philosophie sous l’autorité de la Bible, Levinas n’a pas manqué véritablement de leur dire qu’il est un philosophe qui utilise la phénoménologie pour mettre en lumière sa pensée. Face à ce sarcasme, E. Levinas (1986, pp. 78-79) rétorque : « Non, ce n’est pas sous l’autorité de la Bible que ma pensée se met, mais sous l’autorité de la phénoménologie ».
Cela revient à dire que Levinas s’approprie la phénoménologie pour enraciner sa conception du Visage qu’il appréhende comme quelque chose de phénoménal. En revanche, Levinas ne se limite pas à la phénoménalité du Visage ; il va jusqu’à en montrer le caractère d’insaisissabilité. En ce sens, le Visage qu’il décrit est un Visage méta-physique qui refuse d’être thématisé, totalisé et englobé. De cette façon, le Visage se donne comme quelque chose d’ambigüe voire de mystérieux. Définissant le Visage, Levinas le qualifie comme un être qui se place au-delà de tout attribut. C’est la présence de cet être qu’il appelle Visage. De cette assertion, il ressort que « le Visage, c’est l’identité même d’un être. Il s’y manifeste à partir de lui-même sans concept » (E. Levinas, 1991, p.43). Le Visage apparaît ainsi comme une ressemblance à l’Être du fait de leur caractère insaisissable, car les deux concepts échappent à toute idée de saisie ; d’où leur manifestation énigmatique, voire mystérieuse. Dès lors, on pourrait dire que le Visage présente les mêmes caractéristiques que l’Être heideggérien, car l’Être, qui a le retrait comme caractéristique, demeure insaisissable tout comme le Visage qui se manifeste en dehors de tout cadre conceptuel donc compréhensible. En fait, le Visage, dans la pensée de Levinas, n’est précisément pas phénoménal. Il est non-phénoménal, c’est-à-dire que le Visage se présente comme un visage qui manquera, qui appellera toujours, qui donnera toujours lieu à des interprétations de toutes sortes ; mais qui ne s’y réduit pas.
Aussi convient-il de le relever, la parole, qui se lit dans le Visage, que Levinas nomme le Dit et le Dire s’attache à une explication plus précise de la non-phénoménalité du Visage. Cette façon de dire ‘’ Dire et Dit’’ et de les lier, c’est à cela que l’explicitation phénoménologique du Visage s’attachera. Expliciter, -c’est sans cesse soulever un pli, pli se refermant aussitôt, éclairant une figure et son fond d’opacité- pli au sein duquel se marque bien plutôt une déclivité, en vertu de laquelle l’Être se donne comme ce qui se retire et se soustrait. Il pro-duit ou laisse être l’étant et, par ce retrait même, s’offre à l’oubli. En effet, cette manifestation de l’être s’apparente à la manifestation du visage. C’est pourquoi Levinas pense que c’est à partir de la phénoménologie que le Visage se montre et témoigne de la présence – absence d’un être. À l’analyse, tout revient à dire, ici précisément, que « sens au-delà de ce que l’homme peut être et se montrer, le visage est signifiance de l’au-delà ; celui-ci ne se laisse ni indiquer ni symboliser sans retomber dans l’immanence du savoir » (E. Levinas, 1987, pp.129-130). En un mot, le Visage déborde tout savoir car le Visage échappe à tout objet de connaissance dans lequel l’on pourrait l’enfermer. Ainsi, le Visage se donne à saisir comme révélation d’un individu. Comme telle, comment ne pas le comparer au dévoilement de l’Être- puisque l’Être, lui aussi, pour être compris, demande un demeurer dans son ouvert ?
Du reste, avec Heidegger, comme le dit E. Blanquet, (2012, p. 97), « toute compréhension est d’abord une façon d’être intoné, d’être disposé, et ne se réduit pas à l’activité intellectuelle ». Cela signifie qu’avec toute disposition, il m’est donné une certaine entente de la situation dans laquelle je me trouve, une façon de la comprendre et de m’y comprendre. C’est pour cela que nous devons recourir à une phénoménologie du dévoilement pour comprendre l’Être. Il s’agit de nous laisser sentir l’absence totale de fondement de l’existence. En fait, ce qui nous fonde n’est pas identifiable, car il est toujours à-venir ou pro-venant selon le langage heideggérien. Cela veut dire que nous ne pouvons plus penser selon l’idée que le passé est notre fondement.
Aussi faut-il le relever, l’une des caractéristiques fondamentales de l’Être demeure le dévoilement. Ainsi, avec le dévoilement, qui est indispensable dans la monstration de l’Être, Heidegger retrouve le sens grec de la vérité : alèthéia qui se donne à entendre comme quelque chose de voilé. Pour pouvoir saisir la chose, il faut lui ôter le voile. C’est dans ce sens que Heidegger utilise le dévoilement pour montrer l’apparoir de l’Être. Pour lui, cette manière particulière à l’Être de se dévoiler consiste à faire de la phénoménologie, qu’il a en partage avec Levinas. Car, pour Levinas, le Visage, procédant par la révélation, en appelle phénoménologiquement à la présence d’une personne.
Nous interrogeons l’œuvre de Levinas sans, du tout, vouloir la subordonner à celle de Heidegger, mais simplement en disant : est-ce qu’il n’y a pas dans les deux œuvres quelque chose qui relève de la même interrogation ou du même souci ? Mieux, est-ce qu’il n’y a pas la même chose dans les deux œuvres ? Certes, cela est appelé tout à fait différemment ici et là, et ce n’est pas la même chose de le nommer – Être, ou de le nommer -Visage. De cette différence les implications sont considérables. Mais en tout état de cause, ce qu’il y a de commun, nous semble-t-il, c’est qu’une phénoménologie se fait montre, chez les deux penseurs, et ressentie comme ne pouvant accéder à « l’hétéronomie (ontologie ou éthique), parce que ni l’Être ni le Visage ne peuvent être constitués » (E. Levinas, 1986, p.88). En clair, c’est vrai que Heidegger et Levinas utilisent la méthode phénoménologique pour caractériser respectivement l’Être et le Visage, mais la profondeur inouïe de ces concepts est telle que la phénoménologie ne les couvre pas totalement. Parvenu à ce stade de notre réflexion, nous pouvons dire que Heidegger, lui-même, a toujours revendiqué de se trouver encore dans la phénoménologie, au même titre que Levinas qui revendique aussi d’être toujours dans la phénoménologie ; ni l’un ni l’autre n’ont jamais quitté le sol phénoménologique.
Somme toute, la saisie de ce fond commun phénoménologique nous laisse appréhender une proximité certaine entre Levinas et Heidegger. Si phénoménologiquement Être et Visage convergent, comment, en effet, à partir de cette convergence ne pourrait-on pas donner une orientation éthique à la pensée de Heidegger ?
3. L’APPEL DE L’ÊTRE COMME APPEL DE L’AUTRE : DU SENS ÉTHIQUE DU PHILOSOPHER HEIDEGGÉRIEN
A priori, un tel intitulé peut paraître absurde ; car, bon nombre de détracteurs de la philosophie heideggérienne estiment que sur la question de l’éthique, la philosophie de Heidegger reste silencieuse. Alors, il s’agira, à ce niveau de notre cheminement de démontrer en quoi l’appel de l’Être peut s’entendre comme un appel de l’Autre ! Le dire, c’est montrer que, chez Heidegger, la rencontre éthique est possible même si ses détracteurs estiment qu’il n’y a pas de pensée en direction de l’Autre dans sa philosophie. À ce niveau, comment ne pas faire appel à Levinas qui disait : « Il y a peut être un appel de [l’autre], chez Heidegger, [même si] l’appel de l’Être [ne le mentionne pas ouvertement]- et que cet appel peut prendre la forme de responsabilité à l’égard d’autrui » (E. Levinas, 1986, p.78).
Par ailleurs, pour comprendre la rencontre de l’Autre dans le philosopher Heideggérien, référons-nous au Dasein qui est un-être-au-monde dont Heidegger nous donne une profondeur inouïe. En effet, le Dasein habite le monde, il est toujours en relation. De ce fait, habiter un monde, cela signifie être en contact, pouvoir rencontrer. Deux crayons ne se rencontrent pas, seul le Dasein rencontre ou entre en contact avec les autres étants humains. Qui plus est, le Dasein témoigne d’une manière de se tenir proche des autres humains. C’est pour cette raison que B. Mabille (2004, p. 102) énonce ceci : « Le Dasein destinal comme être-au-monde existe essentiellement dans l’être-avec en compagnie d’autrui, son advenir historial est un co-adevenir historial, il est déterminé comme co-destin, terme par lequel nous désignons l’advenir historial de la communauté, du peuple ». Par-là, nous comprenons que le monde se révèle pour le Dasein comme un réseau de relations familier. Du coup, le dévoilement de l’Être se donne à entendre comme la rencontre de l’Autre. Ainsi, le Dasein est au monde sur le mode de la proximité familière ; il se découvre toujours dans une proximité familière avec les autres.
Cela revient à dire que le Dasein, dans son existence quotidienne, est aussi en relation avec d’autres Daseins qui, comme lui, existent. À ce niveau, comment ne pas faire mien l’exemple d’Édith Blanquet (2012, p. 86) qui stipule que « lorsque j’utilise un ordinateur, il a été fabriqué par un autre Dasein [ ?] Autrui m’est présent même s’il n’est par là corporellement ». De cette façon, le monde est toujours déjà et avant tout un monde compris comme être-ensemble, un monde où nous séjournons avec les autres. Par voie de conséquence, dans le monde, le Dasein n’est pas seul ; il partage le monde avec d’autres Daseins qui ont la même manière d’être dans le monde que lui. On pourrait même affirmer que dans le monde, le Dasein rencontre ses semblables voire ses prochains. Être dans le monde avec ses semblables est une manière d’être du Dasein. Dans cette perspective, l’être-avec est un caractère fondamental du Dasein.
En clair, autrui se trouve déjà enveloppé, d’une certaine façon, dans le monde, dans la mesure où le monde ne peut être conçu sans la présence d’un autre dasein. Du coup, Autrui n’a pas son monde à part. Nous partageons le monde dans lequel nous sommes avec lui. Mais, en tant que nous sommes au monde avec lui, on pourrait dire que l’existence véritable, c’est naviguer vers les autres. En ce sens, M. Heidegger (1986, p. 160) affirme que
sur la base de cet être-au-monde affecté d’un « avec », le monde est chaque fois toujours déjà celui qui se partage avec les autres. Le monde du Dasein est un monde commun [Mitwelt]. L’être-au- monde est un être-avec [Mitsein] en commun avec d’autres. L’être en soi de ceci à l’intérieur du monde est coexistence [Mitdasein].
En d’autres termes, Heidegger souligne ici que les autres Daseins que je découvre ne sont pas des Daseins qui sont en dehors de moi. Mon moi ne se détache pas des autres Daseins. Il y a donc une égalité d’être entre les Daseins. Cela fait que le monde où nous sommes est un monde de communauté où la présence de l’autre participe à ma pleine réalisation. C’est seulement pour autant que « l’homme eksistant dans la vérité appartient à l’Être que l’Être lui-même peut venir à l’assignation de ces consignes qui doivent devenir pour l’homme normes et lois » (M. Heidegger, 1983, p. 148). En réalité, toute loi vient de l’Être. Dans cette perspective, il enjoint à l’homme de communier avec les autres. Cette éthique peut sembler absurde pour la pensée contemporaine qui conçoit l’éthique comme une dissertation de principes et de règles qui régit le vivre-ensemble entre les hommes. Mais, sur le plan de la pensée de l’Être, en tant que pensée fondamentale, cette éthique a du sens parce qu’elle est supérieure à toute praxis. Cette supériorité ne se traduit pas par la grandeur de ce qu’elle réalise, mais, par l’insignifiance de son accomplir qui libère l’homme pour son essence ek-statique.
Ce monde de communauté suppose que nous avons conscience que nous existons de la même manière que les autres. Ainsi, dans l’ontologie fondamentale, la pensée de l’altérité a toujours été présente. Notre être-avec fait que nous nous soucions de l’autre en tant qu’il a les mêmes manières d’être et droits que nous. De ce fait, la considération de l’autre constitue une caractéristique fondamentale du philosopher heideggérien. Du reste, le Mitsein implique un vivre-ensemble paisible et harmonieux avec les autres Daseins. Autrement dit, l’être-avec est une disposition qu’a le Dasein et, il lui permet de vivre authentiquement avec les autres. Dès lors, les Daseins se rencontrent parce qu’ils ont cette capacité ou cette disposition qui favorise la rencontre. À vrai dire, on pourrait mentionner qu’il est impossible de vivre sans les autres Daseins avec qui nous sommes toujours en relation dans un espace commun qu’est le monde.
Un autre mot que Heidegger emploie pour caractériser l’être-avec est le Mitdasein. On a vu que le Mitsein désigne mon être avec autrui. Autrui, de son côté, est là avec moi, il coexiste avec moi. Le Mitdasein que Heidegger, lui-même, traduit par co-existence, décrit que je suis un être-avec, j’appréhende toujours autrui en tant qu’il coexiste avec moi. Le Mitdasein se réfère aux autres qui sont avec moi. Je peux les découvrir comme un existant parce que je suis moi-même être-avec ; je suis ouvert aux autres dans la mesure où je partage avec eux mon ouverture.
Au regard de ce qui précède, retenons que l’appel de l’Être se donne à saisir qu’il existe une rencontre de l’altérité qui renvoie, apparemment, à la relation à l’autre dans le penser de Levinas. En effet, pour lui, devant le Visage de l’autre, le moi est interpellé pour lui enjoindre une responsabilité. C’est pourquoi, toute rencontre a un côté éthique (mon agir est-il droit ?). C’est pour cette raison que l’éthique, chez Levinas, n’est pas une série de grands principes. C’est une attention portée aux détails de nos relations avec l’Autre, jusque dans un fait aussi banal que la conversation. En effet, « le fait banal de la conversation quitte l’ordre de la violence. Ce fait banal est la merveille des merveilles », (E. Levinas, 2003, p. 22). En clair, dans la conversation avec l’autre, une relation véritable s’instaure. De ce fait, la rencontre devient basique à toute relation.
Dans la rencontre de l’Autre en situation de face à face, je dois lui être attentif dans la force de sa différence, et en même temps dans sa dimension de représentation à lui seul de toute l’humanité dans son universalité, car « devant les yeux d’autrui, c’est toute l’humanité entière qui me regarde » (E. Levinas, 2009, p. 234). En fait, Levinas appelle « totalité », la totalité des hommes dont je reconnais le visage. C’est pourquoi, « un être particulier ne peut se prendre pour une totalité que s’il ne manque de pensée » (E. Levinas, 1991, p. 25). En ce sens, nous ne sommes jamais qu’un morceau de la totalité humaine, et pourtant chacun de nous résume en quelque sorte à lui seul toute l’humanité. Cela implique, dans la rencontre, non seulement une modestie et une écoute attentive, mais aussi un respect pour l’humanité de l’autre, un respect de moi-même comme responsable du visage de cette même humanité que je porte en moi. Toute rencontre, dans cette perspective, est une manière de faire vivre l’humanité universelle. Pour comprendre le sens de l’altérité, il résulte que le Dasein doit avoir une compréhension de l’Être. Comme tel, l’éclaircie de l’Être permet de comprendre le sens de la rencontre de l’autre.
Conclusion
Au moment où semble s’achever cette réflexion, retenons que Levinas a toujours gardé ses distances envers Heidegger ; car, il qualifie la philosophie de celui-ci comme science de l’Être, comme ontologie, dont il faut s’évader. Pour lui, le penseur de l’ontologie fondamentale enferme l’Autre dans les rets de l’Être. C’est justement par rapport à cette conception de l’altérité que Levinas prend ses distances avec – son maître. Laissant de côté le nécessaire questionnement des conséquences et des enjeux de cette étude analogique entre Être et Visage, nous estimons que Levinas peut être considéré comme un deuxième Heidegger. Dans cette optique, Être et Visage présentent une certaine similitude phénoménologiquement. –Si phénoménologiquement Être et Visage convergent, comment, en effet, à partir de cette convergence ne pourrait-on pas donner une orientation fondamentale sur leur conception de l’altérité ? L’appel de l’Être donne à saisir qu’il existe une éthique de la rencontre chez Heidegger, rencontre qui renvoie, apparemment, à la relation à l’autre dans le penser de Levinas. Même si la conception heideggérienne se déploie autrement, puisque pour comprendre le sens de l’altérité, il faille que le Dasein demeure dans l’enceinte de l’Être, mais n’empêche qu’on puisse déceler le rapport à l’Autre dans son penser philosophique, en dépit des critiques qu’on lui a adressées. Comme tel, l’Être devient le secret du Dasein. Pour le dire autrement, l’éclaircie de l’Être permet de comprendre le sens de la rencontre de l’autre. Tout l’effort de Levinas sera de tirer la phénoménologie vers l’éthique. Pour lui, le sens de l’existence n’est pas de s’efforcer à être le Même, c’est-à-dire à jouir et à identifier toute chose à soi. Car, la vie de l’homme est d’abord éthique et souci de l’Autre avant d’être la vie de l’Être. Il va sans dire que toute l’entreprise de la pensée levinassienne a consisté à élaborer une éthique, si bien que la philosophie se doit de demeurer éthique. Comme tel, son ouvrage l’éthique comme philosophie première illustre en son fond cette volonté manifeste d’incruster l’éthique comme fondamentale dans la pensée. Dès lors, dans le Visage de l’autre « scintille toute l’humanité entière » (E. Levinas, 2009, p. 234).
Références bibliographiques
BLANQUET Édith, 2012, Apprendre à philosopher avec Heidegger, Paris, Ellipses, 254 p.
BERNAROYO Lazare, (2016), « le visage au-delà de l’apparence Levinas et l’autre rive de l’éthique » in lo Sguardo- Rivista Di Filosophia, no, 20.
FÈVRE Louis, 2006, Penser avec Levinas, Paris, Chronique Sociale, 254 p.
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et Temps, trad. François Vezin, Paris, Jean Vrin, 3840 p.
HEIDEGGER Martin, 1983, Lettre sur l’humanisme, Trad. Roger Munier, Paris, Aubier-Montaigne, 156 p.
LEVINAS Emmanuel, 1986a, Autrement que savoir, Paris, Osiris, 96 p.
LEVINAS Emmanuel, 1986b, Éthique et Infini, Paris, Livre de Poche, 120 p.
LEVINAS Emmanuel, 1987, Hors Sujet, Paris, L.G.F., 224 p.
LEVINAS Emmanuel, 1991, Entre Nous, Essais sur le penser-à-l’Autre, Paris, Grasset, 233 p.
LEVINAS Emmanuel, 2001, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Jean Vrin, 333 p.
LEVINAS Emmanuel, 2006b, Totalité et Infini, Paris, L.G.F., 352 p.
MABILLE Bernard, 2004, Hegel, Heidegger et la Métaphysique, Paris, Jean Vrin, 400 p.
PASQUA Hervé, 1993, Introduction à la lecture d’Être et Temps, Lausanne, L’Âge d’Homme, 184 p.
ZIELINSKI Agata, 2004, Levinas, La responsabilité est sans pourquoi, Paris, PUL, 154 p.
L’HUMANISME PLATONICIEN : UNE SOLUTION À LA CRISE MIGRATOIRE
Ange Allassane KONÉ
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire)
angekone44@gmail.com
Résumé : Les catastrophes naturelles et les conflits socio-politiques, facteurs d’insécurité et de pauvreté, posent à l’humanité une équation à résoudre : la crise migratoire. Apprécié d’un regard platonicien, ce phénomène trouverait son origine dans la mauvaise volonté des pouvoirs politiques, mais plus précisément dans une crise ontothéologique de la personne humaine. Ainsi, pour échapper à une crise existentielle humaine, l’approche d’une réflexion sérieuse, espérant solutionner ce problème, oblige non seulement à porter un examen critique sur nos relations intersubjectives mais aussi à former un citoyen qui développerait une vision sociale plus morale que matérialiste. À partir donc du modèle d’éducation platonicien, on pourrait espérer une humanité plus humaniste, et un humain qui percevrait en le migrant une image de lui-même, dont les attributs différenciés doivent être minimisés.
Mots-clés : ÉDUCATION, HUMANISME, MIGRANT, ONTOLOGIE, PLATON, THEOLOGIE.
Abstract : Natural disasters and socio-political conflicts, factors of insecurity and poverty, pose an equation for humanity to solve: the migration crisis. Appreciated by a Platonic view, this phenomenon originated in the bad will of the political powers, but more precisely in an ontotheological crisis of the human person. Thus, to escape an existential human crisis, the approach of a serious reflection, hoping to solve this problem, obliges us not only to examine critically our intersubjective relations but also to train a citizen who would develop a more moral social vision than materialist. Starting from the Platonic model of education, one could hope for a humanity that is more humanistic, and a human who perceives in the migrant an image of himself, whose differentiated attributes must be minimized.
Keywords: EDUCATION, HUMANISM, MIGRANT, ONTOLOGY, PLATO, THEOLOGY.
Introduction
Réfléchir sur un sujet varié, complexe et surtout aussi important pour le monde contemporain que celui de l’humanité face à la crise migratoire pourrait paraître une gageure. Exercice difficile vue l’extrême diversité des migrants. Cependant, si l’on analyse le sujet d’un point de vu platonicien, on comprendrait la nullité de cette diversité ; on verrait ces différents migrants sous la présentation d’une Idée, d’un “être” commun. Mais peut-on vraiment exhumer Platon et le faire parler dans une affaire de migration contemporaine ? L’idéalisme ou l’éthique platonicienne laisse-t-elle entrevoir des traces d’un éventuel humanisme ?
Roger-Pol Droit, dans son ouvrage, Et si Platon revenait, écrit : « Il existe, (…), quantité de questions (…) que Platon pourrait nous aider à déplacer, ou à transformer, pour peu que nous sachions l’écouter et l’interroger (…) Exemples : ‘’Qu’est-ce que l’humain ?’’(…)’’À quelle condition une société est-elle juste ?’’ » (2018, p. 14). Autrement dit, malgré toutes les critiques dont il fait l’objet, l’idéalisme platonicien, non moins anthropologique, car soucieux d’une existence heureuse, est doublé d’un réalisme qui autorise à parler d’un humanisme capable de résoudre la crise migratoire.
Alors nous pensons que pour espérer une appréhension objective de cette crise universelle, il ne serait pas non moins justifié de considérer l’homme dans sa nature métaphysique ; c’est-à-dire de proposer un humanisme dans l’objectif d’éclairer la vue de chacun sur la perception qu’il doit avoir de l’être du migrant. Ainsi, partant d’un double examen critico-analytique, nous nous évertuerons à démontrer l’importance et l’actualité de l’humanisme platonicien face au problème migratoire que traverse le monde contemporain. Mais avant, quelle serait l’origine de cette crise migratoire, selon une analyse platonicienne ? Et en quoi l’humanisme platonicien pourrait-il nous aider à la résoudre ?
Dans l’objectif de corroborer notre pensée, nous commencerons par examiner cette crise humanitaire sous le regard d’une double crise : métaphysique et religieuse. Ensuite, pour y remédier, nous tenterons de justifier l’éducation platonicienne pour une humanité plus humaniste, afin d’aboutir à un regard nouveau, à une identification nouvelle du migrant.
1. LA CRISE MIGRATOIRE : UNE CRISE ONTO-THÉOLOGIQUE DE L’HUMANITÉ
Le phénomène de la migration, dans nos sociétés actuelles, pose un problème existentiel profond ; ce problème laisse entrevoir une dénaturalisation de la personne humaine, qui inquiète. On perçoit, en effet, une crise humaniste où les intérêts économiques et matérialistes ont éloigné l’humain de son humanité. Mais intrinsèquement, on découvre que les raisons de cette crise sont plus profondes et plus spécifiques. Appréciant ce problème d’un regard platonicien, on voit, en effet, que cette crise repose sur une double origine: ontologique et théologique. Ontologique parce qu’elle renferme une crise de l’Être, une perte de vue de l’essentiel existentiel – et théologique, à cause de la proportion grandissante du fanatisme religieux et de l’impact du spirituel sur la conduite de nos sociétés contemporaines.
1.1. Le fondement ontologique du phénomène migratoire
Selon Jean-François Mattei (2009, p. 128), il incombe au préalable de distinguer les termes “immigré ” et “migrant ” que l’on utilise souvent l’un pour l’autre : « Un immigré est une personne qui s’est installée dans un pays autre que le sien. (Alors que) un migrant est une personne qui a quitté son pays d’origine en quête d’un ailleurs qu’il n’a pas encore trouvé ». Si dans le langage platonicien, le mot “migrant” est quasi inexistant, le rapprocher du terme de l’étranger ou de l’Autre serait plus ou moins concevable. Alors spéculer sur la question du migrant pourrait nous conduire à nous interroger sur la valeur contemporaine de nos semblables qui, affichés ici sous l’image de migrant, ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur dans nos réalités intersubjectives.
De fait, le fondement ontologique de ce fléau dévoile ici une mauvaise appréhension de l’Autre. Le monde contemporain, héritier de la postmodernité, s’est fait une image étrange de l’Être en général et de l’humain en particulier. Le progrès scientifique, phénomène mirifique, a perverti l’entendement humain. Au détriment de sa nature pensante, l’homme est désormais réduit à l’état de simple objet existant. La définition universelle de l’animal politique d’Aristote fait fâcheusement place à un animal biologique qui n’hésite pas à rappeler son essence instinctive égoïste pour la satisfaction de son ego. Les désirs de l’âme, garant du bon sens, sont le plus souvent relégués à un second plan. L’on oublie que « aussi bien en l’homme que dans la totalité du monde, c’est l’âme qui rend raison de tout mouvement, qu’il soit matériel (croissance, locomotion, etc.) ou immatériel (sentiment, perception sensible, connaissance intellectuelle, etc.) », selon Luc Brisson, dans l’introduction des Lois de Platon. (2011, p. 681). Tristement, l’être humain est séparé de sa ressemblance divine et de sa nature métaphysique pour devenir une simple marchandise.
Dans ce contexte de crise ontologique, l’identité du migrant devient problématique. Ce dernier perd sa nature d’être universel et n’est plus reconnu comme le semblable à travers qui je perçois mon identité. Mais au contraire, sa présence déclenche en moi une alarme émotionnelle, à l’image d’une bête dont le territoire est visité par un animal étranger. Alors dans ces conditions, comment prendre le risque de recevoir chez soi l’humain qu’on ne connait pas et qu’on n’a pas appris à connaître, ou qu’on a découvert à travers le miroir du politique et des médias qui présentent l’étranger au gré de leurs intérêts ?
La crise de l’acceptabilité de l’Autre est donc due à une mauvaise appréhension que chacun se fait de son prochain, que Platon nomme “l’ignorance”. Or « l’ignorance n’est autre chose que l’aberration de l’âme quand elle s’élance vers la vérité et que l’intelligence passe à côté du but » (Platon 1, 2011, 228b-228d). Cette pensée révèle que le mauvais jugement découle d’une mauvaise appréciation de l’âme, parce que celle-ci a la vue trouble et distingue difficilement le bien du mal, la justice de l’injustice. C’est donc par ignorance que l’on fait montre d’un mauvais raisonnement, d’une mauvaise idée vis-à-vis de l’être du migrant.
L’on pourrait aller encore plus loin avec Platon pour fonder cette crise ontologique sur l’ignorance de soi. Selon lui, « c’est cette ignorance (qui s’ignore) qui est la cause de ce qui est mal, c’est elle qui est répréhensible (…). Et c’est lorsque les sujets sont les plus importants qu’elle est la plus malfaisante et la plus honteuse » (Platon 2, 2011, p. 118a).
C’est par ignorance que l’humanité s’est éloignée d’une vision métaphysicienne de l’homme ; c’est d’ailleurs ce qui a conduit à une mauvaise interprétation de l’éclatement de l’Être. Cet éclatement qui devait être perçu comme un dévoilement pluriel de l’humain, a plutôt engendré une diversification, une différenciation humaine, oubliant que les hommes se distinguent de par leurs identités nationales mais restent semblables de par leur être. En d’autres mots, la diversification raciale doit être comprise comme une richesse qui doit permettre de se découvrir à travers la rencontre du migrant, qui diffère seulement de moi de par son origine sociale et non naturellement.
Malheureusement les idéologies scientistes ont fait de nous (migrants et non-migrants) des êtres-machines, sans état d’âmes, au comble de l’individualisme et du chauvinisme. Désormais l’amour de l’étranger se calcule à la mesure de l’intérêt national tout simplement parce que les pensées individuelles sont sous le guide d’une lanterne perfide (techno-scientiste) qui a su imposer une définition illusionniste de l’être. Le résultat est le suivant : le sens universel de l’humanisme se perd dans le protectionnisme égoïste de nos institutions.
Or si l’homme se distingue de par sa rationalité, parce que possédant une âme, alors un individu est humain dans la mesure où il est raisonnable, mais aussi parce qu’il privilégie la nature spirituelle de la personne humaine. Ainsi, on conviendrait qu’un individu est humain dans la mesure où il ressemble ou participe à l’humanité comme Idée. Incontestablement, la migration se pose aujourd’hui comme un dilemme à cause de la mauvaise idée qu’on se fait de l’Autre mais aussi de soi-même. Le migrant comme la personne sensée recevoir ce dernier se font réciproquement souvent de fausses idées. Pourtant, c’est partant d’une idée juste qu’on peut prétendre à la connaissance et à l’acceptation de celui qui vient d’ailleurs. C’est par l’intelligible qu’on comprend que cet ailleurs est juste phénoménal et non nouménal. Et cette réalité intelligible, couronnée par l’Idée de bien platonicienne, manque à la vision de l’intellection contemporaine.
Dans la quête d’un raisonnement objectif, il est nécessaire que l’on « pose d’abord comme hypothèse qu’il existe en soi un Beau, un Bon, un Grand » ou un Juste (Platon 3, 2011, p. 100b 5-7) ; car la cause de la présence d’un acte juste, d’une loi ou d’une convention juste, est l’existence d’une justice en soi qui n’est pas totalement ignorée des hommes sinon ils ne sauraient donner le moindre sens aux mots ‘’juste’’ et ’’injuste’’ et ne seraient pas capables de la moindre justice. Alors, dans le but d’avoir une vision juste, objective ou humaniste du migrant, il importe de le considérer sous sa nature ‘’d’être’’ humain, nature que nous avons tous en commun. C’est par l’acceptation de cette ontologie partagée que l’on pourra rejeter le mythe de la différenciation des races. Mais au-delà de cette crise ontologique, nous constatons une encore plus manifeste : la crise théologique ou religieuse.
1.2. Les raisons religieuses du problème de la migration
Le monde contemporain se trouve traversé par des conflits inter-religieux qui partagent une part de responsabilité non négligeable dans la crise migratoire. Comme à l’ère médiévale, on découvre à nouveau des fanatiques qui tentent d’imposer leur foi religieuse. Ce fanatisme multiple et divergent pose le problème de la définition que chacun se fait de la notion de dieu. La diversité religieuse a conduit à une appréhension plurielle de l’être divin. Et étonnamment, l’idée de dieu qui se perçoit chez le croyant est plus dogmatique que rationnelle. Sentiment logique qu’on ne devrait pas reprocher à un dévot, mais qu’on pourrait quand même décrier si on s’entend à reconnaître l’homme, avant tout, comme un être doué de raison. C’est d’ailleurs cette rationalité, éclaireuse de la foi, qu’a revendiquée Platon pour la société grecque. Aussi, est-ce cette rationalité, nécessaire à la bonne pratique religieuse, qui manque aux croyants contemporains.
Dans la pensée religieuse de Platon notamment dans l’Euthyphron (7d-8e), la foi ou la piété était comptée parmi les vertus essentielles et rapprochée de la justice. Mais si la justice règle les rapports des hommes entre eux, la piété, elle, règle le rapport de l’homme avec les dieux. Si dans cet ouvrage cité, le maitre de l’Académie ne propose pas une doctrine claire sur la piété, il oriente néanmoins, de par ses critiques, sur ce que la piété n’est pas. Ainsi, lorsque Euthyphron, un des prêtres de la cité athénienne, affirme qu’il serait vrai de penser que « tout ce qui est pieux soit juste » (Platon 4, 2011, p. 11c), Platon lui fait remarquer, par la bouche de Socrate, que certains dogmes, façonnés dans l’ignorance et l’immoralité humaines, sont jugés pieux, sans l’être pour autant. Dans un contexte similaire, les crises religieuses dont souffrent les pays originaires des migrants, ont à leur origine des dogmes mal interprétés ou contraires à la morale souhaitée.
Les religieux d’aujourd’hui ont un problème avec la morale. La religion en elle-même n’est pas un mal social ; le problème vient plutôt de la passion de ses fidèles. C’est, en effet, de notre moi personnel que naît l’amour abusif de soi, de même que la haine ou la méfiance déraisonnée de l’Autre. Des prêtres pédophiles, des pasteurs corrompus sans oublier des imams djihadistes, justifient à quel point l’immoralité est tolérée dans l’univers religieux. À travers ces différentes conduites immorales, on s’aperçoit que la crainte de dieu n’a plus de sens. Quant à l’amour du prochain, il n’existe quasiment plus, sinon de façon intéressée. Le sens naturel de l’hospitalité a disparu de l’esprit contemporain parce que les conduites intellectuelles et sociales qui le rendaient crédible sont en déliquescence. À en croire Benjamin Boudou, « l’héritage antique et religieux de la vertu et le gain symbolique du don charitable ont peu à peu laissé la place à un souci du juste » (2017, p. 177), c’est-à-dire du légal. Ce souci du juste semble privilégier les droits individuels au détriment du souci de l’Autre.
Aussi, les conflits absurdes entre Chiites et Sunnites au Moyen-Orient tels qu’en Syrie, la persécution des minorités chrétiennes par les groupes terroristes tels que Al-Qaïda et Boko haram ou les guerres passionnelles entre chrétiens et musulmans dans certains pays africains comme le Nigeria, ont-ils une responsabilité majeure dans la vaste crise migratoire que connaît l’humanité. Pour espérer traiter cette crise, la considération et la critique des comportements religieux s’imposent. Une redéfinition de la foi religieuse, à la mesure de l’évolution sociale, s’avère nécessaire, car l’identité religieuse n’a plus de sens, tellement ambiguë.
L’orientation de la conduite religieuse de l’homme contemporain est, en effet, fortement conditionnée par le bonheur matériel, caractérisé par un égoïsme surprenant. La spiritualité ne se satisfait plus de la promesse du salut ou de la vie éternelle. La doctrine de l’amour du prochain a perdu de son authenticité ou subit une interprétation raciale ou ethnique. Étonnement, les croyants de ce siècle luttent davantage pour leurs intérêts économiques et matérialistes sans véritablement se soucier des autres. La doctrine de la charité, si chère à Saint Augustin, se trouve noyée dans un individualisme méchant. Ainsi face à la souffrance des migrants : « Leur épuisement, l’usure de leurs corps, sans doute. L’épreuve de l’exil, la détresse de l’errance », (R.-P. Droit, 2018, p. 57), certains occidentaux, au nom de la compassion religieuse, sont quelque peu émus, mais cette émotion « finit étranglée, le plus souvent, par le calcul et le réalisme » (Idem).
Malgré que l’on croie en dieu, on a du mal à partager son environnement, son pain, ses richesses ou sa joie avec celui qui vient d’ailleurs. On a limité dieu à soi, oubliant de le communiquer et de le partager aux autres, en difficulté, à travers des gestes d’hospitalité et d’humanisme. C’est cette indifférence notoire, vis-à-vis de celui qui frappe à nos portes, qui amplifie ce phénomène de crise migratoire. Mais au-delà de cette réalité, cette crise est aussi due au radicalisme religieux.
Nous pensons que si le monde refuse d’ouvrir ses portes à ceux qui poursuivent la liberté et le bonheur terrestre, c’est parce que les religions se sont confinées sur elles-mêmes, refusant de s’ouvrir à ceux qui ne partagent pas leurs idéologies. Or le religieux doit être vu comme un modèle. Comment serait-il alors possible de recevoir chez soi le migrant désespéré si les lanternes religieuses restent éteintes ou pire si elles refusent d’éclairer l’opinion commune sur l’amour du prochain. Si l’on réfute la reconnaissance de l’Autre comme le semblable à soi alors la menace des conflits, comme une épée de Damoclès sur l’unité de l’humanité, reste à craindre. Alors, dans un contexte socio-politique contemporain, où la masse populaire est facilement manipulable par des leaders vicieux, il est plus qu’urgent de purifier le monde religieux du fanatisme afin de prévenir des crises sociales, facteurs de crises migratoires.
En somme, à la fin de cette partie, une analyse sérieuse de la crise migratoire permet de comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’une crise théologique, relative à une amplification du fanatisme religieux, mais aussi d’un drame métaphysique et ontologique. Aussi, dans l’optique de restaurer l’intelligibilité et la valeur de la nature humaine, une reconnaissance ontologique du migrant, à travers une éducation sociale objective et adéquate, pour une humanité humaniste, s’avère-t-elle nécessaire.
2. L’HUMANISME PLATONICIEN : UN POSSIBLE REMÈDE À LA CRISE MIGRATOIRE
Luc Brisson (2011, p. IX), dans la partie introductive des Œuvres complètes de Platon, intitulée : Platon pour notre temps, écrit : « Après le XXe siècle, qui fut le siècle des idéologies, du prêt-à-penser, il semble que (…) nous redevenons les contemporains de Socrate qui, (…) discutait avec ceux qui l’entouraient de ce qui fait la valeur d’une vie humaine ». Et à travers les propos rapportés par Platon, on découvre que l’homme se caractérise par son être spirituel, l’âme, au détriment de son identité corporelle. C’est l’âme le critère de reconnaissance de l’être de l’homme parce qu’elle renferme notre rationalité. C’est par cette rationalité que nous faisons le choix d’une vie morale exemplaire, le choix d’une humanité humaniste, qui pourra nous permettre de solutionner la crise migratoire.
2.1. L’humanité humaniste : sens et fondement dans la pensée de Platon
Si l’humanité, dans son sens le plus originel, se présente comme un sentiment de bienveillance et de bonté envers son prochain, l’humanisme, lui, est un système de pensée centré sur l’homme, c’est-à-dire un anthropocentrisme ou le processus par lequel l’homme se place au centre de l’existence. Faire preuve d’humanité coïnciderait ainsi avec une conduite humaniste, qui oblige à voir l’étranger ou le migrant non pas comme un être étrange, mais plutôt comme une image semblable à soi, reflétée sous une forme peut-être encore ignorée.
Ainsi, relativement à l’idéalisme platonicien, l’humanité humaniste défend une vision fondamentalement altruiste. Elle prône le sens d’une humanité où se soucier de l’Autre devient un devoir moral. Ici, notre bonheur ne se limite pas à notre existence personnelle ; il est plutôt conditionné par le bonheur de celui qui est proche de nous. Contrairement à l’humanisme contemporain, fondé sur un civisme forcé ou intéressé, l’humanité humaniste, dans une conception platonicienne, est une pensée altruiste qui s’exprime naturellement en celui qui philosophe ; c’est-à-dire celui qui définit l’homme à partir de l’âme et fait du salut de l’Autre, qui souffre, notamment le migrant, sa satisfaction existentielle. Les enseignements et la vie de Socrate en sont d’ailleurs une illustration satisfaisante.
Dans l’Apologie qui lui est consacrée par Platon, Socrate rappelle aux athéniens : « Ma seule affaire est d’aller et de venir pour vous persuader, jeunes et vieux de n’avoir point pour votre corps et pour votre fortune de souci supérieur ou égal à celui que vous devez avoir concernant la façon de rendre votre âme la meilleure possible » (Platon 5, 2011, 30a). Aussi, dans cette consécration sociale ou ce service divin, « est-ce dans une extrême pauvreté que je vis » (Idem, 23b), affirme-t-il. Le devoir du missionnaire du dieu de Delphes était, en effet, le souci de l’Autre. Et ce souci visait, principalement, à débarrasser ses concitoyens de l’ignorance, plaie intellectuelle qui nous éloigne de l’humanisme naturel ; celui de vouloir le bien de tout homme sana condition. Pour cette raison, Socrate n’avait pas le temps de s’occuper de lui-même, parce que préoccupé par le soin des Autres, ou disons par la droiture de la pensée des Autres.
Si penser, ou du moins penser humainement veut dire penser de manière à préserver l’hétérogénéité de la vie humaine, alors penser signifie chercher à comprendre et à accepter la pluralité, la divergence existentielle. Ce principe se justifie, par exemple, par les voyages de Platon en Égypte et en Sicile, où sa pensée s’est enrichie par la rencontre de pensées étrangères. Alors, en tant qu’être pensant, notre existence ne peut s’accomplir séparément de l’existence universelle.
Dans cette vision des choses, penser veut donc dire que le « je » pensant fait partie d’un « nous », de sorte que détruire une partie de la pluralité de la vie humaine signifie non seulement se détruire soi-même, en tant qu’essentiellement lié à cette pluralité, mais détruire également les conditions intrinsèques de la pensée elle-même. Sans contredit, Il serait absurde de penser réaliser sa vie sans se référer à celle des autres. Le penser ou le croire serait nier les principes mêmes de sa condition d’existence ; car selon François Flahault (2005, p. 60), « la coexistence précède l’existence de soi ». Autrement dit, notre nature sociale précède notre nature humaine. Et cela Socrate l’avait bien compris. C’est pour cette raison qu’il ne distinguait pas son humanité de sa société : « Interroger, parler, montrer aux Athéniens qu’ils ne savent pas ce qu’ils croient savoir, devient pour Socrate un devoir, un devoir sacré », écrit Louis Massignon (1909, p. 60).
Cette attitude socratique révèle tout son humanisme en ce qu’elle accorde à l’homme une position privilégiée. Loin de considérer celui-ci comme un être parmi les autres, elle le place, au contraire, sur un plan radicalement différent de ceux-ci, à cause de son essence rationnelle. Et s’il est plausible de voir en Socrate un initiateur de la pensée humaniste, alors ses leçons, développées à travers la philosophie platonicienne, doivent être un modèle scolaire pour l’humanisme contemporain ; modèle scolaire que l’on trouve nettement résumé dans l’allégorie de la caverne.
À l’image du prisonnier de la caverne, revenu auprès des siens leur partager la vérité sur l’existence, chacun devra faire montre d’un raisonnement philosophique, humaniste vis-à-vis de son prochain, en souffrance. En effet, le monde d’aujourd’hui présente une image de la caverne platonicienne. La souffrance des prisonniers de cette allégorie peut être comparée à celle des migrants, marionnettes des hommes politiques. Cependant, à la différence des pays occidentaux, l’homme libéré de la caverne, lui, fait preuve d’un altruisme humaniste. « Se remémorant sa première habitation, et la sagesse de là-bas, et ceux qui y étaient alors ses compagnons de prison » (Platon 6, 2011, 516b), il songera à y retourner pour partager le bien, la vérité dont il a bénéficié. Cette démarche, a priori philosophique, laisse entrevoir une conduite vraisemblablement humaniste. Mais à côté de l’homme de la caverne, l’humanisme platonicien se révèle également à travers le mythe de Prométhée, dans Protagoras.
La lecture de ce mythe nous enseigne la nature distinguée de l’être humain. Sans être méprisant vis-à-vis des autres êtres, nous estimons que l’être de l’homme est sacré, parce que créé à l’image de dieu. Son problème, pour rappeler Blaise Pascal, c’est qu’il ressemble à un roseau, donc vulnérable. C’est face à cette vulnérabilité physique ou naturelle que Prométhée décide de le secourir. Voyant, en effet, que dans la création, toutes les facultés avaient été dépensées pour les animaux, il se soucia du sort de la race humaine. L’homme était « nu, sans chaussures, sans couvertures sans armes » (Platon 7, 2012, 321c). Alors pour lui permettre d’affronter l’existence, Prométhée « dérobe le savoir technique d’Héphaïstos et d’Athéna, ainsi que le feu » (Idem, 321d). Ce savoir, fondement de la rationalité humaine, s’est avéré indispensable à la conservation des premiers hommes.
Lorsque nous analysons la conduite de Prométhée devant l’état piteux de l’homme, on y perçoit une conduite humaniste bien que celui-ci soit un dieu. ’’L’homme nu, sans chaussures, sans couvertures sans arme’’ rappelle sensiblement la condition des migrants. Et là où Platon pense qu’il est judicieux de commettre un délit pour sauver ‘’l’humanité’’, le monde contemporain en commet pour l’étouffer. Et si sauver l’humanité, c’est rechercher le bien-être de l’âme de chacun, loin des considérations nationales et raciales, alors l’humanisme platonicien peut nous aider à résorber la crise des migrants.
2.2. L’humanisme platonicien : leçon pour une résorption de la crise migratoire
Une analyse synoptique de l’humanisme platonicien pourrait nous faire proposer deux arguments principaux pour tenter de résoudre ce phénomène migratoire. Premièrement, notre argumentaire visera à signifier la nécessité de l’éducation dans l’orientation humaniste de ceux qui sont sensés accueillir les migrants ; ensuite il s’agira de partir du sens de l’humain, selon Platon, pour aboutir à une identification objective, altruiste de l’étranger en quête d’humanité.
Joseph Ki-Zerbo, dans Éduquer ou périr, écrit : « Il n’y a pas d’autre choix que d’éduquer et de faire vite et bien. Dans des sociétés en crise où l’urgence criarde et permanente frappe tous les domaines de la vie, les choix doivent être à la fois immédiats et radicaux » (1990, p. 9). C’est par cette motivation, estime-t-il, que les politiques africains produiront un civisme générateur de bonne conduite morale, de conscience d’être, tenant compte de l’Autre, citoyen d’une autre patrie.
Le souci de remédier au phénomène migratoire demande de reconsidérer l’orientation donnée au civisme contemporain et les enjeux qui l’accompagnent. Si les mentalités des uns et des autres se font une mauvaise image de celui qui vient d’ailleurs, assurément, c’est parce que nos systèmes éducatifs souffrent d’une insuffisance d’instruction humaniste. Or justement, chez Platon, la pensée humaine, dans son émergence, doit poser le privilège de la position et des intérêts de l’homme. En d’autres termes, elle doit chercher à dépasser le plan des contingences humaines, en s’élevant vers l’intelligible pour après apprécier objectivement les réalités sociales, à l’image du prisonnier de la caverne.
L’humanisme, chez Platon, parle le langage de l’éducation. La science éducative est le tremplin des sciences humaines et sociales platoniciennes dont l’accomplissement se justifie en la science politique. Ainsi, l’art de bien vivre, de bien se conduire, dont la politique devrait constituer l’expression la plus complète, se distingue de tous les autres arts ou sciences particulières, même s’il leur est formellement analogue. Définie comme « une technique essentiellement formatrice, qui doit rendre l’âme meilleure au moyen de l’éducation » (L. Brisson et F. Francesco, 2006, p. 232), la politique est indispensable à l’orientation du comportement social des individus. Ainsi, la véritable voie de la connaissance ou « l’éducation est donc l’art qui se propose ce but, la conversion de l’âme, et qui recherche les moyens les plus aisés et les plus efficaces de l’opérer » (Platon 6, 2011, p. 519a). C’est par cette éducation à valeur morale, universellement accomplie, que le migrant fera bonne presse dans l’esprit de chacun.
Cependant, pour qu’un enseignement moral remarquable soit possible, il faut, estime Socrate, que la vertu soit une science. Autrement dit, que le jugement de valeur, qui règle la conduite, ne se réduise pas à une opinion reçue ou à une préférence subjective, mais qu’il se fonde sur des raisons objectives, valables pour tous les esprits. C’est la découverte d’un tel fondement que vise l’enquête entreprise dans les premiers dialogues platoniciens. Le but d’une telle recherche, c’est de découvrir un principe qui règle le jugement de valeur.
Se rappelant les propos de son maître, Platon comprend que « la justice est une vertu, et l’injustice un vice de l’âme » (Platon 6, 2011 p. 353e) ; ce qui laisse à penser que toute défaillance morale serait le fait de l’intelligence et reposerait sur une erreur de l’entendement. On dira, en ce sens, que c’est par un jugement erroné que les pays occidentaux refusent l’accueil des migrants. Ces pays jugent ces derniers en fonction de leurs intérêts politiques et économiques au lieu de justifier l’obligation morale qui demande de venir en aide à l’étranger en quête d’asile.
Chez Platon, la finalité de l’éducation est l’orientation vers la vérité du bien et des valeurs qui en dérivent, une formation qui vise l’excellence intellectuelle et morale de l’homme. Ainsi, dans Les Lois, il la définit comme « l’éclosion initiale de la vertu chez l’enfant » (Platon 8, 2011, 653b). Sans aucun doute, sans la vertu, il serait impossible d’apprécier objectivement les réalités sociales. Alors, il est temps que les mentalités soient mieux éclairées sur la notion véritable de l’humain entendu comme valeur universelle. La conscientisation des consciences demande que l’humanité, de l’individu aux communautés, privilégie ou élève l’éducation morale au-dessus de l’éducation capitaliste. Car l’éducation morale a un objectif universel : c’est l’amour de l’humanité ; en ce sens, elle est liée à la tolérance, à la charité. Elle ne juge pas pour opposer, mais plutôt pour rapprocher parce qu’elle apprend à soumettre la voix de la raison à celle de la vertu. Elle « rappelle la valeur de la personne, le caractère sacré de la dignité humaine et le devoir de porter secours et assistance à toute personne en danger ». (J-F. Mattei, 2009, p.150).
Par ailleurs, dans l’accomplissement de cette éducation, il va falloir revoir les paradigmes de la liberté religieuse. Pour se faire, la cité humaine ne saurait trouver en elle-même le principe de l’excellence que nous nous proposons d’atteindre, car la communauté des hommes ne se suffit pas à elle-même. Elle doit chercher en dehors d’elle-même, dans la perfection du monde et de ses causes divines, la raison et le modèle de sa propre organisation et de sa possible réforme. C’est la raison pour laquelle l’institution de la cité suppose, comme sa condition, une connaissance de l’ordre du monde et des causes universelles de la bonté, qu’il est possible de découvrir par un rapprochement au divin.
Le choix d’un comportement humaniste, disposant chacun à l’amour de sa prochaine demande que l’homme se présente Dieu comme la norme de comportement et le principe de détermination de l’action droite. Au lieu de soumettre le migrant à sa propre norme de comportement, on se reporte ensemble à la règle à adopter parce qu’elle est la bonne. Aussi, dans le Théétète, Platon recommande-t-il de se rendre semblable à dieu, autant que possible. Il demande au philosophe de pratiquer l’excellence et de tendre à s’assimiler au divin ; c’est-à-dire « devenir juste et pieux avec intelligence » (Platon 9, 2011, 176b) ou manifester une foi raisonnable. Partant d’un tel principe, l’on pourra interpréter les dogmes religieux en privilégiant avant tout l’humanité envers les autres.
Enfin, notons que l’homme, naturellement, n’est pas encore ce citoyen parfait que la société espère. Il a besoin d’être humanisé. Or « dire que l’homme ne naît pas ‘’Homme’’, il le devient, rappelle l’importance déterminante de l’éducation dans la formation de l’être humain vers son épanouissement en soi-même et avec les autres ». (Louis Marion, 2015, p.161). C’est à partir de telles considérations que l’on parviendra à un humanisme qui permettra de considérer le migrant sous l’identité d’un Autre-moi et non d’un Autre différent de moi. Passons donc, à présent, à notre second argument.
Dans la conception humaniste platonicienne, l’homme se définit à partir de son être spirituel, c’est-à-dire l’âme. C’est à partir de cette identité partagée, l’âme, que nous devons traiter le migrant comme un être avec qui nous sommes naturellement liés, au nom de l’humanité ; car le lieu où l’homme accomplit sa nature, son humanité, c’est l’intersubjectivité. Autrement dit, le rapport à autrui est inclus dans le rapport à soi. Le solipsisme n’existe pas de ce point de vue, car le rapport à autrui fait partie intégrante de notre être. Cette nature partagée avec le migrant, on pourrait l’expliquer avec Platon, à travers Alcibiade.
De fait, à Delphes, en haut du temple, était inscrit un commandement : « connaît-toi toi-même ». Socrate, dans Alcibiade, reprend ce commandement pour montrer comment il implique du même coup la connaissance d’Autrui. Ainsi, discutant avec Alcibiade, il lui fait remarquer ceci : « Quiconque ignore les choses qui lui sont propres ignore aussi bien celles qui sont propres aux autres. (…). Et s’il ignore les choses qui sont propres aux autres, il ignore aussi celles qui sont propres à la cité » (Platon 2, 2011, p. 133e). La connaissance de l’Autre et de la société est donc nécessaire à la connaissance de soi. Ainsi, la quête de définition de la personne humaine doit se réaliser par l’image identitaire de tout être humain avec qui l’on partage l’existence. Alors, pour restaurer l’image du migrant, en tant qu’être humain ou être semblable à soi, il incombe de se le représenter dans la conception altruiste platonicienne. Car si la connaissance de soi est capitale dans l’accomplissement d’une vie heureuse, il ne fait aucun doute que cette connaissance passe nécessairement par le rapprochement avec celui qui nous ressemble.
Vouloir donc définir le migrant en mettant l’accent sur ses différences, c’est faire montre d’une ignorance des principes platoniciens. La connaissance de soi ne signifie pas celle du corps, qualifié d’identité apparente, raciale ou nationale. Au contraire, ce qui fait la caractéristique de la nature humaine, c’est l’âme. Aussi, dirons-nous que par nature, nous sommes, malgré tout, liés avec ceux qui ne sont pas aisément identifiables comme partie de notre société, ceux que nous n’avons jamais choisis, et qui vivent différemment le quotidien. Si nous admettons cette condition ontologique, alors rejeter le migrant, c’est rejeter une partie de nous-même ; de même, il serait faux de croire que si nous méprisons le migrant, les chances que nous soyons nous-même se multiplient. En d’autres termes, nous partageons une condition ontologique commune avec le migrant ; et cette essence partagée implique nécessairement une condition de convergence, de proximité, ou de rencontre possible avec cet étranger, originairement différent de nous.
Les barrières physiques, expression des barrières psychologiques, doivent par conséquent revêtir un sens nouveau ; celui de contrôler le passage des frontières des États, certes, mais aussi de favoriser le passage du migrant vu comme un voisin en quête d’aide et non plus comme un être étrange qui vient troubler notre quiétude. Malheureusement, c’est ce à quoi l’on assiste aujourd’hui, par exemple, en Grèce et il y a fort à douter que l’humanisme qui s’y révèle ait un fondement platonicien.
Depuis 2015, les arrivées de migrants à la frontière gréco-turque sont inédites par leur proportion. Les mesures prises pour la gestion de cette crise s’inscrivent dans une continuité historique de dissuasion et de répression des migrants. La Grèce, notoirement connue pour être un pays d’émigration, a même fait construire une clôture de 12.5 kilomètres de long et 3 mètres de haut. Or, sauf rares exceptions, le consensus semble unanime sur le fait que la clôture ne fera que déplacer le problème, car malgré des mesures de plus en plus restrictives, les migrants affluent aux portes de l’Europe, contournant le plus souvent les barrières. Devant l’échec de cette politique, il saute aux yeux que la réponse à apporter au phénomène migratoire est sans doute plus complexe qu’« un simple appel à la décence politique » (Benjamin Boudou, 2017, p.9) ; car la lecture politique de l’humanisme n’appelle malheureusement pas un cosmopolitisme juste, impartial qui se soucie du migrant. Au contraire, à travers cette politique, les nations cherchent à se protéger derrière le droit pour négliger les devoirs d’humanité.
Le dénouement de ce flux migratoire est donc ailleurs, c’est-à-dire dans une reconsidération plus humaniste du migrant. Dans une vision platonicienne, il faudra définir cet étranger à partir de son être, réalité qui nous oblige à la communauté sociale. Partant de cet être ou cette réalité commune, l’on privilégiera l’universalité de l’homme au détriment de sa nationalité, comme Platon définit l’homme à partir de l’âme. En considérant ainsi son semblable, on parviendra à l’aimer, accomplissant subséquemment, la volonté d’Eros, dieu d’amour, comme Platon le signifie dans Le banquet : « C’est ce dieu qui nous vide de la croyance que nous sommes des étrangers l’un pour l’autre, tandis que c’est lui qui nous emplit du sentiment d’appartenir à une même famille » (Platon 10, 2011, p. 197c).
L’humanité, désormais une famille universelle, nécessite une cohabitation organisée avec l’étranger ; car si d’une part nous sommes contraints de vivre avec ceux que nous n’avons jamais choisis, avec ceux envers qui nous n’éprouvons pas de sentiment social d’appartenance, d’autre part, nous sommes aussi tenus de préserver leur vie et l’humanité dont ils font partie. C’est pourquoi le citoyen contemporain doit comprendre que la cohabitation avec les migrants est, en effet, un caractère indéniable de sa condition humaine.
Enfin, il faut noter que « nous ne nous humanisons pas seuls ; c’est l’humanité des autres qui nous humanise, singulièrement l’humanité de l’autre rencontré dans les relations d’entraide » (J-F. Mattei, 2009, p.204). Se méprisant sur l’identité réelle du migrant, l’on pourrait le stigmatiser comme un citoyen de seconde zone ou tout simplement comme ennemi. Ce dernier devra plutôt être présenté et défini à partir de son essence humaine et non de son image différenciée. En considérant cette essence partagée, la cohabitation avec celui qui vient d’un autre pays, à la recherche d’un asile, est nécessaire et espérée, si nous désirons une société universelle stable et paisible.
Conclusion
Le problème du monde contemporain, c’est que la course au capitalisme a changé les mentalités, présentant des intérêts nouveaux dans les relations humaines. L’humanité ne s’entend plus essentiellement comme l’ensemble des êtres humains, mais intègre aussi des réalités capitalistes qui rivalisent avec la dignité humaine. Le vivre-ensemble se fait de façon intéressée, excluant ainsi la primauté de l’amour du prochain. Face à cette crise onto-théologique, un appel à la cohabitation s’impose donc urgemment. Mais cette cohabitation passe nécessairement par la connaissance ontologique et l’identification objective de l’Autre affiché ici sous l’image de migrant.
Ainsi, comme la pratique philosophique exige le souci de l’Autre, à l’image du prisonnier de la caverne revenu auprès des siens, alors face à la question de la crise migratoire, l’humanisme doit avoir pour but de réguler cette crainte de la menace migratoire ; une crainte bien souvent exagérée face au risque réel, pour penser une ontologie sociale qui prendra son point de départ dans la condition d’épreuves partagées, afin de récuser ces opérations normatives, imprégnées de racisme, et préjudiciables à l’humanité. Et si Platon ne dissocie pas le fait d’apprendre à penser, d’apprendre à connaître et le fait d’apprendre à vivre, en ce sens que, pour lui, la philosophie est une manière de vivre. Alors, à travers l’humanisme platonicien, l’on pourra apprendre à être humain ; car c’est dans ce qu’il nous reste d’humain que nous pourrons encore résister à ce qui est inhumain, à partir des idées morales et humanistes universelles.
Cependant l’expression des pensées humanistes ne peut avoir un écho plus retentissant que « si les politiques se montraient plus responsables, si la gouvernance mondiale voulait légiférer de manière plus efficace, si l’économie planétaire acceptait de se recentrer sur l’homme, si on avait plus souvent le souci du lendemain que de l’immédiat ». (J.-F. Mattei, 2009, p. 187).
Références bibliographiques
BOUDOU Benjamin, 2017, Politique de l’hospitalité, CNRS Éditions, Paris, 247 p.
BRISSON Luc, 2011, Œuvres complètes de Platon, Paris, Flammarion, 2198 p.
BRISSON Luc et FRANCESCO Fronterotta, 2006, Lire Platon, Paris, PUF, 261 p.
BUTLER Judith, 2013, Vers la cohabitation, Paris, Éd. Fayard, 283 p.
DROIT Roger-Pol, 2018, Et si Platon revenait…, Paris, Albin Michel, 317 p.
FLAHAULT François, 2005, Le paradoxe de Robinson, Capitalisme et société, Paris, Mille et une nuits, 174 p.
KI-ZERBO Joseph, 1990, Éduquer ou périr, Paris, L’harmattan, 123 p.
MARION Louis, 2015, Comment exister encore ?, Montréal, Les Éditions Écosociété, 165 p.
MASSIGNON Louis, Doctrines religieuses des philosophes grecs, P. Lethielleux, Paris, Librairie éditeur, 1909, 455p.
MATTEI Jean-François, 2009, Humaniser la vie, Paris, Éditions Florent Massot, 211 p.
PLATON (1), 2011, Le Sophiste, in Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Nestor L. Cordero, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (2), 2011, Alcibiade, in Œuvres complètes, la direction de Luc Brisson, Trad. Jean-François Pradeau et Chantal Marbœuf, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (3), 2011, Phédon, in Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Monique Dixsaut, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (4), 2011, Euthyphron, in Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Louis-André Dorion, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (5), 2011, Apologie de Socrate, in Œuvres complètes, Trad. Luc Brisson, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (6), 2011, La République, in Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Georges Leroux, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (7), 2011 Protagoras, in Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Frédérique Ildefonse, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (8), 2011, Les lois, in Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (9), 2011, Théétète In Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, Trad. Michel Narcy, Paris, Flammarion, 2198 p.
PLATON (10), 2011, Le Banquet, In Œuvres complètes, Trad. Luc Brisson, Paris, Flammarion, 2198 p.
[1] .« L’²horizon², cela veut dire le monde suprasensible en tant que véritable étant. C’est en même temps l’Entier qui embrasse et contient tout le reste, comme la mer. La terre comme séjour des hommes est détachée de son soleil. La sphère du suprasensible étant en soi n’est plus au-dessus de l’homme comme lumière normative. L’horizon entier est effacé. L’entier de l’étant comme tel (la mer) a été bu par l’homme… L’horizon ne rayonne plus à partir de lui-même. Il n’est plus que le point de vue posé dans les institutions de valeurs de la volonté de puissance. » (M. Heidegger, 1962, p. 315).
[2]. « Ce mot ne signifie pas, comme s’il était l’énoncé d’une négation basse et haineuse : il n’y a pas de Dieu. Sa signification est pire : Dieu est tué. C’est ainsi seulement qu’apparaît la pensée cruciale. En attendant, la compréhension devient plus difficile encore. Car le mot « Dieu est mort » serait plutôt plus facile à comprendre s’il signifiait que Dieu lui-même s’est éloigné spontanément de sa présence vivante. Mais que Dieu ait été tué par d’autres, et qui plus est par des hommes, voilà qui est impensable. Nietzsche lui-même s’étonne de cette pensée. C’est pourquoi, immédiatement après le mot décisif : « Nous l’avons tué – vous et moi ! Nous tous, nous sommes ses assassins ! », il fait suivre cette question du forcené : « Mais comment avons-nous pu faire cela ? » Nietzsche explique cette question en la répétant, par périphrase, en trois images « Comment avons-nous pu boire d’un trait la mer tout entière ? Qui nous a donné l’éponge pour effacer tout l’horizon ? Que faisions-nous lorsque nous détachions cette terre de son soleil ? » (M. Heidegger, Op.cit. p. 314-315).
[3] . « Le fond suprasensible du monde suprasensible est, pris comme la réalité efficiente de tout le réel, devenu irréel. Voilà le sens métaphysique du mot pensé métaphysiquement : ² Dieu est mort. ². » (M. Heidegger, 1962, p. 307).
[4] . « En pensant grossièrement, on pourrait croire que ce mot dit que le gouvernement de l’étant passe de Dieu à l’homme, ou, encore plus grossièrement, que Nietzsche met l’homme à la place de Dieu. Ceux qui l’entendent ainsi pensent en vérité bien peu divinement de l’essence divine. Jamais l’homme ne peut se mettre à la place de Dieu, parce que l’essence de l’homme n’atteint jamais la région de l’essence de Dieu, par contre, en comparaison avec cette impossibilité, quelque chose de bien moins rassurant peut arriver, et dont nous avons à peine commencé de méditer la nature. » (M. Heidegger, 1962, p. 308).
[5] . Comme disait M. Heidegger (1962, p. 313) : « Le dernier coup frappé contre Dieu et contre le monde suprasensible consiste en ce que Dieu, l’étant des étants, est ravalé au rang de valeur suprême. Le coup le plus rude contre Dieu n’est pas que Dieu soit tenu pour inconnaissable, que l’existence de Dieu soit démontrée indémontrable, mais que le Dieu tenu pour réel soit érigé en valeur suprême. Car ce coup ne provient justement pas de « ceux qui étaient là et ne croyaient pas en Dieu », mais des croyants et de leurs théologiens, qui discourent du plus étant de tout étant sans jamais s’aviser de penser à l’être même. »
[6] . La mort de Dieu étant l’événement du siècle, c’est finalement ce genre d’événement qui met l’homme en face de sa propre humanité. Comme disait Romano (1999, p. 24) : « l’événement est justement ce qui révèle l’homme à lui-même et l’initie à sa propre humanité, à tel point qu’il n’est homme que dans son rapport à l’événement. »
[7] . « La place à laquelle s’ouvre le vouloir du surhomme est une autre région d’un autre fondement de l’étant en son autre être. Cet autre être de l’étant est devenu entre-temps – et c’est ce qui caractérise le début de la métaphysique moderne – la subjectivité. » (M. Heidegger, 1962, p. 308).
[8] . « L’événement au sens événemential ne s’inscrit pas dans le monde mais ouvre un monde pour l’advenant. » (C. Romano, Ibid., p. 56.)
[9] . « L’effondrement de la primauté de la raison qui (se) re-présente répond à l’essence métaphysique de cet événement que Nietzsche nomme la « mort » du Dieu de la morale chrétienne. » (M. Heidegger, 1971, II, p. 242).
[10] . « Notre temps est un temps qui sait… Ce qui, autrefois, n’était que malade est devenu inconvenant aujourd’hui – de nos jours c’est une inconvenance d’être chrétien. Et c’est ici que commence le dégoût – Je regarde autour de moi : il n’est plus resté un mot de ce qui autrefois s’appelait ‘vérité’, nous ne supportons plus qu’un prêtre prononce seulement le mot de ‘vérité’ (…) Il faut que l’on sache aujourd’hui qu’un théologien, un prêtre, un pape, à chaque phrase qu’il prononce, ne commet pas seulement une erreur, mais fait encore un mensonge. » (F. Nietzsche, 1888, §38).
[11] . L’une des meilleures illustrations est aussi omniprésente dans Essais et conférences dans son chapitre intitulé Qui est le Zarathoustra de Nietzsche ? : « Par le vocable ² surhomme², Nietzsche ne désigne justement pas un homme semblable à ceux que nous connaissons et simplement de plus grandes dimensions. Il ne pense pas davantage à une espèce d’hommes qui rejetterait toute l’humanité, qui érigerait en loi le pur arbitraire et ferait sa règle d’une fureur de titans. Le surhomme, à prendre ce mot tout à fait littéralement, est bien plutôt celui qui s’élève au-dessus de l’homme d’hier et d’aujourd’hui, mais uniquement pour amener cet homme, en tout premier lieu, jusqu’à son être, qui est toujours en souffrance, et pour l’y établir. » (M. Heidegger, 1958, p. 122).
[12] . « L’humanité qui veut son propre être-homme comme volonté de puissance, et éprouve cet être-homme comme appartenant à la réalité déterminée dans sa totalité par la volonté de puissance, cette humanité est déterminée à son tour par une figure essentielle de l’homme qui dépasse et surpasse l’homme ancien. Le nom pour cette figure essentielle de l’humanité qui surpasse l’ancien type, c’est le ²surhomme². » (M. Heidegger, 1962, p. 303).
[13] . Cf. Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 140.
[14] Voir F. Nietzsche, Humain, Trop Humain, II, « Le voyageur et son ombre », paragraphe 232, in Œuvres complètes, Paris, Éditions Robert Laffont, 2004, p. 918.
[15] Voir F. Nietzsche, La Généalogie de la morale, « troisième dissertation », paragraphe 10, Paris, Fernand Nathan, 1981, p. 163.
[16] Voir Mamoussé Diagne, « Contribution à une critique du principe des paradigmes dominants », in Joseph Ki-Zerbo dir., La natte des autres, Dakar, CODESRIA, 1992, p. 109-119.
[17] Voir La Bible. Ancien et Nouveau Testament, Paris, Alliance biblique française, 1982, p. 6.
[18] Critique de la raison pure.