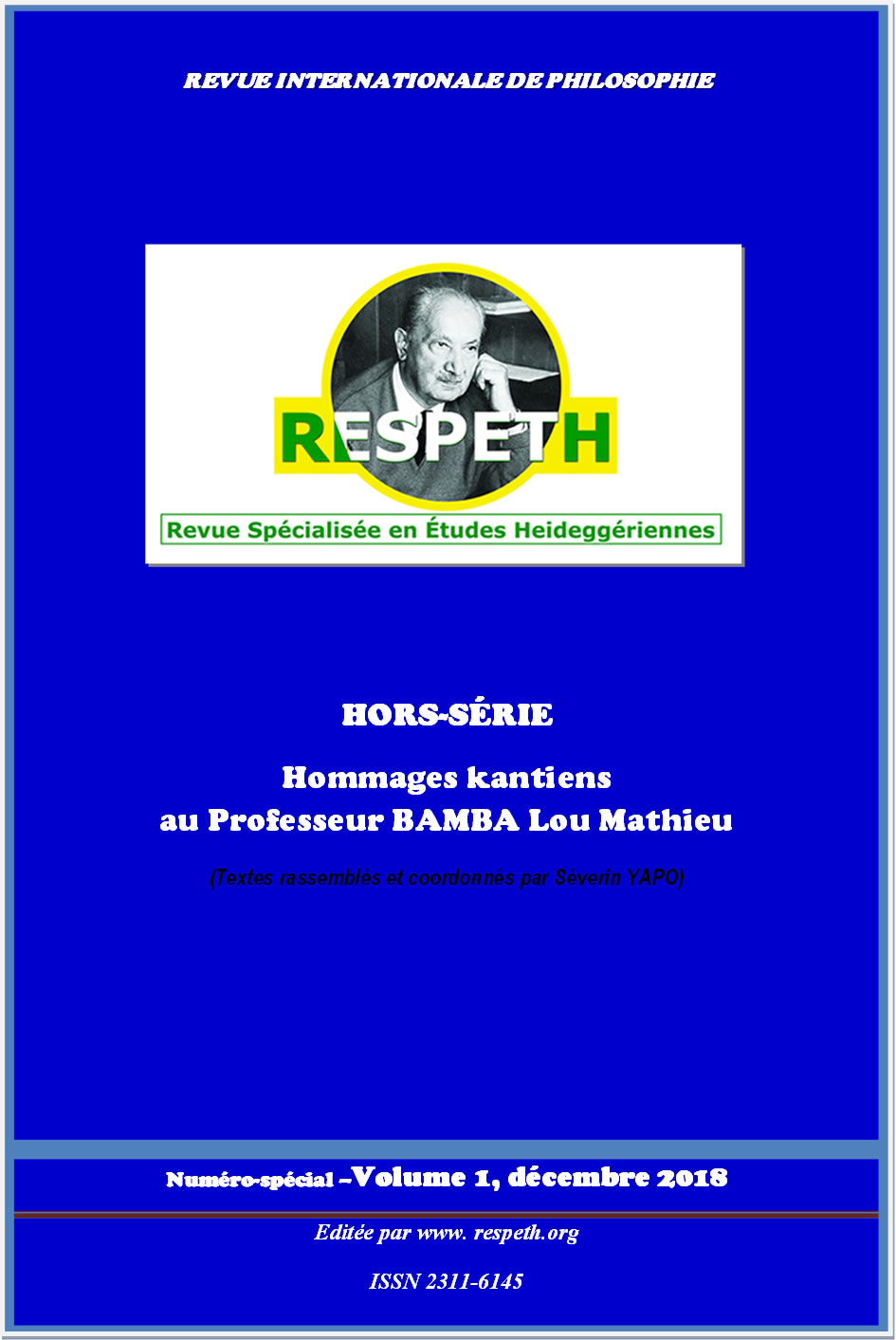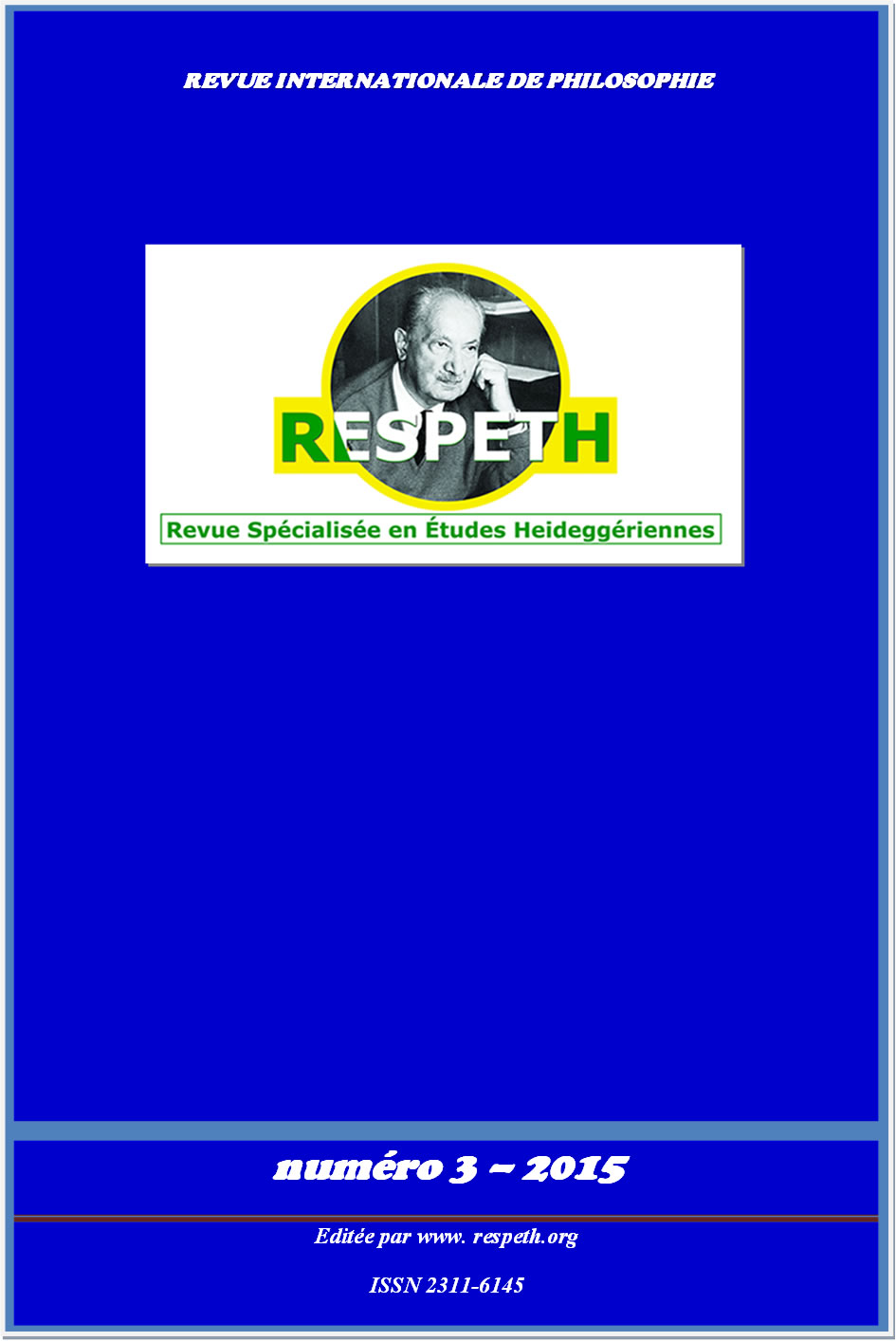RESPETH 5-2017
SOMMAIRE
POURQUOI HEIDEGGER ?…………………………………..5
Argumentaire du Numéro Thématique : Le Discours de Rectorat de Martin Heidegger : ………………………………………………………………..11
- Le Discours de Rectorat de Martin Heidegger : Un Discours d’allégeance à la Révolution Nationale-Socialiste ?, BAMBARA (Romuald Évariste)………..………………………………………. 12
- Allocution de Hegel à ses auditeurs à l’ouverture de ses Leçons de Berlin, le 22 Octobre 1818 : Introduction à une « Philosophie de l’Université », DIA (Oumar)………………………………………….. 36
- Sur le contexte du Discours de Rectorat. Deux leçons pour l’Afrique, YAPO (Séverin)……………………………………………… 49
- La vocation de l’Universitaire à la lumière du Discours de Rectorat de Martin Heidegger, KOUAKOU (Antoine)………………………………………….…. 70
Présentation et Sommaire N°5 > Résumés des articles N°5
www.respeth.org, 2017
22 BP 1266 Abidjan 22 (Côte d’Ivoire)
Email : publications@respeth.org
Tél. : 00225 09 62 61 29 00225 40 39 26 95 00225 09 08 20 94
ORIENTATIONS DE LA REVUE
RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches sur Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody (Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C’est une revue internationale à caractère philosophique qui paraît une fois l’an (en édition régulière). En dehors de cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée du philosophe Martin HEIDEGGER.
La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, novatrices ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions d’ordre théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se rapportant à la pensée du philosophe :
* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les thèmes liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ;
* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ;
* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou moins heideggérien, les textes philosophiques ;
* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de Martin HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes non-occidentaux.
* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons ;
* Des comptes rendus d’ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER.
RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du concours pour le Prix d’Excellence DIBI Kouadio Augustin.
Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue RESPETH se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, les professeurs et étudiants qui s’intéressent au devenir de la philosophie d’influence heideggérienne.
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Andrius Darius VALEVICIUS, Université de Sherkrooke, Québec, Canada
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Augustin DIBI Kouadio, Prof. Titulaire, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Jacques NANÉMA, Prof. Titulaire, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Jean-Luc AKA-EVY, Prof. Titulaire, Université Marien NGOUABI, Congo-Brazaville
Sophie-Jan ARRIEN, Prof. Titulaire, Université de Laval, Canada
COMITÉ DE LECTURE
Andrius Darius VALEVICIUS, Université de Sherkrooke, Québec, Canada
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Raoul KOUASSI Kpa Yao, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Augustin DIBI Kouadio, Prof. Titulaire, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Jacques NANÉMA, Prof. Titulaire, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Jean-Luc AKA-EVY, Prof. Titulaire, Université Marien NGOUABI, Congo-Brazaville
Sophie-Jan ARRIEN, Prof. Titulaire, Université de Laval, Canada
COMITÉ DE RÉDACTION
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
REDACTEUR EN CHEF :
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
Séverin YAPO, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Léonard KOUASSI Kouadio, Institut National du Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle, Côte d’Ivoire
MEMBRES :
Alexis KOFFI Koffi, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Christophe PERRIN, Université Paris-Sorbonne, France
Élysée PAUQUOUD Konan, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire
Oscar KONAN Kouadio, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Pascal ROY-EMA, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Sylvain CAMILLERI, Université Catholique de Louvain, Belgique
RESPONSABLE TECHNIQUE :
Raoul KOUASSI Kpa Yao, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
SOMMAIRE
Pourquoi Heidegger ? .…………………………………………………………………..5
Argumentaire du Numéro Thématique : Le Discours de Rectorat de Martin Heidegger.…………………………………………………………………………11
BAMBARA (Romuald Évariste), Le Discours de Rectorat de Martin Heidegger : Un Discours d’allégeance à la Révolution Nationale-Socialiste ? .……………………………………………….12
DIA (Oumar), Allocution de Hegel à ses auditeurs à l’ouverture de ses Leçons de Berlin, le 22 Octobre 1818 : Introduction à une « Philosophie de l’Université » .……………………………36
YAPO (Séverin), Sur le contexte du Discours de Rectorat. Deux leçons pour l’Afrique .…………………………………………………49
KOUAKOU (Antoine), La vocation de l’Universitaire à la lumière du Discours de Rectorat de Martin Heidegger .………………..70
POURQUOI HEIDEGGER ?
Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, en terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante qu’il faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, avec Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont l’histoire consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire de beaucoup de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit nullement dans un conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise plutôt à scruter un implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport de la conscience aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun prétexte, pour autant que l’homme, quelle que soit sa particularité individuelle ou collective, ne peut pas ne pas comprendre que le point de départ de l’histoire s’inscrit nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-delà de tout ce qui nous préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de divergences ou même de conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous détermine tous : nous sommes des consciences devant les déterminités. Et la conscience ne parvient à sa vérité que dans une appartenance essentielle au Concept, comme expression d’une pensée substantielle de son rapport aux choses. De ce point de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si complexe qu’une complaisance à son égard influence négativement la marche dans l’histoire de tout peuple. La qualité de cette marche est donc déterminée par le sérieux et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans la présence des choses. Husserl, dont la philosophie est une réappropriation de la conscience, dans son essentialité, nous permet de bien comprendre qu’une pensée rigoureuse ne peut se dispenser de la vérité de la conscience dans son rapport aux choses, d’où la nécessité fondamentale de l’époché, pour accéder au moi transcendantal ; car une conscience encombrée de psychologisme rend impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son intentionnalité. C’est la réduction transcendantale pour désobstruer le rapport de la conscience aux choses. Le retour aux choses ou “droit aux choses mêmes”, comme idée substantielle de la phénoménologie husserlienne, est le retour de la conscience dans sa pureté originelle, seul gage pour rendre la philosophie, c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, comme science rigoureuse. Le célèbre article de Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, paru en 1911, en donne la pleine mesure. La conscience, étant le fondement premier de toute science, y compris la philosophie en premier, exige d’être pensée en soi, comme conscience transcendantale, pour donner au Concept toute la rigueur de son sens. La rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la réduction phénoménologique, chez Husserl, traverse toute la pensée de Heidegger, qui l’enracine dans une expérience plus originaire et plus originelle, celle avec l’Être.
Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même que celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du Népal sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la réalité non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le chien comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde sur le non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-présent. Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation constante d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité.
Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver de l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement “jeune”, qui implique, sans aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans laquelle, de toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour donner à l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une question d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, dans la mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui structure, de manière universelle, son existence.
Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige une méditation sur le rapport de l’étant à l’être. Un rapport dans lequel l’étant est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une articulation nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la métaphysique de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières pages de Être et Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est aujourd’hui tombée dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au préalable, il n’a pas manqué de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer tout l’enjeu de sa pensée : « Avons-nous une réponse à la question de savoir ce que nous voulons dire exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. Dans ces conditions, il faut poser en termes tout à fait neufs la question du sens de l’être. Sommes-nous donc seulement aujourd’hui encore dans l’aporie de ne pas entendre l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces conditions, le plus urgent, c’est de réveiller une entente pour le sens de cette question » (Idem, p. 21). Il s’agit, alors, de pousser à fond le rapport de l’homme au savoir pour qu’advienne et se maintienne, sans prétention et de manière définitive, son essence pensante, si tant est que rien ne peut possibiliser son existence, s’il n’est radicalement établi dans cette essence. Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde pensante de la garde de l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans laquelle l’homme accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à aucune race et à aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait pas le propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde de la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et poursuit sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est pleinement chez soi. Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux peuples, qu’elle soit embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut l’accueillir, avec grande sérénité et lui permettre de croître dans le secret de sa puissance, qui rend puissants les peuples qui savent la contempler dans la splendeur de sa vérité. Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin de liberté, parce qu’est libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où sont brisées les idoles de nos excessifs particularismes et de nos primitivités, dénuées du saut qualitatif, nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de cette idée heideggérienne : Là où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. Ce qui suppose qu’il faut, dès la départ, écarter, avec une violence salutaire, l’idée d’une rationalité multiple, comme si “un plus un” feraient, ailleurs, autre chose que deux. La logique n’est ni culturelle, ni géographique, c’est le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, selon Hegel, réside dans la conscience de soi, conscience parvenant à son contenu comme Concept. Ce Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi dire, des Grecs. Serait-il scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il pas revendiquer autre chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est menacée de faillite, en raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, pourrions-nous ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur fondement ultime dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, aujourd’hui, honneur à défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, pas pour des raisons de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut pas avoir un ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire “nous sommes des Grecs ?” Heidegger nous donne l’excellente réponse : « Grec, cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les différents modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée par lui, sans pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405).
Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore suffisante des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité sociale et politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se construit tout peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève dans l’horizon de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais nécessaire. Bien qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la pensée des valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas moins la question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme fondamental, comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance tout humanisme classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à sauvegarder. Il serait, alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre donnerait des directives à l’action de l’homme ; une telle orientation est, simplement, aux antipodes de la pensée de Martin Heidegger, pour qui la pensée est en soi une action radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue au rang d’action du seul fait qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à La pensée agit en tant qu’elle pense. (…) Cet agir est probablement le plus simple en même que le plus haut, parce qu’il concerne la relation de l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, p. 68). Pourquoi ? Parce que là où existent des distorsions sociales et des horizons historiques confus, la pensée ne s’est pas suffisamment accomplie, c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec vigueur et rigueur, porté son essence dans la seule relation, qui lui donne tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il pas alors bien étonnant de montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel Faye, que Heidegger est un théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait injuste d’enfermer le grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa vie (Six mois rectorat sous le régime des nazis), alors même que la commission de « Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu lieu depuis le courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe de la Forêt Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le rectorat sous le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être discrédité par son son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les accointances avec le nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de pensée du dernier des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas Dieu ; et la grande intelligence n’est pas canonisation.
« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). Apprendre à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine l’humanité de l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait écrire : « Plein de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ». Puissent nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de l’Être, pour qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant.
Jean Gobert TANOH
NUMÉRO THÉMATIQUE 2017 DE LA REVUE RESPETH
LE DISCOURS DE RECTORAT DE MARTIN HEIDEGGER
Recteur de l’Université de Fribourg (21 Avril 1933 – 23 Avril 1934), Martin Heidegger prononça, le 27 Mai 1933, le Discours de Rectorat intitulé : « L’Auto-affirmation de l’Université Allemande ». Un tel discours, tout au long de sa carrière de philosophe ou de penseur, et surtout en sa qualité d’Enseignant-Chercheur, n’a pas manqué d’influer sur sa vie et sa notoriété. En parcourant ce discours, l’évidence s’offre à nous qu’il est assez multiforme. Il s’y joue tout à la fois le politique, le scientifique, le socio-culturel et spirituel.
En choisissant, pour ce numéro 5, de méditer sur le Discours de Rectorat de Martin Heidegger, RESPETH a le souci fondamental de convoquer la communauté des chercheurs, penseurs et étudiants à re-penser, à nouveaux frais, et de façon substantielle, les orientations de pensées qu’il offre. En l’occurrence, les questions qui tournent autour de l’Université, la Violence, le National-Socialisme, l’Éducation, la Nation, le Travail, la Défense, les Guides, etc. Aussi, en s’appuyant sur le principe de la liberté de penser, RESPETH ne voudrait-elle nullement dégager quelque axe de réflexions que ce soit ! Il est donné libre cours à chacun, à partir d’une interprétation pertinente de ce discours, de proposer des articles inédits.
LE DISCOURS DE RECTORAT DE MARTIN HEIDEGGER : UN DISCOURS D’ALLÉGEANCE À LA RÉVOLUTION NATIONALE-SOCIALISTE ?
Romuald Evariste BAMBARA
Maître-Assistant, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo (BURKINA FASO)
Résumé : Premier Recteur nazi de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, Heidegger, dans une allocution solennelle pour la prise en charge de sa fonction, fixe le sens de sa mission. Sous son égide, celui du spiritus rector, l’Université ou la communauté de combat a l’obligation d’éduquer les Führer ou les dirigeants du peuple allemand. Cette éducation vise le renouvellement spirituel de toute la vie en Allemagne, dans le sens de répondre au destin de l’Occident. La condition pour réaliser ce projet, c’est-à-dire “spiritualiser” l’Allemagne, réside dans l’enracinement de l’Université à la révolution nationale-socialiste, ce à travers l’État et ses institutions. En d’autres termes, réaliser cette vocation exige d’adhérer au parti, de prendre la carte du parti nazi. Mais, un tel engagement parviendra-t-il à sauvegarder la liberté de l’Université des velléités des institutions politiques de son temps ? Ainsi, cet écrit analyse d’abord le Discours de Rectorat en dégageant ses principales articulations avant d’entreprendre une critique, au sens où les mérites et les limites de cette argumentation sont relevés.
Mots-clés : AUTO-AFFIRMATION, ESSENCE, MISSION SPIRITUELLE, NATIONAL-SOCIALISME, SCIENCE, UNIVERSITÉ.
Abstract : Heidegger, the first Nazi rector of the University of Fribourg-en-Brisgau, in a solemn address when taking responsibility for his office, defines the meaning of his mission. Under its aegis, that of the spiritus rector, the University or the combat community has an obligation to educate the Führer or the leaders of the German people. This education aims at the spiritual renewal of all life in Germany that is to respond to the destiny of the West. The condition for realizing this project, that is to say, to “spiritualize” Germany, lies in the fact that the University is rooted in the National Socialist revolution through the State and its institutions. In other words, fulfilling this vocation requires adhering to the party, taking the Nazi party membership card. But will such a commitment succeed in safeguarding academic freedom from the wishes of the political institutions of his time? Thus, this paper first analyses the structure of the Rector’s Discourse; before coming in to criticize the merits and limits of these arguments.
Keywords: SELF-AFFIRMATION, ESSENCE, SPIRITUAL MISSION, NATIONAL-SOCIALISM, SCIENCE, UNIVERSITY.
Introduction
Martin Heidegger a été élu par ses pairs Rektor-Führer de l’Université de Fribourg-en- Brisgau, le 21 avril 1933. Cette élection s’est déroulée trois mois après l’accession de Hitler à la chancellerie, soit le 30 janvier 1933. Heidegger a été élu par le sénat de l’Université de Fribourg, à l’unanimité moins une voix. Parmi ses concurrents à cette élection, on peut citer Alfred Baeumler, Ernst Krieck et Alfred Rosenberg. La candidature de Heidegger à ce poste a été encouragée par ses collègues qui voyaient en lui celui qui avait des idées et qui était en mesure de sauver l’Université allemande. Et cette élection, disait-on, n’avait aucun caractère politique, car Heidegger, en son temps, n’appartenait à aucun parti politique. Sa nomination devient officielle le 22 avril 1933. À la prise en charge solennelle du Rectorat de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, le 27 mai 1933, Heidegger prononce son Discours de Rectorat. Un discours synthétisant les ambitions de l’auteur pour la nation allemande, et dont l’intitulé exprime la quintessence de la noble mission à lui confiée : L’auto-affirmation de l’Université allemande[1]. Mais le 27 avril 1934, la démission de Heidegger est acceptée, pratiquement un an après son entrée en fonction.
Quelle peut bien être la portée du Discours de Rectorat, discours souvent méconnu, lu avec peu de considération et souvent cité comme document ou pièce à conviction de l’engagement nazi de son auteur ? Que contient-il d’essentiel pour la pensée philosophique ? Ce discours, dont Jean-Michel Palmier (2014, p. 80) disait qu’il « est le seul texte à caractère politique au sens le plus large du mot à figurer dans la bibliographie officielle de Heidegger », a-t-il une dimension philosophique authentique, ou est-ce un simple manifeste épousant les idées du mouvement national-socialiste ouvrier ? Est-ce une réplique conceptualisée de la propagande nazie ou plutôt une intégration des dimensions du discours idéologique du Troisième Reich ? Les thèses de ce discours ne sont-elles pas celles du Parti national-socialiste (NSDAP) ?
L’objectif de cette étude est de faire une lecture critique du Discours de Rectorat de Heidegger. Une lecture attentive, ordonnée, qui vise à expliciter le sens de ce discours et à procéder à une critique en vue de mettre en évidence les mérites et les limites possibles de ce texte. L’ossature de cette analyse comportera trois grandes parties. La première explicitera le principe de « l’auto-affirmation de l’Université allemande », la deuxième montrera l’actualité du discours sur « l’auto-affirmation de l’Université allemande », la troisième analysera l’espoir de Martin Heidegger dans le national- socialisme.
1. « L’AUTO-AFFIRMATION DE L’UNIVERSITÉ ALLEMANDE »
Le 27 mai 1933, Heidegger prononce son Discours de Rectorat. Dans ce discours, on perçoit le principe qui guide Heidegger, non seulement dans l’acceptation de cette charge de Recteur, mais aussi dans sa vision sur la manière de réussir sa mission, notamment bâtir l’Université sur les forces constructives vivantes de la nation allemande qui s’affirmaient au plan politique durant l’année 1933. En effet, ces forces constructives vivantes peuvent sauver l’Allemagne de sa misère, de sa détresse et de la situation sans issue des étudiants. Aussi ce discours vise-t-il à donner un sens à sa fonction de Recteur et au rôle que doivent jouer l’Université et la science dans la sauvegarde de la nation allemande : « Prendre en charge le Rectorat, c’est s’obliger à guider spirituellement cette haute école », tels sont les premiers mots du discours de Heidegger (1982, p. 5). La lecture du Discours de Rectorat nous permet de déceler les grandes articulations suivantes : les acteurs de l’Université allemande que sont le corps des étudiants et celui des professeurs allemands, la mise en évidence de ce qu’est l’essence de la science et celle de l’Université allemande, le combat averti à mener pour sortir le peuple allemand de sa grande détresse morale et matérielle.
1.1. Les acteurs de l’Université allemande
Au nombre des acteurs de l’Université ou de la communauté universitaire, Heidegger cite le corps des étudiants et celui des professeurs. D’abord, le corps des étudiants est résolu à endurer le destin du peuple allemand. Une volonté bénéficiant du nouveau droit des étudiants qui leur octroie la liberté de se donner soi-même la loi. Et pour Heidegger, « se donner à soi-même la loi est la plus haute liberté » (1982, p. 15). À partir de cette donation à soi de la loi, le corps des étudiants allemands peut préciser ses obligations et ses services. Une telle démarche s’oppose de son point de vue à la mauvaise interprétation de la notion de « liberté académique ». Cette “liberté académique” mal comprise n’est aucunement à confondre avec la liberté d’enseignement ou la liberté d’expression des étudiants. Elle a été interprétée comme une incitation à mener une vie facile, à tomber dans la licence et le laisser-faire.
C’est cette incompréhension de la liberté académique que Heidegger critique. Il trouve cette dernière “inauthentique” et estime qu’elle est la porte ouverte à « l’insouciance, l’arbitraire des projets et des inclinations, la licence dans tout ce qu’on faisait ou ne faisait pas. » (Idem) En d’autres termes, cette “liberté” académique n’est rien d’autre qu’une “liberté négative”, une liberté ouvrant la porte à la paresse pour ceux qui ne veulent pas se soumettre à la rigueur des exigences des études scientifiques. Elle ne saurait prendre en charge le destin de l’Université allemande et encore moins celui de la nation allemande elle-même. Par cette critique, Heidegger veut donc ramener la compréhension du concept de liberté propre aux étudiants allemands à sa vérité, substituer une « nouvelle liberté » à la traditionnelle « liberté académique ».
Les obligations du corps des étudiants sont au nombre de trois; trois obligations que Heidegger énumère dans un ordre hiérarchique. La première obligation est celle d’être avec la communauté populaire. Cette obligation consiste à « prendre part à la peine, aux aspirations, aux capacités de tous les membres du peuple, quel que soit leur état, en partageant le fardeau et en mettant la main à la pâte. » (Idem) Ce devoir est à inscrire dans l’existence étudiante à travers ce qu’il nomme « le service du travail » (Idem).
La deuxième obligation réside dans le lien à l’honneur et au destin de la nation allemande. La concrétisation de cette obligation exige des qualités comme la disponibilité et la discipline. Par ailleurs, la disponibilité est elle-même caractérisée par le savoir et la capacité, deux atouts qui, additionnés à la discipline, permettent d’aller jusqu’au bout de la réalisation de cette obligation, c’est-à-dire jusqu’à la mort. Une telle obligation s’assume à travers le service militaire ou des armes.
La troisième obligation lie la communauté universitaire à la mission spirituelle du peuple allemand. Ce peuple doit œuvrer à réaliser son destin en s’accordant une possibilité, « celle de manifester la surpuissance de toutes les puissances formatrices du monde de l’existence humaine » (1982, p.16). Le peuple allemand veut se réaliser lui-même et pour lui-même, c’est-à-dire être un peuple selon l’esprit. Pour cela, « il exige chez ses guides et gardiens, la clarté la plus dure du savoir le plus haut, le plus vaste et le plus riche. » (Idem). Et au nom de cette exigence, la jeunesse étudiante doit se risquer, tôt dans l’âge adulte, à faire coïncider son vouloir avec le destin à venir de la nation allemande et s’engager résolument au service de ce savoir. Ce service du savoir n’est pas à comprendre comme une formation qui donne droit à un métier “distingué”. Heidegger le souligne clairement, « le savoir n’est pas au service des métiers, mais l’inverse : les métiers provoquent et administrent le savoir le plus haut, le savoir essentiel du peuple quant à la totalité de son existence. » (1982, p. 17).
Dans son discours, Heidegger a mis en évidence trois liens et trois services. Au niveau des liens, on dénombre les « liens par le peuple au destin de l’État dans une mission spirituelle » (Idem). Ces liens sont originels et contribuent à établir l’essence allemande. Ils engendrent trois services que sont le service du travail, le service militaire et le service du savoir. Ces services sont nécessaires et d’importance égale. Il revient au corps des étudiants de réaliser la volonté-de-l’essence de leur corps dans la quête du savoir en tenant compte des critères à atteindre tels que la plus haute clarté et la plus haute rigueur. Ce savoir se conquiert en relation avec le peuple et son État.
Ensuite, il précise ce qu’est le corps des enseignants. Pour Heidegger, le rôle d’avant-garde, de veille, de guide dans cette « incertitude permanente du monde » (1982, p. 14) doit être tenu par le corps enseignant de l’Université. Celui-ci doit être animé par
la force pour pouvoir aller seul, non par un entêtement personnel ni pour le plaisir de jouer le chef, mais par la force d’une vocation très profonde et d’une obligation très large. Une telle force oblige à l’essentiel, produit le triage des meilleurs, et suscite l’allégeance authentique de ceux qui sont d’un nouveau courage. (Idem).
Autrement dit, dans leur rôle de guide (Führer) et de gardiens (Hüter), tous puisent leur force dans la volonté commune de vouloir réaliser le destin de la nation allemande et dans l’accord avec la communauté. L’accord du corps des étudiants est un fait. L’essentiel pour lui est de trouver des guides susceptibles de l’aider à s’élever à la quête d’une « vérité fondée et savante » (IbIdem), à partir de laquelle il peut entreprendre des actions. Dans ces conditions, le corps enseignant œuvrera à atteindre l’essence de la science en visant des valeurs comme la simplicité et l’ampleur dans sa quête du savoir.
1.2. L’essence de la science
Heidegger rappelle que l’essence de la science chez les Grecs ou « l’essence grecque originelle de la science…. » (1982, p. 8) consiste dans la puissance manifeste dans l’existence. Partant de cet attribut de la science, il affirme que celle-ci « doit devenir l’évènement fondamental de notre existence spirituelle-populaire. » (IbIdem, p. 12). Le peuple allemand doit s’approprier la science, car c’est en elle que doit résider son monde spirituel. En effet,
le monde spirituel d’un peuple, ce n’est pas la superstructure d’une culture, ni davantage un arsenal de connaissances et valeurs utilisables, mais c’est la puissance de conservation la plus profonde de ses forces de terre et de sang, en tant que puissance d’é-motion la plus intime et puissance d’ébranlement la plus vaste de son existence. Seul un monde spirituel garantit au peuple sa grandeur. (IbIdem, p. 13)
Seule la science comme savoir peut réaliser cet objectif de la nation allemande. Heidegger est en quête d’une « science » qui se veut “objective”, mais aussi et surtout une science dont les interrogations s’enracinent au milieu du monde spirituel, c’est-à-dire du peuple. La notion d’objectivité y trouve son fondement véritable. Partant de là, la science « doit devenir la puissance formatrice de l’Université allemande en tant que corps » (1982, p. 18). Le corps enseignant et celui des étudiants doivent être imprégnés de ce concept de science et co-agir conformément à l’esprit de la science. Ce concept de science doit, pour ce faire, être sous le contrôle des facultés et des départements. Que ce soit la faculté ou le département, ces institutions académiques doivent être en mesure de se déployer en « une capacité de législation spirituelle enracinée dans l’essence de sa science » (Idem). Partant d’une telle exigence fondamentale, la faculté doit constituer le monde spirituel du peuple. Et le département doit s’ouvrir ou se décloisonner et éviter le dressage des étudiants en vue d’exercer un métier. Heidegger (1982, p. 19) estime, à cet effet, que
dès le moment où les facultés et les départements mettent en marche les questions essentielles et simples de leur science, dès ce moment les maîtres et les élèves sont saisis eux aussi par les mêmes nécessités et les mêmes tourments qui sont ceux de l’existence du peuple dans son État.
En somme, dans ce discours, Heidegger rejette deux approches de la science : d’abord, celle de la science comme une simple technique ou simplement comme un moyen en vue d’atteindre une fin. Ensuite, celle qui considère la science comme étant au service des métiers. Toutes les analyses instrumentales de la science ou les théories qui pensent la science dans son rapport à la pratique, sont caduques. Mais précisément, c’est le corps enseignant de l’Université qui peut permettre de réaliser une telle essence de la science. Dégager l’essence de la science ou reconnaître son essence originaire, pour Heidegger, permet de préciser celle de l’Université allemande.
1.3. L’essence de l’Université allemande
Heidegger veut affirmer l’originalité de l’Université ou le caractère propre de l’Université allemande et le rôle que l’histoire lui assigne dans la réalisation du destin du peuple allemand. Aussi, la charge de Recteur consiste-t-elle à « guider spirituellement cette haute école » (1982, p. 5) qu’est l’Université allemande. Cette institution ou haute école du peuple allemand comporte une essence qui fonde la mission spirituelle des maîtres et élèves ou du corps enseignant et corps enseigné. Une telle essence réside dans le « caractère historique propre » (Idem) du destin du peuple allemand. L’Université doit conduire à la réalisation d’une telle essence en gardant tout ce qui contribue à sa spécificité, comme l’autonomie, autonomie comprise comme cette capacité à décider soi-même, à s’imposer des tâches et à déterminer les conditions de réalisation de celles-ci. L’autonomie ainsi définie permet d’être soi-même ou de se réaliser soi-même, conformément à ce qui a été projeté. L’essence de l’Université allemande ne peut être définie que pour le futur. Seul le futur permet de spéculer, car la connaissance de l’état de l’Université, aujourd’hui, et la familiarité avec son histoire ne constituent pas un savoir suffisant qui puisse permettre une définition adéquate de son essence. Dans ces conditions, cette essence doit être une œuvre d’auto-méditation, et l’auto-méditation doit conduire à l’auto-affirmation de l’Université allemande. Cette auto-affirmation réalise l’essence de l’Université allemande qui,
à partir de la science et à travers la science, éduque et élève les guides et gardiens du destin du peuple allemand. Vouloir l’essence de l’université allemande, c’est vouloir la science, au sens de vouloir la mission spirituelle historiale du peuple allemand en tant que peuple qui se sait lui-même dans son État. Science et destin allemands doivent, dans cette volonté de l’essence, parvenir en même temps à la puissance. (1982, pp. 7-8).
L’essence de l’Université allemande réside dans la science qui permet de réaliser la mission historique et spirituelle de l’Allemagne et d’affirmer sa puissance. L’Université allemande réalise son essence ou déploie son essence à partir et à travers la science, qui éduque et élève les guides et gardiens du peuple allemand. L’Université a donc cette obligation de former de futurs dirigeants capables de réaliser la mission historique des Allemands.
Heidegger, dans son discours, cherche à comprendre aussi en quoi consiste l’essence de la science. Ce n’est point ce qu’est la science en général qui l’intéresse mais plutôt la science devenue une propriété de la nation allemande. En d’autres termes, il s’intéresse à une science constituée pour et par la nation allemande. Et l’Université allemande ne pourrait se constituer et devenir une puissance que si l’unité des trois services est réalisée : le service du travail, celui des armes et celui du savoir. Autrement dit, ces trois services doivent se constituer originellement en « une seule force marquante. » (1982, p. 20) Cette force est à orienter dans ce que Heidegger nomme le “combat averti” (Idem).
1.4. La visée finale : le combat averti
L’adresse de Heidegger aux corps des étudiants et des enseignants a pour finalité le combat du peuple allemand. Celui-ci est au centre de la préoccupation heideggérienne. Et, selon lui, « Toutes les capacités de volonté et de pensée, toutes les forces du cœur et toutes les aptitudes de la chair, doivent se déployer par le combat, se renforcer dans le combat et se conserver en tant que combat » (1982, p. 20). En ce sens, Heidegger nomme les acteurs de l’Université, la communauté de combat des professeurs et des élèves. Cette communauté de combat ne pourra faire de l’Université un lieu de législation spirituelle que si les deux principaux acteurs, c’est-à-dire le corps enseignant et le corps des étudiants
mènent leur existence d’une façon plus simple, plus dure et plus libre de besoins que ne le feront tous les autres membres du peuple. Quiconque guide doit reconnaître à ceux qui le suivent leur force propre. Mais quiconque suit porte en soi la résistance. Cette opposition eidétique dans le guider et le suivre ne doit pas être estompée, encore moins effacée. (Heidegger, 1982, p. 21)
Le combat entretient l’opposition, implante chez les maîtres ou les enseignants et les élèves ou les étudiants « cette disposition fondamentale, à partir de laquelle l’auto-affirmation auto-définissante autorise l’auto-méditation résolue en vue d’une autonomie authentique. » (Idem). La communauté de combat des professeurs et des élèves pour réaliser cette auto-méditation et auto-affirmation doit refuser de se contenter d’effort occasionnel, de modifier de vieilles orientations et de faire quelques ajouts pour véritablement déployer un effort fondamental.
Telles sont les grandes lignes du Discours de Rectorat de Heidegger. Elles indiquent l’orientation sur ce que va être son ambition de Recteur et suscitent des débats sur son engagement au sein du national-socialisme. Le discours de Rectorat se résume-t-il à un propos idéologique ou a-t-il une portée philosophique ? Ce discours ne peut-il pas se comprendre aussi en dehors du contexte idéologique, politique, social, etc., de l’Allemagne de 1933 ?
2. L’ACTUALITÉ DU DISCOURS SUR « L’AUTO-AFFIRMATION DE L’UNIVERSITÉ ALLEMANDE »
Les ambitions de Heidegger pour l’Université de Fribourg ont été de courte durée. L’échec de sa tentative de réformer l’Université allemande le conduit à la démission. En effet, il démissionne un an après être entré en fonction, soit le 27avril 1934. Cette démission se justifie par son refus d’accepter la décision de révocation du Parti national-socialiste (NSDAP) des deux Doyens anti-nazis, nommés par lui-même, que sont les professeurs Erich Wolf et Möllendorf. Soulignons que le Discours de Rectorat de Heidegger sera censuré par les membres de la Gestapo. Ce discours qui prouve, pour certains l’allégeance de Heidegger au National-socialisme, est paradoxalement jugé subversif par ce mouvement politique. En effet, l’intention de sauvegarder la nouvelle liberté contre les institutions politiques qui veulent l’assujettir est manifeste chez Heidegger. Son discours reste d’actualité par la permanence des questions évoquées. Il a examiné les conditions dans lesquelles l’institution universitaire peut, dans une symbiose avec les aspirations de la nation allemande, participer à l’épanouissement de celle-ci.
Aussi ce discours, au-delà de son aspect politique, présente-t-il un intérêt philosophique. On peut même percevoir un lien entre ce discours de Rectorat et l’ensemble de la problématique philosophique de Heidegger. Ainsi, plusieurs points méritent d’être évoqués. On peut relever par exemple que ce discours est un acte fondateur de la tâche de Recteur, un refus du scientisme et une expression de l’idée selon laquelle le savoir est au service du peuple.
2.1. Un discours fondateur
Le discours de Heidegger est un texte fondateur de sa future gestion de l’Université allemande. Cette allocution n’est pas un plan de gestion ou un programme d’activités à mener pour l’Université allemande, mais plutôt ce qui doit inspirer tous les plans, toutes les stratégies de l’Université. Au fond, Heidegger dégage ce qui constitue l’essence de l’Université allemande afin de permettre aux différents acteurs de mettre en place tous les projets susceptibles de réaliser celle-ci. L’initiative du philosophe est originale dans la mesure où il ambitionne de redonner sens à l’Université allemande. Ce discours s’interroge sur le sens des sciences et de ce qui doit déterminer la tâche de l’Université allemande dans un contexte caractérisé par la situation désespérante des étudiants, la multiplicité de disciplines dispersées, etc. Cette interrogation trouve sa réponse dans le titre de son discours de Rectorat, intitulé « L’auto-affirmation de l’Université allemande ». Il le dit expressément : « Aucun discours de rectorat de ce temps-là n’a osé se donner un pareil titre. » (Heidegger, 1988, p. 18).
En effet, non seulement de son temps, mais aussi de nos jours, aucun discours de Recteur, de Président d’Université ne s’élève jusqu’à une telle exigence dans l’idée que l’on se fait de la fonction de premier responsable d’Université. À la suite de l’adoption du Führerprinzip, le principe de la nomination des Chefs par l’instance immédiatement supérieure, le Deutscher Studentenbund, le Recteur est immédiatement nommé par le ministre du Reich et les Doyens sont nommés par le Recteur. Le Recteur est aussi révocable par le ministre du Reich. Le successeur de Heidegger ne sera pas élu par le corps des enseignants, mais plutôt nommé par le pouvoir du Reich ou le Parti national-socialiste (NSDAP).
2.2. Le refus du scientisme
« L’auto-affirmation de l’Université allemande » s’explique, dans le contexte de l’élection de Heidegger comme Recteur, par le combat contre le scientisme de l’époque, afin d’affirmer l’originalité de cette Université. Le discours de Rectorat énonce une position contraire à celle de la « science politique ». À la différence de la politologie, par “science politique” il faut comprendre l’idée suivante : « la science en tant que telle, son sens et sa valeur, est mesurée à son utilité pratique pour le peuple. » (Heidegger, 1988, p. 19). Et dans la logique de la science politique, l’Université doit se soumettre à une organisation uniquement technique. De telles idées en vogue dans l’Université allemande devraient être combattues. La révolution technique a fini par déclarer la pensée calculante, seule apte à s’exercer au détriment de la pensée méditante. Pour combattre cela, « L’Université devait se renouveler à partir d’une réflexion propre et conquérir ainsi une position solide en face de la politisation de la science ». (IbIdem., p. 20). L’Université doit promouvoir la pensée méditante, car le propre de l’homme, à savoir son essence, est d’être un être pensant. La philosophie, définie comme un art de questionnement, promeut la pensée méditante. Et la philosophie, dans la pensée heideggérienne, couronne toutes les sciences et tous les arts. Elle est une archi-science, de sorte que la science est indissociable de la philosophie.
Ce refus de la politisation de la science était un fait dans l’Allemagne des années 1933. En effet, certains Recteurs élus, comme celui de l’Université de Francfort, Ernest Krieck, réclamaient le démembrement de l’Université en établissements de formations professionnelles ayant chacun leur spécialité. Des formations ouvertes sur des métiers précis. A contrario, Heidegger part du principe que l’Université doit prendre l’ambition de maintenir en éveil la pensée. C’est le constat qu’établit aussi Christian Sommer (2013, pp. 30-31) à la lecture du Discours de Rectorat :
Il faut selon Heidegger réorganiser les “formes fondamentales” de la communauté universitaire, c’est-à-dire intervenir (eingreifen) dans les “Facultés et les Départements”, en fonction de la nouvelle science souveraine et rectrice qu’est la philosophie comme questionnement, pour lui assurer sa place hégémonique et permettre de relier le corps universitaire aux “nécessités ultimes” du “Dasein populaire-étatique”.
À défaut, nous succombons dans ce nihilisme caractérisé par la domination mondiale de la technique. Aussi le Dasein allemand doit-il chercher les valeurs primordiales existentielles comme les “forces de la terre et du sang” (erdunbluthaftenKräfte), “l’attachement au sol” natal ou l’enracinement (Bodenständigkeit) dans la patrie (Heimat) afin de se réaliser. Le thème philosophique heideggérien de l’abandon de l’homme au sein de l’étant apparaît dans le discours de Rectorat. Dans cet abandon, l’homme doit, malgré tout, se réaliser. Et la Science et le Travail constituent la réponse à cet abandon de l’homme en permettant à celui-ci d’organiser l’étant selon ses projets et sa volonté.
2.3. Le savoir au service du peuple
Heidegger rejette la rupture entre la communauté universitaire et la communauté populaire (ouvriers), tout comme il refuse que la philosophie universitaire devienne une pensée coupée, privée de sol et de puissance. Il postule l’établissement d’une coopération étroite entre ces entités. Le savoir universitaire doit avoir une prise sur les préoccupations du peuple. La finalité de l’existence de l’Université allemande, c’est de permettre la réalisation des aspirations du peuple allemand. C’est pourquoi, le service du savoir occupe la première place chez Heidegger : « travail et défense sont, comme toute activité humaine, fondés dans un savoir et éclairés par lui », précise Heidegger. (1988, p. 21).
Heidegger refuse la séparation établie depuis l’Antiquité grecque entre le travail manuel et le travail intellectuel. Il récuse les barrières et les préjugés qui caractérisent le travail manuel. On peut reconnaître chez lui une certaine exaltation du travail manuel, mais pour finir par signifier le lien intrinsèque qui existe entre les deux : le travail intellectuel ne prend sens qu’à partir du manuel. En d’autres termes, le travail intellectuel ou de la pensée ne peut se comprendre qu’à partir de son enracinement dans l’essence du travail originel manuel.
On peut percevoir dans ce discours heideggérien une remise en cause de la conception élitiste de la philosophie et du savoir en général en Allemagne. L’Université allemande de son époque, selon lui, évoluait dans la tradition mandarinale. Au-delà de ces aspects qui montrent les mérites du Discours de Rectorat, quelles peuvent en être les limites ?
3. L’ESPOIR DE MARTIN HEIDEGGER DANS LE NATIONAL-SOCIALISME
Notre réflexion aboutit dans cette partie à la dimension politique du discours de Rectorat de Martin Heidegger. Une dimension politique qui apparaît à l’étude, à la compréhension de certaines notions, de certains arguments utilisés par Heidegger comme une adhésion ou un soutien ouvert et fort à la révolution nationale-socialiste. Historiquement, Heidegger a fini par admettre cet engagement, ne serait-ce que pendant son bref règne de Recteur de l’Université de Fribourg, soit une année au plus, c’est-à-dire de mai 1933 à avril 1934. Il reconnaît sans hésitation que cet engagement correspondait à sa conviction (Heidegger, 1988, p. 16). Il s’est inscrit au parti nazi[2] le 1er mai 1933 et a sincèrement cru en Hitler. Cet engagement le conduit à apporter son soutien au mouvement national-socialiste. En effet, il s’agissait pour Heidegger de trouver une position nationale et surtout sociale dans cette cacophonie d’opinions et de tendances politiques diverses des vingt-deux partis politiques de l’époque. Une forme d’optimisme l’incitait à s’engager pour le national-socialisme. Et le « discours de Rectorat », à ses yeux, se présente au fond comme une tentative d’infléchir ou de réorienter la révolution nationale-socialiste dans une vision qui ne s’enracine pas dans le racisme et le biologisme. Malheureusement, ce discours comporte des insuffisances ou des points d’accointance avec l’idéologie nationale-socialiste.
3.1. Une Université sans liberté académique
Peut-on dire qu’avec le discours de Rectorat, Heidegger proclame l’autonomie de l’enseignement ? L’Université n’est-elle pas assujettie à des préoccupations politiques qui peuvent la handicaper sérieusement dans sa quête du savoir désintéressé ? Le savoir désintéressé a-t-il encore sa place dans les Universités allemandes sous domination nazie ?
On peut répondre à toutes ces questions par la négative, au vu du développement de la pensée heideggérienne dans le « Discours de Rectorat ». La mission de l’Université est confondue avec la mission historique et spirituelle du peuple allemand : réaliser le salut de l’Occident. Dans ces conditions, la crainte de transformer l’Université allemande en un milieu de propagande, d’assujettissement idéologique, transparaît dans le discours de Rectorat. Cette acceptation des exigences politico-juridiques de l’État national-socialiste, même si cela est juste un moment, dans la stratégie de Heidegger, transforme l’Université en un centre d’endoctrinement. Contrairement à ce que Heidegger affirme, l’Université, pour bien fonctionner certes, ne peut pas se départir des préoccupations de la nation, mais elle ne peut pas davantage être sous son contrôle total parce qu’elle veut réaliser le destin de l’Allemagne. Le risque est énorme que l’Université ne soit plus autonome et que rien ne se décide par et en son sein. L’enseignement de la philosophie va se muer en cours d’idéologie. En effet, c’est ce que nous constatons avec l’exagération du rôle historique de la Grèce dans l’avènement de la philosophie et du rôle que doit jouer maintenant l’Allemagne dans la poursuite de cette aventure de la raison ou du logos. Jürgen Habermas (1988, p. 67) constatait cet éloignement heideggérien de l’activité proprement philosophique en ces termes :
Depuis 1929, Heidegger n’a cessé de s’éloigner de la philosophie universitaire ; après la guerre, il s’est lui-même égaré dans les régions d’une pensée située au-delà de la philosophie, au-delà de toute argumentation. Ce n’était plus là la vision élitiste qu’avait d’elle-même une corporation universitaire ; c’était la conscience d’une mission réservée à sa propre personne, incompatible avec l’aveu d’erreurs commises, ni surtout d’une faute dont il se serait rendu coupable.
Heidegger fait infléchir les exigences de l’Université afin de les accommoder à la réalisation des objectifs du National-socialisme. L’analyse du discours de Rectorat laisse percevoir un lien avec le programme platonicien de la fondation métaphysique du politique. Aussi, on peut avancer l’hypothèse que ce discours reprend l’idée selon laquelle c’est la philosophie, en tant que la science royale et souveraine du “questionnement essentiel” selon Heidegger, qui éduquera les gardiens de la Cité.
3.2. Le discours du Rectorat comme reprise de la République de Platon
Heidegger est soucieux du rôle que doit jouer la philosophie dans la réalisation de cette mission historique de l’Allemagne. C’est pourquoi on perçoit chez lui l’idée d’une forme de domination par les philosophes, une idée platonicienne, reprise par Heidegger dans son discours de Rectorat. Du reste, le Discours de Rectorat s’achève par une référence pleine d’optimisme à une citation de Platon. Heidegger (1982, p. 22) reprend Platon expressément en ces termes : « Tout ce qui est grand se dresse dans la tempête[3]… ». La sonorité platonicienne est nettement perceptible dans le discours de Heidegger. Le philosophe est le guide spirituel (geistige Führer). Et l’Université est le moyen par lequel s’opère l’éducation du peuple allemand ou la formation de la jeunesse académique. En somme, l’Université a la charge de former la future classe dirigeante allemande. Dans l’institution académique, la philosophie est le savoir par excellence, la science royale qui, par son art du questionnement, permet l’accès au Vrai et au Bien. Le philosophe, à l’image du philosophe-roi platonicien, a la responsabilité de guider les guides, de garder les gardiens. Tout comme dans la République IV, où Platon fonde l’ordre de l’État idéal ou rêvé dans l’éducation de l’individu, Heidegger aspire à ériger l’Université ou l’Académie en centre d’éducation des meilleurs gardiens qui pourront réaliser par la suite la cohésion et l’unité de l’État. L’éducation des meilleurs gardiens permettra qu’ils éduquent et dirigent à leur tour le corps enseignant.
Le projet de Heidegger s’inscrit dans la logique platonicienne et ne se réalisera qu’en procédant par une stratégie ou par une forme de ruse, par laquelle l’Université s’affirme avec l’État, c’est-à-dire comme institution fondamentale de l’État. En effet, pour Christian Sommer (2013, p. 31) :
Selon le projet de 1933, l’Université, institution étatique, doit alors, au moins dans un premier temps, répondre aux “exigences” de l’“État nouveau”, c’est-à-dire procéder à l’alignement (Gleichschaltung) sur le régime qui vient de prendre le pouvoir, ce qui signifie, selon la perspective ambitieuse de Heidegger, que l’Université doit s’aligner sur l’État tout en le guidant pour réaliser l’essence du peuple : l’Université a pour tâche d’éduquer le peuple, le former, par l’État.
L’Université ne saurait être séparée de l’État. Elle est son membre suprême, ou plutôt la tête, l’esprit. Au-dessus du corps enseignant ou de la communauté éducative qui forme les couches dirigeantes, se trouve un philosophe. Et ce philosophe est un guide. C’est pourquoi, il assure l’éducation des dirigeants. À l’image de l’État idéal de Platon gouverné par des philosophes-rois, Heidegger ambitionne de construire cet État. Dans son discours, il laisse clairement entendre qu’en tant que philosophe, il possède cette puissance de questionner. En associant cette forme suprême de savoir qu’est la philosophie à son titre de Recteur de l’Université ou spiritus rector, il assure l’alliance du pouvoir politique et la philosophie. Et une telle alliance dans la révolution nationale-socialiste peut permettre de réaliser l’État idéal. L’auto-affirmation de l’Université allemande aboutit à la revendication, à la volonté d’instaurer un gouvernement philosophique. Seul ce gouvernement philosophique connaît l’idée du Bien et est à même de la réaliser. Mais comme le soulignera C. Sommer (2016, pp. 49-50),
Après la démission de son poste de spiritus rector, Heidegger qualifiera l’épisode du Rectorat, entendons son programme platonicien, d’“échec”. Avec cet “échec”, la perspective d’une influence directe sur l’État s’éloigne et avec elle la possibilité d’établir les conditions pour éduquer les guides, voire le guide suprême, à la philosophie. Dans le Discours de Rectorat, peut-on percevoir le lien des thèses développées avec celles de l’antisémitisme ? Peut-on soupçonner ce discours de véhiculer une pensée antisémite ?
3.3. L’antisémitisme de Heidegger
L’appartenance de Heidegger au parti national-socialiste est attestée par certains écrits. Le Discours de Rectorat atteste aussi de cette connivence avec l’idéologie du Führer. Dans ce texte, l’ambition de contribuer au succès du mouvement national-socialiste se perçoit dans une certaine volonté de vouloir servir de guide spirituel au Führer. Jean-Michel Palmier (2014, p. 125), parlant de cet engagement heideggérien soutient que :
On ne peut nier raisonnablement que ces textes portent l’empreinte d’un certain monde idéologique, celui du National-socialisme. Pour les décrire, il faudra pouvoir tracer une véritable constellation de ces thèmes : certains sont propres à Heidegger et se rencontrent dans ses écrits ultérieurs : l’attachement au pays natal, la mystique de la Forêt Noire, l’exaltation du travail manuel. D’autres sont communs à toute une génération : le sentiment de déclin, l’humiliation et la misère de l’Allemagne.
Le discours de Rectorat finit par accorder de la valeur à des notions comme le biologique, le sang, la race, le sol, la nation, le peuple, l’État, le travail, le combat, la communauté, le destin, la mission, etc. Ce sont des thèmes ou des motifs véhiculés aussi par le discours public nazi. La propagande nazie usait d’une rhétorique qui reconnaissait aux Juifs, un “don particulièrement accentué pour le calcul” ou leur “faculté de compter”, une prouesse dans l’incitation et le déclenchement des guerres sans être directement concernés et elle déplorait l’“enjuivement” de la société allemande, etc. Et comme le rapportait Sidonie Kellerer (2014, p. 991) dans une lettre du 22 mai 1992, Heidegger écrivait : « Ces Juifs, à force de vouloir s’enrichir, ne reculent devant rien ».
L’antisémitisme de Heidegger remonte très tôt, vers les années 1916. On trouve par exemple, selon Claude Romano (2014, p. 1011), dans la correspondance du 18 octobre 1916 à sa future femme Elfride, une formule de plainte telle que « “l’enjuivement” de la culture et des Universités allemandes ». Cet antisémitisme, Heidegger le précisera par la suite, se dirige particulièrement contre les Juifs à l’Université, indexant le nombre élevé de Juifs présents à l’Université. À partir de là, des questions pertinentes se posent. Ces questions sont formulées dans les propos suivants de Peter Trawny (2014, p. 157) : « Jusqu’où va la contamination antisémite de la pensée heideggérienne ? Attaque-t-elle l’ensemble du corpus de cette pensée ? Saisit-elle en général l’histoire de l’être, c’est-à-dire la pensée de l’histoire de l’être ? ». De ce point de vue, en se basant sur le questionnement de Peter Trawny sur la dimension antisémite de la pensée de Heidegger, on peut formuler la question suivante : quelle a été l’attitude de Heidegger face à cet antisémitisme qui gangrénait toute l’Europe ? Historiquement, il est admis que Heidegger n’a pas manifesté de soutien public à la politisation du Troisième Reich.
Donatella Di Cesare (2016, p. 35) précise que « le nazisme a été un projet politique. Il a été moins une Weltanschaung[4] idéologique qu’une philosophie à part entière. Emmanuel Levinas l’avait compris avec lucidité… ». Soulignons que Levinas ne cache guère son admiration pour l’excellence de la phénoménologie de Heidegger. L’ouvrage de celui-ci Sein und Zeit comporte une série d’analyses phénoménologiques merveilleuses. Dans Ethique et Infini (1982, p. 27), Levinas classe Heidegger parmi les plus grands philosophes et Sein und Zeit comme l’un des plus beaux livres parmi les quatre ou cinq ouvrages de philosophie. Mais, il ne cesse de le reconnaître, « C’est toujours avec honte que j’avoue mon admiration pour le philosophe. » (Entretien avec Malka Salomon, 1989, p. 104). Levinas ne pardonne pas à Heidegger, d’abord d’avoir été hitlérien en 1933, ensuite d’entretenir un silence sur sa prise de position.
Pendant que Heidegger démissionnait (avril 1934) de son poste de Recteur de l’Université allemande de Fribourg-en-Brisgau, Levinas publiait aussi la même année (1934) dans la revue Esprit, un bref texte intitulé « Quelques réflexions sur l’hitlérisme ». Un texte écrit dans le pressentiment du pire à venir. Dans ce texte, il n’est fait aucunement mention de Heidegger. Mais il peut se laisser interpréter comme une réaction de Levinas au Discours de Rectorat.
Un texte qui, selon Pierre Hayat dans son introduction à l’ouvrage de Levinas (1994, p. 8), définit l’hitlérisme comme « une rupture radicale » avec l’humanisme occidental. La société occidentale animée de la lumière de la raison est impuissante face aux discours exaltant la race, l’attachement profond au sol natal et l’autochtonie, faisant l’apologie de la force conquérante. Mais que dit précisément Levinas dans ce texte ? A contrario de Heidegger, Levinas (2008, p. 23) taxe l’hitlérisme de philosophie « primaire », d’ « un réveil des sentiments élémentaires ». La philosophie de l’hitlérisme est une remise en cause des principes mêmes de la civilisation. Et ce conflit touche toute la société occidentale et ne se résume pas à une simple remise en cause du libéralisme. En effet, il le souligne assez clairement (IbIdem, p. 33),
le racisme ne s’oppose pas seulement à tel ou tel point particulier de la culture chrétienne et libérale. Ce n’est pas tel ou tel dogme de démocratie, de parlementarisme, de régime dictatorial ou de politique religieuse qui est en cause. C’est l’humanité même de l’homme.
Malheureusement, l’hitlérisme n’a pas été perçu par tout le monde comme une barbarie qui s’abattait sur l’humanité. Et Heidegger, pour nous, demeure un philosophe qui s’est trompé sur la nature réelle du national-socialisme et du parti nazi. Son engagement a reçu les qualificatifs d’erreur politique, d’aveuglement politique, de tragique, de terrible, etc. Et son erreur s’est amplifiée avec son silence volontaire, son refus de communiquer publiquement sur cette tragédie après la guerre. Tout cela vient confirmer l’antisémitisme de Heidegger. Sur cette question, Peter Trawny (2014, p. 156) tire la conclusion suivante :
Il y a chez Heidegger un antisémitisme inscrit dans l’histoire de l’être qui semble contaminer bien des dimensions de sa pensée. Cet état de fait jette une nouvelle lumière sur la philosophie de Heidegger ainsi que sur sa réception. Si jusqu’alors l’engagement national-socialiste de Heidegger fut un problème qui a conduit en partie à des condamnations exagérées, en partie à des réticences justifiées, alors la publication des Cahiers noirs révèle clairement l’existence d’un antisémitisme spécifique qui émerge à un moment où Heidegger soumet le national-socialisme réellement existant à un examen particulièrement critique.
Au-delà de l’antisémitisme de Heidegger, le Discours de Rectorat exprime son profond mépris pour les autres civilisations. Dans ce discours, il réactive son européocentrisme légendaire.
3.4 L’européocentrisme de Heidegger et la critique partiale de la pensée heideggérienne
La pensée heideggérienne est européocentriste. Cette critique récurrente peut encore se prouver dans le Discours de Rectorat. Toute la rationalité se résume à l’œuvre de l’Occident. La philosophie est d’essence grecque. Seul l’apport de la Grèce retient l’attention de Heidegger. D’où l’idée que la philosophie est née de rien. La notion de “miracle grec” véhiculée répond à cette prodigieuse invention de la Grèce, par extension de l’Occident. Et ce thème constant selon lequel l’univers de la pensée s’est vu imprimer le premier mouvement par les Grecs, est présent dans ce discours. L’idée aussi que l’autre mouvement doit venir des Allemands est reprise. L’émergence de l’idéologie national-socialiste crée un contexte propice pour la transition vers l’autre mouvement et il incombe aux Allemands de réaliser le destin de l’Occident. Ainsi le Discours de Rectorat manifeste clairement l’idée selon laquelle seuls les Allemands pourront réaliser l’avenir de l’Occident.
Nulle autre civilisation n’a contribué à l’éclosion de la philosophie ou de la rationalité. Cet européocentrisme est du racisme. Il s’exprime dans l’ “occidentalité” exclusive de la philosophie. Et par là, il faut comprendre, selon Marcien Towa (1971, p. 25), que « la philosophie était considérée comme l’attribut essentiel et indispensable d’une humanité véritable ».
Aujourd’hui, cette thèse heideggérienne est remise en cause par les historiens de la philosophie comme Jan Assmann, Roger-Pol Droit, etc., et les philosophes africains comme Jean-Godefroy Bidima, Souleymane Bachir Diagne, Séverine Kodjo-Grandvaux, etc. En réagissant à cette approche de l’histoire de la philosophie comme telos propre d’une culture privilégiée, Souleymane Bachir Diagne (2016, p. 56) invite au contraire à
convenir que la philosophie n’a ni commencement ni lieu d’élection. Car, d’une part, les Grecs eux-mêmes n’ont pas pensé qu’ils étaient à l’origine de l’activité philosophique. Platon indique toujours ce que la Grèce doit à la civilisation égyptienne. […] Descartes signale […] que le renouvellement de la philosophie, que lui-même représente, tient à l’invention d’une science dont il dit qu’elle est étrangère : il pense précisément à l’algèbre issue du monde arabo-musulman.
Par conséquent, l’auteur rejette ce « nationalisme ontologique » (2017, p. 89) représenté par Heidegger. Toutes les cultures possèdent à la fois une sagesse profonde et une disposition à un retournement critique sur soi. Cette capacité intrinsèque à toute société de questionner, de remettre en cause ce qui a toujours été admis et donc d’être en mesure d’utiliser, d’employer les lois logiques de la pensée comme les principes d’identité, de contradiction ou de tiers exclu constitue la preuve que la logique humaine est la même partout. Cette logique humaine est donc à l’œuvre dans le vécu de chaque culture. C’est pourquoi, la philosophie ne saurait être le propre de l’Europe. En effet, démontre-t-il (2016, p. 56),
Toutes les sociétés humaines sont des sociétés où l’on sait que l’on va mourir, où l’on honore les morts, où l’on a le sentiment que la mort d’un être humain est chargée de significations au point que les cultures en général ont inventé la notion d’un autre monde au-delà de la mort. Toutes ces questions amènent à interroger le sens de l’existence et ne sauraient être absentes d’aucune culture humaine.
Le mythe du “miracle grec” ou la Grèce comme le seul berceau de la philosophie est un refus de retracer l’histoire des appropriations de la philosophie grecque.
Conclusion
Comment aider l’Allemagne à réussir sa mission salvatrice de l’humanité occidentale en crise ? Ou comment se servir de la révolution nationale-socialiste pour participer à cette mission qui consiste à accomplir le destin de l’Allemagne ? Le Discours de Rectorat de Heidegger se donne les moyens de prendre part à cette aventure. Ce discours, soucieux de spiritualiser le national-socialisme, est précis sur les ambitions ; il prétend orienter et servir de guide. Car l’Université est le lieu institutionnel privilégié pour accomplir la mission spirituelle de l’Allemagne dans l’histoire universelle. C’est pourquoi ce discours cherche à déterminer le sens des sciences ou l’essence de la science, l’essence de l’Université, et à définir la tâche de l’Université. Toujours dans cette logique, Heidegger veut clarifier, déterminer le rôle des étudiants et des enseignants. Le savoir est à mettre au service du peuple, de la patrie.
De ce discours fondateur de sa mission de Recteur, on peut retenir que le principe d’orienter ses actions en tant que Recteur, d’organiser tout le système universitaire allemand des années 1933, en lui assignant une mission au service de la patrie, reste d’actualité. Mais de quelle mission s’agit-il ? Quelle aspiration le savoir universitaire tel que conçu par Heidegger en rupture avec l’élitisme classique des Universités réalise-t-il ? Le discours du Rectorat de Martin Heidegger fait-il allégeance au national-socialisme ?
Oui, pour nous, l’analyse des propos du philosophe ne fait plus de doute, et le contexte d’élaboration de ce discours le prouve davantage. Le Discours de Rectorat précise la vision heideggérienne de la grandeur du national-socialisme et des moyens de sa réalisation. Ce discours reprend le rêve platonicien d’instaurer un gouvernement de philosophes-rois. L’Université, rattachée à la communauté du peuple et reliée à l’État sous l’égide du philosophe Recteur, du berger de l’être, doit assurer la formation des dirigeants et configurer ainsi le monde spirituel du peuple allemand. Un tel projet commande l’engagement dans le national-socialisme. Et cet engagement politique s’est accompagné d’une dimension antisémite, même si Heidegger veut le restreindre uniquement aux questions universitaires. Mais au-delà de son engagement nazi, peut-on encore lire sereinement Heidegger ? C. Romano (2014, p. 1016) s’est posé la même question et sa réponse se veut cinglante :
Est-ce que la philosophie de Heidegger conserve un intérêt malgré les stigmates ineffaçables de cet antisémitisme ? Comme beaucoup d’autres, je répondrai que oui. […] La pensée de Heidegger restera à la fois une pensée majeure du XXᵉ siècle et une pensée qui s’identifiera en partie avec ce qu’il y a eu de pire dans ce siècle.
Références bibliographiques
CESARE Donatella Di, 2016, Heidegger, les Juifs, la Shoah. Les Cahiers noirs, Traduit de l’Italien par DENIAU Guy, Éditions du Seuil, 381 p.
DIAGNE Souleymane Bachir, Juin 2016, « Qu’est-ce que la philosophie ? Est-ce une invention de l’Occident ? », in Philosophie magazine, n° 100, pp. 56-57.
DIAGNE Souleymane Bachir, 2017, « Pour une histoire postcoloniale de la philosophie », in Cités, « Le postcolonialisme : une stratégie intellectuelle et politique », n° 72, pp.81-93.
HABERMAS Jürgen, 1988, Martin Heidegger. L’œuvre et l’engagement, Traduit de l’allemand par ROCHLITZ Rainer, Collection « La nuit surveillée », Les éditions du Cerf, Paris, 73 p.
HEIDEGGER Martin, Octobre 1982, L’auto-affirmation de l’Université allemande, Discours tenu pour la prise en charge solennelle du Rectorat de l’Université de Fribourg-en- Brisgau, le 27.5.1933, traduit de l’Allemand par GRANEL Gérard, Édition : Trans-Europ-Repress (TER), 22 p.
HEIDEGGER Martin, 1988, Réponses et questions sur l’histoire et la politique, interrogé par « Der Spiegel », traduit de l’allemand par LAUNAY Jean, Paris, Mercure de France, 82 p.
KELLERER Sidonie, Décembre 2014, « Heidegger et le nazisme à travers sa correspondance avec sa famille et Kurt Bauch », in Critique, Tome LXX-N° 811, pp.989-998.
MALKA Salomon, 1989, « Entretien avec Emmanuel Levinas », in Lire Levinas, Paris, Les Éditions du Cerf, pp103-114.
SEBBAH François-David, 2010, Levinas, Perrin/ Société d’édition des Belles Lettres, 250 p.
Entretien de ROMANO Claude avec SERBAN Claudia, Décembre 2014, « L’idée d’antisémitisme philosophique est un non-sens », in Revue Critique, Tome LXX-N°811, pp.1008-1018.
Entretien avec FEDIER François, réalisé par de RUBERCY Eryck de, avril 2014 « Heidegger était-il nazi ? Antisémite ? », Revue des deux mondes, pp. 102-122.
PALMIER Jean-Michel, 2014, Les écrits politiques de Heidegger, Paris, L’Herne, 297 p.
TOWA Marcel, 1971, Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, Yaoundé, Editions Clé.
TRAWNY Peter, 2014, Heidegger et l’antisémitisme. Sur les “Cahiers noirs”, Traduit de l’Allemand par CHRIST Julia et MONOD Jean-Claude, Paris, Éditions du Seuil, 163 p.
SOMMER Christian, 2013, Heidegger 1933. Le programme platonicien du Discours de Rectorat, Paris, Hermann Éditeurs, 61 p.
LEVINAS Emmanuel, 1982, Éthique et infini (dialogues d’Emmanuel Levinas et Philippe Nemo), Paris, Fayard et Radio-France, Librairie générale française, collection Le livre de Poche, n°4018, série Biblio-essai, 121 p.
LEVINAS Emmanuel, 2008, Les imprévus de l’histoire, Paris, Librairie générale française, collection Le livre de Poche, n°4296, série Biblio-essai, 190 p.
ALLOCUTION DE HEGEL À SES AUDITEURS À L’OUVERTURE DE SES LEÇONS DE BERLIN, LE 22 OCTOBRE 1818 : INTRODUCTION À UNE « PHILOSOPHIE DE L’UNIVERSITÉ »
Oumar DIA
Maître-Assistant, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (SÉNÉGAL)
Résumé : Le 22 octobre 1818, Hegel prenait fonction à l’Université de Berlin en qualité de professeur de philosophie. À cette occasion, il a, en ouverture à ses cours, prononcé un discours programmatique dans lequel il a exposé les grands principes d’une « philosophie de l’université » qui consiste non pas à placer l’université sous le regard extérieur de la discipline philosophique, mais à expliciter la philosophie que recèle en soi la chose universitaire et que le fonctionnement de l’institution est censé mettre en œuvre conformément à ce qui fait son essence. C’est de cela que cet article entend rendre compte en suivant les principaux moments à travers lesquels le Philosophe de Berlin avait exposé cette thèse.
Mots-clés : AUDITEURS, BERLIN, DISCOURS, ESSENCE, GERMANITÉ, PHILOSOPHIE, UNIVERSITÉ.
Abstract : On October 22, 1818, Hegel took office at the University of Berlin as a professor of philosophy. On this occasion, he opened his lectures and delivered a programmatic speech in which he outlined the main principles of a “philosophy of the university” which consists not in placing the university under the external gaze of the philosophical discipline, but to explain the philosophy that the academic thing contains in itself and that the functioning of the institution is supposed to implement in accordance with what is its essence. That is what this article intends to account for by following the principal moments through which the Philosopher of Berlin had expounded this thesis.
Keywords: AUDITORS, BERLIN, SPEECH, ESSENCE, GERMANITY, PHILOSOPHY, UNIVERSITY.
Introduction
D’ordinaire, les activités universitaires se déroulent dans des lieux réservés à un public qualifié et y ayant formellement droit. Mais, cela ne veut pas dire pour autant qu’elles se tiennent toujours de façon strictement privée et à l’intention exclusive des pensionnaires officiels de l’institution universitaire. C’est ce que prouvent les traditionnelles cérémonies de rentrée qui, rassemblant symboliquement tous ceux qui participent à la vie universitaire, marquent solennellement le fait que commence quelque chose de spécial et dont l’importance mérite la séance spéciale en question. Déroulées sous forme de discours programmatiques, ces traditionnelles séances de rentrée, sous forme de leçons inaugurales, constituent de rares occasions, pour celui qui les prononce, de prendre date avec l’institution universitaire. Et quand c’est un philosophe qui se livre à un exercice d’une telle solennité, son discours a naturellement une tout autre étoffe : rigoureux et profond, il transforme la séance de rentrée et l’amphithéâtre qui accueille celle-ci en moment et en lieu où se joue le destin final de l’université. Hegel, un des plus grands philosophes de l’histoire, avait sacrifié, de façon mémorable, à ce rite en mobilisant, à cette occasion, tous les moyens que lui offrait son immense culture et son très grand génie.
Contrairement à son prédécesseur Kant, Hegel est un philosophe qui ne dissociait pas ses publications de ses enseignements. Mieux, il les associait étroitement dans un cadre universitaire soumis à l’autorité de l’État. C’est ce dont témoigne d’ailleurs, non seulement la publication posthume de ses cours par ses élèves, mais aussi son célèbre discours à l’ouverture de ses leçons de Berlin, le 22 octobre 1818, où il présente les grands contours de ce que l’on peut qualifier de « philosophie de l’université », c’est-à-dire, dans le fond, la philosophie que recèle en soi la chose universitaire. Âgé alors de quarante-huit (48) ans, il venait de prendre la succession de Fichte, décédé en 1814, à la prestigieuse chaire de philosophie de l’Université de Berlin. Et à cette occasion, il prononça, en ouverture de son cours, une importante allocution (1970, p. 7-10) qui était, dans ses grandes lignes, une reprise de celle qu’il avait prononcée, deux ans plus tôt (le 28 octobre 1816), à Heidelberg (F. Nicolin, 1991, p. 64) lors de son grand retour à l’Université. Dans ces deux allocutions, il s’efforce de donner une caution universitaire au changement de sa façon d’exposer son discours philosophique. En effet, il y a bien chez lui une différence de style entre la Phénoménologie de l’esprit (1807) et la Science de la logique (1812) d’un côté et l’Encyclopédie des sciences philosophiques (1817) et les Principes de la philosophie du droit (1821) de l’autre. La forme de l’exposé philosophique n’est pas la même dans ces quatre grands ouvrages qui ont fait sa renommée. Dans les deux premiers (Phénoménologie de l’esprit et Science de la logique), elle est spéculative, voire dogmatique, alors que dans les deux derniers (Encyclopédie des sciences philosophiques et Principes de la philosophie du droit), elle est fondamentalement didactique. Ce qu’il y a de significatif à signaler à ce sujet, c’est que ce changement de la forme d’exposition du discours philosophique correspond à son accession à des fonctions universitaires importantes. En accédant à une carrière académique plus importante d’abord à Heidelberg (1816), puis à Berlin (1818), Hegel a certainement dû trouver nécessaire de changer sa méthode d’exposition de son système philosophique en lui donnant désormais le style de « discours universitaires » adressés non pas uniquement à des lecteurs spécialisés de l’histoire de la philosophie, mais aussi à un public plus large et plus diversifié. De nature fondamentalement didactique, son discours à l’ouverture de ses leçons de Berlin, le 22 octobre 1818, est bien une justification de ce changement de style de l’exposé philosophique. En rupture évidente avec le style spéculatif de la Phénoménologie de l’esprit et de la Science de la logique, ce discours traite didactiquement des questions ci-après : quel contexte pour l’essor de la philosophie ? Qu’est-ce qu’être un philosophe allemand ? À quoi cela engage-t-il ou destine-t-il ? En quoi cette nécessité est-elle conforme à l’essence même de la philosophie ?
1. LE TEMPS DE LA PHILOSOPHIE
L’idéaliste Hegel n’est paradoxalement pas un philosophe enfermé dans sa tour d’ivoire et pour qui la pensée est totalement coupée du réel. Dès le début de cette allocution, il dissipe un tel malentendu en se démarquant clairement d’une telle façon de concevoir la pratique philosophique. Inscrivant l’exercice de la pensée dans un contexte déterminé, il défend et assume l’idée que celle-ci ne s’exerce pas dans l’abstrait. Pour lui, la pensée découle toujours d’un point de vue déterminé qui la configure et la détermine. Ce qui, d’une certaine façon, relativise l’existence, dans son système, d’un point de vue global qui effacerait tous les autres. Si, objectivement, on ne peut pas totalement exclure l’existence d’un tel point de vue chez lui, on ne peut, toutefois, considérer ce dernier que comme un simple point de vue qui engloberait certes ceux qui l’ont précédé mais qui, en tant que tel, serait aussi naturellement disposé à être dépassé et à être englobé par ceux qui le suivront dans l’histoire.
Chez Hegel donc, la pensée est toujours inscrite dans son contexte et la philosophie dans son temps comme l’atteste ce passage de la préface aux Principes de la philosophie du droit (Hegel, 1821-2013, p. 132) « Conceptualiser ce qui est, c’est la tâche de la philosophie, car ce qui est est la raison. En ce qui concerne l’individu, chacun est de toute façon un fils de son temps ; ainsi, la philosophie est-elle aussi son temps appréhendé en pensées ». Ce thème de l’articulation de la philosophie à son temps, constant chez lui, réapparaît avec force dans ce discours comme l’atteste ce passage (1817-1970, p. 7) où il proclame : « En ce qui concerne le moment, des circonstances paraissent s’être produites, à la faveur desquelles la philosophie peut de nouveau se promettre d’attirer l’attention et la sympathie et cette science presque réduite au silence, espérer élever à nouveau la voix ». Se prononçant sur les opportunités philosophiques du moment de son retour à l’université, il n’hésite pas à affirmer que celui-ci coïncide avec une conjoncture particulièrement favorable à un nouvel envol de la philosophie. Ce moment hégélien de la philosophie, évoqué dans son discours par l’usage répétitif de la locution « à nouveau », est celui d’une renaissance de cette discipline s’effectuant en même temps qu’une refondation de l’université. C’est en fonction des exigences propres à cette conjoncture déterminée que, pense-t-il, s’est imposée au philosophe qu’il est une mission spéciale dans la vie de l’université allemande. La coïncidence entre son retour à l’université et la nouvelle conjoncture particulièrement favorable à la philosophie s’explique par le fait que le destin de celle-ci s’était trouvé, au moment même où il en parlait, étroitement lié à l’histoire de l’Esprit universel dans la forme spécifique que lui avaient donné le peuple et l’État allemand.
Dans la période immédiatement antérieure à la défaite des armées napoléoniennes et à la Restauration, l’esprit avait été condamné à une vie en extériorité, contraire à sa propre nature faite d’intériorité. En effet, affirme Hegel à ce propos, « (…) il y a peu de temps encore, (…). L’esprit de l’univers, si occupé par la réalité, entrainé vers l’extérieur, se trouvait empêché de se replier vers le dedans et sur lui-même, pour se rendre dans la patrie qui lui est propre et jouir de lui-même » (IbIdem). Cette référence à une « occupation » de l’esprit par la réalité extérieure est à prendre au pied de la lettre : elle rend compte de l’occupation provoquée par les guerres napoléoniennes qui ont agité l’Europe entière et mis en péril l’identité et l’unité de la nation allemande. À propos de cette situation politique de son pays, Hegel écrivait d’ailleurs dès le début de son texte sur la Constitution de l’Allemagne (1800-1802-1977, p. 33) : « L’Allemagne n’est plus un État ». Écartelée en petites féodalités, puis affaiblie davantage à la suite de l’occupation des troupes napoléoniennes, l’Allemagne de cette époque n’avait, à proprement parler, rien d’un État.
Mais la défaite de Napoléon a été accompagnée par une renaissance de la nation allemande. Ce qui a amené Hegel à avancer, dans son allocution de Berlin, un point de vue totalement opposé à celui du début de la Constitution de l’Allemagne. En effet, avance-t-il dans son discours de 1818 (1817-1970, p. 7) à propos de la nouvelle situation politique de l’Allemagne, « Aujourd’hui, alors que ce torrent de la réalité a été brisé et que la nation allemande a, d’une manière générale, sauvé sa nationalité, le fondement de toute vie vraiment vivante, le temps est venu aussi pour le libre empire de la pensée de fleurir dans l’État, de la manière qui lui est propre, à côté du gouvernement du monde réel ». Avec l’échec du projet napoléonien de domination de la Prusse, l’esprit n’a plus affaire à une réalité extérieure mais à sa propre intériorité. Avec cette nouvelle situation, revient en Allemagne le temps de l’intériorité et du recueillement qui sont les dispositions propres à l’esprit et à la pratique philosophique. C’est ainsi que s’est resserré dans ce pays le lien entre l’État et l’esprit, rendant de nouveau possible un nouvel essor de la philosophie allemande. Pour Hegel donc, l’esprit ne peut pas, pour affirmer son indépendance, se couper complètement de l’État.
2. LE RÔLE DU PHILOSOPHE ALLEMAND
Le lien entre l’État et la philosophie est une idée hégélienne constante réaffirmée avec force dans ce discours. Le philosophe de Berlin est, certes, d’avis que l’esprit est en soi indépendant. Mais, en même temps, soutient-il, celui-ci ne peut pas se couper complètement de l’État qui est son incarnation comme l’atteste ce passage de son discours où il affirme :
Et la puissance même de l’esprit s’est fait valoir en cette époque, au point que les idées seules et ce qui leur est conforme, sont ce qui peut aujourd’hui d’une manière générale se maintenir et que ce qui veut avoir quelque valeur, doit se justifier devant la sagesse et la pensée. C’est tout particulièrement cet État qui m’a accueilli, qui, par sa prépondérance intellectuelle, s’est élevé à l’importance qui lui convient dans le monde réel et politique, se rendant égal en puissance et en indépendance à des États qui lui eussent été supérieurs par leurs moyens extérieurs. Dans cet État, la culture (Bildung) et la floraison des sciences est un élément des plus essentiels dans la vie de l’État. (IbIdem.)
Les mots soulignés dans le texte contextualisent le rôle imparti à l’esprit et au philosophe qui en est le porte-parole. Devenu sujet du roi de Prusse, – dont le palais était à quelques encablures de l’université -, Hegel a trouvé nécessaire et justifié d’associer plus étroitement ses activités de philosophe à la vie de l’État. D’ailleurs, pour lui, les deux (l’activité philosophique et le service de l’État) ne sont pas et ne peuvent pas être séparés. Considérant l’État prussien comme l’État culturel par excellence, le philosophe de Berlin dira que c’est ce dernier qui, en l’accueillant, a restitué par la même occasion leur prépondérance aux puissances spirituelles dont la philosophie est la fleur ultime. Si la parole du philosophe a une quelconque autorité, elle la doit, non au génie particulier de ce dernier, mais à l’État. Le philosophe n’a d’existence que dans l’État ; il lui est organiquement lié. C’est donc à l’État et, dans le contexte hégélien, à l’État prussien que revient le rôle de garantir l’existence d’un « libre et raisonnable monde de l’esprit ». Cette situation s’impose d’autant plus selon Hegel qu’il vit dans un monde et une époque où seules les idées comptent. Dans ce “chez-soi de l’intelligence”, incarné par l’université où il démarre ses cours par une allocution officielle, le philosophe Hegel devient fonctionnaire de l’esprit. L’université n’est donc pas un lieu quelconque et indifférent. En réalité, elle est le lieu où se fait la rencontre entre l’esprit et l’État dont les fruits sont naturellement recueillis par la philosophie. À ce propos, Hegel déclare à ses auditeurs : « Il faut aussi que dans cette Université, l’Université du centre, le centre de la culture de l’esprit, de toute science et de toute vérité, la Philosophie, trouve sa place et soit, par excellence, un objet d’étude » (IbIdem, p. 7-8).
L’expression « université du centre » n’est pas anodine : elle signifie que l’université, surtout quand elle tire sa légitimité d’un État comme l’État prussien dont la vocation est de se tenir au centre et de rendre ainsi possible l’existence d’une sphère autonome, assume le rôle de faire converger des aspirations diverses auxquelles elle assure les conditions de réalisation, à travers une « culture de l’esprit » dont la « science » (Wissenschaft) constitue la forme par excellence. Plus loin, dans son discours, le philosophe de Berlin insiste sur le caractère conjoncturel de cette convergence qui n’a rien d’automatique mais qui dépend de conditions exceptionnelles réunies hic et nunc. Ainsi, déclare-t-il à ses auditeurs :
Nous devons considérer comme un bien inappréciable que notre génération ait vécu, agi et obtenu des résultats en ayant ce sentiment, sentiment où s’est concentré tout ce qui est droit, moral et religieux. En une action profonde et universellement compréhensive de ce genre, l’esprit s’élève en lui-même jusqu’à sa dignité propre ; la trivialité de la vie et la platitude des intérêts disparaissent, et la superficialité de l’intelligence et des opinions se montre dans sa nudité et se dissipe. Ce sérieux profond qui a pénétré l’âme est le vrai terrain de la philosophie. (IbIdem.)
Pour Hegel, ce qui fait la particularité de la philosophie, c’est sa capacité à rejeter la superficialité viscéralement attachée aux intérêts profanes. Son lieu propre, son chez-soi, est le sérieux et la profondeur. Insistant sur ce caractère fondamental de la philosophie, le philosophe de Berlin soutient :
Ce qui d’une part, s’oppose à la philosophie, c’est l’attitude de l’esprit qui se plonge dans les intérêts et la nécessité de la journée et d’autre part, la vanité des opinions ; l’âme qui en subit l’emprise, n’a point de place pour la raison, qui ne recherche pas l’intérêt particulier. Cette frivolité doit se dissiper en son néant, quand c’est devenu pour l’homme une nécessité de faire effort en vue de ce qui est substantiel et quand on en est arrivé au point que cet élément substantiel seul peut se faire valoir. (IbIdem.)
Pour que s’effectue l’union du réel et du rationnel, dont la philosophie est la manifestation, il faut, comme le soutient Hegel, que les choses en soient venues à un point tel que seul un contenu consistant substantiel puisse se faire valoir. C’est à cette condition seulement, estime-t-il, qu’il est permis de faire état de l’existence d’une « université du centre » d’où peut être tenue une parole spirituellement empreinte de sa centralité. Disposant désormais de l’espace lui permettant d’exercer la plénitude de ses fonctions, la raison serait coupable de ne pas l’occuper. C’est ce dont il a pleinement conscience quand il déclare : « Notre mission et notre tâche consistent à consacrer nos soins au développement philosophique de ce fondement substantiel, actuellement rajeuni et fortifié » (IbIdem).
Le philosophe n’a donc pas le choix : son rôle, sa vocation fondamentale est de coller le plus étroitement possible à son époque et de réaliser les possibilités exceptionnelles que celle-ci lui offre. C’est, du moins, de cette façon que Hegel comprend son propre rôle, non seulement en tant que philosophe, mais aussi – les deux ne sont d’ailleurs jamais totalement séparés chez lui – en tant que professeur. Pour lui, les possibilités uniques de son époque font écho à l’existence d’un contenu consistant substantiel auquel l’université offre le meilleur espace de résonnance. Pour conforter ce point de vue, il déclare, du haut de son pupitre, que son temps n’est pas un temps comme les autres, quelconque et indifférent. S’il y adhère sans réserve, c’est parce que celui-ci n’a rien à voir avec une actualité circonstancielle et passagère, exposée à la superficialité et à la futilité de l’opinion inconstante et prête à changer d’orientation d’un moment à l’autre. Ce temps hégélien de la philosophie, pas du tout comme les autres, est « profond » parce qu’avec lui sont réunies les conditions d’un ressourcement et d’un renouvellement profond de la pensée philosophique. Au peuple allemand, qui est le peuple élu des temps modernes, incarnant pour cette raison le principe le plus élevé de l’esprit du monde, revient le rôle de gardien de ce feu sacré.
3. LA GERMANITÉ : ESSENCE FONDAMENTALE DE LA PHILOSOPHIE
Pour effectuer sa régénération, le Weltsgeist ou l’esprit du monde a porté son choix sur le peuple allemand ainsi que le confirme ce passage de l’allocution du philosophe de Berlin :
En ce qui concerne la supériorité des Allemands dans l’étude de la philosophie, on peut dire que l’état de cette discipline et la signification de ce nom dans les autres nations, montrent que le nom s’en est sans doute conservé chez elles, mais que le sens en a été modifié et que cette étude a dégénéré et est disparue, en sorte qu’il en est à peine resté un souvenir et un pressentiment. Cette science s’est réfugiée chez les allemands et ne vit plus que chez eux. La conservation de cette lumière sacrée nous a été confiée ; nous sommes appelés à en prendre soin, à l’entretenir, et à veiller à ce que, ce que l’homme peut posséder de plus sublime, la conscience de son essence, ne s’éteigne ni ne disparaisse. (IbIdem.)
N’importe quel peuple n’a pas le privilège unique d’être le gardien du feu sacré, de la pensée. Cette charge revient électivement à l’esprit allemand qui y est, naturellement et historiquement, destiné. Si le peuple allemand est le peuple élu des temps modernes, c’est parce que sa langue, apparentée en profondeur à la langue grecque, est la langue même de l’esprit. Adhérant sans réserve à cette idée, Hegel s’intronise solennellement dans la fonction de gardien du feu sacré, de la pensée. À cette noble fonction, il associe ses auditeurs.
La philosophie qu’il va enseigner sera, pour cette raison, essentiellement allemande. Ce qui d’ailleurs est la condition pour qu’elle soit authentiquement philosophique, c’est-à-dire le mieux conforme au désir de l’esprit universel de parvenir à la conscience de soi de son essence. En arrière-plan de cette démarche se trouve la conviction hégélienne que la philosophie, pour parvenir à l’universalité, doit nécessairement s’appuyer sur la médiation que lui offre l’esprit d’un peuple déterminé. Un philosophe qui tenterait de se passer de la médiation de l’esprit d’un peuple prendrait le risque de basculer fatalement dans la forme d’une universalité abstraite dépourvue de contenu.
Le contenu du propos de Hegel selon lequel le peuple allemand est le peuple élu des temps modernes paraît clair de prime abord. En soutenant que, chez les autres peuples, la philosophie ne subsiste plus que de nom, il pense principalement à deux pays : d’abord à la France, qui a répudié la métaphysique, et avec elle le sens de l’absolu, et ensuite à l’Angleterre, où la spéculation, sous prétexte de se rapprocher davantage de l’expérience, s’est subordonnée à des intérêts pragmatiques qui l’ont ramenée sur le plan d’un calcul rationnel soucieux avant tout d’utilité. Contre cette double orientation donnée à la philosophie en France et en Angleterre, Hegel justifie son assurance de philosophe animé par la volonté de maintenir une flamme qui, sans lui, risquerait de s’éteindre, en prenant appui sur l’effort de renaissance initié au dix-huitième siècle par Kant et qui a donné naissance à la glorieuse entreprise de ce que l’on a appelé l’idéalisme allemand.
Continuateur de cette tradition qui, prétend-il, parle et pense allemand, Hegel se présente comme celui qui en incarne au présent les orientations essentielles. Si, c’est en Allemagne que, en dépit des guerres impériales qui ont menacé son identité et son unité, a pu s’affirmer envers et contre tout le sérieux de l’époque, c’est, assure-t-il, à ses philosophes que la nation allemande le doit : grâce à ces nobles esprits, elle est arrivée à remplir la mission historique qui ne revient qu’à elle seule et qui garantit sa prééminence sur les autres nations, tout au moins pour ce qui concerne « la chose la plus haute que l’homme puisse posséder », c’est-à-dire « la conscience de soi de l’esprit ». C’est donc naturellement qu’en prononçant cette allocution lors de sa prise de fonction à l’Université de Berlin, l’université même du centre, il a revendiqué l’obligation d’adhérer aussi étroitement que possible à l’esprit de son temps. En poursuivant ainsi la noble mission assignée à l’esprit allemand, soucieux avant tout de son intériorité, Hegel s’est naturellement interdit de le laisser se diluer en subordonnant son essence à des préoccupations futiles qui en effectueraient le décentrement.
Cette interprétation, qui s’impose à première vue, n’est pourtant que partielle. Car, en décidant d’adhérer à l’esprit de son temps, un esprit qui entretient naturellement et historiquement des rapports d’affinité avec la nation allemande, Hegel ne fait pas que s’insérer dans une dynamique déjà enclenchée dont il ne ferait que suivre passivement la direction. En réalité, en adhérant à l’esprit de son temps, il prétend également donner une nouvelle impulsion à cette dynamique dont les résultats ne sont pas déjà donnés mais à conquérir. C’est donc logiquement que son propos, à première vue triomphaliste, dévie aussitôt vers des considérations sur la misère du temps, une misère dont l’Allemagne n’est nullement exemptée. Avec un tel constat, Hegel tire la conclusion surprenante que la philosophie allemande n’a jamais été dans un si mauvais état.
Que s’est-il donc passé, pour que le peuple le plus proche dans les temps modernes de l’esprit ait dévié du droit chemin sur lequel il était naturellement lancé ? Comme principale responsable de cette situation – qui nécessite une rectification de trajectoire qu’il s’engage lui-même à accomplir –, Hegel a un coupable tout désigné : la philosophie critique de Kant. Pour lui, la critique kantienne est la principale responsable de l’entreprise de diversion ayant empêché l’esprit de se rapprocher de son but authentique qui est de parvenir à la conscience de soi ou, en d’autres termes, d’atteindre l’absolu. À ce sujet, devant ses auditeurs, il affirme :
Or, même en Allemagne, la platitude de l’ancien temps, avant sa renaissance, en était venue au point qu’elle pensait et assurait avoir découvert et démontré qu’il ne pouvait y avoir de connaissance de la vérité ; que Dieu, l’essence du monde et de l’esprit était quelque chose d’inconcevable, d’incompréhensible ; que l’esprit devait s’en tenir à la religion et celle-ci s’en tenir à croire, sentir et pressentir, en dehors de tout savoir rationnel. Le connaître, pensait-on, n’atteint pas la nature de l’absolu, de Dieu et de ce qui dans la nature et l’esprit est vrai et absolu, mais plutôt, seulement, d’une part, le négatif, le vrai ne pouvant être connu ; le faux, le contingent, le périssable uniquement ayant en quelque sorte le privilège de l’être, – d’autre part ce qui, à proprement parler, en relève, l’extérieur, c’est-à-dire l’historique, les contingences parmi lesquelles s’est manifestée cette connaissance prétendue, supposée ; on ajoutait qu’une connaissance de ce genre devait être considérée seulement comme historique et examinée à ce point de vue extérieur par une méthode critique et savante ; toutefois, on ne pouvait en prendre, disait-on, le contenu au sérieux. (Ibid., p. 8-9).
Ce que vise Hegel ici en première ligne, c’est la délimitation par Kant des objets de la connaissance au monde phénoménal. Dans (1781-2006), Kant refuse, dans la perspective propre à un négativisme critique, de donner un contenu réel aux conclusions des démarches de la théologie rationnelle, de la cosmologie rationnelle et de la psychologie rationnelle. Ce refus kantien de donner un contenu effectif à des objets qui ne seraient pas situés dans le monde phénoménal est, d’après Hegel, la principale cause du relativisme sceptique. Vigoureusement opposé à celui-ci, il se fixe comme objectif, au moment où il effectue son entrée à l’Université de Berlin, de le combattre. L’Université de Berlin, créée une dizaine d’années plus tôt sur l’incitation et sous l’inspiration de philosophes, était naturellement le bastion d’un idéalisme néo-kantien. Stratégiquement donc, Hegel avait intérêt à mener ses premiers combats contre le criticisme de Kant. Pour lui, il faut d’autant plus se démarquer de Kant que le suivre revient tout simplement à désespérer de la raison. Et pire encore, avance-t-il, c’est fonder cette désespérance sur des arguments qui présentent une apparence raisonnée. En attrayant, dans la Critique de la raison pure, la raison devant son propre tribunal, le philosophe de Königsberg a fait de la raison son propre adversaire. Sous prétexte de délimiter le domaine où l’intervention de celle-ci est légitime, il l’a ruinée de l’intérieur en l’acculant à reconnaître son impuissance. En sa qualité de gardien du feu sacré, de la pensée, Hegel se propose de mettre fin à ce processus d’auto-destruction de la raison entamé par Kant.
Au fond, si Hegel manifeste un sentiment de déception vis-à-vis de la philosophie critique de Kant, c’est parce que celle-ci a renoncé à la connaissance rationnelle. Se prononçant sur cette renonciation kantienne à la connaissance rationnelle et ses conséquences sur la philosophie allemande, il (1817, 1970, p. 9) déclare à ses auditeurs :
On peut bien dire que depuis que la philosophie a commencé à se distinguer en Allemagne, elle n’a jamais paru en une posture aussi mauvaise, pour permettre à de telles conceptions, à une telle renonciation à la connaissance rationnelle d’afficher de pareilles prétentions et de se répandre ainsi, – bref à des conceptions qui traînent depuis la période précédente et qui sont en complète contradiction avec les sentiments plus sérieux, l’esprit plus substantiel d’aujourd’hui. Je salue cette aurore d’un esprit plus sérieux et je l’invoque ; je n’ai affaire qu’à lui en soutenant que la philosophie doit avoir une valeur intrinsèque et en l’exposant devant vous.
Assumant ouvertement son rôle de nouveau représentant de la pensée, le célèbre philosophe termine son allocution par une adresse aux étudiants à qui il propose de s’associer à son projet de renouveau de la philosophie allemande contre les positions obsolètes de l’idéalisme critique de Kant encore en vigueur à l’Université de Berlin. C’est dans ce sens que, s’adressant à eux, il déclare (IbIdem, p. 9-10) :
Mais d’une manière générale, je fais appel à l’esprit de la jeunesse ; car c’est le beau temps de la vie qui n’est pas encore préoccupé par le souci des fins bornées de la nécessité et qui est susceptible de la liberté qu’exige une occupation scientifique désintéressée ; et c’est ainsi qu’elle n’est pas encore en proie à l’esprit négatif de la vanité, à l’inutilité d’un effort purement critique. Un cœur encore sain a le courage de réclamer la vérité ; or, c’est là où règne la liberté que la philosophie est chez elle, c’est ce royaume qu’elle construit et nous y participons en l’étudiant. Ce qui dans la vie est vrai, grand, divin, ne l’est que par l’Idée ; la fin de la philosophie consiste à la saisir sous sa vraie forme et en son universalité. La nature est obligée d’accomplir le rationnel, nécessairement, mais le règne de l’esprit est celui de la liberté. Tout ce qui maintient la vie humaine, tout ce qui a de la valeur est esprit par nature, et ce règne de l’esprit ne doit son existence qu’à la conscience de la vérité et du droit, à l’appréhension des Idées.
Conclusion
L’appel de Hegel, à la fin de son discours, ne s’adresse pas uniquement au public qui était présent dans l’amphithéâtre au moment où il prenait fonction à l’Université de Berlin, mais à la jeunesse en général qu’il a invité publiquement à s’associer à son entreprise de renouveau de la philosophie allemande. Son discours, composé avec soin et doté d’un contenu d’une très grande richesse, témoigne de son effort de mieux comprendre et maîtriser le contexte dans lequel prend place son activité de professeur de philosophie. Décidé à exercer son activité dans un esprit de responsabilité et d’engagement et non au titre d’une formelle obligation professionnelle, il lui fallait d’abord définir, dans ce discours d’ouverture, les exigences auxquelles celle-ci correspond en théorie et en pratique. Ayant toujours, comme il l’écrit (1807-1939), considéré la philosophie comme une affaire très sérieuse, il a également entrepris, dans ce discours, de communiquer ce sérieux, sous la forme d’un exposé d’intention argumentée ayant valeur de programme, à son auditoire.
Références bibliographiques
HEGEL G.W.F., 1800-1802 (1977), Écrits politiques, trad. Michel Jacob, GF, Paris, collection « 10/18 », 422 p.
HEGEL G.W.F., 1817 (1970), Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, trad. J. Gibelin, Vrin, Paris., 620 p.
HEGEL G.W.F., 1807 (1939), La Phénoménologie de l’esprit, trad. J. Hyppolite, Aubier, Paris., Vol 1 (348 p) et Vol 2 (357 p)
HEGEL G.W.F., 1821 (2013), Principes de la philosophie du droit, trad. Jean François Kervégan, PUF, Paris., 816 p.
HEGEL G.W.F., 1812 (2015), Science de la logique, trad. Bernard Bourgeois, Vrin, Paris. 336 p.
KANT E., 1781 (2006), Critique de la raison pure, trad. Alain Renaut, GF, Paris., 749 p.
NICOLIN Friedhelm, 1991, Von Stuttgart nach Berlin : die lebenstationen Hegels, Marbacher Magazin., 80 p.
SUR LE CONTEXTE DU DISCOURS DE RECTORAT. DEUX LEÇONS POUR L’AFRIQUE
Séverin YAPO
Maître-Assistant, Université FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY d’Abidjan-Cocody (CÔTE D’IVOIRE)
Résumé : Pourquoi l’intelligentsia africaine semble-t-elle ne pas pouvoir sortir d’une domination politique et religieuse dont le contexte philosophique du Discours de rectorat de M. Heidegger semble analogiquement restituer des traits culturels ? Pour répondre à cette question, l’article remonte aux sources idéalistes platonico-allemandes d’une domination ethnoculturelle et religieuse endogène et exogène dont, tout comme les Juifs allemands en 1933, le peuple africain contemporain constitue la victime. Voyant dans la dia-logique culturelle le modèle philosophique de rapports interculturels libérateurs entretenus entre l’Allemagne et son voisin français, puis entre les Juifs et la philosophie-poétique heidegériano-hölderlinienne, l’article invite à en faire le socle de rapports exogènes et endogènes exempts de toute domination entre l’Afrique et son ex-colonie et entre les philosophes africains et leur propre peuple.
Mots-clés : DISCOURS DE RECTORAT, IDEALISME PLATONICIEN ET ALLEMAND, HEIDEGGER, DOMINATION POLITIQUE ET RELIGIEUSE, IDEALISME ET MATERIALISME AFRICAINS.
Abstract : Why does the African intelligentsia seem unable to emerge from a political and religious domination which philosophical context of Martin. Heidegger’s Rector’s Address seems analogically to restitute cultural traits? To answer to this question, the article goes back to the Platonic-German idealistic sources of an endogenous and exogenous ethnocultural and religious domination of which, just like the German Jews in 1933, the contemporary African people constitute the victim. Seeing in the cultural dia-logic the philosophical model of liberating intercultural relations maintained between Germany and its French neighbor, then between the Jews and the Heidegeriano-hölderlinian poetic philosophy, the article invites to make it the basis of exogenous and endogenous relations, free of any domination between Africa and her ex-colony and between African philosophers and their own people.
Keywords: RECTORATE SPEECH, PLATONIC AND GERMAN IDEALISM, HEIDEGGER, POLITICAL AND RELIGIOUS DOMINATION, AFRICAN IDEALISM AND MATERIALISM.
Introduction
Cet article voudrait tirer quelques leçons interculturelles sur le contexte du Discours de rectorat de Martin Heidegger, discours au sujet duquel c’est un lieu commun que de soutenir qu’il relève d’une forte teneur politique, et plus précisément dominatrice national-socialiste sous-estimée par le Philosophe lui-même. Toutefois, ce sera moins en cherchant à discuter la volonté heideggérienne de domination qu’à faire voir sa source platonicienne et tirer leçons de ses expressions culturelles pour la philosophie africaine contemporaine que nous aborderons le discours du 27 mai 1933. En effet, dès cette année où il prononça son Discours de rectorat, M. Heidegger fut qualifié de philosophe officiel du régime hitlérien, lui qui avait été nommé à ce poste du Rectorat de la prestigieuse Université de Fribourg au début de l’année. Mais, notre réflexion s’intéressera moins au Discours qu’au contexte philosophique et, partant, à l’esprit qui en éclaire la teneur dans l’optique d’en tirer les enseignements qui s’en dégagent pour notre contemporanéité.
On sait, à ce titre, que Heidegger est un phénoménologue allemand dont la pensée est métaphysiquement héritière de celle de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Si la métaphysique se partage entre matérialisme et idéalisme, pour certains, les matérialistes en particulier, l’idéalisme théologico-politique, au service du pouvoir politique, est un vecteur de grande domination des masses. Cette observation regarde surtout les « hégéliens de gauche » dont Heidegger pourrait être le continuateur de la pensée. À ce sujet, il se peut que sa philosophie ait une teinture fortement idéaliste. Notre propos part de l’hypothèse que l’idéalisme à la fois antique grec et moderne allemand, avec ses ramifications spirituelles (plus précisément ontiques, entretenant avec un certain matérialisme des liens aux contours pas vraiment clairs) appliquées au champ politique, a pu influer sur le Discours de Heidegger, lequel est perçu comme une légitimation de la politique allemande de domination endogène des Juifs (non plus idéellement mais ontiquement, matériellement considérés), politique développée par le gouvernant nazi d’alors.
Notre objectif est de tisser des liens instructifs avec la situation philosophico-politique de l’intelligentsia africaine aux prises avec les questions de domination politique et culturelle face au défi d’une autodétermination du continent. Questionnant dans cette optique les rapports de Heidegger avec l’idéalisme spéculatif en sa source platonicienne et sa spécificité allemande que Heidegger hérite d’abord de Fichte, notre propos, qui voudrait particulièrement tirer intelligence des incidences de l’idéalisme heideggériano-philosophique sur le contexte politique africain, s’affronte au problème suivant : quelles leçons politiques émanent du contexte philosophique du Discours, pour l’Afrique ?
Décelant dans les concepts de 1) l’élitisme heideggériano-platonicien, 2) et de l’exacerbation de l’auto-affirmation politique, les spécificités du problème de la domination chez Heidegger, nous en partons pour dégager deux leçons respectives susceptibles de les réparer. Méthodologiquement, nous appréhendons le monde politique européo-allemand où prend place le Discours de rectorat en réception par la culture philosophique afro-ivoirienne actuelle comme un unique « « sujet transcendantal » doté d’ubiquité » (A. V. Akhutin, 2014, p. 349). Ce, au sens où « la dialogique ontologique de la culture, conception philosophique élaborée dans les années 1970-1980 par le philosophe russe Vladimir Salomonovich Bibler » (Idem.) permet de procéder concomitamment à une explicitation des problèmes de domination et à la présentation des enseignements découlant de cette dialogique culturelle. C’est cette dialogique, qu’autorise « la con-temporanéité de[s …] différents horizons ontologiques » (Idem.) européens et africains, et plus spécifiquement allemands et ivoiriens, qui structure la méthode d’analyse adoptée pour développer notre hypothèse de travail. Nous commencerons par présenter l’intérêt de la dia-logique culturelle comme grille de lecture des enseignements générés par le contexte du Discours de rectorat. D’emblée, l’intérêt philosophique et social de la dia-logique est double : critique et positif.
1. PREMIER ENSEIGNEMENT : QUE LE SAVOIR ÉLITISTE FASSE PLACE À UNE PRAXIS OFFRANT UNE VOIE POPULAIRE
Dans un premier temps, le modèle de la dia-logique, négativement critique, permet de comprendre la source de la culture élitiste qui, philosophiquement et politiquement, constitue la cause de la teneur dominatrice reconnue au Discours de rectorat. Développer dans ce sens le modèle dia-logique conçu par Vladimir Salomonovich Bibler, c’est réaliser qu’avec le XXe siècle, les rapports entre les peuples et partant entre les visions philosophiques du monde, sont passés d’un modèle rationaliste et politique univoque, à une conception plurale, épocalement multiculturelle, invitant à un dialogue de ces univers pris comme êtres culturels.
Un de ces êtres se rapporte à la « raison » classique (cartésienne, kantienne) du XVIIe-XVIIIe siècle et à son expression politique relative à la mesure qui commandait au philosophe, ayant besoin d’une stabilité politique et religieuse pour poursuivre ses recherches, et doté d’une morale provisoire, d’adopter les opinions politiques des personnes les plus modérées ainsi que l’ordre religieux dominant son temps. Une déclinaison, spécifiquement moderne, de ce même être classique, consiste en la « raison » dialectique (hégélienne) du XIXe siècle qui incline à garder encore l’ordre religieux classique (chrétien, mais plutôt luthérien) tout en développant un ordre politique nouveau, celui qu’inspirât une Révolution française dénonçant, dans le christianisme, une superstition insupportable pour tout chercheur de liberté rationnelle ; cette mixture de l’ancien régime religieux et d’un ordre politique en conséquence hybride porte à la reproduction d’une certaine domination politique liée aux ruses de la raison dont l’époque contemporaine pourra dénoncer l’éclipse. Cette raison classique est considérée par V. S. Bibler « comme une formation spécifique de la pensée, caractéristique d’une culture épocale donnée, celle des Temps Modernes » (A. V. Akhutin, 2014, p. 349).
Un autre de ces êtres tient dans « les formations logiques de la pensée caractéristiques des autres cultures » (Idem) qu’illustrent la métaphysique idéaliste platonicienne (antique) ou l’ontologie chrétienne (médiévale) ou encore celles, postmoderne (heideggérienne) du XXe siècle, ou mimétique postcoloniale (africaine) ; les deux dernières cultures étant contemporaines. Nous intéressant en particulier à la « raison » postmoderne de Heidegger, celle-ci permet de saisir l’origine et la dynamique de l’ontologie de la domination qui sous-tend le Discours. C’est que « sa » raison postmoderne détruit phénoménologiquement l’ontologie religieuse chrétienne qu’elle croit attachée au régime politique ancien, qui est monarchique, tout en développant un ordre politique qui, revendiquant un caractère laïc, pour ne pas dire idéaliste antique, constitue une répétition insoupçonnée par Heidegger lui-même, de la domination politique, à la fois monarchique, liée au pouvoir catholique médiéval, et métaphysico-démiurgique qui inspirait la théorie platonicienne du philosophe-roi en réactualisation contemporaine chez l’auteur du Discours dont le projet est d’universaliser la théorie platonicienne du philosophe-roi au travers d’une révolution politique dont lui-même serait l’auteur.
Il s’ensuit que, aussi bien dans la contemporanéité politique heideggérienne qu’africaine, non seulement l’on fait face au même « constat d’une orientation analogue vers l’universalité » (Idem), mais également à un ethnocentrisme inclinant à une opposition des expériences philosophiques et politiques déjà revendiquée dans la modernité philosophique par la « raison » classique. C’est ainsi que la dialogique négative explique la source de la culture élitiste fondatrice du discours de domination tenu par M. Heidegger en 1933.
Dans un second temps, appliquant à notre sujet la portée créatrice inhérente à la dialogique contenue dans le modèle de V. S. Bibler, il vient que pour parer au danger lié au cloisonnement des rationalités et partant à un éventuel choc irréversible des cultures que compliquera l’ère ultratechnologique contemporaine, avec le risque d’une guerre nucléaire qui pourrait s’ensuivre, ce dont il est ici question, « c’est de pouvoir envisager différentes logiques de l’être (ou « sujets transcendantaux ») ». En sens, devant la prétention de chacune des rationalités à l’universalité, V. S. Bibler invite à appréhender différentes cultures logiques de la pensée qui constituent les cultures comme des mondes pourvoyeurs de sens, fondés ontologiquement, et entre lesquels ne peuvent exister que des relations dialogiques, relations qu’il nous plaira d’analyser en vue du dialogue entre la culture politique postmoderne de M. Heidegger et celle postcoloniale africaine demeurant curieusement encore aux prises avec une domination dont les aspects endogène et extérieur ne sont pas sans rappeler le contexte philosophique et politique d’émergence du Discours.
Ce contexte, pour la situation intermédiaire entre le XXe siècle de Heidegger et l’antiquité grecque, nous semble se profiler dans l’idéalisme du XIXe siècle avec les rapports, empreints d’allégeance et de résistance à quelque domination politique et qui, ayant été scientifiquement marqués par le projet hégélien de doter l’Allemagne d’une constitution nouvelle, pourraient avoir été ceux d’un philosophe aux prises avec le pouvoir politique, mais surtout religieux.
- W. F. Hegel ne semble pas étranger à tout projet de domination politique dont Heidegger pourrait avoir hérité. Pour le dire autrement, « le texte de La Constitution de l’Allemagne […] écrit entre 1799 et 1802 » (J. Deliniere, 2003, p. 73) par Hegel n’est peut-être pas étranger à tout projet de domination politique. Et ce, même si, contrairement à Heidegger dont la réflexion ultérieure à sa Phénoménologie de la vie religieuse rédigée en 1919, s’est voulue systématiquement opposée au christianisme, ce sont les « célébrations confessionnelles » (P. Büttgen, 2008, p. 51) protestantes qui furent le théâtre de la réflexion « théologico-politique » (Idem), mieux, de la « théologie gouvernementale ou ministérielle, dans laquelle le discours de Hegel prend […] place au titre de l’alliance du Trône, de l’Autel et de la Chaire académique » (Idem). Discours donc à la fois politique, théologique, religieux et universitaire, comme il en sera pour Heidegger, si l’on accepte de substituer au religieux le « spirituel ». C’est un tel discours qui, en 1830, donna à Hegel le droit d’être qualifié de « philosophe de l’État prussien » (Idem). Ce fait n’a point disparu !
En Afrique, de manière générale, en Côte d’Ivoire en particulier, formés aux canons « spirituels » ou plutôt théologico-grecs, la plupart des philosophes de la première génération après le départ des universitaires français venus en coopération technique, ont tenu le rôle de fonctionnaires officiels des différents pouvoirs s’étant succédés, y ayant joué le rôle de conseillers de haut niveau. Quant à Heidegger, il ambitionnait, depuis 1922, de déconstruire les traditions entremêlées qui ont concouru à former ce qu’il appelle « l’interprétation gréco-chrétienne de la vie » (J.-C. Monod, 2002, p. 12), encore dominante aujourd’hui. C’est dans ce contexte philosophique spécifiquement heideggérien de la déconstruction de « l’intrication entre la conceptualité grecque-platonicienne de la métaphysique et l’interprétation chrétienne du monde opposé au siècle, médiée par la « latinisation » du christianisme que s’inscrit » (Idem, p. 11-12) la nomination de Heidegger au poste de Recteur. Comme le souligne J.-C. Monod (2002, p. 12), « cette déconstruction devrait être étudiée conjointement avec la volonté manifestée dans le Discours de penser « l’esprit », le Geist, ou la Geistigkeit en l’émancipant de « l’interprétation christo-théologique du monde ». En tout état de cause, même si toute l’œuvre de Heidegger constitue un développement autonome de sa propre pensée, son Discours semble procéder d’un certain héritage philosophique reconnaissable aux “jeunes hégéliens“ encore appelés “hégéliens de gauche“. C’est même la déconstruction de la christo-théologie comme telle, mutée par Heidegger en méta-théologie platonicienne, à laquelle présidera la Geist, la « spiritualité » idéaliste allemande, qui semble autoriser à voir en Heidegger un des hégéliens de gauche, couramment opposés aux “hégéliens de droite“ ou “vieux hégéliens“. Ces derniers prônent le maintien du système de pensée global de Hegel, en particulier sa théologie, en considérant l’État prussien comme la « Fin de l’Histoire ».
Quant aux “hégéliens de gauche“, ils se débarrassent de ce qui, chez Hegel, fait allégeance à la religion et à la monarchie. Ainsi en est-il de Heidegger qui, bien que voulant « détruire » tout ce qui relève de la religion chrétienne, le catholicisme en particulier, nostalgique de la monarchie platonicienne, voudra ériger Hitler en monarque allemand. Ayant à leur tête Bruno Bauer, les hégéliens de gauche prônent ce qui est révolutionnaire et progressiste chez Hegel, notamment l’idée de dialectique, laquelle sera toutefois renversée par Heidegger dans le sens de la simplicité phénoménologique. L’on sait que plus que Heidegger dont l’opposition à Hegel relèvera plutôt de ce que lui-même appelle la lutte amoureuse autour de l’affaire de la pensée, Karl Marx, même s’il s’oppose à l’idéologie de la domination allemande qu’il dénonce chez les hégéliens de droite, en ce que, tout comme l’idéalisme hégélien, son matérialisme se voudra dialectique, il hérite par là-même d’un hégélianisme de gauche, lui qui participa aux séances du Doktorclub conduites par Bruno Bauer.
En tout état de cause, tout comme pour Heidegger en 1933, et Fichte un siècle plus tôt, dont Heidegger sera aussi l’héritier, en rapport avec la problématique de la domination allemande en Europe, ou de la Côte d’Ivoire en Afrique, qui a lu un peu de Marx et s’intéresse au développement social de son monde, sait qu’au niveau national ivoirien et continental africain, tout comme il en aura été de même pour la nation allemande ou le continent européen, il se rencontre de jeunes philosophes idéalistes, en particulier des hégéliens, opposables à des philosophes matérialistes franchement marxiens.
Sur l’héritage hégélien de Heidegger, traduisible en Côte d’Ivoire au sens de l’héritage heideggériano-hégélien, dans le cas du pays ouest-africain nommé, il se dégage deux Écoles de pensée. La première regroupe les contemporains héritiers de Hegel ou, plus précisément, du premier hégélien ivoirien, auteur du premier ouvrage d’envergure dans la catégorie des études ivoiriennes de souche hégélienne, L’Afrique et son autre. La différence libérée (1994), nous avons nommé le Professeur Augustin K. Dibi. De celui-ci, hormis quelques disciples explicitement heideggériens plus ou moins fidèles à la pensée du pionnier ivoirien, comme Antoine Kouakou de qui l’on tient de belles pages de philosophie de l’éducation à davantage promouvoir, à en croire certains observateurs, l’on ne peut dire qu’il se compte beaucoup d’illustres disciples. Et ce, hormis en premier chef, de ce même côté, un disciple du tout premier cercle dibien comme Jean Gobert Tanoh, auteur d’un livre fondamental sur les enjeux philosophiques et politiques de l’héritage france-africain du Rassemblement démocratique africain (RDA) d’Houphouët-Boigny – par où un panafricanisme démocratique ou une nation ouest-africaine est-elle envisagée en un dia-logue à entretenir –, et T. Ezoua, cette fois-ci, du côté des hégéliens de droite, lui dont les productions et cours de Métaphysique approchent spéculativement ceux d’A. K. Dibi, il se dénombre, une fois encore, bien peu de disciples fidèles au Maître ivoirien. La deuxième École regroupe des hégéliens de gauche pouvant être présentés comme des héritiers de Karl Marx, ou du socialisme de Kwame Nkrumah, théoricien d’un consciencisme de l’unification politique de l’Afrique moderne en mal d’appropriation par les jeunes socialistes dont nous espérons que des chercheurs, comme Eméry Raoul Dagaud, auteur, en 2013 du Chœur de Nkrumah, hymne au relèvement futur de l’Afrique, sauront relever le défi.
Selon une vision matérialiste, (le dernier nommé ne participe pas aux querelles intestines africaines), les premiers, hégéliens de droite, pensent les rapports de domination qui définissent l’élaboration de la conscience historique africaine d’un point de vue qui, pour être spéculatif, relèverait essentiellement d’un idéalisme que les seconds, au nombre desquels le philosophe Charles Romain Mbelle (plutôt camerounais, donc non situé dans la région ouest-africaine, n’est pas disciple de A. K. Dibi et n’est pas en débat ouvert avec quelque hégélien ivoirien), accuseraient d’abstraire les réalités matérielles africaines et d’être incapable d’accéder à leur essence existentielle, qui serait matérielle, liée aux événements politiques traumatisants vécus hier et aujourd’hui encore par les Africains et les Ivoiriens. Ceux-là feraient de la conscience idéelle, issue de la société instruite à l’École de l’impérialisme européocentriste, la mesure du changement en Afrique.
Quant aux philosophes africains héritiers de Marx et Nkrumah, s’intéressant plutôt aux rapports de domination qui définissent concrètement l’élaboration de l’histoire contemporaine du continent, ils voient dans la réalité matérielle le lieu du véritable changement social. Pour eux, les héritiers de Hegel en appellent au développement d’une conscience sociale tout en négligeant l’être social lui-même ; lequel serait entendu, dans la ligne de Marx, comme les modes de production, les rapports de production et les rapports sociaux. Pour le dire avec C. R. Mbelle (2014, p. 167) qui, voyant dans l’opposition entre panafricanisme et postcolonialisme, la lutte en cours en Afrique (selon lui les vieux hégéliens seraient postcolonialistes et les jeunes hégéliens, panafricanistes), soutient : « Sur le plan social, la philosophie des [jeunes hégéliens] apparaît idéaliste – même si, comme Feuerbach, ce sont des matérialistes, du point de vue philosophique. Leur idéalisme tient au fait qu’ils posent les idées comme la réalité véritable » tout en négligeant d’interroger les rapports de production sur lesquels il convient d’agir, concrètement, pour parvenir à des rapports sociaux plus justes. Un tel propos n’est vraiment pas étranger au philosopher de Hegel, lui, dont la position dans La Constitution allemande fustige l’idéalisme creux qui conduit à un État simplement abstrait. Ainsi qu’on peut le dire aujourd’hui des États africains, Hegel soutenait, au sujet de l’État allemand du XIXe siècle : « C’est un État en idée, ce n’est pas un État dans la réalité, l’élément formel et l’élément réel sont séparés, le formalisme vide est du côté de l’État, la réalité du côté de l’absence d’État. » (GWF Hegel, 1913, p. 73).
Suivant la critique faite par C. R. Mbelle (2014, p. 167), sous le règne du formalisme idéaliste innervant l’intelligentsia africaine contemporaine, c’est en croyant que c’est la conscience qui détermine le réel qu’une conscience creuse apparaît la mesure du réel : « C’est la conscience qui détermine l’être et la réalité. Changer ceux-ci suppose changer les idées, c’est-à-dire, au niveau de la conscience, élaborer une philosophie plus juste ». Tout chez eux se passerait comme s’il suffisait d’élaborer une philosophie idéellement plus juste pour parvenir à un monde réellement plus juste, c’est-à-dire pour parvenir à un changement effectivement observable dans la vie des populations africaines. Or, « pour Marx et Engels […] l’être détermine la conscience. L’être, c’est l’activité matérielle – la vie des hommes pour satisfaire leurs besoins, et ce, au moyen du travail, afin de reproduire leur existence » (Idem).
Sous l’angle du rapport à la domination, les jeunes philosophes idéalistes africains apparaîtraient les reproducteurs d’un système d’aliénation des populations africaines, système qui aurait sa source dans l’idéologie coloniale, pour ainsi dire exogène à l’Afrique. À entendre les hégéliens marxisant ou marxistes hégéliens, il est besoin que ces philosophes idéalistes se convertissent à la réalité effective du continent, afin de pouvoir devenir les reproducteurs d’un système nouveau, celui qui, parce qu’il est regardant de l’activité matérielle – la vie réelle des hommes et des femmes africains – voit dans les travaux que ceux-ci entreprennent effectivement pour satisfaire leurs besoins et ainsi modifier leurs conditions matérielles d’existence, ce qui par ricochet modifiera la conscience sociale des Africains. Or, selon les tenants de l’idéalisme politique, il faut mettre le matérialisme philosophique au placard ; parce que, mauvais héritier de Hegel, il n’aura pas su se servir des conditions matérielles de la vie des populations africaines, lisibles à l’aune de la philosophie de la nature de Hegel, pour transformer l’Afrique.
Par-delà ce débat, mais toujours sur cette problématique du rapport national ou continental à la domination endogène ou exogène, la question qui, dans le contexte africain actuel, se pose à la conscience historique, nous semble s’entendre de ce qu’expose E. Wamba-Du-Wamba (1984, p. 12) dans les termes suivants : « Quels sont les rapports dominants concrets qui définissent l’élaboration de l’histoire en Afrique aujourd’hui ? ». Son hypothèse générale de travail est la suivante : si les expériences […] importantes en matière de lutte de libération anti-impérialiste […] n’ont pas encore produit leur histoire » (Idem), c’est parce que
le savoir produit est de nature essentiellement spéculative (l’interprétation pouvant se faire en termes subjectifs ou objectifs) et ne peut fournir d’éléments de réponse à la question : Comment les masses africaines ont-elles été elles-mêmes transformées tout en intervenant dans la transformation des situations coloniales et néocoloniales ? (E. Wamba-Du-Wamba, 1984, p. 9).
L’hypothèse testable, développée par l’auteur, qui par-là s’oppose à la prétendue réponse que les marxistes auraient apportée aux problèmes africains de domination politique, est la suivante :
L’histoire objectivante et radicale des modes de production n’a pas réussi à fournir aux masses africaines les moyens de maîtriser leur mouvement social contre les démobilisations suscitées ou organisées par l’impérialisme. C’est pourquoi les théorisations concernant la démocratie sont restées abstraites. Les besoins de base des peuples africains n’ont pas été pris en considération. (Idem, p. 9-10.)
Pour notre part, loin de la querelle hégéliens-marxiens, il s’agit de penser la domination politique sans passion et dia-logiquement.
En Afrique de l’Ouest, l’actualité ivoirienne des deux dernières décennies apprend qu’il y a une opposition quasi-patente entre les Ivoiriens et leurs voisins Burkinabè accusés par une frange de la population ivoirienne d’avoir servis de base arrière à une rébellion ayant perturbé l’ordre social national, là où l’autre frange se sent plus liée aux Burkinabè qu’aux Ivoiriens, soit par filiation ou par proximité naturelle, soit par compassion ou par préférence contextuelle.
Une question principielle, se pose, ici : à supposer qu’une nation ouest-africaine soit envisageable, que nous enseignera l’exemple continental européen dans lequel s’inscrit la problématique de l’impérialisme endogène lié au nationalisme allemand quant à ses réponses que nous verrons d’abord être relatives à la fraternité sous-régionale entre la base des peuples allemand et français, au point où l’on verra Fichte au XIXe siècle en appeler à l’armée française pour la libération de l’Allemagne des mains de l’ancien régime, et ensuite à la théorisation et la diffusion, au sein du peuple français par les intellectuels français, d’un modèle de résistance ressortissant de l’Allemagne occupante, en l’occurrence la poésie de Hölderlin, ainsi consacrée à la résistance contre l’occupant nazi ? Sinon la fourniture par les intellectuels (penseurs, poètes et autres historiens) européens, aux masses européennes, des moyens de maîtriser leur mouvement social contre les démobilisations organisées par l’impérialisme endogène, ultranationaliste, ou exogène, cosmopolite !
Dans le cas européen, l’on sait, par l’exemple allemand, que ce ne sont pas uniquement d’impérialistes nationaux qui revendiquent qu’une nation assume son destin en affirmant, de manière marquée, ses intérêts propres. L’on sait aussi, avec l’environnement de turbulences internationales, que la nation allemande se trouve aux prises avec des menaces liées à des puissances impérialistes étrangères. Plus près de nous, J.-P. Gougeon (2009, p. 33) fait cas du Livre blanc sur la politique de sécurité et l’avenir de l’armée fédérale, faisant état de ce que « l’Allemagne […] possède une puissance d’influence mondiale ». L’auteur souligne que c’est un social-démocrate, « Egon Bahr, [qui] recommande à ses compatriotes d’assumer leur nouvelle […] souveraineté afin d’éviter d’être « le jouet des intérêts d’autrui », l’Histoire ne devant plus constituer un blocage à l’affirmation d’intérêts nationaux » (Idem, p. 42). Selon E. Bahr (2003, p. 139) lui-même, « il est encourageant de constater que l’Allemagne surmonte la peur inhibitrice résultant de l’obsession de son histoire et se projette dans l’avenir qui comportera inévitablement une voie allemande ».
2. DEUXIÈME ENSEIGNEMENT : QUE L’AUTODÉTERMINATION CULTURELLE SOIT L’ESSENCE DU POLITIQUE
Peut-être est-ce pour tendre vers une voie africaine que K. Kavwahirehi (2009, p. 298) a posé la question suivante : « Comment libérer les sociétés africaines de tares dont elles semblent bien s’accommoder pour les lancer sur la voie du développement et de la modernité ? » Convaincu que « le développement est un processus culturel et politique avant d’être économique et technologique », et conscient de l’urgente nécessité d’une révolution culturelle sine qua non à la survie politique des populations africaines, comme Marcien Towa dans son Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, Kasereka Kavwahirehi développe l’hypothèse que, pour parvenir à une culture qui soit le moteur d’un développement économique et technologique durable, il importe de « révolutionner la culture indigène de fond en comble » (Idem), pour qu’elle manifeste la volonté de changement des Africains.
En un sens dialogique, quelle réalité culturelle africaine illustrera l’expérience nationale allemande où s’énonce la problématique de l’auto-détermination, telle que restituée par la voie allemande quant à ses réponses que l’on pourra voir se décliner doublement : d’abord, en une dynamique interculturelle constituée par la volonté, la persévérance, l’écoute mutuelle, la retenue, le courage, mais surtout l’obéissance à la loi qui détermine une nation à suivre sa propre voie, ce au point où, en une dynamique culturelle de type à la fois dialogique, telle celle développée par Edgard Morin, et originaire, ainsi du monde antique, l’on verra M. Heidegger confier le devenir allemand et européen à des créateurs de l’ordre des Grecs ; ensuite, en une conception politique de nature originaire, comme M. Heidegger, en ne considérant jamais la culture grecque antique comme l’accomplissement ethnique d’un seul peuple, mais de l’Europe entière ? Sinon une vision analogique du fondement historique d’une révolution culturelle qui l’ouvrira à sa modernité nouvelle, pour mobiliser la conscience nationale ouest-africaine, par l’exemple de sa filiation égyptienne antique, démontrée par Cheikh Anta Diop dans Nations nègres et cultures, en vue de réveiller les vecteurs de son développement économique et technologique historiquement perçus dans le phénomène scientifique propre au génie africain ayant sous-tendu la construction des pyramides d’Égypte. Ce, en révolutionnant la culture indigène de fond en comble, de sorte que, la méditation et la réactualisation de l’exemple égyptien ancien servant de modèle unique, le génie africain apparaisse le cadre d’un dialogue interafricain qui, comme pour Fichte qui, on le verra, implicitement, désirera ardemment l’advenue d’une nation unique pour l’Europe, comme pour en appeler au fondement phénoménologique d’une nation ouest-africaine, la culture panafricaine de souche égyptologique serve au changement radical de la vision africaine actuelle du monde.
Il s’agit de se donner une vision qui sache prémunir le renouveau culturel panafricain de la prédation des marchés financiers, lesquels, faisant des micro-nations africaines actuelles, les jouets des intérêts étrangers, régulent les termes des échanges dans l’environnement des affaires à l’échelle planétaire. Analogiquement, sur les réalités allemandes relatives à l’environnement fichtéen ayant précédé le XXe siècle de Heidegger, ne pas être permanemment le jouet des intérêts d’autrui semble signifier un comportement qui sache préserver des affres d’un cosmopolitisme inconscient.
S’il faut se préserver d’un cosmopolitisme nivelant et, par conséquent, destructeur des identités nationales, c’est que ce n’est pas la seule France ou encore les seuls Juifs qui peuvent avoir été victimes d’une domination de nature exogène. Au témoignage de R. Lauth (1991, p. 249), « entre 1806 et 1809, Fichte découvre la pleine signification de la détermination de l’histoire en s’engageant dans une lutte de résistance active à l’occupation française des territoires qu’il regroupe sous le terme de « nation allemande » ». Un an plus tôt, Johann Gottlieb Fichte énonçait la thèse selon laquelle la « conscience cosmopolite » regarde, avec indifférence, « les actions et le sort des États » (Fichtes Werke, 1971, VII, 212). Qu’affirmer ses intérêts nationaux, au point d’offrir une voie qui puisse être typiquement nationale, telle la voie allemande actuelle, ne soit le fait d’un nationalisme qui, pour être exacerbé, serait exclusionniste, cela peut, dès lors, se comprendre également de l’expérience philosophico-politique fichtéenne, qui relève toutefois d’une vision se trouvant à l’intersection entre le cosmopolite et le nationaliste. Une telle vision semble être en lien avec notre vision, en Afrique de l’Ouest, d’une nation dont l’étendue spirituelle et culturelle saura dépasser les limites des micro-États-nations africaines actuelles.
Or, comme Heidegger à partir de la Deuxième Guerre mondiale, « Fichte, à partir surtout de la Première Guerre mondiale […] est considéré comme synonyme de nationalisme exacerbé et de culte exalté de la nation allemande et de sa primauté sur le monde […] » (D. Losurdo, 2001, p. 298) ; par où Fichte pourrait avoir été le précurseur du Discours de Heidegger. Cette éventualité n’est pas fortuite. « Au nom de la langue, du caractère et du peuple allemands, [Fichte] dénonce en Napoléon l’« usurpateur sans nom » qui a détruit les idéaux révolutionnaires et ouvert la voie au règne du capital » (R. Lauth, 1991, p. 249). Au sujet du capitalisme désorganisateur, si les Juifs, la France et l’Europe parviendront, un siècle plus tard, à voir en Hitler et Heidegger les désorganisateurs politique et philosophique de l’espace culturel européen, le désordre culturel sous-régional et continental n’est pas une nouveauté. En effet, le Français Napoléon aura précédé l’Allemand. Sur ce chapitre, comment ne pas penser au projet explicite d’une nation ouest-africaine comme solution politique au désordre sous-régional minant ce début de XXIe siècle. Un tel projet, sous-tendu par la proposition d’ériger le dioula ou l’haoussa comme langue ouest-africaine nationale, fait écho au positionnement fichtéen à l’intersection du cosmopolitique et du nationaliste.
Mais, il reste à savoir si, comme leurs homologues allemands ou français des deux siècles précédents, les philosophes ouest-africains du moment sauront, en plus de l’ouverture au prochain qu’est le pays voisin ou lointain, faire le pari de l’humain contre le capital, face aux Napoléon et aux Hitler contemporains qui pourraient étouffer leurs contemporains, comme le firent Fichte et, tant bien que mal, Heidegger. En l’ère planétaire de la fusion des États dans le moule d’une mondialisation sans visage humain, l’intelligentsia africaine est explicitement, aujourd’hui plus que jamais, invitée à entendre ce moins nationaliste que régionaliste « citoyen » européen, Fichte. Celui-ci, dans son Discours à la nation allemande, en 1808, n’hésita pas à encourager ses contemporains à assumer la conviction que « le patriotisme allemand existe, à prétendre connaître la valeur infinie de son objet et à affirmer que cet amour seul l’a poussé à dire ce qu’il a dit, en dépit du danger » (Fichte, 1975, p. 399).
Maintenant, pour s’étendre sur le rapport de Heidegger à son prédécesseur quant à l’engagement politique, chez le Philosophe de Messkirch qui voit, dans le dialogue entre les peuples, par exemple entre l’Allemagne et la France, une voie de sortie d’une hégémonie en planétarisation, il s’agit, comme le rapporte F. Dastur (2011, p. 37), « d’ouvrir l’espace d’un voisinage entre les deux peuples, ce qui requiert à la fois », ainsi que l’écrit précisément M. Heidegger ([1983] 1985, p. 163), « la volonté persévérante de s’écouter l’un l’autre et le courage retenu d’obéir à sa propre détermination ». A contrario, le vécu de Fichte est singulier. Tant, en s’inscrivant moins dans la perspective de l’autodétermination, entrevue plus haut, que dans une vision cosmopolite intelligente liée à la construction d’un État unique par l’éclatement futur des frontières interétatiques exigeant de confier son sort au voisin, il « commence […] sa carrière philosophique en prononçant un terrible réquisitoire contre l’Allemagne et [jusque dans ses] œuvres théoriques les plus importantes, il est […] animé par l’espoir d’une régénération provenant d’Outre-Rhin » (D. Losurdo, 2001, p. 298), entendez la France ! C’est que, fondamentalement inter-culturaliste et progressiste, Fichte sait imbiber la question nationale dans le thème plus universel de la lutte pour « l’abolition de l’ancien régime et la réalisation qui en découle de la paix perpétuelle » (Idem). Il s’insurge notamment contre les cours et les cabinets qui ont produit « un orgueil national sans nation » (Nationalstolz ohne Nation) (Fichtes Werke, 1971, VI, 97).
Chez Fichte donc, l’espérance et la perspective que « tous les hommes qui habitent la surface de la terre finissent par s’unifier graduellement en un État unique » (Fichtes Werke, 1971, III, 369) rendent désuet tout nombrilisme nationaliste. Or, se réclamant moins d’un nationalisme formaliste retenu dans les mains de juristes, d’experts et autres savants qu’à une espèce de nation continentale, se référant à cet effet moins à l’ancien régime qu’au monde antique, c’est « à l’hellénisme » que Heidegger voudrait confier le sort de l’Allemagne et, partant de l’Europe. Ce, « du fait que, pour lui, la nouvelle espèce d’homme qui construira l’Europe de l’avenir ne peut être qu’une race d’artistes [- entendez de poètes – et] de créateurs semblables aux anciens Grecs. Car […] Heidegger n’a jamais considéré la culture grecque comme l’accomplissement ethnique d’un peuple particulier » (F. Dastur, 2006. p. 5). Mais, au sujet des artistes, il est convenu que c’est plutôt à un artiste particulier, en l’occurrence le poète allemand Hölderlin, que Heidegger réfère. Plus spécifiquement, selon Emmanuel Faye qui, en sa lecture des séminaires inédits de la période du Discours de rectorat, 1933-1935, dénonce chez Heidegger, une introduction du nazisme dans la philosophie, « Heidegger réinterprète Hölderlin en un sens radicalement nationaliste et völkisch. Il prétend tirer de ce dernier, qualifié de « poète des Allemands », une mythologie politique exprimant la « voix du peuple » germanique » (E. Faye, 2005, p. 25).
Sur le rapport du philosophe au poète sous l’enjeu du dialogue interculturel, pour E. Faye, dont l’interprétation du philosopher heideggérien est tributaire de l’hypothèse ouverte par Victor Farias, Heidegger est antisémite. Il existe toutefois une ligne de lecture autre. Celle-ci inscrit le dialogue interculturel entre Heidegger et le judaïsme dans une perspective d’avenir. Dans cette ligne, le dialogue est en passe de devenir étonnamment fructueux. Ainsi, Dirk Weissmann voit dans l’héritage heideggériano-hölderlinien, le lieu d’une fécondation mutuelle des études communes entre pensée et poésie. En sa vision philologique, D. Weismann est issu de l’héritage philosophique de Beda Allemann, qui est l’auteur d’une « comparaison du poète et du philosophe […] réalisée dans ce que l’auteur a voulu être un « dialogue » (die Zwiesprache) « entre l’interprétation heideggérienne de Hölderlin et l’influence de Hölderlin sur Heidegger » (J.-D. Robert, 1961, p. 142). Ce dialogue, l’on voudrait le voir devenir effectif aujourd’hui, au plan philosophique, par exemple entre la Côte d’Ivoire, religieuse et politique, avec l’Europe aux prises avec les problèmes liés à la planétarisation du monde, aussi bien qu’avec le Burkina Faso voisin.
Sur la visée nationale en contexte multiculturel, un interlocuteur de premier choix pour les philosophes ivoiriens pourrait être le philosophe burkinabé, Mahamadé Savadogo. Il observe qu’« une nation est susceptible de regrouper des locuteurs de langues différentes […]. L’unité d’une nation se conquiert à travers une histoire qui conduit des groupes humains différents à […] adhérer à des règles communes qui organisent leurs rapports » (M. Savadogo, 2015, p. 3-4). Au sujet des rapports spécifiques aux diverses cultures présentes dans l’espace sous-régional, il signifierait que « la nation ne craint pas la diversité culturelle parce qu’elle ne s’appuie pas sur un trait culturel pour se développer mais sur l’action collective, sur la politique » (Idem, p. 4). Quant aux risques d’une domination nationale ou supranationale, de souche ancestrale ou française, pour lui, « une société dominée par une identité contraignante est incapable de s’ouvrir à la richesse d’autres cultures. [Et] l’unité nationale ne peut être réconciliée avec la diversité culturelle que là où il est clairement admis que la nation est un cadre moderne de socialisation et non un héritage culturel » (Idem, p. 15).
In fine, parviendra-t-on à construire une nation ouest-africaine ? Même si tel ne semble pas le projet de M. Savadogo (2014, 4è de couverture), celui-ci développe un « programme politique révolutionnaire qui interroge les formes de l’action collective dans leur rapport avec la capacité de changer la société ». Tout intellectuel ouest-africain, philosophiquement marxo-hégélien ou fichto-heideggérien, est, pour ainsi dire, invité à un « engagement militant recouvr[ant] des formes qui vont de la participation à une association fondée sur une affinité quelconque à l’engagement dans un regroupement politique qui poursuit la transformation de la société ». Idem, p. 8).
Conclusion
Deux problèmes ont été décelés comme ayant émané du contexte culturel relatif au Discours de rectorat. Le premier a concerné l’élitisme heideggériano-platonicien. Les termes de cet élitisme apparurent dia-logiquement les visions, soit idéalistes, soit matérialistes mais, uniment, élitistes, inhérents aux rapports de domination qui définissent l’élaboration de l’actuelle conscience historique africaine. La solution africaine déclinant de l’expérience germano-européenne apparut la fourniture par les intellectuels (penseurs, poètes et autres historiens) africains de ressources interculturelles libératrices aux masses africaines pour maîtriser leur mouvement social propre. Par où il importe que, philosophes ou politiques, idéalistes et matérialistes africains quittent le mimétisme pour rejoindre leur peuple.
Le deuxième problème soulevé fut l’exacerbation de l’auto-affirmation allemande chez Heidegger. Problème qui à l’inverse, en Afrique, est apparu l’insuffisance d’une affirmation culturelle n’ayant pu jusque-là offrir une voie explicitement ivoirienne, par exemple. Cette problématique, dirigée à la fois sur les défis de la libération de l’Afrique et sur la limitation de la volonté heideggérienne de puissance, aura porté sur la nécessité d’une révolution culturelle. Celle-ci habilitera l’Afrique à résolument se doter d’une culture de progrès basée sur l’autodétermination par le dialogue interculturel, ainsi d’E. Morin dans le sens de l’autonomie-dépendance comme paradigme. L’heideggérianisante volonté de puissance trouve sa solution dans le dialogue culturel franco-allemand ayant yantgénéré une adoption de la philosophie-poétique allemande, précisément, hölderlinienne, de libération d’une France alors assiégée par l’Allemagne. Ce qui, pour chaque pays africain, la Côte d’Ivoire en particulier, reste à promouvoir dans ses rapports autant avec son (ses) voisin(s), burkinabé ou sénégalais par exemple, qu’avec l’ex puissance coloniale.
Au total, afin qu’émerge une génération de philosophes engagés au service de l’unité nationale ouest-africaine, à tout intellectuel en mal d’incursion dans le champ politique, s’offre à méditer, la vie de Senghor. Il n’est pas philosophe, mais ce poète auquel, entrant en dia-logue avec Idrissa Diarra (2016), Secrétaire exécutif du Mouvement de la génération consciente du Faso, nous-même, heideggérien, assignons les traits du « profil décrit par Platon […] dans l’expression « philosophe roi ou roi philosophe […] » pour son « humanisme universaliste culturel et politique ».
Références bibliographiques
AKHUTIN Anatoly V., 2014, « Dialogique ontologique de la culture », dans Revue philosophique de la France et de l’étranger, 3 (Tome 139), p. 347-362.
BAHR Egon, 2003, Der deutsche Weg. Selbstverständlich und normal, München, Blessing Verlag, 157 p.
BÜTTGEN Philippe, 2008, « Hegel à Augsbourg. Confession et commémoration », dans Revue germanique internationale, 8, CNRS Éditions, p. 33-53.
DASTUR Françoise, 2006, « L’Europe et ses philosophes: Nietzsche, Husserl, Heidegger, Patocka », dans Revue Philosophique de Louvain, Louvain-la-neuve, 104-1, pp. 1-22.
DELINIERE Jean, 2003, « La constitution de l’Allemagne de Friedrich Hegel », dans Siècles, Centre d’Histoire “Espaces et Cultures”, 17, p. 73-89.
DIARRA Idrissa, 2016, 28 mai, « Léopold Sédar Senghor et l’alternance au pouvoir : le philosophe roi ou le roi philosophe décrit par Platon », Le Faso.net, En ligne. http://lefaso.net/spip.php?article71445.
FAYE Emmanuel, 2007, Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie. Autour des séminaires inédits de 1933-1935, Paris, Le livre de Poche, 767 p.
FICHTE Johann Gottlieb, 1975, Discours à la nation allemande, trad. S. Jankélévitch, Paris, Aubier Montaigne, 245 p.
GOUGEON Jean-Pierre, 2009, « L’Allemagne puissance », dans Revue internationale et stratégique, 2 (n° 74), p. 33-47.
HEIDEGGER Martin, [1983] 1995, Écrits politiques : 1933-1966, Présentation, trad. et notes par François Fédier, Paris, Gallimard, 552 p.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, La Constitution de l’Allemagne, dans Georg LASSON, 1913, Hegels Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie, Leipzig, (1977, Ecrits politiques), trad. de Michel JACOB, Paris, p. 21-181.
KAVWAHIREHI Kasereka, 2009, L’Afrique entre passé et futur: l’urgence d’un choix public de l’intelligence, Bruxelles, Peter Lang, 332 p.
KOUVOUAMA Abel, 2000, « Penser la politique en Afrique », dans Politique africaine, 1, no77, p. 5-15.
LOSURDO Domenico, 2001, « Fichte et la question nationale allemande », dans Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2, no 14, p. 297-319.
MBELE Charles Romain, 2014, « Panafricanisme ou postcolonialisme ? La lutte en cours en Afrique », dans Revue scientifique du CERPHIS, n°012, p. 142-197.
MONOD Jean-Claude, 2009, « L’interdit anthropologique » chez Husserl et Heidegger et sa transgression par Blumenberg, in Revue germanique internationale, 10, p. 221-236.
ROBERT Jean-Dominique, 1961, Compte rendu (CR) de : Beda Allemann, 1959, Hölderlin et Heidegger. Recherche de la relation entre poésie et pensée. Traduit de l’allemand par François Fédier, Paris, PUF, dans Revue Philosophique de Louvain, no 61, 290 p, p. 42 pour le CR.
SAVADOGO Mahamadé, 2014, Philosophie de l’action collective, Paris, L’Harmattan, 222 p.
SAVADOGO Mahamadé, 2015, « Diversité culturelle et unité nationale », Le cahier philosophique d’Afrique, no 13, Ouagadougou, Presses Universitaires de Ouagadougou, p. 1-16.
WAMBA-DU-WAMBA Ernest, 1984, « L’autodétermination des peuples et le statut de l’histoire », in Histoire du néo-colonialisme ou histoire néo-coloniale ? L’autodétermination et 1’Histoire en Afrique, Extrait synthétique d’une communication présentée lors d’une Table ronde sur l’élaboration de l’histoire en Tanzanie, trad. Jean Copans, Dar Es Salaam, Université de Dar Es Salaam, p. 7-14.
YAPO Séverin, 2009, « Généalogie de la docilité dans l’Antiquité et le haut Moyen Âge, Gaëlle JEANMART », Labyrinthe, 32, Hermann, p. 177-185.
LA VOCATION DE L’UNIVERSITAIRE À LA LUMIÈRE DU DISCOURS DE RECTORAT DE MARTIN HEIDEGGER
Antoine KOUAKOU
Professeur Titulaire, Université Alassane OUATTARA (CÔTE D’IVOIRE)
Résumé : Renvoyant dos à dos l’hospitalité systématique et le refus catégorique, Emmanuel Kant, face à la question de l’immigration, prône un « droit de visite » tenant compte des droits fondamentaux de la personne humaine et du droit à l’autodétermination des peuples conformément à ses attentes vis-à-vis du droit cosmopolitique. Il fait appel à un humanisme critique qui tranche avec l’humanisme naïf des tenants de l’hospitalité illimitée. Ce qui préfigure une politique d’immigration à la fois lucide, responsable et flexible visant à mettre en œuvre les conditions auxquelles l’installation des étrangers pourrait être compatible avec la liberté et la souveraineté des communautés politiques dans un environnement cosmopolitique.
Mots-clés : DROIT À L’AUTODÉTERMINATION, ÉTRANGER, HOSPITALITÉ, LIBERTÉ DE CIRCULATION, RÉPUBLICANISME.
Abstract : On the basis of human rights and peoples’ sovereignty on the one hand, and according to his view of the cosmopolitan law on the other hand, E. Kant opposes both total acceptance and refusal of immigration for a “right of access”. He suggests a critical humanism that contrasts with the naivety of the adepts of absolute hospitality. That attitude requires at the same time, a perspicuous, responsible and flexible immigration policy that defines the settlement conditions of the foreigners, according to the liberty and political sovereignty of local communities in a cosmopolitan environment.
Keywords: RIGHT TO SELF-DETERMINATION, FOREIGNER, HOSPITALITY, FREEDOM OF MOVEMENT, REPUBLICANISM.
Introduction
L’actualité transnationale est dominée par le phénomène de l’immigration qui connaît un essor considérable ces dernières années. C’est dans un tel contexte qu’intervient ce qu’il est convenu d’appeler « la crise des migrants » à laquelle l’Europe reste durement confrontée depuis 2010. Alimentée en continue par la guerre civile syrienne encore en cours depuis 2011 et bien d’autres situations de détresse de par le monde, cette crise ne semble pas connaître de répit et l’espoir d’une normalisation imminente semble hors de portée. En guise de définition, l’immigration désigne l’entrée, dans un pays ou une aire
[1]Notre analyse se fonde sur la traduction allemande de Gérard GRANEL, publiée en octobre 1982, aux éditions Trans-Europ-Repress (TER).
[2] Cette adhésion au parti national-socialiste ouvrier allemand est annoncée le 3 mai 1933 par le journal allemand Der Alemane. Et le 4 mai 1933, le journal Brisgauer Zeitung l’annonce aussi. Heidegger restera inscrit à ce parti jusqu’en 1945.
[3] Platon, République 497d, 9.
[4] Ce terme allemand signifie « une conception du monde ».