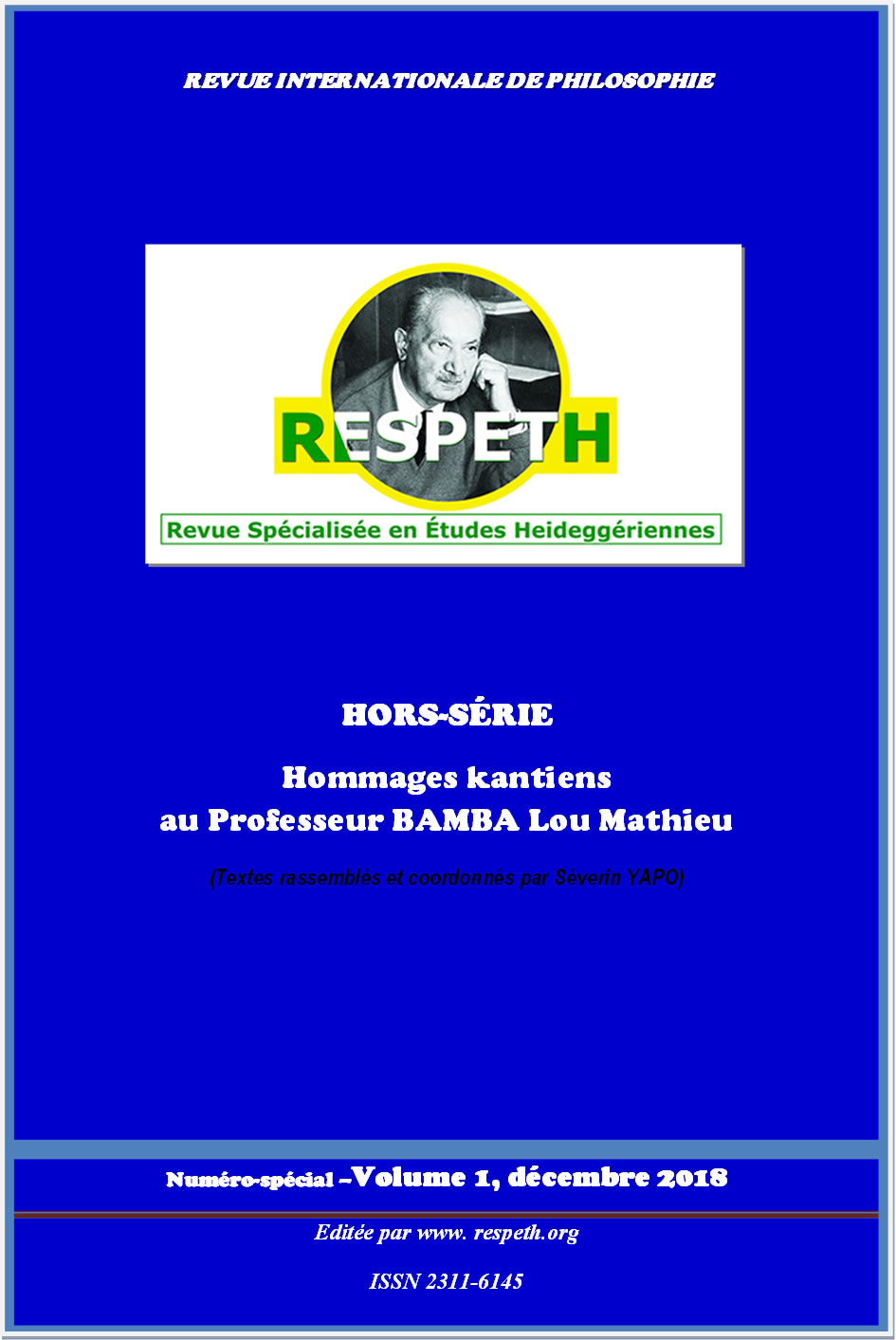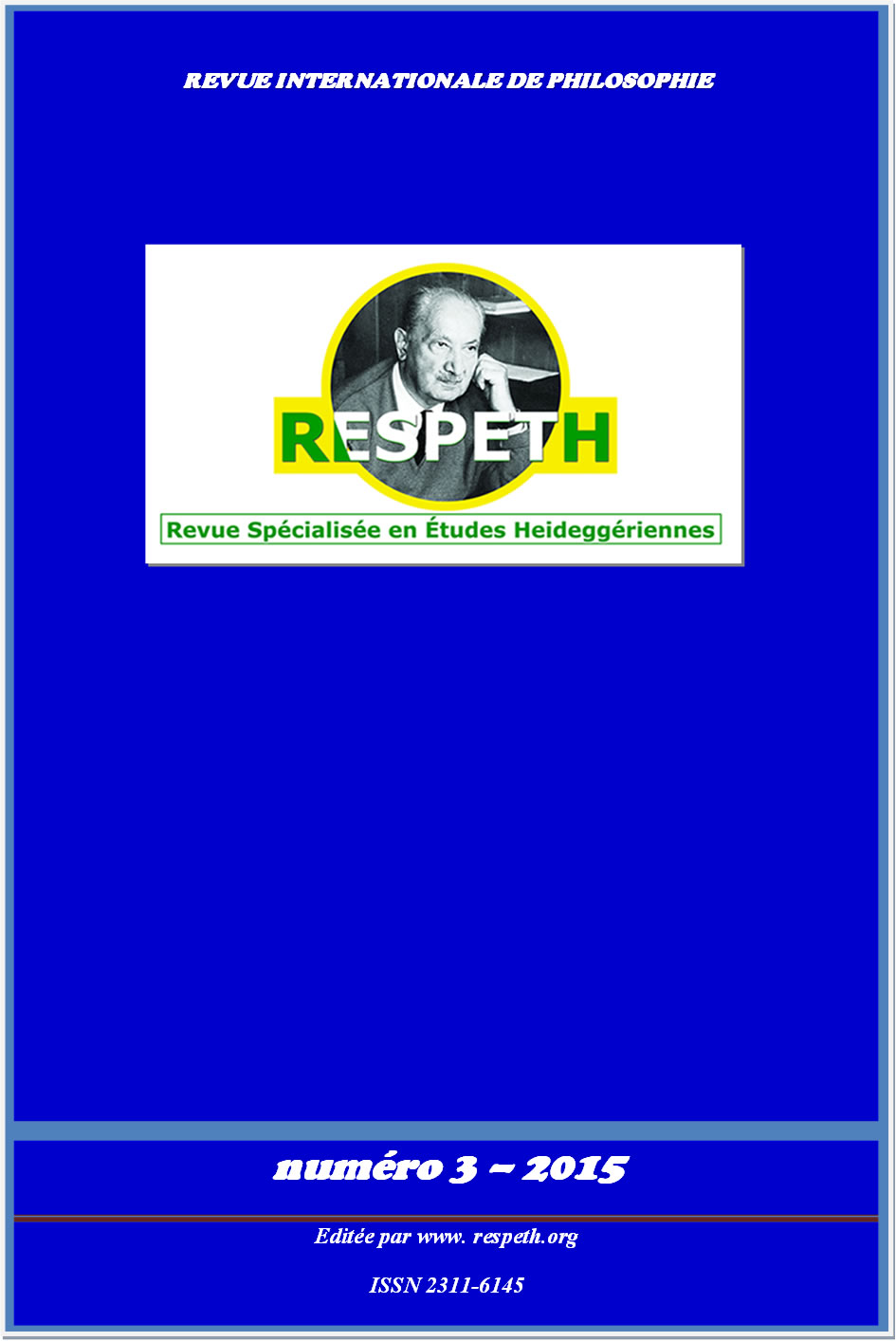RESPETH 4-2016
SOMMAIRE
Avant-Propos : POURQUOI HEIDEGGER ?…………………………………..2
PRÉSENTATION DU TROISIÈME NUMÉRO : Sur les traces de Martin Heidegger : ………………………………………………………………..8
MARTIN HEIDEGGER, CRITIQUE DE L’ONTOLOGIE CLASSIQUE ……………………………………………………………..11
MÉTAPHYSIQUE ET SENS …………………………………………………………48
AKANOKABIA (Akanis Maxime), Nietzsche et la métaphysique de la présence………………………………………………………..66
MARTIN HEIDEGGER ET NOTRE HUMANITÉ……………………….85
ROY-EMA (Pascal Dieudonné), Solidarité et souci chez Martin Heidegger………………………………………………86
Présentation et Sommaire N°4 > Résumés des articles N°4
www.respeth.org, 2016
22 BP 1266 Abidjan 22 (Côte d’Ivoire)
Email : publications@respeth.org
Tél. : 00225 09 62 61 29 00225 40 39 26 95 00225 09 08 20 94
ORIENTATIONS DE LA REVUE
RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches sur Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody (Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C’est une revue internationale à caractère philosophique qui paraît une fois l’an (en édition régulière). En dehors de cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée du philosophe Martin HEIDEGGER.
La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, novatrices ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions d’ordre théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se rapportant à la pensée du philosophe :
* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les thèmes liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ;
* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ;
* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou moins heideggérien, les textes philosophiques ;
* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de Martin HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes non-occidentaux.
* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons ;
* Des comptes rendus d’ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER.
RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du concours pour le Prix d’Excellence DIBI Kouadio Augustin.
Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue RESPETH se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, les professeurs et étudiants qui s’intéressent au devenir de la philosophie d’influence heideggérienne.
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Andrius Darius VALEVICIUS, Université de Sherkrooke, Québec, Canada
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Augustin DIBI Kouadio, Prof. Titulaire, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Franklin NIAMSI, Prof. Agrégé de Philosophie, Université de ROUEN, France
Jacques NANÉMA, Maître de Conférences, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Jean-Luc AKA-EVY, Prof. Titulaire, Université Marien NGOUABI, Congo-Brazaville
Sophie-Jan ARRIEN, Prof. Titulaire, Université de Laval, Canada
COMITÉ DE LECTURE
Andrius Darius VALEVICIUS, Université de Sherkrooke, Québec, Canada
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Raoul KOUASSI Kpa Yao, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Augustin DIBI Kouadio, Prof. Titulaire, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Jacques NANÉMA, Maître de Conférences, Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
Jean-Luc AKA-EVY, Prof. Titulaire, Université Marien NGOUABI, Congo-Brazaville
Sophie-Jan ARRIEN, Prof. Titulaire, Université de Laval, Canada
COMITÉ DE RÉDACTION
DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Antoine KOUAKOU, Prof. Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
REDACTEUR EN CHEF :
Jean Gobert TANOH, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
Séverin YAPO, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
Léonard KOUASSI Kouadio, Institut National du Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle, Côte d’Ivoire
MEMBRES :
Alexis KOFFI Koffi, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Christophe PERRIN, Université Paris-Sorbonne, France
Élysée PAUQUOUD Konan, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire
Oscar KONAN Kouadio, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Pascal ROY-EMA, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire
Sylvain CAMILLERI, Université Catholique de Louvain, Belgique
RESPONSABLE TECHNIQUE :
Raoul KOUASSI Kpa Yao, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire
SOMMAIRE
Avant-Propos : POURQUOI HEIDEGGER ?…………………………………..2
MARTIN HEIDEGGER, CRITIQUE DE L’ONTOLOGIE CLASSIQUE .………………………………………………………………………………….11
KOUAHO (Marcel Silvère Blé), Le substantialisme cartésien à l’épreuve de l’ontologie heideggérienne .……….12
SANGARÉ (Abou), Dialectique et ontologie : sens et enjeux du procès heideggérien de la métaphysique ……….30
MÉTAPHYSIQUE ET SENS …………………………………………………………48
YÉO (Kolotioloma Nicolas), L’homo mensura de Protagoras : une proposition métaphysique fondamentale ………49
AKANOKABIA (Akanis Maxime), Nietzsche et la métaphysique de la présence.……………………………………………………….66
MARTIN HEIDEGGER ET NOTRE HUMANITÉ ………………………85
ROY-EMA (Pascal Dieudonné), Solidarité et souci chez Martin Heidegger…………………….……………………………86
BAMBARA (Romuald Évariste), L’“insomnie” comme expression du philosopher chez Emmanuel Levinas ……………110
YAPO (Séverin), Phénoménologie de l’humanité mariale. Réflexion à partir de Whitehead ……………………………………131
POURQUOI HEIDEGGER ?
Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, en terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante qu’il faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, avec Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont l’histoire consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire de beaucoup de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit nullement dans un conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise plutôt à scruter un implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport de la conscience aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun prétexte, pour autant que l’homme, quelle que soit sa particularité individuelle ou collective, ne peut pas ne pas comprendre que le point de départ de l’histoire s’inscrit nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-delà de tout ce qui nous préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de divergences ou même de conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous détermine tous : nous sommes des consciences devant les déterminités. Et la conscience ne parvient à sa vérité que dans une appartenance essentielle au Concept, comme expression d’une pensée substantielle de son rapport aux choses. De ce point de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si complexe qu’une complaisance à son égard influence négativement la marche dans l’histoire de tout peuple. La qualité de cette marche est donc déterminée par le sérieux et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans la présence des choses. Husserl, dont la philosophie est une réappropriation de la conscience, dans son essentialité, nous permet de bien comprendre qu’une pensée rigoureuse ne peut se dispenser de la vérité de la conscience dans son rapport aux choses, d’où la nécessité fondamentale de l’époché, pour accéder au moi transcendantal ; car une conscience encombrée de psychologisme rend impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son intentionnalité. C’est la réduction transcendantale pour désobstruer le rapport de la conscience aux choses. Le retour aux choses ou “droit aux choses mêmes”, comme idée substantielle de la phénoménologie husserlienne, est le retour de la conscience dans sa pureté originelle, seul gage pour rendre la philosophie, c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, comme science rigoureuse. Le célèbre article de Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, paru en 1911, en donne la pleine mesure. La conscience, étant le fondement premier de toute science, y compris la philosophie en premier, exige d’être pensée en soi, comme conscience transcendantale, pour donner au Concept toute la rigueur de son sens. La rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la réduction phénoménologique, chez Husserl, traverse toute la pensée de Heidegger, qui l’enracine dans une expérience plus originaire et plus originelle, celle avec l’Être.
Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même que celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du Népal sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la réalité non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le chien comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde sur le non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-présent. Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation constante d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité.
Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver de l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement “jeune”, qui implique, sans aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans laquelle, de toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour donner à l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une question d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, dans la mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui structure, de manière universelle, son existence.
Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige une méditation sur le rapport de l’étant à l’être. Un rapport dans lequel l’étant est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une articulation nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la métaphysique de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières pages de Être et Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est aujourd’hui tombée dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au préalable, il n’a pas manqué de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer tout l’enjeu de sa pensée : « Avons-nous une réponse à la question de savoir ce que nous voulons dire exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. Dans ces conditions, il faut poser en termes tout à fait neufs la question du sens de l’être. Sommes-nous donc seulement aujourd’hui encore dans l’aporie de ne pas entendre l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces conditions, le plus urgent, c’est de réveiller une entente pour le sens de cette question » (Idem, p. 21). Il s’agit, alors, de pousser à fond le rapport de l’homme au savoir pour qu’advienne et se maintienne, sans prétention et de manière définitive, son essence pensante, si tant est que rien ne peut possibiliser son existence, s’il n’est radicalement établi dans cette essence. Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde pensante de la garde de l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans laquelle l’homme accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à aucune race et à aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait pas le propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde de la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et poursuit sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est pleinement chez soi. Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux peuples, qu’elle soit embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut l’accueillir, avec grande sérénité et lui permettre de croître dans le secret de sa puissance, qui rend puissants les peuples qui savent la contempler dans la splendeur de sa vérité. Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin de liberté, parce qu’est libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où sont brisées les idoles de nos excessifs particularismes et de nos primitivités, dénuées du saut qualitatif, nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de cette idée heideggérienne : Là où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. Ce qui suppose qu’il faut, dès la départ, écarter, avec une violence salutaire, l’idée d’une rationalité multiple, comme si “un plus un” feraient, ailleurs, autre chose que deux. La logique n’est ni culturelle, ni géographique, c’est le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, selon Hegel, réside dans la conscience de soi, conscience parvenant à son contenu comme Concept. Ce Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi dire, des Grecs. Serait-il scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il pas revendiquer autre chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est menacée de faillite, en raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, pourrions-nous ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur fondement ultime dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, aujourd’hui, honneur à défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, pas pour des raisons de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut pas avoir un ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire “nous sommes des Grecs ?” Heidegger nous donne l’excellente réponse : « Grec, cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les différents modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée par lui, sans pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405).
Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore suffisante des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité sociale et politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se construit tout peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève dans l’horizon de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais nécessaire. Bien qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la pensée des valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas moins la question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme fondamental, comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance tout humanisme classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à sauvegarder. Il serait, alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre donnerait des directives à l’action de l’homme ; une telle orientation est, simplement, aux antipodes de la pensée de Martin Heidegger, pour qui la pensée est en soi une action radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue au rang d’action du seul fait qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à La pensée agit en tant qu’elle pense. (…) Cet agir est probablement le plus simple en même que le plus haut, parce qu’il concerne la relation de l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, p. 68). Pourquoi ? Parce que là où existent des distorsions sociales et des horizons historiques confus, la pensée ne s’est pas suffisamment accomplie, c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec vigueur et rigueur, porté son essence dans la seule relation, qui lui donne tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il pas alors bien étonnant de montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel Faye, que Heidegger est un théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait injuste d’enfermer le grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa vie (Six mois rectorat sous le régime des nazis), alors même que la commission de « Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu lieu depuis le courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe de la Forêt Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le rectorat sous le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être discrédité par son son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les accointances avec le nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de pensée du dernier des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas Dieu ; et la grande intelligence n’est pas canonisation.
« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). Apprendre à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine l’humanité de l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait écrire : « Plein de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ». Puissent nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de l’Être, pour qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant.
Jean Gobert TANOH
MARTIN HEIDEGGER, CRITIQUE DE L’ONTOLOGIE CLASSIQUE
LE SUBSTANTIALISME CARTÉSIEN À L’ÉPREUVE DE L’ONTOLOGIE HEIDEGGÉRIENNE
Marcel Silvère Blé KOUAHO
Maître de Conférences, Université Alassane OUATTARA
kouahoblemarcelsilvere@yahoo.fr
Résumé : Une lecture de l’ontologie fondamentale de Heidegger permet de saisir l’histoire de la philosophie comme celle de l’oubli de la question de l’Être initiée par les penseurs matinaux. Cet oubli dénote d’une confusion indifférenciant l’Être et l’étant à partir de la métaphysique traditionnelle Si la métaphysique cartésienne n’échappe pas à cette critique heideggérienne, cependant, la différence ontologique qu’elle établit entre la substance infinie et la substance finie, (laquelle différence ne laisse pas indéterminé le sens d’être du « sum ») et la mise en évidence des similitudes que présente l’Être heideggérien avec le Dieu de révélation induisent à une remise en question de l’ontologie fondamentale.
Mots-clés : COGITO, MÉTAPHYSIQUE TRADITIONNELLE, ONTOLOGIE FONDAMENTALE OUBLI DE L’ÊTRE, SUBSTANTIALISME.
Abstract : A reading of Heidegger’s fundamental ontology allows us to grasp the history of philosophy as the forgetting of being question initiated by morning thinkers. This oblivion denotes an undifferentiating confusion of to be and being through traditional metaphysics. If Cartesian metaphysics does not escape from this heideggerian criticism, therefore the ontological difference that it establishes between the infinite substance and the finite substance (which difference does not leave undetermined the being sense of the “sum”) and the highlighting of the similarities, that heideggerian being presents with the god of revelation, induce to a questioning of the fundamental ontology
Keywords: COGITO, TRADIONNAL METAPHYSICS, FUNDAMENTAL ONTOLOGY, BEING OBLIVION, SUBSTANTIALISM.
Introduction
Le conflit entre Heidegger et Descartes a lieu autour de la période dite Moderne que J.-M. Vaysse (2000, p. 57), pastichant Heidegger, présente ainsi :
Les Temps Modernes (Neuzeit) désignent la configuration historiale se caractérisant par la détermination de l’être de l’étant comme subjectivité et recoupant l’époque qui va de Descartes à Nietzsche. Ils marquent une grande étape de questionnement, avec l’apogée de la science techniciste, en tant que contemporanéité de la métaphysique et du nihilisme lié au subjectivisme.
De cette définition des Temps Modernes, on retient que le phénomène, la question qui fait l’objet de débat entre Heidegger et ses prédécesseurs métaphysiciens, est celui de l’être, ce fil conducteur qui gouverne tacitement l’ontologie depuis l’Antiquité grecque. Sur une grande partie de son œuvre, Heidegger s’est référé suffisamment à Descartes, pour engendrer des commentaires et susciter des disputes, de très loin, plus longues et abondantes que les références ou les allusions à Descartes.
Dans l’entendement du philosophe allemand, Descartes serait ainsi le point de départ de ce qu’on appelle « la philosophie du sujet » dont l’aboutissement (ou l’impasse) est la phénoménologie de Husserl, puis l’ontologie phénoménologique sartrienne. Il est celui dont l’ontologie classique du sujet, nourrissant l’espoir et l’optimisme placés dans la science et la technique, liquide la question du sens de l’Être qui, dans l’ordre de préséance des soucis du Dasein, reste prioritaire, urgente. Et c’est cette question posée, depuis des lustres, que Heidegger s’est résolue à faire resurgir, et ce, en procédant à une dé-construction des classiques, laquelle déconstruction se veut comme une propédeutique nécessaire à la construction de son ontologie fondamentale.
Ce que Heidegger veut donc détruire, ce sont ces métaphysiques ayant consolidé, solidifié, figé une interprétation de l’Être comme présence permanente qui ressortit à un « oubli de l’Être, c’est-à-dire de l’histoire du dévoilement et du retrait de ce qui donne à être » (M. Heidegger, 1990, p. 248). Dit autrement, ce qu’il déplore, c’est la lecture de l’être de l’étant comme substance permanente parce qu’elle obstrue la question de l’Être. Et de la sorte, c’est le substantialisme cartésien, voire le subjectivisme moderne qui se trouve particulièrement visé, convoqué au tribunal de la pensée heideggérienne. Le Cogito, c’est-à-dire le sujet humain rationnel, placé au fondement de la métaphysique par Descartes, sera substitué par le Dasein vu, par M. Heidegger (1964, p. 101), comme « le berger de l’Être ». L’Être dont il dit qu’il n’est ni Dieu ni l’Étant suprême.
Au regard de cette analyse, des questions se posent. Comment Heidegger justifie-t-il l’oubli de l’Être, voire la confusion de l’Être et de l’étant par Descartes ? La différence ontologique opérée par Descartes entre l’Être divin et le cogito rend-elle encore possible cette confusion imputée à la métaphysique traditionnelle ? L’Être, tel que perçu par Heidegger, n’a-t-il pas quelque chose de divin ? Ne porte-t-il pas l’empreinte de l’héritage judéo-chrétien ?
Ainsi donc, nous exposerons, dans un premier moment, l’argumentaire heideggérien contre le subjectivisme moderne. Dans un deuxième temps, il s’agira de montrer que la métaphysique cartésienne ne saurait confondre l’Être et l’étant.
Dans un troisième temps, enfin, nous montrerons l’existence d’une analogie entre l’Être de Heidegger et le Dieu de la révélation que Descartes, d’ailleurs, ne rejette pas.
1. CRITIQUE HEIDEGGÉRIENNE DU CARTÉSIANISME : DE L’ÉVIDENCE DU COGITO COMME OUBLI DE LA QUESTION DE L’ÊTRE
Chez Heidegger, penser l’Être implique de dépasser la métaphysique et l’humanisme qui recèlent un même destin historial dissimulant l’essence destinale même de la pensée authentique. C’est pour n’avoir donc pas perçu cette essence destinale de la pensée authentique que la métaphysique moderne de la subjectivité, qui débute avec Descartes, s’est reposée sur la détermination de l’essence de la vérité comme certitude. M. Heidegger (1962, p. 79) dira, à cet effet, que « la métaphysique moderne entière, Nietzsche y compris, se maintiendra dorénavant à l’intérieur de l’interprétation de l’étant et de la vérité initiée par Descartes ». Autrement dit, l’Être demeure manquant dans la métaphysique moderne, car l’essence moderne de la vérité voile la manifestation de celui-ci.
Descartes a, en réalité, remis en question tout l’héritage de la tradition scolastique pour s’engager dans la recherche d’un fundamentum inconcussum, à partir duquel il pourra déduire les vérités du savoir humain. « L’exigence de la certitude vise à un fundamentum absolutum et inconcussum, soit à une substructure qui ne dépende plus du rapport à une autre substructure, mais qui, à l’avance dégagée de ce rapport, repose en soi-même » (M. Heidegger, 1971, p. 343-344). Mais, quel est ce fondement ou encore cette certitude ? S’interroge Heidegger ! Ce fundamentum inébranlable, Descartes ne le trouve pas dans les choses, car elles sont changeantes et leur réalité a été mise en doute, mais plutôt dans la pensée elle-même, qui, ayant beau douté et être trompée autant qu’on voudra, se maintient tout de même comme ‘‘être pensant’’. M. Heidegger (1958, p. 84) affirme :
Pour Descartes, l’ego cogito est, dans toutes les cogitationes, ce qui est déjà présenté et pro-duit, ce qui est présent, hors de question, indubitable, ce qui est déjà dans toute science, la chose proprement certaine, solidement établie avant toute autre.
Ainsi, le début métaphysique des temps nouveaux est un changement du foyer de déploiement de la vérité, changement dont le fond reste en retrait. Au concept traditionnel de vérité, selon lequel la vérité qui repose sur la concordance de la pensée avec son objet (la chose), se substitue le concept de vérité en tant que certitude chez Descartes. Pour Heidegger, c’est justement la transformation de la vérité en certitude qui met en marche le mouvement conduisant au subjectivisme moderne.
Ce qui perdure, ce qui se trouve constamment en position de sujet, c’est le cogito, pensé comme l’exercice fondamental et essentiel de l’ego que je suis. C’est ainsi que l’ego devient, en germe, le sujet par excellence et, finalement, le seul. Le point de vue du Je et le subjectivisme de l’époque moderne prennent leur source dans la proclamation du ‘‘Je’’, de la subjectivité humaine comme centre de la pensée. Le subjectum, c’est dorénavant l’homme, pensé, bien sûr, à partir de sa pensée.
Cependant, des questions demeurent : Qu’est-il advenu de l’Être pour que se développe une pensée de la subjectivité ? « Dans quel sol les racines de l’arbre de la philosophie trouvent-elles leur point d’attache ? » (M. Heidegger, 1968, p. 23).
Pour le philosophe de la forêt noire, plutôt que de parler de racines métaphysiques, le gentilhomme-poitevin aurait dû sonder le sol d’où se trouvent les racines de la philosophie, lequel sol est resté impensé, et donc tombé dans l’oubli. La vérité de l’arbre de la philosophie qu’est la métaphysique n’est le fondement de l’arbre que parce qu’elle prend sa source dans le sol en question. Celui-ci est le fondement abyssal ou sans fond du fondement, c’est-à-dire la vérité de l’Être qui laisse être les racines de la philosophie. Dès lors, M. Heidegger 1962, p. 288) affecte une certaine distance vis-à-vis de « la métaphysique des temps modernes qui commence et déploie son essence en ceci qu’elle cherche l’absolument indubitable, le certain, la certitude ». Comme M. Haar (1990, p. 20) pouvait le souligner, « la question réflexive “qui suis-je ?” cache l’accès à l’Être ».
De ce fait, la métaphysique cartésienne est non seulement vouée à l’explication de l’étant et étrangère au mystère de l’Être, mais aussi elle ignorerait l’Être en le confondant au véritablement étant. Elle fait donc passer l’étant pour l’Être et réduit l’Être, comme tel, à l’étantité de l’étant. Et c’est cette méprise qu’on retrouve chez Descartes. M. Heidegger (1976, p. 50) écrit :
Avec le « cogito sum », Descartes prétend munir la philosophie d’un sol nouveau et assuré. Ce qu’il laisse indéterminé ; dans le commencement radical de la philosophie, c’est le genre d’être de la res cogitans, plus précisément le sens d’être du « sum ».
Dit autrement, il y a un « sum » qui apparaît avec l’évidence de l’ego cogito, mais ce « sum » est inquestionné, laissé hors du débat. Comment alors Heidegger explique-t-il cette mise de côté, voire l’occultation, par Descartes, de la question de l’Être ?
En effet, si, conformément à ce que dit Descartes, la métaphysique est la racine de cet arbre qu’est la philosophie, la question sur l’essence de la métaphysique, selon Heidegger, ne peut pas se poser à l’intérieur de la métaphysique, mais suppose une question plus fondamentale concernant non plus l’étantité de l’étant, mais l’Être, en tant que tel, ouvrant la voie à un autre commencement de la pensée. Une pensée qui pense la vérité de l’Être ; d’où un retour au fondement de la métaphysique. Il ne s’agit pas pour autant, selon les mots mêmes de Heidegger, de penser contre la métaphysique et d’arracher la racine de la philosophie, mais d’en explorer le fondement.
Pour Heidegger, la métaphysique classique a conçu l’Être comme présence constante, précisément sous l’angle de la seule clarté. Elle a oublié, selon M. Heidegger (1959, p. 8), que « c’est dans la sombre-clairière, l’obscurité que l’Être se donne en tant qu’éclaircie » ou fait advenir l’étant à l’existence. Par la mutation de l’Être en être-certain, Descartes s’écarterait du bon chemin, donc détournerait la philosophie de sa préoccupation majeure en appréhendant l’Être sous le mode de la représentation. L’Être se réduit à la représentation devenue, par elle-même, instauration et détermination de l’essence de la vérité et de l’Être. Contre l’idéalisme de Descartes et surtout celui de Husserl qui appréhende la vérité comme une construction transcendantale définie par l’activité d’une subjectivité constituante, Heidegger pense que ce ne sont pas les hommes qui font la vérité, c’est plutôt elle qui se donne, se révèle à eux. C’est donc à cette critique heideggérienne de la subjectivité égotique, du substantialisme cartésien qu’il nous faut répondre.
2. DE LA DIFFÉRENCE ONTOLOGIQUE ENTRE LA SUBSTANCE INFINIE ET LA SUBSTANCE FINIE : LE « SUM » À L’HONNEUR
Descartes a-t-il réellement laissé le « sum » inquestionné ? A-t-il confondu l’Être à l’étant ? La contingence existentielle éprouvée par le cogito, voire le problème de la condition humaine permet d’assister à l’éclosion de l’Être divin dans toute sa fulgurance. Autrement dit, la temporalité du cogito mène résolument à l’ontologie. En ce sens, M. Heidegger (1976, p.71) n’affirmait-il pas que « l’homme ou le Dasein est, de tous les étants, le seul qui s’interroge, le lieu où l’être lui-même se met en question ». La métaphysique cartésienne est une méditation sur l’être, une ontologie, et contrairement à ce qu’affirme Heidegger, elle n’est donc pas éloignée de la question de l’être. Pour G. Rodis-Léwis (1990, p. 120), « Descartes n’a pas complètement laissé de côté la question de l’Être ».
En effet, c’est dans le Discours de la méthode et les Méditations métaphysiques que la question de l’Être chez Descartes se pose ; et ce, à partir de la découverte de la substance pensante sur laquelle achoppe le doute, en tant que démarche méthodique devant conduire au savoir, à la vérité. Alors que Descartes doutait de tout, à savoir de la connaissance acquise à l’école scolastique et à l’existence du monde, il se rendit compte qu’il y a une chose dont il ne pouvait douter : c’est le fait qu’il soit lui-même en train de douter, de penser, d’où la remarque de cette vérité : « Je pense, donc je suis », (R. Descartes, 2000, p. 110). Cette vérité, si ferme et si assurée, le gentilhomme poitevin « jugeait qu’il pouvait la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie, qu’il cherchait » (Id., p. 110).
Si l’existence du Je échappe au doute et s’impose comme une certitude absolue, c’est en raison du fait qu’il pense. La pensée a ceci de propre que rien de ce qu’elle est ne lui est extérieur, c’est-à-dire n’échappe à sa propre saisie, que son être se confond avec son apparaître Le « Je pense donc je suis » ou encore « je suis une chose qui pense » (R. Descartes, 1979, p. 81) traduit l’existence de la pensée, de l’âme. L’existence de l’homme tient à la spiritualité, à l’intemporalité de l’âme, de la pensée et c’est d’ailleurs pour cette raison que Descartes trouve en cette faculté, l’essence de l’homme. Comme pouvait le signifier V. Sahi (2003, p. 47), « l’âme est en l’homme, ce qui est universel et échappe au temps, elle est ce qui reste identique à l’homme à travers le temps ». Elle est l’« identité métaphysique » (N. Grimaldi, 1988, p. 23) ou encore l’« identité spirituelle » (R. Lefèvre, 1965, p. 40) maintenue comme permanence, à travers la durée et ses changements. À partir du seul cogito, R. Descartes (2000, p. 111) affirme la substantialité de l’âme : « Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser ».
Cela étant, si dans l’ordre logique ou de la connaissance, la substance pensante est le premier principe dont la primauté est certifiée par l’expérience du doute, cependant se suffit-elle à elle-même dans l’ordre de l’existence. Autrement dit, le cogito peut-il, de lui-même, poser son existence ? L’évidence première n’est-elle pas celle à partir de laquelle se pose la question du sens de cette existence ? Telles sont, pourrait-on dire, les questions ontologiques qui taraudent Descartes et qui seront plus tard reprises par Heidegger lui-même concernant le Dasein en tant que le là de l’Être. À partir du moment où Descartes tenait entre ses mains l’identité métaphysique du sujet, en l’occurrence l’âme se situant par-delà le temps, à l’image du concept d’Être, pouvait-il se poser, à lui, la nécessité de trouver un fondement au fondement comme le recommandait Heidegger ?
Ces questions permettent de saisir, chez Descartes, deux ordres distincts : un ordre atemporel et un ordre soumis au temps, voire à la durée. Partant de cette distinction, on peut penser que le cogito se suffit à lui-même si on le situe dans l’instant, si on le saisit comme une certitude présente à l’esprit.
Expliquons : R. Descartes (1979, p. 73) écrivait que la proposition « je suis, j’existe est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois dans mon esprit ». Si à chaque fois que je pense, je suis obligé de reconnaître que j’existe, en ce sens le cogito n’a pas besoin d’autre chose que soi-même pour fonder son existence. Et, ici, il n’est pas question de savoir d’où lui vient cet acte de penser. Toutefois, les choses changent quand il s’agit d’inscrire le cogito dans la durée : « Je suis, j’existe : cela est certain ; mais combien de temps ? à savoir autant de temps que je pense : car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d’être ou d’exister » (Ibid., p. 77).
Tant que je pense, je suis certain de mon existence ; quand je ne pense pas, rien ne m’assure que j’existe. Or, à coup sûr, nous ne pensons pas toujours, car il arrive souvent que nous marchons et que nous mangeons sans penser en aucune façon à ce que nous faisons. Ma conscience me révèle cette radicale contingence ou impuissance à assurer moi-même mon existence. Il faut alors chercher en dehors de l’ipséité de l’ego, la condition de sa durée. Cette condition, c’est la substance infinie qui n’a besoin d’aucune conservation par autre chose, puisqu’elle est à elle seule sa propre cause ou raison d’exister. Et c’est ici que l’ontologie cartésienne, qui permet de montrer la différence ontologique existant entre l’être fini et l’Être infini.
Cette différence ontologique, chez Descartes comme chez Heidegger, n’a aucun caractère historique : l’idée d’un péché originel, temporellement situé, et appelant à une incarnation rédemptrice, ne joue aucun rôle chez ces philosophes. Cette différence ontologique tient, d’abord, à la conception cartésienne de Dieu : « Par le nom de Dieu, j’entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même, et toutes les autres choses qui sont ont été créées et produites ». (Ibid., p. 115).
Ensuite, elle révèle la non-suffisance, la contingente du sujet pensant par rapport à la substance infinie. R. Descartes, (1973, p. 104) soulignait en ces termes :
De ce que nous sommes maintenant, il ne s’ensuit pas nécessairement que nous soyons un moment après, si quelque chose, à savoir la même qui nous a produit, ne continue pas à nous produire, c’est-à-dire ne nous conserve. Et nous connaissons aisément qu’il n’y a point de force en nous par laquelle nous puissions subsister ou nous conserver un seul moment et que celui qui a tant de puissance qu’il nous fait subsister hors de lui et qui nous conserve, doit se conserver soi-même, ou plutôt n’a besoin d’être conservé par qui que ce soit, et enfin qu’il est Dieu
Du fait qu’une chose existe à un instant donné, on ne peut conclure qu’elle exister dans l’instant suivant, car « les instants du temps n’ont, entre eux, aucune connexion intrinsèque » (J. Walh, 1920, p. 71). Autrement dit, les moments de la durée étant indépendants les uns des autres, ils se succèdent sans jamais coexister, et je n’ai pas, en moi, le principe qui me maintient en vie. Il suffirait donc que la substance infinie cessât de vouloir nous conserver ou renouveler à chaque instant notre existence pour que nous retombions dans le néant.
Ainsi, à partir de sa théorie discontinuiste du temps ou théorie de la création continuée, Descartes en vient à rattacher, connecter la temporalité des êtres à l’éternité de la substance infinie. Il montre, par-là, la défaillance de l’ego au regard de la durée (combien de temps suis-je, moi qui suis ?) et la défaillance de tout être créé à subsister sans l’Être divin un seul moment. Il y a, ici, une articulation de l’ontique à l’ontologique au sens heideggérien. R. Lefèvre (1965, p. 52), commentant Descartes, notait que « la temporalité phénoménologique inhérente aux créatures se rencontre avec l’intemporalité ontologique inhérente à l’Être ».
On peut le dire, contre la critique heideggérienne, Descartes ne laisse nullement indéterminé le « sum » du cogito. Ce « sum » implique une liaison transcendantale, celle de l’âme humaine avec l’Être comme fondement de la substance pensante. Ainsi, Descartes n’a non seulement pas laissé complètement chômée la question de l’Être, mais il en est venu à montrer que la certitude du cogito ne le dispensait de poser la question du genre d’être de la res cogitans, plus précisément du sens d’être du « sum » comme Heidegger le lui reprochait à tort d’ailleurs. Cependant, une question demeure. Le divin est-il, dans l’entendement cartésien, un Étant suprême ? Est-ce oublier, occulter le problème de l’Être que de chercher l’origine de tous les étants dans la substance infinie que Descartes appelle Dieu ? Qu’est-ce donc que l’Être ?
Si, pour M. Heidegger, (1987, p. 88) l’Être, ce « pleinement-indéterminé, éminemment déterminé » est celui qui fonde l’étant comme monde de la représentation, des objets et des sujets, ne pourrait-on pas en dire autant concernant l’Être divin et ses créatures chez Descartes. La cause étant ce qui produit l’effet, il va sans dire que le fondement ne saurait avoir les mêmes attributs ou déterminations que ce qui dépend et diffère ontologiquement de lui. Dans ces conditions, au nom de quelle ontologie le Dieu tel que perçu par Descartes ne pourrait-il pas être saisi comme l’Être ? L’assimiler à un étant alors qu’il est cause et fondement de toutes choses, n’est-ce pas commettre un paralogisme ? Les propos confus tenus par M. Heidegger (1976, p. 131) illustrent bien ce paralogisme :
Par substance, nous ne pouvons rien entendre d’autre qu’un étant qui est tel qu’il n’a besoin d’aucun autre étant pour être (…) L’être d’une substance se caractérise par une absence de besoin (…) Tout étant qui n’est pas Dieu (ens creatum) a besoin d’être produit au sens le plus large du mot et conservé…mais nous donnons cependant le titre d’étant au créé aussi bien qu’au créateur (…) Aussi pouvons-nous avec un certain droit nommer aussi substance un étant créé. Cet étant est relatif à Dieu dont il dépend pour sa production et sa conservation.
Le fossé ontologique entre cet Être divin et ses créatures chez Descartes est là pour, sans cesse nous, rappeler l’impossibilité d’une confusion indifférenciant l’Être et l’étant. De ce fait, le caractère ontothéologique de la métaphysique traditionnelle, dénoncé par Heidegger, ne saurait suffire à court-circuiter, supprimer cette différence ontologique entre l’Être divin et ses créatures. N’est-ce pas cette même différence ontologique qui, d’ailleurs, prévaut dans le rapport entre l’Être et l’étant chez le philosophe de la forêt noire ?
Plutôt que d’approuver la dénomination heideggérienne d’Étant suprême attribuée à l’Être cartésien, on est à se demander hic et nunc s’il n’existe pas quelque chose de divin en l’Être heideggérien en tant que tel.
3. DE L’ANALOGIE ENTRE L’ÊTRE DE HEIDEGGER ET LE DIEU DE LA RÉVÉLATION : L’ONTOLOGIE FONDAMENTALE EN DIFFICULTÉ
Comme F. Alquié (1950, p. 108) pouvait l’écrire, « la métaphysique est découverte de l’Être préexistant à tout objet et qui réalise, hors de nous, notre continuité existentielle ». N’est-ce pas l’idée qui se dégage de l’ontologie fondamentale de Heidegger ?
À proprement dit, le cheminement suivi par Descartes, conduisant au surgissement de l’Être et celui suivi par Heidegger, procèdent d’une même source : celle de la finitude, voire de la temporalité du Cogito et celle du Dasein, impuissant, se tenant dans le néant. L’identification de la question du sens de l’Être en général à celle de la finitude qu’est pour lui-même le Cogito et le Dasein est fort remarquable. C’est cette réalité que W. Schulz (1978, p. 50) exprime en ces termes : « Si nous portons notre attention sur l’événement fondamental que présente la philosophie des deux penseurs, alors nous percevons une parenté intime et fondamentale. Descartes et Heidegger veulent tous deux montrer l’homme comme essence de la finitude ».
Comme Descartes, Heidegger a compris la finitude à partir de ce qui en est la mesure opposée, il a déterminé le Dasein fini par opposition à la transcendance qui ne pouvait plus être Dieu, l’étant le plus élevé. Toutefois, le rapport de l’Être au Dasein est le même que celui de la substance infinie à la substance finie Si, pour Heidegger, l’Être et Dieu ne sont pas identiques et qu’il n’y a de confusion possible entre l’un et l’autre que dans la métaphysique, par ce que Dieu y est interprété comme un étant suprême, toutefois, à y voir de plus près, l’Être heideggérien, n’en déplaise à Heidegger, recèle quelque chose de divin. De ce fait, on pourrait retourner, à Heidegger, le reproche qu’il adresse à la métaphysique traditionnelle la taxant d’ontothéologique.
En effet, dans sa tentative de dépasser la métaphysique, et d’en éclairer l’impensé, la philosophe de la forêt noire a débouché sur des énonciations qui présentent d’étroites analogies avec ce qui se trouve déposé dans la tradition judéo-chrétienne. Ce constat est celui de M. Zarader (1986, p.21) défendant l’idée selon laquelle « on peut trouver dans les textes heideggériens, des traces d’un héritage qu’il n’a pas reconnu » ou même ajoutons qu’il a dissimulé au profit de celui hellénique. Heidegger, lui-même, n’arrive pas à faire l’économie de la tradition hébraïco-biblique, voire de l’ontothéologie dans son ontologie fondamentale. Expliquons :
Descartes fut élève des Jésuites de la Flèche, et s’est résolu à se maintenir dans la religion dans laquelle il a été élevé dès sa jeunesse par la grâce de Dieu. Heidegger vient également de la tradition chrétienne, et, M. Zarader, évoquant la dette de Heidegger à l’égard de la théologie, faisait cette révélation : « [Il] reconnut que sans la provenance théologique, [il] ne serai[t] jamais arrivé sur le chemin de [sa] pensée ». (Ibid., p. 139)
Si, le philosophe de la forêt noire remet en question le plus radicalement la personnalité du Dieu chrétien, toutefois il montre de la manière la plus nette, en parlant du tournant, combien il est si proche de l’évènement fondamental de l’existence chrétienne. Le tournant, en effet, c’est le passage du néant à l’Être. C’est la forme sécularisée de la conversion chrétienne. En effet, M. Heidegger (1990, p. 449) comprend que le néant ou le rien, loin d’être « la simple négation de l’étant », est l’Être lui-même. Et c’est ce néant, comme lieu de surgissement de l’Être, qui s’adresse au Dasein à travers des dispositions affectives, l’angoisse spécialement.
À la faveur de l’angoisse, le Dasein se trouve plongé dans un état de solitude, laquelle le porte vers son acheminement, vers la région sourcière de l’Être. L’Être se dévoile dans une éclaircie, il se manifeste comme vérité dont l’étymologie grecque « alètheia » signifie avant tout dé-voilement, révélation de l’Être. Et c’est cela qui marque sa Présence, sa Transcendance et son Historicité. Mais, en même temps qu’il illumine les étants, l’Être se dérobe lui-même dans son être, il se retire, s’enfonce et demeure dans le mystère. Résumons pour dire que quelque chose qui était caché nous est donné, quelque chose qui se dissimulait se dévoile, se manifeste à nous.
À rigoureusement parler, l’Être heideggérien a quelque chose de sacré, de divin. Certes, le Dieu annoncé, chanté poétiquement à partir du « chaos sacré » de Hölderlin, – identifié à la béance primordiale d’où peut surgir toute ouverture et, par là, tout étant, – et qui intéresse uniquement la pensée, a pour trait principal, la pure présence, mais les termes utilisés par Heidegger pour décrire la révélation, l’épiphanie de l’Être, dont-il s’efforce de nous faire retrouver mémoire, sont si proches de ceux consignés dans les Écritures saintes. Par exemple, l’exclamation d’Ésaïe (45, 15, 1999) « Dieu d’Israël, toi qui sauves, tu es vraiment un Dieu caché ! » est une affirmation sur le mode de la présence propre. C’est cette présence qui décide de l’attitude de l’homme à son égard-, attitude de confiance malgré le mystère, d’attente du salut malgré le silence et la nuit, comme on le voit encore en Ésaïe: « J’attends le Seigneur. Pour l’instant, il se détourne des descendants de Jacob ». (Ibid., 8,17)
Aussi, l’importance de la parole dans la Bible ne passe pas inaperçue chez Heidegger. Dans la Genèse (1,2, 1999), il est écrit ceci : « Dieu dit alors : ” Que la lumière paraisse !” et la lumière parut ». Cette proximité entre la création de l’univers et la parole qui n’a pas statut d’instrument est également mise en évidence dans l’Évangile selon Jean (1,1-6) : « Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la Parole existait déjà ; celui qui est la Parole était avec Dieu, et était Dieu (…) Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes ». Cette dimension à la fois créatrice et éclairante de la parole, en sa pureté, on la retrouve dans l’ontologie heideggérienne.
En effet, le regard tout à fait nouveau que le philosophe de la forêt noire porte sur le langage et qui consiste en l’appréhension de l’essence du langage dans son rapport essentiel à l’Être est très proche de ce que nous apprend la Bible. En la parole, se joue l’ouverture de la présence éclaircissante de l’Être lui-même. M. Heidegger, (1986, p. 212) souligne : « C’est le mot seul qui accorde la venue en présence, c’est-à-dire l’être – en quoi quelque chose peut faire apparition comme étant ». La parole constitue la maison de l’Être, elle est bien la demeure de toute présence, elle dit, dévoile la vérité de l’Être et constitue le signe du mystère de l’homme, en tant qu’elle révèle le Dasein dans son ouvertude à cette vérité. « Dans son abri [le langage], habite l’homme ». (M. Heidegger, 1986, p. 244)
À y bien observer, le renouvellement décisif de l’interprétation heideggérienne de la question de l’Être est dû, en partie au moins, à des catégories de pensée et d’appréhension qui trouvent précisément leur origine dans l’approche biblique de Dieu : ce Dieu caché, qui se révèle dans l’histoire, qui s’abrite dans la parole, qui est à tout instant en danger d’oubli, etc. C’est dire que Heidegger se sert des traces religieuses pour penser la question héritée des Grecs. Et, c’est là tout le paradoxe qui apparaît problématique. Heidegger a toujours soutenu que la théologie, (la foi) n’avait strictement rien à faire de la philosophie, (l’être) ni avec lui, et le penseur, en retour, n’avait fondamentalement rien à dire au croyant.
Aussi, la relecture heideggérienne du concept fondamental du retrait décrédibilise l’œuvre du philosophe allemand. D’abord imputé à la pensée, aux métaphysiciens classiques, le retrait, origine essentielle et fondement de l’oubli (de l’être) fut ensuite reconnu comme procédant de l’Être même : Pour Heidegger, la pensée ne se caractérise par l’oubli que parce que l’être déploie son essence comme retrait. Dit autrement, l’acte par lequel l’être se soustrait ou se dérobe est reconnu comme constitutif de son déploiement : c’est en se retirant qu’il peut donner lieu à l’étant, en se voilant qu’il peut rendre possible tout dévoilé, et ainsi, à proprement parler, être. Comment donc expliquer un tel retournement ?
En tout état de cause, ce revirement sonne comme un aveu d’échec et met à nu les insuffisances contenus dans la philosophie de Heidegger. Comme quoi, la tâche du philosophe, qui consistait à débarrasser la métaphysique traditionnelle de ses alluvions, à la décaper de ses revêtements au nom d’une reprise de la question de l’Être, a plutôt conduit à obstruer, à déconstruire son ontologie fondamentale.
Conclusion
Que retenir au terme de notre réflexion sur la querelle suscitée par Heidegger contre Descartes et la métaphysique traditionnelle ? Il convient de signifier que celle-ci a consisté à requalifier la critique heideggérienne portée contre la métaphysique cartésienne, traditionnelle cette forme de pensée dont Heidegger prend congé, car substituant à l’Être, comme tel, un Étant divin, confondant l’Être et l’étant.
Une lecture patiente et attentionnée des œuvres de Heidegger, nous a permis de comprendre que l’invocation de l’Être divin qui, chez Heidegger, est un argument de constitution ontothéologique de la métaphysique, – laquelle constitution demeure une preuve de l’oubli de l’Être – ne saurait prospérer. D’abord, au regard de la différenciation ontologique présente chez Descartes entre l’Être et ses créatures, et qui lève toute suspicion sur la confusion de l’étantité à l’être ou encore de l’Être à l’étant ; ensuite, au regard des similitudes que l’ontologie heideggérienne partagent avec la tradition judéo-biblique, et, enfin, au regard de la nouvelle approche du retrait opérée par Heidegger au crépuscule de sa vie. Cette nouvelle approche du retrait de l’être, qui rend confuse son ontologie, pose un problème éthique : celui de la crédibilité du procès intenté par Heidegger contre la métaphysique traditionnelle, laquelle a besoin d’être solennellement réhabilitée.
Références bibliographiques
ALQUIÉ Ferdinand, 1950, La découverte métaphysique de l’Être chez Descartes, Paris, PUF, 384 p.
BEYSSADE Jean-Marie, 2001, Études sur Descartes, Histoire d’un esprit, Paris, Éditions du Seuil, 394 p.
DESCARTES René, 2000, Discours de la méthode, Introduction et dossier par Denis MOREAU, Paris, Vrin, 249 p.
DESCARTES René, 1979, Méditations Métaphysiques, Objections et réponses. Paris, Garnier-Flammarion, 574 p.
DESCARTES René, 1973, Les principes de la philosophie, Paris, Ferdinand-Alquié, 543 p.
GRIMALDI Nicolas, 1988, Six études sur la volonté et la liberté chez Descartes, Paris, Vrin, 178p.
GUENANCIA Pierre, 2000, Lire Descartes, Paris, Gallimard, 156 p.
HAAR Michel., 1990, Heidegger et l’essence de l’homme, Paris, Editions Jérôme MILLON, 257 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et conférences, trad. fr. André Préau, Paris, Gallimard, 349 p.
HEIDEGGER Martin, 1962, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. fr. Kahn, Paris, Gallimard, 320 p.
HEIDEGGER Martin, 1968, Qu’est-ce que la métaphysique ? dans Questions I et II, trad. fr. H. Corbin, Paris, Gallimard, 591 p.
HEIDEGGER Martin, 1986, Achèvement de la métaphysique et poésie, trad. Fr. Jean Beaufret, Paris, Gallimard, 187 p.
HEIDEGGER Martin, 1987, Introduction à la métaphysique, trad. Fr. W Brokmeier, Paris, Gallimard, 236 p.
HEIDEGGER Martin, 1990, Questions III et IV, trad. fr. André Préau, Jean Hervier, Roger Munier, Paris, Gallimard, 543 p.
HEIDEGGER Martin., 1976, Être et temps, trad. Fr. Francois Vezin, Paris, Gallimard, 590 p.
La Sainte BIBLE, 1999, Paris, le Cerf, 370 p.
LEFÈVRE Roger, 1965, La pensée existentielle de Descartes. Paris, Bordas, 176 p.
RODIS-LÉWIS Géneviève, 1950, L’Individualité selon Descartes, Paris, Vrin, 247 p.
RODIS-LÉWIS Géneviève, 1990, L’Anthropologie cartésienne, Paris, PUF, 297 p.
SCHULZ Walter, 1978, Le Dieu de la métaphysique moderne, Paris, CNRS, 154 p.
VAYSSE Jean-Marie, 2000, Le vocabulaire de Martin HEIDEGGER, Paris, Ellipses, 64 p.
VOHO Sahi Alphonse, 2003, DESCARTES le philosophe et le temps, Abidjan, PUCI, 123 p.
WALH Jean, 1920, Du rôle de l’idée de l’instant dans la philosophie de Descartes, Paris, Alcan, 68 p.
ZARADER Marlène, 1986, La dette impensé Heidegger et l’héritage hébraïque, Paris, Éditions du Seuil, 245 p.
DIALECTIQUE ET ONTOLOGIE : SENS ET ENJEUX DU PROCÈS HEIDEGGÉRIEN DE LA MÉTAPHYSIQUE
Abou SANGARÉ
Maître de Conférences, Université Alassane OUATTARA
Résumé : Le procès, dans le langage courant, désigne le moment où, dans une juridiction, les juges procèdent publiquement à l’instruction contradictoire d’un fait litigieux. Tout comme cette instance judiciaire, Heidegger, dans une explication ouverte avec Hegel dans Questions I et II, procède à une remise en cause de la logique dialectique, expression utilisée par Hegel pour désigner la métaphysique, ouvrant ainsi la voie à un procès de cette discipline. Les questions de fondement se décidant, selon Heidegger lui-même, cette contribution se propose d’analyser les tenants et aboutissants de ce procès, afin de comprendre pourquoi Heidegger qui fonde pourtant sa pensée sur la question de l’être, thème central de la philosophie première, s’est livré à un questionnement qui doit, selon lui, prendre ses distances vis-à-vis de la métaphysique pour aboutir à des conclusions non métaphysiques sur l’être.
Mots-clés : DIALECTIQUE, ONTOLOGIE, PROCÈS DE LA MÉTAPHYSIQUE, ÊTRE, ONTO-THÉO-LOGIE.
Abstract: The trial, in everyday language, refers to the moment when, in a court, the judges publicly proceed to the trial of a contentious matter. Like this judicial instance, Heidegger, in an open explanation with Hegel in Questions and I and II, calls into question the dialectical logic, Hegel’s expression of metaphysics, thus paving the way for a process of this discipline. The basic questions deciding, according to Heidegger himself, this contribution proposes to analyze the ins and outs of this process in order to understand why Heidegger, who nevertheless bases his thought on the question of being, the central theme of the first philosophy, has engaged in a questioning which, according to him, must distance himself from metaphysics and lead to non-metaphysical conclusions about being.
Keywords: DIALECTICS, ONTOLOGY, TRIALS OF METAPHYSICS, BEING, ONTO-THEO- LOGY.
Introduction
Jadis appelée la reine de toutes les sciences en raison de l’importance capitale de son objet, la métaphysique, pour sa prétention à étendre son champ savant au-delà des cadres spatio-temporels, a été, depuis la Critique de la raison pure, sommée de revoir ses capacités réelles de connaître. « La métaphysique, connaissance rationnelle spéculative tout à fait isolée qui s’élève entièrement au-dessus des leçons de l’expérience en ne s’appuyant que sur de simples concepts » (E. Kant, 1987, p. 40), doit, désormais, étudier l’étendue de son pouvoir de connaître, si elle veut, selon le philosophe de Königsberg, comme la physique newtonienne et la logique aristotélicienne, « emprunter la voie sûre de la science » (Ibidem). Cette soumission de la toute puissante métaphysique à des critères de scientificité l’a désanctifiée au point où mêmes les penseurs qui ont conçu les systèmes métaphysiques les plus élaborés de l’histoire de la philosophie, se sont largement gardés de présenter leur pensée sous le titre de métaphysique, lui préférant nettement d’autres appellations. C’est le cas de Heidegger qui, après avoir promu la cause de la métaphysique au 20è siècle, son projet essentiel ayant été d’investir la question de l’être, en a définitivement pris congé en faisant inscrire sa pensée sous la bannière de l’ontologie fondamentale. Mais pourquoi le philosophe de la forêt-noire, pour qui l’affaire de la philosophie, c’est la question de l’être, par ailleurs question fondamentale de la métaphysique, a-t-il préféré l’appellation “ontologie fondamentale” et non métaphysique pour qualifier sa pensée ? Si Heidegger s’est gardé de présenter sa pensée sous un tel titre, c’est certainement parce que la métaphysique, dans ses investigations, se voue à une recherche du fondement de l’étant ou à celle de l’étant le plus haut dans l’ordre des causes, laissant ainsi l’être lui-même dans l’impensé. Mais pourquoi et comment la métaphysique peut-elle dévoyer le sens de sa recherche pour ne s’occuper que de l’étant ? Cette question, interpellante de par son enjeu, demande que soit levé un coin du voile sur la cause profonde de ce dévoiement. Ainsi, on peut s’interroger : le primat que la métaphysique accorde à l’étant n’est-il pas l’œuvre de la dialectique ? Autrement dit, n’est-ce pas parce qu’elle pense sur le mode de la logique dialectique, la science de la logique de Hegel étant visée, que la métaphysique privilégie l’étant ? Ces questions, dont l’arrière-fond révèle des lacunes de la dialectique, ne constituent-elles pas, du même coup, un procès à la métaphysique ? Quels peuvent être les sens et enjeux de ce procès ? Et que peut-on espérer de la dialectique dans un tel procès ?
1. DU CONFLIT D’INTÉRÊTS ENTRE ONTOLOGIE ET MÉTAPHYSIQUE : HEGEL ET HEIDEGGER EN DÉBATS
Le projet d’un renouveau de la question de l’être ne peut parvenir à la pleine mesure de son déploiement que s’il s’accomplit dans une explication de fond avec la dialectique. Mais mettre en débat dialectique et ontologie, n’est-ce pas convoquer deux figures, celles de Hegel et Heidegger, qui en sont, dans l’histoire de la philosophie, les représentants les plus illustres ? Ainsi, se comprend pourquoi Heidegger, pour ressusciter la question de l’être, s’est livré à une explication très ardue avec Hegel au sujet de la dialectique. Cette explication, qui prend tantôt la forme d’une vénération, tantôt celle d’un procès, dénote de la complexité des rapports entre les deux penseurs. « Tantôt Hegel incarne le pire recouvrement de l’être à l’époque de la représentation, tantôt il s’élève à une grandeur inégalée et fait signe vers une véritable pensée de l’être » (S. Lindberg, 2010, p. 56). Dans ce dialogue aux contours très instables, le tome 63 de l’édition intégrale des œuvres de Heidegger, intitulé Herméneutique de la factivité, constitue une pièce maîtresse. Dans cet ouvrage, on peut lire :
La question du rapport entre dialectique et « ontologie » doit se décider au vu de l’objet de la philosophie, plus précisément au contact de cette tâche fondamentale qui vise à configurer concrètement la question sur cet objet et la façon de la trancher (M. Heidegger, 2012, p. 71).
C’est donc autour de la question de l’objet de la philosophie et du mode d’accès susceptible de le laisser apparaître que dialectique et ontologie s’affrontent. Mais si leur différend, comme le suggère ce texte, porte sur l’affaire de la pensée et le mode d’y accéder, peut-il y avoir un terrain qui puisse mieux se prêter à cet affrontement que celui de l’intuition immédiate ?
Pour les dialecticiens, l’ontologie, par la phénoménologie qui en constitue la méthode d’approche, demeure enchaînée à la donation immédiate de l’être. Elle faillit ainsi à concevoir un degré plus éminent d’immédiateté, celui de l’immédiat médiatisé. En d’autres termes, l’ontologie se satisfait d’une simple présentation, celle de l’être, alors que la dialectique seule accéderait à une véritable connaissance de celui-ci. Cette idée de la dialectique comme apothéose de la connaissance est bien perceptible chez Platon avec qui, en dehors de toute interprétation, le concept se trouve formulé et développé systématiquement pour la première fois. Dans son œuvre, la dialectique prend sens dans un double système d’opposition. Elle est d’abord la connaissance vraie par opposition à la connaissance sensible ; ensuite la connaissance anhypothétique des réels intelligibles par opposition à la connaissance hypothétique ou symbolique des mathématiques. À partir de là, la dialectique est perçue comme le vrai savoir, distinct du savoir scientifique et discursif qui procède par intermédiaire et est incapable de déterminer en lui-même ce qui le fonde. Dans le livre VII de la République, où la dialectique désigne la démarche par laquelle l’Esprit s’élève jusqu’à l’Idée du Bien, et où cette ascension est présentée sous une forme concrète et imagée avec la célèbre allégorie de la caverne, on peut lire :
Il faut assimiler le monde visible au séjour de la prison, et la lumière du feu dont elle est éclairée à l’effet du soleil ; quant à la montée dans le monde supérieur et à la contemplation de ses merveilles, vois-y la montée de l’âme dans le monde intelligible (Platon, 1966, pp. 275-276).
L’ontologie, en sa démarche phénoménologique, s’enliserait dans son point de départ et ne parviendrait jamais à s’élever à une compréhension englobante des plus hautes sphères de l’esprit. De cette façon, elle échouerait à pénétrer, de manière compréhensive, l’irrationnel, si on entend par cette expression ce qui, hors de la science rigoureuse, relève de la transcendance, de la métaphysique, mais aussi de l’art et de la religion. À cet égard, la dialectique serait plus apte à penser l’infinie richesse de la vie que ne le serait l’ontologie dont l’ambition se trouverait constamment entravée par un excédent de scrupules méthodologiques. Pour Hegel dont la philosophie est, de part en part, nourrie par ce mouvement, l’immédiateté intuitive, parce qu’elle est, dans son expression, cette immédiateté pure qui ne peut rien présupposer, se distingue par sa pauvreté, sa subordination et sa finitude, et ne peut se qualifier qu’en tant que résultat de la médiation totale. « Elle se révèle expressément comme la plus abstraite et la plus pauvre vérité. De ce qu’elle sait, elle exprime seulement ceci : il est ; et sa vérité contient seulement l’être de la chose » (F. Hegel, 1941, p. 81). Cela signifie qu’elle n’est appelée à révéler sa véritable valeur qu’en s’inscrivant dans un ensemble complexe de relations susceptibles de pallier son incomplétude. La stricte immédiateté a sa vérité au-delà d’elle-même, de sorte que bien loin de pouvoir fonder la science, elle ne reçoit plutôt de sens qu’à la lumière du tout vivant que constitue déjà cette dernière.
La vraie figure dans laquelle la vérité existe ne peut être que le système scientifique de cette vérité. Collaborer à cette tâche, rapprocher la philosophie de la forme de la science, ce qui revient à dire que c’est dans le concept seul que la vérité trouve l’élément de son existence, c’est là ce que je me suis proposé (Idem p. 8).
Suivons maintenant les réponses que Heidegger va formuler pour réagir à ce réquisitoire dressé contre l’intuition, terrain de prédilection de la phénoménologie, méthode d’approche de l’ontologie. Pour commencer, il définit formellement la tâche traditionnelle de la philosophie comme détermination ou classification thématique de l’étant, envisagé sous l’angle de sa totalité. Et la dialectique, dont l’affaire est celle d’une unification constamment sursumante, ne saurait se soustraire à cette exigence initiale. La vocation que la métaphysique se donne, en cherchant à ordonner les unes aux autres les catégories avec lesquelles elle compose, l’oppose nécessairement à d’autres modes de classification dont la tendance consiste plutôt à juxtaposer de manière statique ces mêmes catégories, tendance à laquelle l’ontologie appartient. Heidegger, dans un bref chapitre du cours sur l’herméneutique de la factivité (2012, p. 65), met en scène, sur un ton singulièrement sévère, et extraordinairement radical, les enjeux du débat qui oppose dialectique et phénoménologie. « Chercher, comme on le fait aujourd’hui, à mettre en relation la tendance fondamentale véritable de la phénoménologie avec la dialectique, c’est comme vouloir marier le feu et l’eau ». Et, comme pour ajouter de l’huile sur ce feu, il déclare la dialectique fondamentalement non philosophique, ajoutant, au passage, que « si la mode hégélianisante aujourd’hui naissante réussit à s’imposer, elle finira par saper la possibilité d’avoir la moindre entente de la philosophie » (Op. cit., p. 70).
Si Heidegger se sent justifié de déclarer ainsi la dialectique non philosophique, c’est qu’il est d’avis qu’un regard radical et originaire porté sur l’objet de la philosophie lui fait défaut. Pour lui, la dialectique, en tant que résorption du négatif au profit du positif, par l’entremise de la sursomption, ne saurait caractériser le mouvement qui anime la pensée de l’être, car l’accès à la chose même s’opère par une intuition originaire. Comment peut-on, à ce niveau, occulter la dette que Heidegger n’a cessé de reconnaître à Husserl pour la découverte d’une présence intuitive de catégorie de l’être à même l’expérience concrète, et source de toute légitimation possible ? C’est dire que la stabilité de tout ensemble de connaissances complexes tient au fait qu’il puisse être assuré, en son fondement, par une donation immédiate et évidente ; donation dont la philosophie, dès lors qu’elle entend assumer son rôle de science première, doit décrire les structures antéprédicatives. Fort de cette conviction, Heidegger s’inscrit dans la perspective d’une critique réaliste, d’inspiration aristotélicienne, de la philosophie spéculative, qu’il est possible de faire remonter jusqu’à Trendelenburg[1]. Ce dernier, au nom d’une relecture d’Aristote, reprochait à Hegel de n’avoir pas reconnu, au sein de ses considérations sur la genèse du concept, la dette que celui-ci contracte nécessairement à l’égard d’une intuition présupposée première et au contenu indépendant. « Hegel hypostasie le mouvement de réflexion et fait comme si la succession des figures de pensée pouvait se passer de l’intuition ».
En se privant ainsi d’une véritable matière à travailler, la dialectique produirait un discours qui tournerait en quelque sorte à vide. Ainsi, elle apparaît comme une connaissance sans contenu, puisque les idées sur lesquelles elle se fonde sont purement des concepts auxquels ne correspond aucun objet. Elle désigne l’illusion de la raison à connaître par elle-même et sans recours à l’expérience. En ce sens, elle est un usage erroné de la raison qui ne peut effectivement connaître que lorsqu’elle est appliquée aux données sensibles desquelles elle tire son contenu. Écoutons, à ce propos, Kant dont les arguments semblent ici servir la cause de l’ontologie heideggérienne :
Sans la sensibilité, nul objet ne nous serait donné ; sans l’entendement, nul serait pensé. Des pensées sans matière sont vides ; des intuitions sans concepts sont aveugles. Aussi est-il tout aussi nécessaire de rendre sensibles les concepts (…), que de rendre intelligibles les intuitions (E. Kant, 1987, p. 110).
Ainsi, il est affirmé de la métaphysique qu’elle doit vivre en n’ayant rien à mettre sous la dent. C’est qu’en acquérant un ensemble de concepts prédéfinis, le dialecticien, comme un sophiste, parviendrait à discourir indistinctement à propos de toute chose. S’il est vrai que la dialectique excelle à une telle loquacité, il faut bien qu’elle puise les concepts, avec lesquels elle jongle, quelque part.
En outre, au dialecticien qui reprocherait à l’ontologie son manque de portée métaphysique, le chantre de l’ontologie pourrait répondre que cette tendance que présente l’ontologie à séjourner, avec prudence et patience, auprès de son objet, loin d’être un défaut, relève plutôt d’une retenue salutaire. Par ces vertus, elle arrive à saisir l’essentiel que la précipitation excessive de la dialectique, à vouloir exprimer le tout de la vie au sein d’un système achevé, laisse dans l’oubli. En faisant écran à la question de l’être, la cause de la pensée, la métaphysique ne s’expose-t-elle pas à un procès légitime ?
2. L’AFFAIRE DU PROCÈS DE LA MÉTAPHYSIQUE : L’OUBLI DE L’ÊTRE ET LA CONSTITUTION ONTO-THÉO-LOGIQUE
Dans Questions I, précisément dans les articles intitulés « Qu’est-ce que la métaphysique ? » où la métaphysique est interrogée en son essence, et « Identité et différence » où un dialogue est ouvert avec Hegel sur la cause de la pensée, Heidegger s’emploie, non pas à une remise en cause radicale de la métaphysique, puisqu’il en reconnaît lui-même la valeur fondatrice, mais à la déchoir du piédestal sur lequel elle se trouvait depuis sa naissance.
Une pensée qui pense la vérité de l’Être, dit-il, ne se contente plus de la métaphysique ; mais elle ne pense pas pour autant contre la métaphysique. Pour parler en image, elle n’arrache pas la racine de la philosophie (…). La métaphysique demeure l’élément premier de la pensée (M. Heidegger, 1968, p. 20).
Mais, s’interroger sur l’essence de la métaphysique, n’est-ce pas déjà se y consent lorsqu’il écrit : « La question « Qu’est-ce que la métaphysique ? » questionne par-delà la métaphysique. Elle surgit d’une pensée qui est déjà entrée dans le dépassement de la métaphysique ».
Passer de la métaphysique à la pensée qui pense la vérité de l’Être, tel est le projet que Heidegger assigne à Sein und Zeit. Dépasser la métaphysique pour une autre forme de pensée, n’est-ce pas, d’une certaine manière, montrer qu’elle n’a pas pu ou su se rendre digne de soi dans la saisie de la cause de la pensée ? Cette question, dont la réponse doit cristalliser les attentions dans l’accomplissement de ce projet, ne peut qu’ouvrir la voie d’un procès de la métaphysique, puisque pour que sa cause soit entendue, elle doit mettre en avant ce qu’elle considère être les plus grosses tares ou lacunes de cette discipline. Les questions de mise en lumière devant se décider, il convient de saisir le fond de ce procès pour en savoir la cause qui en est aussi, selon un texte du philosophe de la forêt-noire, l’affaire. « La cause ou l’affaire de la pensée est un différend dans ce qu’il a de litigieux » (Idem, p. 277).
Mais, y a-t-il, en régime heideggérien, meilleure question interrogeant en direction du fondement, que la question pourquoi ? La question « pourquoi y a-t-il l’étant et non pas plutôt rien ? » (M. Heidegger, 1967, p. 13), par laquelle il ouvre l’Introduction à la métaphysique, n’est-elle pas, selon ses propres termes, la question la plus originaire ? Ainsi, quiconque veut approfondir une question doit faire l’épreuve de la question “pourquoi”. Nous sommes donc, dans cette partie, en dette de cette question. C’est pourquoi nous nous interrogeons ainsi qu’il suit : Pour-quoi le projet heideggérien d’un dépassement de la métaphysique se mue-t-il en procès ? Cette question, en prenant en compte le trait d’union de l’adverbe interrogatif pourquoi, qui ramasse deux questions en une, questionne en direction du sens que peut revêtir ce projet-procès.
La question que nous voulons résoudre, en utilisant ce mot à géométrie variable qu’est le mot sens, est la suivante : pour quelles raisons Heidegger entend-il opérer un dépassement de la métaphysique ? Ici, le mot “raison”, qui doit restituer au mot sens son lieu propre, questionne aussi en direction du mot “fin” qui, dans sa double acception allemande de Zweck (but) et de Ziel (destination), renvoie au fondement. Ainsi, sens et fondement se trouvent liés, et cela, parce que le sens lui-même n’est saisi pour ce qu’il est qu’en vue d’un fondement. Relançons alors la question du fondement de cette entreprise par cette autre question : que reproche Heidegger à la métaphysique qui, pourtant, est définie comme la science de l’être en tant qu’être et que lui-même reconnait comme « l’édifice doctrinal de la philosophie » (M. Heidegger, 1968, p. 27), pour qu’il lui soit venu l’idée de la dépasser ?
La métaphysique est, en effet, restée, selon lui, un mode de pensée confiné dans l’explication de l’étant, sans aucun égard à l’être. Elle substitue à la question ontologique une double question ontique, laissant l’être lui-même non questionné. Elle s’interroge, en tant que science du fondement, sur le fond ultime en lequel s’enracine tout étant ; et comme recherche des causes ou des principes premiers, elle questionne sur l’étant suprême, fondement de la totalité de l’étant.
La métaphysique pense l’étant comme tel, c’est-à-dire dans sa généralité. La métaphysique pense l’étant comme tel, c’est-à-dire dans sa totalité. La métaphysique pense l’être de l’étant, aussi bien dans l’unité approfondissante de ce qu’il y a de plus universel, c’est-à-dire de ce qui est également valable partout, que dans l’unité, fondatrice en raison, de la totalité, c’est-à-dire de ce qu’il y a de plus haut et qui domine tout. Ainsi d’avance l’être de l’étant est pensé comme le fond qui fonde (M. Heidegger, 1968, p. 292).
De cette manière, la métaphysique ne peut être appréhendée autrement que comme fondation qui rend à la fois compte et raison du fond auquel elle demande constamment raison. Dans cette double substitution, l’être lui-même reste impensé, puisque l’étant, même pensé dans son être, demeure toujours un étant. Cette subreptice substitution qui, depuis Aristote, fait écran à la « question de l’être » en le confondant soit au fondement d’un étant, soit à l’étant le plus haut dans l’ordre des causes, c’est-à-dire Dieu, fait se renverser la métaphysique en une « onto-théo-logique ». « La métaphysique, pensée d’une façon plus vraie et plus claire, est une onto-théo-logique » (Op. cit., p. 293). Et c’est cette constitution onto-théo-logique qui est au fondement du projet-procès heideggérien d’un dépassement de la métaphysique.
Mais que suggère cette thèse éponyme d’une constitution onto-théo-logique de la métaphysique ? Ce qualificatif ne peut se comprendre, pour ce qu’il est dans l’économie de la pensée heideggérienne, sans un recours à Kant qui s’avère être le premier à en user. L’auteur de la Critique de la raison pure écrit dans la septième section du chapitre III de la Dialectique transcendantale, intitulé « Critique de toute théologie issue de principes spéculatifs de la raison » :
La théologie transcendantale, ou bien pense dériver l’existence d’un être premier d’une expérience en général sans rien déterminer de plus sur le monde auquel elle appartient, et elle s’appelle cosmothéologie ; ou bien elle croit pouvoir connaître son existence sans le moindre concours de l’expérience, et elle se nomme alors ontothéologie (E. Kant, 1987, p. 497).
Pour le philosophe de Königsberg, l’ontothéologie désigne cette branche de la théologie qui prétend conclure à l’existence de Dieu a priori. Le même terme, sous la plume de Heidegger, consiste, essentiellement, en l’articulation de deux moments : le moment où l’on pense l’étant en le réduisant au seul fait qu’il est, et le moment où l’on le pense sous la figure de l’étant le plus parfait, le tout aboutissant à un discours qui porte sur tous les étants à partir et en vue de l’étant premier et nécessaire qui est l’étant divin. Comment Heidegger pouvait-il s’empêcher d’utiliser un tel terme qui renvoie, de par sa constitution, à la fois à l’étant – onto -, au divin – théo -et à la logique, pour qualifier le type de discours que véhicule la métaphysique, un discours qui met au premier plan l’étant suprême ? Mais la métaphysique ne pouvait-elle pas fonctionner autrement que sous cette forme ?
Apparemment non ! Parce qu’elle pense sur le mode de la logique dialectique qui, elle-même, est, par définition, une pensée par prédication ou par représentation. « La logique est la représentation de Dieu tel qu’il est dans son essence éternelle, avant la création de la nature et d’un esprit fini » (F. Hegel, 1972, p. 19). La logique, justement parce qu’elle est un mode de pensée par représentation, ne peut garder sa validité que, s’il y a un étant, un étant suprême qui subsiste, identique à lui-même, dans la présence. Voilà comment Dieu entre en philosophie. Dieu entre en philosophie, en métaphysique, non pas parce qu’il l’aurait décidé ou parce que la pensée chrétienne l’aurait imposé à la métaphysique, mais parce que la métaphysique a besoin de Lui. Dans « La constitution onto-théo-logique de la métaphysique », thème qui vient clore un ensemble de travaux consacrés à la Science de la logique de Hegel, et qui constituera, par ailleurs, la deuxième partie de son œuvre intitulée Identité et différence, M. Heidegger (1968, p. 290) fait remarquer : « Dieu ne peut […] entrer dans la philosophie que dans la mesure où celle-ci, d’elle-même et conformément à son essence exige que Dieu entre en elle et précise comment il le fera ». Mais, en quel sens peut-on dire que la métaphysique a besoin que Dieu soit et y soit ?
La réponse vient, selon Heidegger, du fait que la métaphysique, et c’est là ce que montre Hegel, pense l’être comme fondement. La métaphysique est onto-théo-logique, et cela, essentiellement, parce que l’être de l’étant se dévoile comme le fondement qui détermine le fond ultime des choses. Ainsi, « toute métaphysique apparaît, dans son fond et à partir de son fond, comme la fondation qui rend compte du fond, qui lui rend raison et qui, finalement, lui demande raison » (M. Heidegger, 1968, p. 292-293). Si l’être est toujours abordé, par la métaphysique, comme fondement de l’étant, on ne s’étonnera pas de l’irruption de Dieu comme causa sui, c’est-à-dire comme cause déployant la causalité efficiente sans aucune exception, en étant à la fois cause des autres étants et cause de lui-même. Dans ce registre où l’être est cause première, son identité conceptuelle au néant est établie, puisqu’en tant que substantif, il ne renvoie à rien de déterminé, selon la métaphysique hégélienne. « L’être, l’immédiat indéterminé, est en fait néant, et ni plus ni moins que néant » (F. Hegel, 1972, p. 58). Dans cette évocation, il faut, selon Heidegger, par “être”, entendre “étant”.
La métaphysique, dit-il, vise l’étant dans sa totalité et parle de l’Être. Elle nomme l’Être, et vise l’étant en tant qu’étant. L’énoncé de la métaphysique, de son commencement à sa consommation, se meut d’étrange façon dans une confusion permanente d’étant et d’Être (Heidegger, 1968, p. 29).
C’est un fait que pour Hegel, l’affaire de la pensée, c’est la pensée de l’étant absolu qui ne peut être atteint que dans un mouvement dialectique qui consiste à relever le niveau de la représentation par le niveau du concept. C’est pourquoi, à la question : par quoi la Science devrait-elle commencer ? Hegel répondait :
Dans la mesure où l’on réfléchit sur le fait qu’à partir du premier vrai doit être déduit tout ce qui suit, sur le fait que le premier vrai doit être le fondement du tout, alors il semble nécessaire d’exiger que l’on commence par Dieu, par l’absolu, et que l’on comprenne tout à partir de lui (Hegel, 1972, p. 48).
Pareille confusion ne permet pas d’établir la différence ontologique. De tout cela, Heidegger conclut que la métaphysique, pensée d’une façon plus vraie et plus claire, est une onto-théologie, c’est-à-dire une logique qui confond être et étant (au sens de l’étant suprême), donc une pensée qu’il faut dépasser au profit d’une autre qui, elle, peut saisir la vérité de l’être.
3. DIFFÉRENCE ONTOLOGIQUE ET VERITÉ DE L’ÊTRE : LES ENJEUX DU PROCÈS DE LA MÉTAPHYSIQUE
Le mode de pensée de la métaphysique est, nous l’avons dit, la re-présentation. En tant que telle, elle ne peut penser sans présenter, sans placer devant elle ce à quoi elle pense. De cette manière, elle ne peut penser que des étants, même si elle en élève un au rang d’étant parfait comme fondement des autres. Mais, en prenant l’étant parfait comme l’être ou le fondement des autres étants, la métaphysique tombe dans une certaine impasse. Elle pense la différence ontologique en la laissant impensée. Ce n’est pas en élevant un étant à un principe qui porte le nom de substance, de sujet, de concept ou de volonté de puissance qu’on pourra accéder à l’être. Il est impossible, avec un étant, de faire un pas en direction de l’être. Heidegger, après s’être interrogé plusieurs fois si son « chemin » de pensée était le bon, entérine définitivement, dans « La constitution onto-théo-logique de la métaphysique », que l’étude de l’étant, même celle d’un étant insigne, n’est jamais un « modèle » pour la question de l’être. Seul semble propice à approcher ce dernier le fait d’insister sur sa séparation d’avec l’étant. « Nous ne pensons l’être tel qu’il est que si nous le pensons dans la différence qui le distingue de l’étant » (M. Heidegger, 1968, p. 296).
En vérité, la métaphysique établit bien une différence : différence entre l’ontologie, qui considère tous les étants égaux en tant qu’ils sont, et la théologie, qui envisage l’étant suprême en tant qu’il permet à tous les autres étants d’être. Cette différence est, certes capitale, puisqu’elle rejoint celle de la possibilité et de l’effectivité, du conditionné et de l’inconditionné, mais pas encore radicale, car malgré sa propension à se faire passer pour une différence entre les étants et l’être, elle demeure une différence entre les étants et cet autre étant qui les fonde, et non entre les étants et l’être véritable. Si nous représentons cette différence que la métaphysique établit entre les étants qu’elle hiérarchise, nous sommes tentés de la concevoir comme une relation que notre représentation produit entre l’être et l’étant. La différence ontologique se trouve, par-là, rabaissée à n’être plus qu’une simple distinction, une fabrication de notre entendement. Il convient donc, selon Heidegger, de sortir de cette habitude de pensée métaphysique qui ne peut rien produire d’autre qu’une pensée de l’étant, et d’en adopter une qui, elle, peut lever sur l’être l’oubli que la métaphysique fait peser sur lui.
La métaphysique a oublié, non par faute d’attention ni par manque de mémoire, de poser la question de l’être. Cet oubli dû à sa confusion avec l’étant, « il faut assurément le penser comme évènement et non comme faute » (M. Heidegger, Op. cit., p. 29). Au fond, si elle l’a oublié, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas pu le voir, mais c’est parce que l’être lui-même ne se déploie dans la phénoménalité que sur un mode où il se donne d’abord comme caché. Comment comprendre cela ? Pour parler de la présence d’une chose, ne disons-nous pas, la plupart du temps, que cette chose est là ? Cette expression, bien intuitionnée, révèle qu’en elle, “est” n’est pas simplement une copule, au sens d’un verbe d’état dont la tâche est simplement de qualifier la réalité à laquelle il est attaché. Le mot prend le sens fort d’être dans la position d’existence ou de subsistance, selon le mode d’être de l’étant dont il est question. Pourtant ce “est” lui-même est complètement caché par la chose dont nous disons qu’elle est. Imaginons ce qui suit : au moment où je me rends au bureau de mon Directeur de Thèse pour faire signer mon dossier de bourse, je ne l’y trouve pas, parce qu’il est envahi, dans le bureau contigu au sien, alloué au Département pour la gestion des examens, par un groupe d’étudiants venus faire des réclamations de notes. Je demande ainsi, d’une voix grave, à mes camarades étudiants en Thèse que je trouve sur place, venus, eux aussi, pour la même raison : où est le Professeur ? Qu’un étudiant venu pour les réclamations de notes réponde : “Il est là, le Professeur !” Assurément, au moment même où j’entends une telle phrase, je ne considère pas le fait que le Professeur est, mais le fait qu’il s’agit bien de celui dont j’ai besoin. Ce n’est pas le “est” qui m’intéresse quand je réussis à voir le Professeur après plusieurs heures d’attente. Pourtant, c’est ce “est” qui me permet de le recouvrer, puisque si le “est” n’était pas, le Professeur ne serait tout simplement pas là où je l’ai trouvé. A-t-on besoin de grande instruction pour comprendre comment l’être, dans ce cas, est aussitôt oublié. Et c’est là l’une de ses caractéristiques essentielles à savoir que nul n’y prête attention, chacun ne se préoccupant, dans ce qui est, que de ce qui est, à savoir l’étant. Tentons, avec notre exemple, d’en dire davantage sur lui en le considérant, ainsi que le suggère Heidegger, comme un verbe transitif. Le professeur est là. Ce qui est, c’est le Professeur. Le “est” produit le Professeur, le dévoile. Ainsi, le Professeur n’est là que lorsque l’être se déploie. Mieux, c’est l’être qui rend le Professeur présent et visible. L’être, en effet, fait bien événement, puisqu’il fait que le Professeur est. Dès lors, si l’être survient, c’est le Professeur qui advient. En un mot, c’est l’être qui fait être l’étant. Être, en ce sens, n’est pas ce verbe d’état que l’on croit, mais un verbe d’action et, plus précisément, un verbe transitif, puisqu’il implique un passage, celui du néant de l’étant à l’étant qui est. Quand l’être survient, c’est l’étant qui advient. Mais comment se fait exactement ce passage ? Heidegger (Idem, p. 298-299) le précise en ces termes : « L’être passe au-delà et au-dessus de ce qu’il découvre, il survient à ce qu’il découvre et qui, par cette Sur-venue seulement, arrive comme ce qui de soi se dévoile ».
Rapportons cette description phénoménologique à notre exemple. Quand on me dit : “Il est là le Professeur”, le “est”, en arrivant, pour ainsi dire, dévoile le Professeur. Quand le “est” se produit, c’est le Professeur que je vois. L’être fait ainsi surgir l’étant tout en se mettant lui-même en retrait. Ainsi, tant que l’on ne peut employer le verbe être au présent, l’étant n’est pas là, mais sitôt qu’on le peut, l’étant est découvert, mieux, il est à découvert ; il apparaît. À strictement parler, l’être survient de on ne sait où et, survenant, fait découvrir l’étant qui, découvert, arrive lui-même comme pour la première fois. Par conséquent, il y a entre l’être et l’étant un jeu qui est celui d’une venue qui vient dévoiler ce qui, sans cela, ne serait pas. Cette venue, c’est l’être. L’être se manifeste alors « comme la survenue qui découvre » (M. Heidegger, Op. cit., p. 299). L’étant, lui, apparaît comme tel « dans le mode de cette arrivée qui s’abrite dans la non-occultation » (Ibidem). Cela veut dire que quand l’être est survenu, il a révélé l’étant, tant et si bien que l’étant, une fois arrivé ou pleinement dévoilé, est la seule réalité qu’on voit. On ne voit plus que lui, tant son dévoilement ou sa présence occulte le fait qu’il lui a fallu arriver. Et comme tout “arriviste”, l’étant qui est arrivé, pour ainsi dire, par l’être, fait croire qu’il est arrivé tout seul ou, ce qui revient au même, qu’il est le seul à être.
Voilà comment l’étant dissimule, dans l’évidence de sa présence, le fait que celle-ci provient d’une advenue qui est due à la survenue de l’être. Et c’est là qu’il faut voir le lieu où l’être disparaît. L’étant n’est rien sans l’être, mais il n’en montre rien, du moins, il ne peut rien en montrer, puisque l’être a cette particularité que, du point de vue des étants, il n’est pas. On pourrait dire, pour utiliser une expression de Hegel dans la Phénoménologie de l’esprit, (1941, p. 6), qu’être et étant « sont mutuellement incompatibles ». Cette mutuelle incompatibilité fait penser aussi à ce texte d’Épicure qui disait, parlant du rapport entre l’homme et la mort, que l’homme ne doit nullement avoir peur de la mort parce que les deux ne peuvent jamais cohabiter.
Familiarise-toi, dit Épicure, avec l’idée que la mort n’est rien pour nous, car tout bien et tout mal résident dans la sensation : or la mort est la privation complète de cette dernière. Si une chose ne nous cause aucun trouble par sa présence, l’inquiétude liée à son attente est sans fondement puisque quand nous existons, la mort n’est pas, et que quand la mort est là, nous ne sommes plus (Épicure, dans J. Brun, 1964, p. 126).
Comme le Dasein (mien) et la mort qui ne subsistent guère au même moment, l’être et l’étant ne peuvent surgir conjointement. C’est pourquoi, lorsque l’étant occupe la scène, l’être, le metteur en scène, lui, se dissimule. Ainsi, ils ne peuvent être pensés que sous le rapport d’une différence ontologique entendue comme la différence nécessaire à opérer entre eux, même si l’être est toujours l’être d’un étant.
Conclusion
Rien ne saurait dispenser de soumettre les thèses heideggériennes à l’épreuve d’un examen attentif des textes hégéliens, entreprise qui va peut-être prendre la forme d’une tentative de sauver Hegel de Heidegger. Mais puisqu’il est question, dans ce texte, de montrer les sens et enjeux du projet heideggérien d’un dépassement de la métaphysique, peut-être conviendrait-il simplement de conclure en formulant juste quelques interrogations. La relève de la question de l’être, tombée dans l’oubli sous les auspices de la logique dialectique, enjeu fondamental du procès heideggérien de la métaphysique, a-t-elle pu véritablement s’opérer en faisant fi de la dialectique ? Le mode d’expression qui qualifie la pensée heideggérienne, bien qu’il ne soit en rien celui d’une dialectique exacerbée, ne demeure-t-il pas néanmoins celui d’un dé-couvrement sur le mode de la traversée discursive, animé par la force productrice de la négation critique ? Procédant par dénonciation critique, critique qui est l’œuvre de la dialectique, Heidegger n’a-t-il pas, malgré lui, réhabilité ce contre quoi il voulait construire son édifice ontologique : la métaphysique ? Cette réhabilitation involontaire de la dialectique, fille de la métaphysique, confirme la difficulté qu’il y a, pour une philosophie quelconque, à sortir de la dialectique, poumon de la philosophie de Hegel. Comme Hegel qui, dans une déclaration touchant le temps présent, disait qu’« il est aussi fou de s’imaginer qu’une philosophie quelconque dépassera le monde contemporain que de croire qu’un individu sautera au-dessus de son temps » (F. Hegel, 1940, p. 43), ne pouvons-nous pas dire que toute tentative de se défaire du langage de la dialectique demeure une véritable gageure ? Cette difficulté à dépasser Hegel et la dialectique, c’est Michel Foucault qui en a véritablement pris la mesure à travers ce texte :
Échapper réellement à Hegel suppose d’apprécier exactement ce qu’il en coûte de se détacher de lui ; cela suppose de savoir jusqu’où Hegel, insidieusement peut-être, s’est approché de nous ; cela suppose de savoir, dans ce qui nous permet de penser contre Hegel, ce qui est encore hégélien ; de mesurer en quoi notre recours contre lui est encore peut-être une ruse qu’il nous oppose et au terme de laquelle il nous attend, immobile et ailleurs (M. Foucault, 1971, p. 74-75).
Références bibliographiques
BRUN Jean, 1964, Épicure et les épicuriens, Paris, P.U.F., 176 p.
FOUCAULT Michel, 1971, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 82 p.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1940, Principes de la philosophie du droit, trad. André Kaan, Paris, Gallimard, 380 p.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1941, Phénoménologie de l’esprit, T1, trad. Jean Hyppolite, Paris, Montaigne, 540 p.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1941, Phénoménologie de l’esprit, T1, trad. Jean Hyppolite, Paris, Montaigne, 540 p.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1972, Science de la logique, T1, trad. Jean Hyppolite, P. J. Labarrière et G. Jarczyk, Paris, Aubier-Montaigne, 414 p.
HEIDEGGER Martin, 1967, Introduction à la métaphysique, trad. Gilbert Kahn, Paris, Gallimard, 237 p.
HEIDEGGER Martin, 1968, Questions I et II, trad. Kostas Axelos et Jean Beaufret, Paris, Gallimard, 582 p.
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et temps, trad. Emmanuel Martineau, Paris, Gallimard, 594 p.
HEIDEGGER Martin, 2012, Herméneutique de la factivité, trad. Alain Boutot, Paris, Gallimard, 166 p.
KANT Emmanuel, 1987, Critique de la raison pure, trad. Jules Barni, Paris, Flammarion, 725 p.
LINDBERG Suzanna, 2010, Entre Heidegger et Hegel. Eclosion de l’être, Paris, L’Harmattan, 194 p.
PLATON, 1966, République, Paris G F, Trad. Robert Baccou, 672 p.
MÉTAPHYSIQUE ET SENS
L’HOMO MENSURA DE PROTAGORAS : UNE PROPOSITION MÉTAPHYSIQUE FONDAMENTALE
Kolotioloma Nicolas YÉO
Maître-Assistant, Université Alassane OUATTARA
nicolasyeo@yahoo.fr
Résumé : L’idée générale qui ressort des interprétations classiques de la théorie protagoréenne de l’homo mensura (homme-mesure) est que celle-ci est l’expression d’un relativisme. Pourtant, à bien la méditer, la théorie de l’homo mensura de Protagoras se révèle être une proposition métaphysique fondamentale. Elle suppose que l’être a un caractère ambivalent et que la vérité est dévoilement, d’une part, et, d’autre part, elle met en exergue l’être-soi de l’homme ainsi que la modération dont celui-ci doit faire preuve dans son approche des étants et de l’être.
Mots-clés : ÊTRE-SOI, MÉTAPHYSIQUE, MODÉRATION, RELATIVISME, VÉRITÉ.
Abstract : According to the classical interpretations of Protagorean theory of homo mensura (man-measure), the main idea is that this one is a relativism expression. Therefore, through its good meditation, Protagoras’s homo mensura theory proves to be a “fundamental metaphysical proposition”. It supposes, on the one hand, that being has an ambivalent character and that the truth mean revealing ; on the other hand, it respectively shows the human’s own-being and the moderation that he has to give the proof as far as his conception of beings and being is concerned.
Keywords: OWN-BEING, METAPHYSICS, MODERATION, RELATIVISM, TRUTH.
Introduction
Sur la base de la philosophie de Platon et de son disciple Aristote, l’on conçoit généralement la théorie de l’homo mensura (homme-mesure) de Protagoras comme l’expression d’un relativisme. D’après ces philosophes, Protagoras, en énonçant sa maxime de l’homme-mesure, a voulu signifier que la connaissance varie en fonction du sujet-connaissant. Dans le Théétète, précisément, Platon (2011, 152a) mentionne que la maxime de Protagoras signifie que « telles chacun sent les choses, telles, pour chacun, elles ont chances aussi d’être ». Abondant dans le même sens, Aristote (2009, 1062 b) écrit que la théorie de l’homo mensura de Protagoras ne traduit « rien d’autre que : ce que chacun croit est aussi fermement établi ». Ces différents propos renvoient incontestablement à l’idée que le penser protagoréen aboutit à la thèse selon laquelle la connaissance est relative à chaque individu.
Mais, cette approche aristotélo-platonicienne, en tant qu’elle considère la théorie de l’homme-mesure de Protagoras comme l’expression d’un relativisme, rend-elle compte, de manière adéquate, de la pensée de Protagoras ? Précisément, quel est le véritable sens de cette pensée de Protagoras : exprime-t-elle un relativisme ou une vérité métaphysique fondamentale ? Tel est le problème central de la présente contribution.
L’intention fondatrice est de montrer que, contrairement aux thèses de Platon et d’Aristote, la théorie de l’homme-mesure de Protagoras nous plonge au cœur de la métaphysique. Elle rend manifeste les idées que l’être a le double caractère de la présence et de l’absence, et que la vérité est dévoilement. Qui plus est, elle donne à comprendre que les termes « homme » et « mesure » signifient respectivement l’être-soi de l’homme et la modération de celui-ci dans ses prétentions à cerner les étants et l’être.
L’approche argumentative adoptée, en tant qu’elle analyse les conceptions de Platon et d’Aristote de l’homo mensura en vue de les dépasser, se veut critique. Elle s’organise autour de trois points. Le premier montre que, par-delà les divergences de points de vue entre Platon et son disciple Aristote, leurs pensées gravitent autour de l’idée que de l’homo mensura est l’expression d’un relativisme. Le deuxième montre que la théorie de l’homme-mesure est l’expression de l’ambivalence de l’être et de la vérité comme dévoilement. Le troisième soutient que les termes « homme » et « mesure » de l’homo mensura renvoient respectivement à l’être-soi de l’homme et à la modération de celui-ci dans son rapport aux choses.
1. L’HOMO MENSURA : UNE EXPRESSION DU RELATIVISME CHEZ PLATON ET ARISTOTE
Aristote est souvent considéré, non sans raison, comme « le meilleur ennemi de son maître » (C. Godin, 2008, p. 95) Platon, tant il s’oppose farouchement à l’essentiel de ses idées. Mais, si ce rapport d’antagonisme entre le disciple et le maître est incontestable pour des idées telles que la distinction radicale entre le monde sensible et le monde intelligible, la place du mythe dans le penser philosophique, ou encore la critique de la sophistique, il ne l’est pas pour la question spécifique de l’interprétation de l’homo mensura de Protagoras. Platon et Aristote, loin de s’opposer, pensent plutôt, dans un rapport d’analogie, que l’homo mensura de Protagoras est l’expression d’un relativisme.
Rappelons la maxime de l’homo mensura de Protagoras. Elle est formulée comme suit : « L’homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont en tant qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas » (J.-F. Pradeau, 2009, p. 69). Cette maxime apparaît, dans l’économie générale des pensées de Platon et d’Aristote, comme l’expression d’un relativisme. En fait, d’après ces deux philosophes, l’idée que véhicule l’homo mensura est que toute connaissance est relative à l’homme, en tant que subjectivité autonome. Cette conception a fait autorité au point que H. Moysan-Lapointe (2010, p. 533) a fini par conclure que l’on n’admet plus communément qu’une interprétation individualiste de la doctrine, où l’homme mesure est individuel et particulier.
Pour se faire une idée de cette interprétation individualiste de l’homo mensura de Protagoras que développent Platon et Aristote, il convient de prêter attention à leurs propos suivants : « Voici, [écrit Platon (2011, 152a)], à peu près ce que Protagoras dit : telle m’apparaît chaque chose, telle elle est pour moi, et telle elle t’apparaît à toi, telle à nouveau elle est pour toi ; or tu es homme et moi aussi ». Quant à Aristote (2009, 1062 b), il note :
Protagoras […] disait que l’être humain est la mesure de toute chose, en quoi il ne disait rien d’autre que : ce que chacun croit est aussi fermement établi ; dans ces conditions, il en résulte que la même chose est et n’est pas, est mauvaise et bonne, et ainsi de suite pour tout ce qu’on exprime par les affirmations opposées, parce que souvent telle chose semble bonne à ceux-ci, le contraire à ceux-là, et que la mesure est ce qui paraît à chacun. Cette difficulté peut être levée si on étudie d’où est venu le principe de cette conception ; en effet, elle est née probablement, pour certains, de l’opinion des physiologues, mais, pour d’autres, elle vient de ce que tous n’ont pas la même appréhension des mêmes choses : les uns trouvent telle chose agréable, les autres trouvent le contraire.
À première vue, la proposition aristotélicienne « la même chose est et n’est pas, est bonne et mauvaise, et ainsi de suite pour tout ce qu’on exprime par des affirmations opposées » peut donner à penser que son propos suppose l’abolition du principe de non-contradiction. En effet, affirmer que « la même chose peut être bonne et mauvaise », cela peut signifier que le même appartient et n’appartient pas « en même temps à la même chose et du même point de vue » (Aristote, 2009, 1005 b).
Mais, lus attentivement, il convient de reconnaître que, tout comme ceux de Platon, ces propos d’Aristote expriment fondamentalement le caractère relativiste de l’homo mensura de Protagoras. En font foi, leurs expressions suivantes : « Ce que chacun croit est fermement établi », « telle chose semble bonne à ceux-ci, le contraire à ceux-là », « telle m’apparaît chaque chose, telle elle est pour moi », « les uns trouvent telle chose agréable, les autres trouvent le contraire ». En effet, tenir de tels propos, c’est reconnaître que les choses sont relatives aux individus.
Bien comprises, les affirmations de Platon et d’Aristote revêtent un double intérêt. Le premier est que la vérité, au sens où l’entend Protagoras, n’est pas de l’ordre de l’universellement admis, mais du personnellement perçu. Elle demeure dans la sphère de la multiplicité, reléguant celle de l’unicité à un plan secondaire. Il s’ensuit que le nombre de vérités reste tributaire du nombre d’individus. Autrement dit, autant il existe d’individus, autant il existerait de vérités, dans la mesure où chacun détient sa vérité. C’est dans ce sens que Platon (2011, 161c-162b) tourne en dérision la pensée de ce sophiste en allant jusqu’à la position extrême attribuant même aux animaux des pans de vérités : « J’en reste étonné : il [Protagoras] n’a pas commencé La vérité en disant : de toutes choses, mesure est le “cochon”, ou “le babouin”, ou, parmi les êtres pourvus de sensation, quelque autre plus étrange ». Cela signifie qu’au nom du relativisme dont Protagoras serait le héraut, la vérité peut s’étendre même jusqu’aux animaux.
Le deuxième intérêt des déclarations platonico-aristotéliciennes est que, dans la perspective protagoréenne, il n’existerait pas de vérité objective. En effet, dans la mesure où la vérité est multiple, au sens du « à chacun sa vérité » (L. Pirandello, 1975, p. 75), elle ne saurait être objective. En fait, à partir de la maxime de Protagoras, il
n’y a rien que l’on puisse dénommer ou qualifier de quelques manières avec justesse. Si tu désignes une chose comme grande, elle apparaîtra aussi petite, et légère si tu l’appelles lourde, et ainsi du reste, parce que rien n’est un, ni déterminé, ni qualifié de quelque façon que ce soit (Platon, 1975, 152b-153b).
En prêtant attention à cette affirmation, l’on comprend que, selon Platon et Aristote, Protagoras aurait soutenu qu’il n’existe que des vérités non-objectives ; car, lorsqu’une chose est désignée par un individu comme grande, l’on doit admettre qu’un autre individu ait le droit d’émettre un avis contraire. La même réalité peut, de ce point de vue, apparaître à la fois grande et petite, dans la mesure où sa perception est relative à l’individu qui la perçoit.
- Gomperz (2008, p. 88) relève, avec éloquence, cette vision commune entre Platon et son disciple Aristote sur le sens à accorder à l’homo mensura de Protagoras. Il fait remarquer qu’en
deux endroits de sa Métaphysique, [Aristote] mentionne la proposition homo mensura de façon à laisser supposer que Platon, dans son Théétète, et en se répétant presque mot pour mot dans le Cratyle, frère jumeau du Théétète, en avait donné une interprétation authentique.
Autrement dit, selon Gomperz, Aristote donne son assentiment à l’interprétation platonicienne de l’homo mensura comme l’expression d’un relativisme.
Ainsi que l’on peut s’en apercevoir, aux yeux de Platon et d’Aristote, la théorie de l’homo mensura de Protagoras conduit à un relativisme de type individualiste. Cependant, une telle interprétation de la maxime de Protagoras ne paraît pas vraiment authentique ; car, en supposant que Protagoras ait voulu signifier que l’individu est le canon des choses, la suite de la maxime de l’homo mensura, c’est-à-dire des choses « qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas », n’a plus de signification rationnelle. En effet, il est difficile de s’enquérir des qualités des choses qui n’ont pas d’existence. Dans ce sens, à l’encontre des partisans de la position selon laquelle la maxime de Protagoras est une thèse en faveur du relativisme de type individualiste, en l’occurrence Platon et Aristote, Gomperz (2008, p. 77) affirme : « On peut faire (…) remarquer que (…) le membre de phrase négatif (de celles qui ne sont pas, comme elles ne sont pas) n’aurait aucun sens raisonnable ». Il va sans dire qu’interpréter la maxime de Protagoras comme le fondement d’un relativisme de type individualiste, c’est s’exposer à l’errance. Il convient donc de rechercher la vraie signification de l’homo mensura dans un autre registre. Ne faut-il pas percevoir cette théorie de Protagoras comme une position métaphysique fondamentale ?
2. L’HOMO MENSURA : EXPRESSION DES SPÉCIFICITÉS DE L’ÊTRE ET DE L’ESSENCE DE LA VÉRITÉ
À analyser attentivement la maxime protagoréenne de l’homo mensura, il est possible de retenir qu’elle dévoile les spécificités de l’être et de l’essence de la vérité. À proprement parler, la théorie de l’homme-mesure de Protagoras montre, d’une part, que l’être a un caractère ambivalent et, d’autre part, elle articule l’idée que la vérité est dévoilement. C’est pourquoi elle doit se saisir comme une proposition métaphysique fondamentale.
Pour s’en apercevoir, soulignons d’emblée les caractéristiques essentielles de ce qu’il convient d’entendre par cette expression. C’est le métaphysicien allemand M. Heidegger (1962, p. 135) qui nous en fournit l’une des réponses les plus précises. En substance, il écrit que la proposition fondamentale métaphysique est déterminée par quatre éléments essentiels :
- Par la manière dont l’homme est lui-même tout en se sachant lui-même ; 2. par le projet de l’étant sur l’être ; 3. par la délimitation de l’essence de la vérité de l’étant ; 4. par la manière selon laquelle à chaque fois l’homme prend la “mesure” et la donne pour la vérité de l’étant.
Il en résulte que la position métaphysique fondamentale est une thèse métaphysique dont le but est de révéler l’être dans toutes ses dimensions. Elle rend explicite le rapport de l’être aux trois entités que sont : l’homme, l’étant et la vérité.
Cet éclairage fait, analysons l’homo mensura à l’aune des deuxième et troisième caractéristiques de la proposition métaphysique fondamentale, à savoir celle du projet de l’étant sur l’être et celle de la délimitation de l’essence de la vérité. En considérant la deuxième partie de la maxime de l’homo mensura, c’est-à-dire « de celles qui sont en tant qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas », l’on constate qu’elle traduit parfaitement l’ambivalence de l’être et l’occultation de la vérité.
Pour ce qui est de l’ambivalence de l’être, elle est traduite par le substantif « choses » de l’homo mensura. En effet, « les choses », dont l’homme est la mesure dans la pensée de Protagoras, possèdent la double capacité d’être et de ne pas être. Or, seul l’être, à en croire M. Heidegger (1976, p. 243), possède cette spécificité. Voici ce qu’il écrit à ce sujet : L’être est « ce qui précisément montre, rend visible, sans se montrer soi-même ». C’est dire que l’être possède la double spécificité de se montrer et de ne pas se montrer ». Selon J.-P. Faye (2004, p. 19), « en visant l’être, l’on rencontre l’étant. […] L’être ne se présente jamais sans l’existant ». Il convient donc de retenir que, l’être et « les choses » de Protagoras, en tant que potentiellement invisibles et visibles, possèdent les mêmes caractéristiques. Il s’ensuit, comme l’on peut s’y attendre, que « les choses » dont parle Protagoras ne traduisent rien d’autre qu’une allusion à l’être. C’est pourquoi, la bonne entente, qu’il convient d’avoir sur « les choses » de la maxime de Protagoras est qu’elles ne sont que l’autre nom de l’être. En d’autres termes, la maxime de Protagoras ne signifie rien d’autre que l’idée selon laquelle, tout en se laissant découvrir, « les choses » ou l’être demeurent dans un retrait à travers lequel il n’est pas percevable.
L’on l’aura comprise, la voie d’intelligibilité de l’approche de l’homo mensura comme une expression de l’être demeure l’analogie qu’il convient d’établir entre l’être et l’expression « toutes choses ». Autant l’être a le caractère essentiel de l’ambivalence de la présence et de l’absence, autant « les choses » dont parle Protagoras sont à la fois présentes et absentes. « Les choses » et l’être sont, soit présents dans le ce-qui-se-donne-à-voir à travers l’étant, soit absents parce que retirés dans la clairière de l’être. Dans ce sens, si M. Heidegger (1976, p. 234) rappelle qu’à toute pensée de l’être s’imposent deux tâches : celle « de penser l’être de façon telle que le retrait lui appartienne essentiellement », mais aussi celle de la pensée de l’être dans son rapport à l’étant, il est possible de tenir aussi le même propos à l’égard « des choses » de la maxime protagoréenne. Précisément, la capacité de se retirer ou de ne pas se retirer appartient essentiellement aux « choses » qui se déploient grâce à l’être.
À partir de là, nous ne pouvons qu’être d’avis avec M. Heidegger (1971, p. 110) lorsqu’il retraduit l’homo mensura de Protagoras de la manière suivante : « De toutes choses […] l’homme […] est la mesure des choses en présence, en sorte qu’elle se présencifient ainsi qu’elles se présencifient, mais aussi de celles auxquelles il demeure refusé de se présencifier, en sorte qu’elles ne se présencifient point ». L’enjeu de cette retraduction réside dans l’idée que, d’après Protagoras, les choses ont la double possibilité de se présencifier et de ne point se présencifier. En tant que telles, elles peuvent se présenter et s’absenter. Et, dans la mesure où « ce qui se présencifie se tient à l’avance en tant que tel dans un district de l’accessible, district de la non-occultation » (M. Heidegger, Op. cit., p. 112), « toutes choses » sont inscrites, à la fois, dans le district de la non-occultation, c’est-à-dire dans l’ouvert, mais également dans le retrait de l’être.
Le rapprochement que nous établissons ici, entre « les choses » de la maxime de Protagoras et l’être, est loin de recueillir l’assentiment de penseurs tels que T. Gomperz et C. Godin. Pour T. Gomperz (2008, p. 79), par « les choses », Protagoras a voulu mettre l’accent sur leur existence. En effet, selon lui, « les choses » de Protagoras traduisent le réel existant. Ce qui le conduit à reconstruire la maxime de Protagoras de la manière suivante : « L’homme est la mesure de l’existence des choses. Ce qui revient à dire : le réel seul peut être perçu par nous ». Si Gomperz identifie « les choses » au réel tel qu’il se donne aux sens, C. Godin (2008, p. 54), quant à lui, considère que
le mot grec utilisé par Protagoras renvoie plutôt aux actions et aux œuvres humaines, donc au domaine pratique. Selon cette lecture, le soleil par exemple ne fait pas partie “des choses”, mais la décision d’engager une guerre, oui.
Somme toute, ces deux pensées montrent qu’au fond, la deuxième partie de la maxime de Protagoras, « de celles qui sont en tant qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas » aboutit à l’idée que la connaissance n’est possible qu’en dehors de toute transcendance, de tout absolu et de toute ontologie. Nous retrouvons, à ce niveau, l’idée selon laquelle « les choses » dont parle Protagoras ne sauraient renvoyer à l’être. Elles traduiraient le réel et les choses humaines contraires à l’être.
Pourtant, il est bien difficile que, dans la perspective de Protagoras, « l’homme soit la mesure des choses qui ne sont pas », et que ce même homme renonce aux enseignements fournis par cette forme particulière de choses. Plus précisément, affirmer que « l’homme est la mesure des choses qui ne sont pas, en tant qu’elles ne sont pas » suppose, à tout le moins, une familiarisation, un souci fondamental de celui-ci à s’élever vers les choses qui ne sont pas. De ce point de vue, il ne saurait raisonnablement être question, pour cet homme, de tourner le dos aux leçons fournies par les choses qui ne sont pas. Il ne s’agit donc pas de réduire la pensée de Protagoras à l’appréhension du réel et des actions humaines, comme le pensent Gomperz et Godin, mais de cerner les étants comme des prétextes pour la pensée de l’être authentique.
Quant à la vérité, il est évident que Protagoras ne cherche nullement à la saisir à partir de sa conception classique fondée sur une relation de correspondance. En effet, il est connu que la vérité a été conçue comme une « adaequatio intellectus et rei », c’est-à-dire une adéquation entre la pensée et le réel. Dans cette optique, l’on parle de vérité lorsque la pensée traduit fidèlement ce qui se produit dans le réel. En soutenant l’idée que les choses peuvent être et ne pas être, Protagoras ouvre une autre voie de compréhension de ce que peut être une chose vraie. En effet, mentionner, dans un ouvrage intitulé La Vérité, que des choses « sont en tant qu’elles sont » et que certaines « ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas » (Protagoras, 2009, p. 69), c’est reconnaître que la vérité est à rechercher dans le dévoilement et le voilement. La vérité, dans ce sens, ne se laisse découvrir qu’au terme d’un dévoilement à travers lequel la chose qui disparaît laisse apparaître la vérité.
- Heidegger (1976, p. 137) exprime bien cette orientation protagoréenne de la vérité lorsqu’il fait remarquer la chose suivante :
« La sophistique [protagoréenne] n’est possible que sur le fond de la σoφία [sophia : sagesse], c’est-à-dire de l’acception grecque […] de la vérité comme ouvert sans retrait, lequel reste à son tour une détermination essentielle de l’être ».
C’est dire qu’en son étoffe fondamentale, la théorie de l’homme-mesure de Protagoras nous renvoie à l’idée selon laquelle la vérité se dé-couvre, en se présentant pleinement dans une sorte d’ouvert. Plus précisément, en mettant l’accent sur l’idée que les choses pour lesquelles l’homme est la mesure ont la possibilité de se présenter ou de ne pas se présenter, Protagoras montre que la vérité d’une chose relève du voilement et du dévoilement. Elle ne consiste nullement dans une adéquation de la pensée et du réel, mais dans une équation de voilement et de dévoilement à résoudre.
C’est pourquoi, à la compréhension traditionnelle de la vérité comme adéquation de la chose et de l’intellect, il convient de substituer « une entente plus originelle de la vérité comme non-occultation à partir de ce que les Grecs ont nommé aléthéia » (J.-M. Vaysse, 2001, p. 60). En d’autres termes, la vérité ne saurait être entendue en son sens courant, c’est-à-dire au sens d’« accord ou de concordance d’une représentation et de son objet » (A. Boutot, 1989, p. 44). Elle n’est nullement « adaequatio intellectus et rei ». Au contraire, la vérité est le dévoilement de l’étant conduisant à la dé-couverte de l’être.
Ainsi entendue, la vérité, au sens où l’entend Protagoras, est logée dans un “ouvert sans retrait”. Dans cet ouvert sans retrait, « advient à soi la φαντασία [phantasia : ce qui apparaît], c’est-à-dire le venir au paraître […] du présent comme tel pour l’homme qui est, de son côté, présent pour ce qui apparaît » (M. Heidegger, 1968, p. 138). Ce qui sous-entend que “l’ouvert sans retrait” articule “le venir au paraître” conduisant à ce que M. Heidegger (1971, p. 112) a baptisé comme « le district de la non-occultation ». Ce qu’il faut surtout retenir de ces propos, c’est que, chez Protagoras, en considérant l’homo mensura, l’on est ramené inéluctablement à l’essence de la vérité comme non-occultation, donc à la vérité en tant que dévoilement. Autrement dit, il est impossible de concevoir l’homo mensura en dehors de l’idée qu’il conduit à la thèse selon laquelle la vérité est dévoilement.
De ce qui précède, il ressort que l’homo mensura exprime deux idées fondamentales. La première, découlant du projet de l’étant sur l’être, montre que l’être a le caractère essentiel de la présence et de l’absence. La seconde, en tant qu’elle est relative à la délimitation de l’essence de la vérité de l’étant, révèle que la vérité est non-occultation, c’est-à-dire qu’elle réside dans le dévoilement. Mais, si cela ne convainc pas de ce que la théorie de l’homme-mesure de Protagoras est « une position métaphysique fondamentale » niant l’idée de relativisme que l’on en déduit couramment, il convient de considérer les concepts d’« homme » et de « mesure » qui, pour nous, renvoient respectivement à « l’être soi de l’homme » et à une sorte de « modération », quant à l’appréhension de l’étant en totalité.
3. L’HOMO MENSURA OU LA MODÉRATION DE « L’ÊTRE SOI » DE L’HOMME
Si la deuxième partie de la maxime de l’homo mensura exprime les spécificités de l’être ainsi que l’essence de la vérité, répondant ainsi aux deuxième et troisième caractéristiques de la position métaphysique fondamentale, les concepts d’« homme » et de « mesure » traduisent, quant à eux, « l’être soi de l’homme » et la « modération » de celui-ci dans l’abord de l’être et des étants. Ces concepts répondent aux première et quatrième caractéristiques de la position métaphysique fondamentale.
S’agissant du concept « homme » de l’homo mensura, il convient de le considérer comme une expression de l’être-soi de l’homme, c’est-à-dire comme l’essence de l’homme. Pour s’en convaincre, référerons-nous au sens de l’expression « les choses », tel que précisé plus haut. Nous avons indiqué que « les choses » de la maxime de Protagoras ne sont pas à appréhender physiquement, mais méta-physiquement. Or, ce n’est pas à la dimension physique de l’homme qu’il convient de faire appel pour cet exercice de saisie suprasensible des choses, mais à sa dimension transcendante, à son être-soi. Donc, il y va ici de l’être soi de « l’homme ». Présenté simplement, ce propos revient à ceci : étant entendu que l’affirmation « l’homme est la mesure des choses qui ne sont pas, en tant qu’elles ne sont pas » présuppose que l’homme doit s’élever vers l’essence des choses, cet homme doit posséder la capacité d’entrer en lui-même pour pouvoir appréhender les choses en elles-mêmes.
Bien entendu, ce qu’il faut retenir, c’est que, « pour Protagoras, le “moi” se détermine par l’appartenance chaque fois délimitée, au non-occulté de l’étant. L’Être-soi de l’homme se fonde dans la confiance qu’inspirent l’étant non-occulté et son ambiance » (M. Heidegger, 1971, p. 114). En d’autres termes, le « moi », renvoyant au concept d’« homme » dans la théorie protagoréenne de l’homo mensura, est un « moi » qui s’affilie au non-occulté de l’étant, c’est-à-dire à l’être-soi de l’homme. Ainsi, à partir de l’homo mensura, l’ « homme » dont il s’agit, chez Protagoras, c’est l’homme dans son être, en tant qu’il ek-siste (existe authentiquement) dans la clairière ou dans le se montrer de l’être, pour parler comme Heidegger.
Concevoir « l’homme » de l’homo mensura de Protagoras comme l’être-soi de l’homme pourrait apparaître comme une méprise, tant les thèses développées sur cette question sont éloignées d’une telle interprétation. En effet, à partir de la pensée de Platon et d’Aristote, deux thèses s’opposent sur le sens à donner au substantif homme de la maxime protagoréenne. La première est celle défendue par des penseurs tels que O. Dillhy et B. Piettre (2007, p. 13). Elle résulte d’une retranscription littérale de la pensée platonicienne donnant à comprendre que l’homme de Protagoras est l’individu pris isolément. Ils affirment : « C’est l’homme seul qui, par son jugement, détermine ce qui est et ce qui n’est pas. Il y a donc autant de vérités que de jugements ou d’opinions humaines diverses ».
La deuxième thèse, défendue par des penseurs comme T. Gomperz et C. Godin, ne se contente plus de retranscrire littéralement la pensée de Platon. Elle se situe à un degré supérieur d’explication consistant à ne plus lire « l’homme » de Protagoras comme l’individu de l’espèce humaine, mais comme l’espèce humaine en tant qu’individu. Concrètement, « l’homme » dont il est question chez Protagoras n’est pas tel ou tel élément de l’espèce humaine, mais l’espèce humaine elle-même. Ce qui sous-entend que « Protagoras n’était pas un subjectiviste ; pour lui, c’est l’homme en général qui est la mesure de toutes choses » (C. Godin, 2008, p. 54). Bien comprises, ces deux thèses renvoient à l’idée qu’à partir de sa maxime de l’homo mensura, Protagoras serait un penseur réduisant l’homme à son apparaître, au détriment de son essence. « L’homme » dont parle Protagoras serait un être purement physique, nullement métaphysique.
À l’analyse, accorder du crédit à ces lectures, c’est faire une mésinterprétation de l’expression « choses » de Protagoras. En fait, O. Dillhy, B. Piettre, T. Gomperz et C. Godin, en se contentant de lire « les choses » uniquement en leurs dimensions physiques, se sont privés, eux-mêmes, de tirer toutes les conséquences de la deuxième partie de l’affirmation de Protagoras (2009, p. 69) : « De celles qui sont, en tant qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas, en tant qu’elles ne sont pas ». Étant entendu que ces penseurs n’ont pas compris que « les choses » de la maxime protagoréenne renvoyaient aux essences, ils ne pouvaient pas non plus comprendre que l’homme devait être saisi en tant qu’être métaphysique.
À vrai dire, il s’agit de concevoir l’homme comme cet être possédant la capacité de se transcender pour contempler l’être. C’est pourquoi nous sommes victimes d’une funeste illusion, si nous concevons que l’« homme » de Protagoras est « “chacun” (moi et toi, lui et eux) [où] chacun peut dire “moi” [et que] l’homme à chaque fois est le “moi” de chacun » (M. Heidegger, 1971, p. 111). Cela signifie que « l’homme », au sens où l’entend Protagoras, ne devrait pas être « compris en tant qu’égoïté » (Ibidem). Au contraire, il doit être cerné comme cet « être-soi » demeurant dans l’ouvert de l’être.
Une fois la signification de « l’homme » fondée par sa demeurance dans l’ouvert de l’être, la question du sens à attribuer au concept de « mesure », employé par Protagoras, se décante aisément. En effet, « mesure » ne doit plus être comprise au sens de « critère », ainsi que le pensait J.-P. Dumont (1988, p. 990), lorsqu’il affirmait : « Par mesure, il [Protagoras] veut dire critère ». Toute interprétation qui laisse accroire l’idée selon laquelle « mesure » signifierait « critère » est une erreur, une errance. Ce qu’il faut retenir, c’est que « mesure a le sens de modération / juste mesure / de la non-occultation » (M. Heidegger, 1971, p. 114). En d’autres termes, « mesure » doit revêtir le sens de modération, c’est-à-dire de modestie de l’homme, quant à la saisie rationnelle de l’étant en totalité et de l’être.
C’est pourquoi nous sommes d’avis avec B. Cassin (1995, p. 108) lorsqu’elle fait observer que l’homo mensura « consiste à entendre la mesure non comme une mainmise du sujet souverain sur les objets, mais comme une restriction, une modération, voire une juste mesure de la non-occultation ». En fait, « mesure » nie la prétention humaine à cerner l’être de manière souveraine. Elle met plutôt l’accent sur l’humilité que doit avoir tout homme abordant l’être en totalité. Cette modération dans l’abord des étants et de leur ouverture suppose un renoncement à l’excessivité, à la prétention, à l’orgueil et à la vanité, au profit de la retenue, de la circonspection et de la modestie. Au fond, la seule qualité capable de servir de pont entre l’être-soi de l’homme et l’ouvert de l’être est la reconnaissance de ses limites.
En tant que « mesure » modératrice, l’homme doit prendre
sur soi de ne pas outrepasser la sphère du dévoilement limitée au rayon de présence d’un je, reconnaissant ainsi le retrait de l’être avec son indécidabilité quant à la présence ou à l’absence de celui-ci, quant au visage, tout aussi bien, de l’ainsi présent-absent (M. Heidegger, 1968, pp. 136-137).
Il en résulte que, dans la mesure où l’être possède le double caractère de la présence et de l’absence, et que l’homme, en tant qu’être-soi, n’est offert à l’ouvert de l’être qu’à la manière d’un rayon, il est indiqué qu’il soit humble dans son abord de l’être. En un mot, « l’homme est certes “mesure de toutes choses”, mais il obéit à la loi d’une sophia qui lui enjoint les strictes frontières de son règne et de son savoir » (M. Haar, 1990, p. 96). Tel est le sens qu’il convient de donner à la « mesure » de Protagoras.
Au total, à partir des caractéristiques de la « position fondamentale métaphysique », l’on aboutit à l’idée que les termes « homme » et « mesure », perceptibles dans l’homo mensura, doivent être respectivement compris comme l’être-soi de l’homme et comme la modération qui impose une reconnaissance de ses propres limites.
Conclusion
L’interprétation de l’homo mensura de Protagoras comme l’expression d’un relativisme n’est absolument pas dénuée de fondements textuels. Les œuvres de Platon et d’Aristote nous fournissent des indices solides allant dans le sens de rapprocher sémantiquement cette maxime de Protagoras du relativisme. Seulement, cette interprétation ne nous fournit pas une explication assez convaincante de la deuxième partie de l’homo mensura à savoir « des choses qui sont, en tant qu’elles sont et des choses qui ne sont pas, en tant qu’elles ne sont pas ».
Dès lors, il convient d’émettre des réserves quant à l’interprétation de l’homo mensura comme l’expression d’un relativisme. Ce qui apparaît plus conforme à la pensée du penseur antique, c’est de considérer cette maxime, pour reprendre les termes du philosophe de Fribourg, comme une « proposition fondamentale métaphysique ». La raison d’une telle prise de position est simple. C’est que la maxime de Protagoras suppose quatre idées essentielles que l’on pourrait réduire à deux : d’une part, l’être a le double caractère de la présence et de l’absence et que la vérité est dévoilement ; et d’autre part, les termes « homme » et « mesure » renvoient respectivement à l’être-soi de l’homme et à la modération de celui-ci dans l’abord des étants.
Une telle interprétation se veut authentique dans la mesure où elle donne un sens, on ne peut plus clair, à la deuxième partie de l’homo mensura. Quoique relativement peu adoptée, cette interprétation a le mérite d’ouvrir la voie à l’inscription du sophiste Protagoras dans la classe des philosophes et non dans celle des philodoxes dans laquelle les sophistes sont généralement rangés.
Références bibliographiques
ARISTOTE, 2008, Métaphysique, trad. Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, Paris, G.F., 494 p.
BOUTOT Alain, 1989, Heidegger, Paris, P.U.F., 128 p.
CASSIN Barbara, 1995, L’effet sophistique, Paris, Gallimard, 693 p.
DILLHY Olivier, PIETTRE Bernard, 2007, Les Grandes figures de la philosophie, Paris, L’Étudiant, 178 p.
DUMONT Jean-Paul, 1988, « Les sophistes » dans Les Présocratiques, trad. Jean-Louis Poirier, Paris, Gallimard, 1680 p.
FAYE Jean-Pierre, 2004, « Heidegger et son explicitation de l’oubli de l’être dans la métaphysique de Platon » dans Revue du CAMES-Série B, 006 (1-2), pp. 17-25.
GODIN Christian, 2008, La philosophie : Antiquité, Moyen Âge et Renaissance, Paris, First-Gründ, 357 p.
GOMPERZ Théodore, 2008, Les sophistes, Paris, Manucius, 148 p.
HAAR Michel, 1990. Heidegger et l’essence de l’homme, Grenoble, Jérôme Millon, 254 p.
HEIDEGGER Martin, 1962, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. Wolfang Brokmeier, Paris, Gallimard, 463 p.
HEIDEGGER Martin, 1968, Questions I et II, trad. Jean Baufret et alli, Paris, Gallimard, 582 p.
HEIDEGGER Martin, 1971, Nietzsche II, trad. Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 408 p.
HEIDEGGER Martin, 1976. Questions III et IV, trad. Jean Baufret et al, Paris, Gallimard, 488 p.
HEIDEGGER Martin, 2005, Grammaire et étymologie du mot « être », trad. Pascal David, Paris, Seuil, 102 p.
MOYSAN-LAPOINTE Héloïse, 2010, « La vérité chez Protagoras » dans Laval théologique et philosophique, 66 (3), pp. 529-545.
PLATON, 2011. Théétète in Œuvres complètes, trad. Sous la direction de Luc Brisson, Paris, Flammarion, pp. 1891-1975.
PRADEAU Jean-François, 2009. Les Sophistes, tome I : de Protagoras à Critias. Fragments et témoignages, trad. Mauro Bonazzi, Luc Brisson, et al, Paris, G.F., 562 p.
VAYSSE Jean-Marie, 2001. Le vocabulaire de Heidegger, Paris, Ellipses, 64 p.
NIETZSCHE ET LA MÉTAPHYSIQUE DE LA PRÉSENCE
Akanis Maxime AKANOKABIA
Maître-Assistant, Université Marien NGOUABI de Brazzaville
Résumé : Ce travail se veut une contribution à la question liée au statut de la métaphysique, car il s’agit de repenser à nouveaux frais, le concept nietzschéen de la métaphysique. La métaphysique se rapporte à un ensemble spécifique de questions philosophiques, qui la distingue essentiellement des autres théories du savoir. Avec Nietzsche, et contrairement à ses prédécesseurs, la métaphysique s’assigne une autre ambition. Elle n’est plus comprise comme la volonté de vérité, la recherche effrénée du Bien, de l’Absolu, etc., mais plutôt la science qui s’occupe du concret, de ce qui est, c’est-à-dire de ce qui est présent. C’est ici, tout le sens du concept nietzschéen de métaphysique de la présence, entendue comme l’expression de ce qui est et non l’objet d’une expression contemplative. Avec Nietzsche, le concept de métaphysique devient tout un programme à exécuter qui placerait l’homme au centre de ce qu’on pourrait appeler ²destin de la métaphysique² .
Mots-clés : MÉTAPHYSIQUE, PRÉSENCE, VÉRITÉ, APPARENCE, VIE.
Abstract: This work is a contribution to the issue related to the status of metaphysics, because it is a matter of rethinking, by new ways, Nietzschean concept of metaphysics. Metaphysics refers to a specific set of philosophical questions, which essentially differs from other theories of knowledge. With Nietzsche, and unlike his predecessors, metaphysics assigns itself another ambition. It is no longer understood as the will to truth, the unrestrained search of the Good, of the Absolute, … but rather the science that deals with the concrete, of what exist, that is to say what is present. It is here, the whole meaning of nietzschean concept of metaphysical presence, understood as the expression of what is and not object of a contemplative expression. With Nietzsche, the concept of metaphysics becomes an entire program to run which would place man at the center of what could be called ²destiny of metaphysics².
Keywords: METAPHYSICS, PRESENCE, TRUTH, APPEARANCE, LIFE.
Introduction
Pour certains esprits mal informés, la question ˝qu’est-ce que la métaphysique ? ˝ ne sert à rien, et par conséquent, son objet relève d’un débat sans intérêt. D’autres parleront même de sa disparition pure et simple, comme si la science peut, à elle seule, répondre aux questions liées à la finitude, au sens, voire à la question qu’est-ce que l’homme ? Un tel raisonnement n’est que le reflet d’une certaine ignorance, parce que le concept de métaphysique, à en croire Nietzsche, est probablement le plus important et certainement le plus célèbre, pour la simple raison qu’il s’intéresse aussi aux réalités concrètes. Cependant, l’objet de notre interrogation est celui des modes d’accès à la métaphysique de la présence. Autrement dit, pourquoi métaphysique de la présence, et en quoi consiste-t-elle ? En définissant sa philosophie comme du “platonisme inversé”, tout en faisant de l’art “l’activité métaphysique” par excellence, Nietzsche trace les grandes orientations de son projet métaphysique. Il s’agit, en d’autres termes, d’un véritable programme métaphysique qui se donne à lire comme un véritable mot d’ordre. Ce programme consiste à revisiter l’argument largement avancé qui affecte les conditions essentielles sur lesquelles reposent notre manière de vivre et notre attachement à la notion de vie. Il s’agit, plus précisément, de la montée d’un sentiment de détresse, de l’absurdité de vivre et malheureusement de la conviction selon laquelle la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Là, naît le dégoût de la vie, tout en voulant en finir avec elle. En clair, la volonté du néant et le goût effréné de la vérité ont avili et méprisé l’ici-bas au profit d’un au-delà sans fondement. C’est de là que naît le nihilisme. Comme le souligne P. Wotling (2009, p. 94),
combattre cette montée du nihilisme qui s’empare de l’Europe, rend l’homme malade et le pousse à désirer l’extinction de l’existence, tel est l’objectif fondamental du philosophe, tâche qui ne s’identifie plus à la connaissance ou à la recherche de la vérité, mais est bien plutôt de nature pratique et artistique.
Ce que nous envisageons proposer, à partir de ce projet nietzschéen, c’est de rendre à l’apparence ce qui lui appartient ; autrement dit, réhabiliter la vie longtemps dénigrée, dégradée et humiliée. Il s’agit, en termes clairs, de rendre compte des erreurs de la métaphysique du néant, tout en réhabilitant l’apparence telle qu’elle s’offre à nous, c’est-à-dire sous toutes ses formes.
1. MÉTAPHYSIQUE ET NOSTALGIE DE LA VÉRITÉ
- Balibar (1994, p. 7) disait : « L’entreprise d’un discours philosophique sur la vérité, n’a pas besoin de justification particulière, puisqu’il fait corps avec l’existence même de la philosophie… la question de la vérité, sous une forme ou sous une autre, n’est jamais séparable des entreprises philosophiques ». Cela voudrait dire que la question ²qu’est-ce que la vérité ? ² n’est pas une question étrangère en philosophie, en ce sens qu’elle fait partie des préoccupations majeures du discours métaphysique. Mais notre rapport à la vérité, souligne Nietzsche, est un rapport ambigu, parce qu’il n’est toujours pas aisé, lorsqu’il s’agit de dégager du sens à ce concept même de vérité. La notion de vérité torture les esprits. Cela est dû aux conflits de légitimité qui semblent surgir entre des champs à la fois multiples et différents, par exemple entre la philosophie décadente, qui se donne pour objet l’idée d’une vérité absolue ou d’une volonté de vérité, et la philosophie de la vie, qui réhabilite l’apparence, tout en faisant d’elle le lieu par excellence de la vérité. Nous saisissons ainsi le projet nietzschéen de la métaphysique de la présence, entendue comme la réhabilitation de l’ici-bas. Cela dit, qu’entendons-nous par métaphysique ? Et pourquoi le concept de vérité, s’invite-t-il dans le programme nietzschéen de la métaphysique ?
Il serait en effet absurde de cerner ce mot d’ordre nietzschéen, sans pour autant circonscrire, le plus précisément possible, ce que nous entendons par métaphysique. Autrement dit, qu’est-ce que la métaphysique ? Concept étonnant d’ailleurs, puisqu’il fait l’objet d’un revirement extraordinaire. Du Grec : meta, trans, exprimé par le terme allemand ‘’Űber’’, renvoyant, en français, à ²au-delà², la métaphysique est un concept qui n’apparaît pas ex-nihilo, car il dérive d’un travail de classement et de rangement[2]:
Au contraire du terme physis, le terme métaphysique ne nous apprend rien sur l’objet dont il traite. Au commencement, il s’agit d’un terme de classement. Il a été mis en circulation peu après la mort d’Aristote, c’est-à-dire à une époque où la philosophie commençait à institutionnaliser son enseignement sous la forme de différentes académies (J. Greisch, 1998, p. 7-9 ).
Il est en réalité question d’un travail réalisé par Andronicos de Rhodes, éditeur d’Aristote, qui, en séparant les écrits de ce dernier traitant de la physique et d’autres qui n’avaient pas de titre, a proposé le titre « métaphysique ». Cela voudrait dire, en d’autres termes, qu’il s’agissait, au départ, d’un travail d’éditeur visant à donner un titre, à ce qui était sans titre. Mais ce ‘’titre’’ (la métaphysique) a pu acquérir, par la suite une valeur sémantique et philosophique propre. On a lu la préposition méta, ²après² comme signifiant méta, trans, ²au-delà². Par conséquent, il ne s’agit plus seulement des écrits venant après la physique, mais désormais d’un au-delà de la physique. Comme le dit M. Heidegger (1953, p. 66),
on sait que l’expression ta méta ta phusika, qui désignait l’ensemble des traités d’Aristote faisant matériellement suite à ceux du groupe de la physique, n’avait primitivement qu’une valeur de classification, mais se transforme plus tard en une dénomination expliquant le caractère philosophique du contenu de ces traités. Cette altération de sens n’est cependant pas aussi insignifiante qu’on le dit habituellement. Elle a, au contraire, orienté l’interprétation de ces traités dans une direction bien déterminée, et fait qu’il faudra désormais comprendre comme ²métaphysique² ce dont traite Aristote. On peut néanmoins douter que le contenu des écrits aristotéliciens réunis sous le titre de métaphysique soit vraiment une métaphysique.
Mais, la métaphysique, telle qu’elle se donne à voir comme la science d’un au-delà, d’un arrière monde, assigne à la philosophie un autre statut, consistant à se mettre au service de la théologie chrétienne où la préoccupation n’est plus celle de la recherche de la vérité à méditer, à questionner et à dévoiler, mais celle d’une vérité venant d’en haut, c’est-à-dire d’un monde supposé supra sensible. Un tel argument ne peut que déprécier et humilier l’ici-bas, qualifié de simple copie et de simple apparence. Cette hostilité à la vie terrestre, du fait de son impureté, et de son statut de copie, a finalement permis à Nietzsche de mettre en place son projet métaphysique, qui constitue essentiellement à rehausser la vie, c’est-à-dire à sortir du nihilisme décadent qui n’est rien d’autre que l’expression de la volonté de vérité. Comme on peut le constater,
« la croyance que le monde qui devrait être est, existe réellement, est une croyance des improductifs qui ne veulent pas créer un monde tel qu’il doit être. Ils le posent comme donné, ils recherchent les moyens et les voies pour y accéder ‘’volonté de vérité’’ en tant qu’impuissance de la volonté de créer » F. Nietzsche, (1887, 9[60]).
Croire en une vérité dans l’au-delà, c’est croire en Dieu, c’est croire en l’existence d’un monde meilleur que celui-ci (sensible) ; c’est nier et condamner le monde tel qu’il est, et poser l’existence idéale du monde tel qu’il devrait être, parce qu’on est incapable de créer et de redonner goût à la vie. Cela revient à appréhender la réalité, l’être comme devenir tout en admettant le monde comme changeant et mouvant. Par conséquent, il n’y a rien de stable d’immuable et d’éternel. La vie est un processus dynamique qui ne dépend pas de quelqu’un d’autre, d’une autre force, d’une autre énergie. La vie est vie, parce que nous la façonnons, nous la créons. Dès que nous imaginons que notre existence, que notre monde dépend d’une force supérieure à la nôtre, alors, nous créons les conditions d’un nihilisme décadent, ainsi que le réaffirme F. Nietzsche (1887, 9 [91]) :
Dès que nous imaginons quelqu’un qui est responsable de ce que nous sommes tels ou tels, etc. (Dieu, la nature), donc lui imputons et lui attribuons en tant qu’intention notre existence, notre bonheur et notre misère, nous nous gâchons l’innocence du devenir. Nous avons alors quelqu’un qui à travers nous et avec nous veut atteindre quelque chose.
C’est dans cette optique que Nietzche s’en prend non seulement au christianisme, qu’il considère d’ailleurs comme le sommet même de l’idéal ascétique, mais aussi et surtout à Socrate, qui est le symbole par excellence de la décadence. Mais, pourquoi la figure de Socrate comme problème métaphysique ? Socrate n’est-il pas le symbole par excellence de la dépréciation des valeurs ? Que dire finalement de Platon qui célèbre sans cesse la volonté de vérité ?
Dans son projet métaphysique, Nietzsche pense que pour vivre, l’homme a besoin de permanence, de stabilité, de vérité, donc il projette un monde stable, permanent et vrai. Or, la croyance en un au-delà illusoire est un signe d’affaiblissement, voire d’épuisement. C’est bien en cela que Nietzsche s’en prend aux illusionnistes de l’arrière monde :
‘’Le monde vrai’’ une idée qui ne sert plus de rien, qui n’oblige même plus à rien, une idée devenue inutile et superflue, par conséquent, une idée réfutée : supprimons-là ! (…) Le ‘’monde vrai’’, nous l’avons aboli : quel monde nous est resté ? Le monde des apparences peut-être ? Mais non ! Avec le monde vrai nous avons aussi aboli le monde des apparences ! (F. Nietzsche, 1993, II, p. 968 § 5 et 6).
Le propos nietzschéen consistant à légitimer l’effondrement du monde supra sensible, du monde de la vérité, se justifie par le fait que toute prétention à vouloir ériger la vérité dans un monde supposé vrai s’efface d’elle-même. Il n’y a pas de vérité qui serait dans l’au-delà, car il faut, dit-il, affirmer le retour éternel, tout en faisant du physique l’objet d’une métaphysique. Une métaphysique qui, au lieu de dénigrer l’ici-bas, accorde au contraire une vraie place à l’apparence, car
l’apparence, au sens où je l’entends, est la véritable et l’unique réalité des choses – ce à quoi seulement s’appliquent tous les prédicats existants et qui dans une certaine mesure ne saurait être mieux défini que par l’ensemble des prédicats, c’est-à-dire aussi par les prédicats contraires. Or, ce mot n’exprime rien d’autre que le fait d’être inaccessible aux procédures et aux distinctions logiques : donc une « apparence » si on la compare à la « vérité logique » – laquelle n’est elle-même possible que dans un monde imaginaire. Je ne pose donc pas « l’apparence » en opposition à la réalité, au contraire, je considère que l’apparence, c’est la réalité, celle qui résiste à toute transformation en un imaginaire « monde vrai ». Un nom précis pour cette réalité serait la volonté de puissance (F. Nietzsche, 1982, XI, 40 [53] ).
Ce qui nous semble plus intéressant dans ce fragment posthume, c’est le fait qu’il assimile et n’opère aucune différence entre réalité et volonté de puissance ; combien dire que la réalité est, selon Nietzsche, à la fois apparence et volonté de puissance. Par conséquent, il se démarque des philosophes nihilistes qui ont dénigré l’apparence en la faisant passer pour une simple copie de ce qui existerait là-haut, alors que le présupposé « là-haut », nous dit Nietzsche, n’existe plus, ce qui veut dire que l’autorité qui fonderait ce monde suprasensible s’est éteinte.
Nietzsche identifie apparence et réalité et rejette la théorie des deux mondes sous toutes ses formes, caractéristique de la pensée métaphysique. Dans ces conditions, le rêve, avec sa logique propre, devient un modèle d’intelligibilité privilégié pour penser la réalité comme apparence : « Qu’est-ce pour moi à présent que l’apparence ! Certainement pas le contraire d’une quelconque essence, – que puis-je énoncer d’une quelconque essence sinon les seuls prédicats de son apparence ! (…) L’apparence, c’est pour moi cela même qui agit et qui vit, qui pousse la dérision de soi-même jusqu’à me faire sentir que tout est ici apparence, feu follet, danse des esprits et rien de plus,- que parmi tous ces rêveurs, moi aussi, l’homme de connaissance, je danse ma propre danse, que l’homme de connaissance est un moyen de faire durer la danse terrestre, et qu’il fait partie en cela des grands intendants des fêtes de l’existence (P. Wotling, 2013, p. 17).
Ce quelque chose qui a disparu s’appelle Dieu, et ce quelque chose s’inscrit désormais dans les registres du passé. C’est ce que Nietzsche lui-même appelle « la mort de Dieu » ou la perte de l’Absolu. Comme le souligne très justement M. Heidegger (1962, p. 261-262),
ainsi le mot « Dieu est mort » signifie : le monde suprasensible est sans pouvoir efficient. Il ne prodigue aucune vie. La métaphysique, c’est-à-dire pour Nietzsche la philosophie occidentale comprise comme platonisme, est à son terme. Quant à Nietzsche, il conçoit lui-même sa philosophie comme un mouvement anti-métaphysique, c’est-à-dire pour lui, anti-platonicien.
Or, l’Absolu est, par définition, ce qui n’a besoin que de soi-même pour exister, ce qui a en soi-même sa raison d’être. Il est l’ultime degré de l’être, c’est-à-dire, ce par quoi se tient l’échelle des valeurs, étant entendu qu’une telle échelle se tient par le haut. Il est aussi l’horizon que l’homme est contraint de poser s’il veut penser ou donner un sens à sa vie. C’est le sens même de l’argument platonicien, qui souligne, à juste titre, que notre vie n’a de sens que d’avoir, en dehors d’elle, ce quelque chose qui l’anime. Ce quelque chose est bel et bien l’Absolu, considéré aux yeux de Platon comme l’incarnation même de toutes nos valeurs. L’Absolu, c’est bien le soleil qui brille hors de la caverne, il est considéré comme l’axe et le pivot autour desquels tourne l’univers. Mais, paradoxalement, cet absolu s’est éteint, il n’existe plus, il a été assassiné occasionnant, par conséquent, l’effacement de tout horizon. Comme dit M. Heidegger (Idem, p. 262) :
Si Dieu, comme Cause suprasensible et comme Fin de toute réalité, est mort, si le monde suprasensible des idées a perdu toute force d’obligation et surtout d’éveil et d’élévation, l’homme ne sait plus à quoi s’en tenir, et il ne reste plus rien qui puisse l’orienter. (…) Ainsi le mot « Dieu est mort » constate qu’un néant commence à s’étendre. Néant veut dire : absence d’un monde suprasensible à pouvoir d’obligation.
Cela voudrait dire, en d’autres termes, que l’idéal n’est plus, que le désir ne sait plus vers quoi tendre. Par conséquent, des expressions du type « au nom de Dieu », « le royaume des cieux », « l’au-delà » s’effondrent d’elles-mêmes, puisque l’échelle des valeurs qui se trouvait dans ce monde imaginaire n’existe plus. La parole du prêtre et toutes les recommandations du christianisme tombent d’elles-mêmes. Comme nous pouvons le constater,
les idées ²d’au-delಠ, ²de jugement dernier², ²d’immortalité de l’âme², ²l’âme² elle-même, sont des instruments de torture, des systèmes de cruauté dont le prêtre se servit pour devenir maître, pour rester maître (…) et tout le christianisme roule dans le néant – Regardé de haut, ce fait, le plus étrange de tous, une religion non seulement fondée sur des erreurs qui mettent la vie en danger et empoisonnent le cœur, demeure un spectacle pour les dieux (F. Nietzsche, 1993, II, p. 1071-1072, § 38 et 39).
Toujours dans l’Antéchrist, § 38, nous pouvons aussi lire :
Je regarde autour de moi : il n’est plus resté un mot de ce qui autrefois s’appelait « vérité », nous ne supportons plus qu’un prêtre prononce seulement le mot de « vérité ». Même avec les plus humbles exigences de probité, il faut que l’on sache aujourd’hui qu’un théologien, un prêtre, un pape, à chaque phrase qu’il prononce, ne commet pas seulement une erreur, mais fait encore un mensonge (Idem, § 38).
La métaphysique de l’éternel retour, c’est la métaphysique de ceux qui sont restés fidèles à la terre, c’est la métaphysique de la présence, de ce qui est, et existe réellement. Comme le stipule Zarathoustra :
Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d’espérances supraterrestres ! Ce sont des empoisonneurs, qu’ils le sachent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée : qu’ils s’en aillent donc ! (F. Nietzsche, 1993, II, p. 290, § 2).
Le projet nietzschéen d’une réhabilitation du sensible se donne à voir clairement, en ce sens qu’il dénonce non seulement les égarements des philosophes décadents à l’instar de Socrate, Platon, Schopenhauer et autres, mais aussi donne ici le là d’une vraie métaphysique de la vie, c’est-à-dire d’une réhabilitation de tout ce qui est, d’un retour de l’homme à lui-même, d’une désaliénation, d’une restitution à l’homme de son honneur perdu. Le temps n’est plus d’accorder de l’importance, de la valeur aux idées creuses et insensées. C’est tout le combat de Nietzsche contre Socrate. D’où le problème Socrate sinon Socrate en tant que problème. Cela revient à dire qu’en méconnaissant la valeur de la réalité sensible, la vie réelle des choses, Socrate sombre dans une forme d’antinomies et devient en même temps un réel problème métaphysique. Ainsi, Socrate entant que problème se présente à la fois comme une succession d’antinomies et comme une épreuve.
2. SOCRATE COMME PROBLÈME MÉTAPHYSIQUE
Dans Les philosophes préplatoniciens, on peut lire :
Les philosophes de la Grèce antique étaient des individus d’exception, qui avaient su passer du mythe à la science, qui avaient su vivre pour la vérité, pour leur propre vérité, même au prix de l’isolement ou du conflit avec la communauté (F. Nietzsche 1994, p. 13).
Pourquoi une telle déclaration, et à quoi sert-elle ? Le projet nietzschéen de la métaphysique du concret peut-elle rendre compte d’une telle déclaration ? En quoi consiste l’exception des philosophes présocratiques ? Pour répondre à ces interrogations, relisons Nietzche : « Socrate, simple aveu de ma part, m’est si proche que je suis en un perpétuel combat avec lui » F. Nietzsche (1991, p. 144.)
La déclaration de Nietzsche contre Socrate dans ²la science et la sagesse en conflit² montre jusqu’à quel point Socrate est devenu pour lui une difficulté à résoudre. Contrairement aux philosophes présocratiques et notamment à Héraclite, avec Socrate et Platon par la suite, la métaphysique s’assigne un programme ambitieux, qui est celui de la radicalité en matière de pensée à savoir le mépris du sensible au profit de la recherche de l’essence, de la vérité. Socrate, quant à lui, accepte de mourir sous prétexte que la vraie vie, la vraie justice se situe dans l’au-delà, et que le corps qui est signe d’impureté, de contre vérité est le berceau de nos malheurs. Par conséquent, tout ce qui relève de l’ici-bas est sans intérêt, car
pour la psychologie de la métaphysique, ce monde est apparence, par conséquent il y a un monde vrai. Ce monde est conditionnel, par conséquent il y a un monde inconditionnel. Ce monde est rempli de contradictions, par conséquent il y a un monde sans contradictions. Ce monde est en devenir, par conséquent il y a un monde de l’étant. Rien que des contradictions fausses (confiance aveugle dans la raison : si A est, son concept opposé B doit être aussi) (F. Nietzsche, 1885-1887. p. 318).
Finalement, en adorant la vérité et l’éternité, tout en niant l’apparence, Socrate vivrait dans une espèce de nostalgie de l’être à tel point que nous comparons même son existence à celle d’une personne vivant sur une terre d’exil. C’est tout le sens du combat de Nietzsche qui va jusqu’à qualifier Socrate de monstre et d’homme dangereux pour l’avenir de la philosophie, car l’homme, pour vivre, a besoin de permanence, de stabilité et de vérité. Mais, la stabilité et la vérité ne se trouvent pas dans le monde supposé intelligible, plutôt dans le réel, le monde sensible, c’est-à-dire le monde de l’apparence. Alors qu’avec Socrate, ce monde ci est faux et ennuyeux, et que, la vérité, loin d’être l’expression même de ce qui est, relève d’abord et avant tout de la contemplation. Comme disait G. Deleuze (1962, p. 149) :
Si quelqu’un veut la vérité, ce n’est pas au nom de ce qu’est le monde, mais au nom de ce que le monde n’est pas. Il est entendu que ² la vie vise à égarer, à duper, à dissimuler, à éblouir, à aveugler². Mais celui qui veut le vrai veut d’abord déprécier cette haute puissance du faux : il fait de la vie une ²erreur², de ce monde une ²apparence²(…), il oppose au monde un autre monde, un outre-monde, précisément le monde véridique. Le monde véridique n’est pas séparable de cette volonté, volonté de traiter ce monde-ci comme une apparence.
C’est de là que naît la confusion, et que toute prétention à vouloir humilier l’apparence relève d’un non-sens, car
les raisons qui firent appeler ‘’ce’’ monde un monde d’apparence prouvent au contraire sa réalité, une autre réalité est absolument indémontrable. (…) les signes distinctifs que l’on a donnés de ‘’l’être’’ véritable « des choses » sont les signes caractéristiques du non-être, du néant ; de cette contradiction, on a édifié le ‘’monde vrai’’ par opposition au monde réel : (…) Fabuler à propos d’un autre monde que celui-ci n’a aucun sens, à moins que nous n’ayons en nous un instinct dominant de calomnie, de rapetissement, de mise en suspicion de la vie : dans ce dernier cas, nous nous vengeons de la vie avec la fantasmagorie d’une « autre », d’une vie « meilleure » (…) Séparer le monde en un monde « vrai » et un monde des « apparences », soit à la façon du christianisme, soit à la façon de Kant, ce n’est là qu’une suggestion de la décadence, un symptôme de la vie déclinante (F. Nietzsche, 1993, II, p. 965-966, § 6).
Le combat de Nietzsche contre Socrate consiste essentielle à mettre en cause l’argument privilégiant l’au-delà au détriment du réel. La vie digne de ce nom se trouve dans le monde sensible, dans le monde de l’apparence. Par conséquent, vouloir surestimer l « ’idée », le « vrai », le « Bien » au détriment de ce qui existe réellement, relève d’une véritable absurdité. C’est dans cette optique que tous ceux qui voudront tuer la vie, tout en militant pour sa disparition, ne sont en réalité que des criminels, c’est-à-dire des décadents, à commencer bien sûr par Socrate lui-même :
Enfin de compte Socrate était-il un Grec ? La laideur est assez souvent l’expression d’une évolution croisée, entravée par le croisement. Autrement dit, elle apparaît comme le signe d’une évolution déclinante. Les anthropologues qui s’occupent de criminologie nous disent que le criminel type est laid (…). Mais le criminel est un décadent. Socrate était-il un criminel type ? (…). En passant par Athènes, un étranger qui se connaissait en physionomie dit, en pleine figure, à Socrate qu’il était un monstre, qu’il cachait en lui tous les mauvais vices et désirs. Et Socrate répondit simplement : Vous me connaissez, monsieur ! (F. Nietzsche, Idem, p.957, §3).
Socrate n’est pas le seul criminel, il n’est pas non plus le seul philosophe décadent qui a tenté de juger et d’évaluer la vie, car nous avons aussi Platon qui
représente le début de quelque chose de tout à fait nouveau ; ou, comme il est tout aussi juste de le dire, depuis Platon, il manque aux philosophes quelque chose d’essentiel lorsqu’on les compare à cette République des génies qui va de Thalès à Socrate. Si l’on veut être malveillant à l’égard de ces vieux maîtres, on peut dire d’eux qu’ils sont bornés, et de leurs épigones, Platon en tête, qu’ils sont plus complexes. (…) Platon lui-même fait figure de premier grand hybride, et cela est inscrit aussi bien dans sa personnalité que dans sa philosophie… C’est pourquoi il ne présente pas un type pur. (…) Le philosophe protège et défend sa patrie. Or, désormais, depuis Platon, le philosophe est en exil et conspire contre sa patrie. Il est vraiment malheureux qu’il nous reste si peu de chose de ces premiers maîtres de la philosophie et que tout ce qui était achevé nous ait échappé (F. Nietzsche, 1975, §.2).
Dans le corpus nietzschéen, Platon est considéré comme le continuateur de la nostalgie de l’être, le philosophe de la volonté de vérité, à tel point qu’il taxe de moins sérieux tout ce que l’on peut observer ici et là, et aucune des choses humaines ne mérite qu’on y accorde une attention particulière. Nietzsche n’est d’ailleurs pas surpris d’entendre de tels propos venant de Platon, qui, à ses yeux, ne font que confirmer sa propre maladie ; une maladie qui semble vouloir s’emparer de l’Europe entière. Comme on le constate d’ailleurs dans une de ses promenades à Gênes, lorsque Nietzsche entend le son des cloches dans l’air du soir, chargé de toute cette dimension symbolique, cela a été pour lui l’angoissante représentation sonore du nihilisme, c’est-à-dire un véritable retentissement célébrant l’absence de valeurs de l’existence terrestre. Comme l’écrivait Platon lui-même, « aucune des choses humaines ne mérite qu’on n’y attache beaucoup d’importance et que ce qui devrait venir le plus vite possible à notre secours dans ces circonstances en est empêché par le chagrin » (Platon, 1950, C, 604 b 10-c 3).
Ces propos platoniciens montrent bien la volonté de cette métaphysique nihiliste à vouloir dévaster le monde tout en se l’appropriant. Il s’agit bien d’une entreprise métaphysico-classique, qui est en train d’humilier la vie, et qu’il faille, absolument en découdre, c’est-à-dire opérer un autodépassement. Or, cet autodépassement, c’est ce que Nietzsche nomme « l’inversion de toutes les valeurs », car il faut, dit-il, instaurer de nouvelles valeurs, mettre en place une nouvelle table des valeurs, c’est-à-dire, recréer le monde en lui donnant un autre sens qui n’est rien d’autre que la valorisation du devenir. À ce propos, relisons M. Dixsaut (2015, p. 25) :
Nietzsche ne parle pas ici de monde vrai, mais d’étant vrai. Selon Heidegger, il veut pourtant dire que pour lui « le monde vrai est le devenant, le monde apparent ce qui est fixe et constant. (…) de l’étant vrai, il faut s’éloigner, non pour aller vers du « plus vrai », mais vers du meilleur. (…) Si le monde apparent est pour Nietzsche le monde vrai, la vie la meilleure serait celle vécue dans la vérité, nommée par Nietzsche ²apparence², et le monde vrai de Platon serait un monde faux ou non existant, un monde apparent où il ne faudrait pas vivre : l’apparence s’opposerait à l’apparent. L’inversion permuterait les contenus mais conserverait les valeurs, en particulier celle attribuée au vrai. L’apparence serait mise « en haut » parce qu’elle serait le « vrai monde vrai », de sorte que ce qu’elle mettrait en bas… ne serait qu’apparence. La présenter ainsi est pourtant nécessaire pour que l’inversion du platonisme relève de la métaphysique.
La lecture de Monique Dixsaut ne fait que confirmer la thèse selon laquelle le monde que Platon qualifierait d’apparence et de sans épaisseur est en réalité le vrai monde, et que son monde imaginaire reste comparable à cette pièce de monnaie sans effigie, qui, en réalité, n’est pas utile, puisqu’elle n’est que du métal sans valeur ; car nous ne pouvons cautionner l’existence de quelque chose que nous n’avons pas encore vu, et qu’une simple imagination servirait de caution pour valider son existence. C’est pour cette raison que F. Nietzsche (1991, p. 123) disait :
Ces vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des métaphores qui ont été usées et qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont perdu leur empreinte et qui entrent dès lors en considération, non plus comme pièces de monnaie, mais comme métal.
Cela prouve à suffisance que tous ceux qui ont toujours milité pour l’existence de ce monde inexistant ne sont en réalité que des décadents c’est-à-dire des malades. Autrement dit, pourquoi vouloir en découdre avec l’existence, alors que nous savons qu’il n’y a rien là-haut, et que Dieu avait été assassiné ? Pourquoi toute cette haine contre la vie ? Pourquoi vouloir toujours l’appréhender comme signe d’assombrissement ?
Tout ceci constitue ce que nous appelons nihilisme métaphysique, parce qu’il s’agit de la guerre contre la vie, de la haine et du mépris de la vie. C’est d’ailleurs tout le sens de notre interrogation sur le sens que l’on pourrait établir entre le dépassement et la création. Cela revient à poser la question suivante : comment la création de valeurs nouvelles peut-elle rendre possible l’élaboration d’une métaphysique de la vie ?
3. DU DÉPASSEMENT À L’ACCOMPLISSEMENT DE LA MÉTAPHYSIQUE
Si la volonté de vérité n’est rien d’autre que la dernière fumée d’une réalité inexistante, Nietzsche pense, que l’homme doit se surpasser ou se dépasser soi-même afin de mettre en place une nouvelle échelle des valeurs. Il s’agit bel et bien des valeurs de la vie, c’est-à-dire de la volonté de puissance, entendue comme
« un principe qui, comme la « vie », n’exclut ni ne restreint rien ; c’est une formule pour désigner des êtres vivants et en particulier des êtres humains qui, en tant que foyers de force vitale, déterminent par eux-mêmes les choses et les valeurs au lieu d’être déterminés par elles » (F. Nietzsche, 1993, II, p. 557).
Le projet nietzschéen du dépassement de soi-même, se donne à voir au travers du souci constant de vouloir réaffirmer sans cesse la grandeur du sensible, pour et par le devenir entendu comme l’axe et le pivot de la pensée métaphysique. Ainsi, se réalise le dépassement du dualisme, qui, à l’image d’un aigle qui volerait très haut dans un autre monde qui vaudrait bien mieux que celui-ci, et d’un serpent qui pourrait ramper sur ce monde-ci, seul existant et sans valeur. C’est dans ce sens que se donne à lire le coup d’envoi de tout le renversement métaphysique qui, au lieu de diviser le monde en deux, c’est-à-dire de parler d’un monde qui serait apparent et d’un autre qui serait parfait, célèbre l’existence d’un seul et unique monde, à savoir le monde de la vie. Autrement dit, le monde de la volonté de puissance, de celui qui agit et impose sa force active au réel, domine et transforme le réel et non celui-là qui assume passivement et accepte le réel tel qu’il est. C’est pour cela qu’il a besoin des compagnons, non pas pour être passif, mais plutôt pour se dépasser soi-même, tout en se réalisant eux-mêmes.
Dans cette perspective, se dépasser soi-même, c’est se prolonger, s’épanouir, se réaliser, s’enfanter et enfanter. Se dépasser soi-même, c’est ne plus suivre Dieu, puisqu’il n’existe plus, c’est renoncer aux tables de la loi, directement gravées par une force extérieure que l’on impose aux hommes. Le destin de l’homme ne se trouve plus, comme certains le croyaient, entre les mains d’un divin, d’une force extérieure qui dicterait notre conduite, mais bien plutôt entre les mains de l’homme lui-même, considéré comme un pont et un passage : c’est pour cela qu’il est appelé créateur. Comme nous pouvons le lire dans Ainsi parlait Zarathoustra, « j’ai besoin (…) de compagnons vivants – non de compagnons morts et de cadavres, que j’emporte avec moi ou que j’aille. (…) des compagnons vivants, qui me suivent où que j’aille, parce qu’ils veulent se suivre eux-mêmes » (F. Nietzsche, 1993, §. 7).
Le surpassement de soi-même s’entend ici comme l’acte à partir duquel s’opère en tout être humain, une espèce de métamorphose où l’on s’élève de l’inférieur vers le supérieur, et dont le mouvement n’est pas provoqué de l’extérieur, mais plutôt de l’intérieur même, c’est-à-dire à partir d’un principe interne de l’être. Avec la volonté de puissance, Nietzsche crée les conditions de la mise en place d’une nouvelle échelle des valeurs, car l’être est ici pensé comme expression du devenir, c’est-à-dire comme ce qui advient : « Imprimer au devenir le caractère de l’être – c’est la forme supérieure de la volonté de puissance (…) Dire que tout revient, c’est rapprocher au maximum le monde du devenir et celui de l’être : cime de la contemplation » (F. Nietzsche. 1995, I, p. 251).
Le dépassement de soi-même, compris comme élaboration d’une nouvelle métaphysique, se donne à voir à partir de la revalorisation du concept de vie, entendu comme volonté de puissance. En ce sens, c’est à partir de la vie et dans la vie que doit s’élaborer la philosophie comme expression même de la vie. Ce qui voudrait dire, en d’autres termes, que la notion de vie chez Nietzsche est inséparable de la notion de volonté de puissance, et qui dit volonté de puissance met en exergue ce qui veut vivre, ce qui favorise la vie. C’est ce qui justifie la naissance d’un nouveau type d’homme, c’est-à-dire la naissance d’un homme nouveau avec de nouvelles valeurs.
Conclusion
Nous voulons, au terme de notre travail, rappeler que la métaphysique est un concept qui fait preuve d’une histoire mouvementée et complexe, à telle enseigne qu’il n’est toujours pas aisé de répondre à la question liée à son statut. La mission que nous nous sommes assignée, c’était de répondre à un appel, c’est-à-dire à ce que nous avons qualifié de mot d’ordre nietzschéen. Il s’agit plus précisément, de ce que Nietzsche entend par métaphysique de la présence. Autrement dit, il est question de la philosophie de la vie, celle qui réhabilite l’homme, la terre, c’est-à-dire le concret. C’est l’interrogation sur ce qui est, sur l’être sous toutes ses formes, c’est-à-dire, sur l’être comme devenir. La vie, la seule et l’unique réalité, loin d’être jugée, humiliée et méprisée, mérite ici une attention particulière, car il s’agit de la vie en tant que volonté de puissance, en tant que création d’une nouvelle table des valeurs. Ainsi, se réalise enfin la réconciliation de l’homme avec lui-même. Il s’agit pour Nietzsche de rendre au monde ce qui lui appartient. La vraie vie, c’est celle de la présence, celle qui se présente à nous, c’est-à-dire la vie dans l’apparence comme valeur.
Références bibliographiques
AKA-EVY Jean-Luc, 2011, L’Appel du cosmos ou le pas de la réflexion, Brazzaville, Hemar, 266 p.
BALIBAR Etienne, 1994, Lieux et noms de la vérité, Paris, Éditions de l’Aube, 216 p.
DELEUZE Gilles, 1962, Nietzsche et la philosophie, Paris, P.U.F., 314 p.
DIXSAUT Monique, 2015, Platon-Nietzsche. L’autre manière de philosopher, Paris, Éditions Fayard, 360 p.
DIXSAUT Monique, 2012, Nietzsche. Par-delà les antinomies, Paris, Vrin, 480 p.
FAYE Jean-Pierre & COHEN HALIMI, Michèle, 2008, L’histoire cachée du nihilisme. Jacobi, Dostoïevski, Heidegger, Nietzsche, Paris, La Fabrique Éditions, 310 p.
GUERY François, 2015, Archéologie du nihilisme, De Dostoïevski aux djihadistes, Paris, Grasset & Fasquelle, 248 p.
GUERY François, 1999, Ainsi parla Zarathoustra (volonté, vérité, puissance – 9 chapitres du livre II), Paris, Ellipses, 79 p.
GUERY François, 1995, Heidegger rediscuté (Nature, technique et philosophie), Descartes & Cie, 155 p.
GRANIER Jean, 1997, Nietzsche, « Que sais-je ? » Paris, P.U.F., 6ème édition, 127 p.
GRANIER Jean, 1966, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris, Seuil, 643 p.
GREISCH Jean, 1988, Être et Langage, I, Introduction à l’ontologie. Le temps des fondations, Institut catholique de Paris, 385 p.
HAAR Michel ? 1993, Nietzsche et la métaphysique, Paris, Gallimard, 293 p.
HEIDEGGER Martin, 1953, Kant et le problème de la métaphysique, trad. fr, Alphonse de Waelhens et Walter Biemel, Paris, Gallimard, 302 p.
HEIDEGGER Martin, 1958, Essais et conférences, Trad. fr, André Préau, préface de Jean Beaufret, Paris, Gallimard, 349 p.
HEIDEGGER Martin, 1962, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. fr, Wolfgang Brokmeier, Paris, Gallimard, 461 p.
HEIDEGGER Martin, 1971, Nietzsche I, trad, fr, de Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 512 p.
HEIDEGGER Martin, 1971, Nietzsche II, trad, fr, de Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 402 p.
MATTEI Jean-François, 2005, Nietzsche et le temps des nihilismes, Paris, P.U.F., 225 p.
CREPON Marc et De LAUNAY Marc, 2012, Les configurations du nihilisme, Paris, Vrin, 232 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1993, Œuvres, Tome 1, pour la traduction française des textes du professeur Pütz, pour l’appareil critique et la révision des traductions par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Robert Laffont, 1365 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1993, Œuvres, Tome 2, pour la traduction française des textes du professeur Pütz, pour l’appareil critique et la révision des traductions par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Robert Laffont, 1750 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1995, La volonté de puissance, Tome 1. Texte établi par Friedrich Würzbach et traduit de l’Allemand par Geneviève Bianquis, Paris, Gallimard, 435 pages.
NIETZSCHE Friedrich, 1995, La volonté de puissance, tome 2. Texte établi par Friedrich Würzbach et traduit de l’Allemand par Geneviève Bianquis, Paris, Gallimard, 498 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1975, La philosophie à l’époque tragique des Grecs, Paris, Gallimard, 243 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1982, Fragments posthumes, Automne 1885-Automne 1887, trad. Julien Hervier, in Œuvres philosophiques complètes, Paris, Gallimard, 392 p.
NIETZSCHE, Friedrich, 1991, Le livre du philosophe, Présentation et traduction par Angèle Kremer-Marietti. Paris, GF Flammarion, 178 p.
NIETZSCHE Friedrich, 1994, Les philosophes préplatoniciens, textes établis, d’après les manuscrits, par paolo D’Ioro, présentés et annotés par Paolo D’Ioro et Francesco Fronterotta, trad. de l’allemand par Nathalie Ferrand, Paris, Édition l’éclat, 395 p.
PLATON, 1950, Œuvres complètes, Tome 1, traduction nouvelle et notes établies par Léon Robin avec la collaboration de Joseph Moreau, Paris, Gallimard, 1448 p.
PLATON, 1950, Œuvres complètes, Tome 2, traduction nouvelle et notes établies par Léon Robin avec la collaboration de Joseph Moreau, Paris, Gallimard, 1659 p.
WOTLING Patrick, 1995, Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, P.U.F., 386 p.
WOTLING Patrick, 1999, La pensée du sous-sol, Paris, Allia, 108 p.
WOTLING Patrick, 2008, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, 463 p.
WOTLING Patrick, 2009, Idées reçues, Nietzsche, Paris, Le cavalier bleu, 127 p.
WOTLING Patrick, 2013, Le vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipse, 87 p.
WOTLING Patrick, 2016, « Oui, l’homme fut un essai » : La philosophie de l’avenir selon Nietzsche, Paris, P.U.F., 324 p.
MARTIN HEIDEGGER ET NOTRE HUMANITÉ
SOLIDARITÉ ET SOUCI CHEZ MARTIN HEIDEGGER
Pascal Dieudonné ROY-EMA
Maître-Assistant, Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)
roypascal2007@yahoo.fr / royema@me.com
Résumé: On apprend, avec Heidegger, notamment dans son traité de 1927, que le monde est un réseau de relation : il est le sens. C’est dans ce périmètre que se construisent nos repères et nos références, et si nous pouvons partager repères et références, il faut reconnaître que chaque être humain en est possesseur. C’est ce que Jean-Luc Nancy nommera la singularité. Nous sommes donc invités à faire briller notre singularité dans un souci de l’autre, de notre monde et donc dans une existence solidaire, pour rester authentique en toutes circonstances. Dans le souci, il y a l’idée d’attention, de préoccupation, de sollicitude et cela peut être saisi comme une forme de solidarité: le souci comme ouverture à l’autre et son monde. Dans le souci donc, le Dasein se montre solidaire d’autrui et de son monde.
Mots-clés: ÊTRE, SOUCI, SOLIDARITÉ, DASEIN, ANGOISSE.
Abstract : We learn, with Heidegger, particulary in his treaty of 1927, that the world is a network of relation : it is the sense. It is in this perimeter that our marks and our references are built, and if we can share marks and references, it is necessary to recognize that every human being is an owner. It is what Jean-Luc Nancy will name the singularity. Thus we are invited to make shine our singularity in a concern of other, of our world and thus in a united existence, to remain authentic in any circumstances. In the concern, there is an idea of attention, concern, care and it can be considered as a kind of solidarity : the concern as opening to the other and his world. Therefore in the concern Dasein shows himelf united of other and his world.
Key words : BEING, CONCERN, SOLIDARITY, DASEIN, ANGUISH
Introduction
L’homme, existant dans le monde, est un être-été jeté dans celui-ci pour qu’il se réalise. Comme étant jeté dans le monde, il trouve d’autres hommes qui y vivent déjà. Non seulement il rencontre des hommes comme lui, mais il rencontre aussi des choses, des outils ou instruments qu’il utilise pour sa réalisation. L’homme découvre qu’il est un être-au-monde et, par ricochet, un être-avec-autrui de par sa nature. Autrement dit, il est appelé à vivre avec d’autres pour sa réalisation dans le monde où il est jeté par l’Être qui lui a donné d’être. L’être-là, qui est l’homme (M. Heidegger, 2001, p. 7 et 13), est ontologiquement un être-au-monde et un être-avec-autrui, un « Mit-sein ». Cet être est appelé à assister l’autre qu’il rencontre dans le monde qui l’angoisse. Et le souci est l’être du Dasein, puisqu’il consiste à ce que dans l’angoisse que procure l’être-au-monde, le Dasein puisse se transcender. Le souci est celui de l’être. Le “rien-et-le-nulle-part” du monde, comme tel, nous pousse à vivre pour que notre être ne se dérobe pas dans des futilités, renchérissait S. Mutumbo (2003, p. 1) de l’Institut Saint Jean Bosco Kansebula.
Le souci est celui du dépassement de notre être qui aspire toujours à un plus-être, puisqu’il est fini. Il y va de son être, d’être-en-avant-de-soi-même pour toujours vouloir un plus pour son être, aux dires de M. Heidegger (1927, p. 249). Et ainsi, il ne saurait oublier qu’il est toujours et avant tout un être-déjà-à… et un être-auprès-de …dans ce monde où il habite comme berger de l’être qu’il n’épuise pas, même s’il est le lieu de l’ouverture de ce dernier. D’où la place privilégiée qu’occupe l’être-là par rapport aux autres étants avec qui il partage l’existence. Cette place de choix révèle manifestement de la solidarité: solidarité avec lui-même, solidarité avec les autres étants et solidarité avec son monde. L’être-là a, pourrions-nous dire en d’autres termes, un souci de lui-même, un souci des autres étants voire donc un souci solidaire. En clair, le souci chez Heidegger emprunte les habits de la solidarité. Qu’en est-il exactement? Comment cela se manifeste-t-il?
Au cours de notre réflexion, nous passerons en revue la notion de souci chez Martin Heidegger, le sens, les enjeux et la valeur de la solidarité, en tirant la conséquence de l’existence d’une forme de souci solidaire.
1. LE SOUCI COMME ÊTRE DU DASEIN CHEZ MARTIN HEIDEGGER
Les divers moments constitutifs de l’être-au-monde montrent une multiplicité qui ne doit pas troubler la vue de l’unité du Dasein. C’est pourquoi nous devons nous demander comment la totalité structurelle de ce dernier peut être une unité: « Comment déterminer existentialement et ontologiquement l’unité de la totalité des structures d’être du Dasein? » (M. Heidegger, 1986, p. 229). La question se pose avec d’autant plus d’acuité que l’être du Dasein est jeté dans le monde, projeté devant lui-même pour être ce qu’il peut-être. Dans cet état de déréliction, de complet abandon, il sent qu’il y va de son être, de son avoir- à-être.
Voyons donc le chemin à suivre pour trouver le principe unificateur de ce tout. Cette unification est nécessaire, parce que sans elle, l’analytique existentiale serait descriptive, non ontologique, et offrirait uniquement un échantillonnage de différentes sortes de moments existentiels. L’être du Dasein éclaterait dans une multiplicité chaotique de modes d’être. Aucun lien ne serait possible entre la quotidienneté du Dasein et son fondement ontologique:
L’unité de la structure totale ne peut être phénoménalement atteinte par un agencement artificiel de ses éléments. Celui-ci présupposerait un plan de construction. Or, l’être du Dasein est être qui porte ontologiquement et comme tel la totalité des structures de Dasein, ne devient accessible à notre vue que lorsque nous reconnaissons dans cette totalité un phénomène unitaire et originel, phénomène qui régit toujours déjà cette totalité de manière à fonder ontologiquement la possibilité de chacun de ces moments à l’intérieur de la structure totale (M. Heidegger, 1986, p. 230).
Où donc trouver la source de l’unité du Dasein ? Nous savons que le Dasein ek-siste en se transportant au-devant de lui-même. Il passe, pour ainsi dire, à travers lui-même en s’ouvrant. Cette ouverture qui le constitue – ne pourrions-nous pas dire qui le destitue ? – de part en part et d’où il tombe depuis toujours à l’intérieur de lui-même dans le monde, dévoile l’être du Dasein comme “souci” (Sorge). Il s’agit d’un phénomène ontologique. Gardons-nous donc de voir dans le souci un état d’âme ou un phénomène tel que la volonté, le souhait, la tendance, la pulsion. La dimension existentiale du souci permettra à l’analytique de passer du stade préparatoire au problème du fondement de l’être en général, car c’est le souci qui relie tous les moments de l’ek-sistence du Dasein.
Il est intéressant de saisir, ici, la nature du rapport entre le souci et la conception heideggerienne de l’être. Être, pour Heidegger, c’est toujours être quelque chose, c’est pouvoir être, c’est pouvoir être de l’étant. Ce sens actif de l’être n’a aucune relation avec l’acte d’être, tel qu’un Saint Thomas, selon J.-M. Goglin (2013, p. 6), l’a élaboré. Pour ce dernier, l’Acte exprime la plénitude de l’Être qui est toujours l’Être de l’Être. Cela signifie que l’Être n’a besoin de rien d’autre que lui pour être. Si la création n’est pas nécessaire à Dieu, c’est parce que l’être des étants créés n’ajoute ni n’enlève rien à l’Être. Il n’en est pas de même pour l’Être actif de Heidegger. Le Sein ne s’appartient pas, il est toujours à l’étant. C’est la raison pour laquelle le souci s’inscrit dans l’être du Dasein comme ce qui le constitue, c’est-à-dire, comme ce qui se destitue de soi pour se remettre au monde. Le souci nous permettra donc de savoir ce qu’est l’être du Dasein.
Aussi, l’angoisse révèle-t-elle au Dasein son être-au-monde et ses composantes: existentialité, facticité et déchéance. Ces caractères ontologiques fondamentaux forment un tout. Mais quant à savoir comment cette totalité se lie, cela, l’angoisse ne nous le dévoile pas. L’être du Dasein ek-siste, il se jette en avant de lui-même. Tout son être réside dans ce mouvement. Cette structure ontologique, Heidegger (1986, p. 241) la nomme: « l’être-en avant-de-soi-même ». Elle caractérise le Dasein comme toujours déjà jeté dans le monde. Son ek-sistence est « factice » en ce sens qu’elle se déroule toujours dans le monde. Ce déroulement est un dévalement, une déchéance, une chute. Existentialité, facticité et déchéance forment donc bien une unité qui pourrait ainsi se formuler: « Être-déjà-a (au monde)-en- avant-de-soi-même-comme-être-auprès-de » (M. Heidegger, 1986, p. 242). Cet être répond précisément à la conception que nous nous faisons du « souci ».
N’entendons pas le souci de manière ontique au sens d’«accablement». Il est purement ontologique. C’est l’être-au-monde qui est souci. Telle est la raison pour laquelle nous avons interprété l’être-auprès-de comme « préoccupation » et l’être-avec-autrui comme « sollicitude ». Cela nous permet de comprendre que le souci n’est pas coupé de toute facticité. Il englobe l’ensemble des déterminations existentiales qui articulent la totalité du Dasein. Celui-ci est donc intimement concerné par le souci. C’est pourquoi parler de souci de soi est une tautologie; car être soi, c’est être en-avant-de-soi, et être-en-avant-de-soi, voilà la définition du souci. Le souci précède tout comportement, toute situation. On ne saurait le ramener à un acte particulier, ou le réduire à une tendance psychologique telle que le souhait, l’impulsion ou l’inclination. Tous ces phénomènes, loin d’expliquer le souci, se fondent au contraire sur lui, car il leur est antérieur. Ainsi, la structure unitaire du souci transparaît dans le phénomène du vouloir comme fondement de ce dernier. Vouloir, c’est toujours vouloir quelque chose, donc anticiper, se projeter, se jeter en avant. De même, penser, c’est penser quelque chose, agir ; c’est faire quelque chose. Le Dasein, en lui-même, dans son ipséité, n’est jamais donné séparément comme une substance fixe. Il se dépasse toujours soi-même. « Je » est sans cesse mis en « jeu ». Son unité́ est dynamique et non statique, passive. C’est l’unité́ d’une totalité articulée. En résumé, nous pouvons dire :
Le terme du souci désigne un phénomène ontologico-existential et fondamental dont la structure, pourtant, n’est pas simple. L’unité ontologique originelle de cette structure ne saurait se réduire à un élément ontique premier, tout comme l’être du Dasein (M. Heidegger, 1986, p. 246).
Cette absence de simplicité de « l’être en général » est révélatrice de la spécificité de la pensée heideggérienne: l’Être n’est pas une unité simple, mais une totalité articulée. Ainsi, Heidegger s’inscrit en faux contre une philosophie de l’Être pour laquelle l’absolue simplicité de celui-ci est la garantie de son immuabilité et de sa transcendance : c’est parce qu’il est Un que l’Être demeure le Même. Il ne peut être autre que soi. Aucune potentialité ne se trouve en lui parce qu’il est plénitude d’être. L’Être peut donc régner au-dessus des étants dont l’existence est « participation » et non « déroulement » catastrophique. Il n’en est pas ainsi pour l’auteur de Sein und Zeit. L’équivocité de l’Être entraîne son glissement dans le multiple. Cette déchéance se produit à l’intérieur de soi. Au niveau du Dasein, l’être s’articule dans une totalité structurée sur le mode de l’« aller-en-avant-de-soi ». Dans le Dasein, l’être se trouve là, comme à un moment de son dévalement, avant l’anéantissement final.
« Le souci est l’être du Dasein » (M. Heidegger, 1986, p. 248). Tel est l’acquis majeur des analyses qui précèdent. Il s’agissait de dégager le fondement ontologique de l’étant que nous sommes et que nous avons nommé « Dasein ». Heidegger a évité, avec soin, de partir de la définition traditionnelle de l’homme, car ce dernier n’est pas une unité substantielle, mais une totalité articulable dont les moments constitutifs sont reliés ontologiquement par le souci. Le souci n’a pas le sens ontique de tracas, d’ennui, avons-nous dit. L’auteur de Sein und Zeit voit un témoignage pré-ontologique du caractère originellement existential du souci dans une ancienne fable (M. Heidegger, 1986, pp. 247-248) qu’il cite en son entier. Nous ne la reproduisons pas. Ce qu’il importe de retenir, c’est que Heidegger vise à étayer sa thèse d’un exemple poétique témoignant que le souci est bien l’essence de l’homme, et qu’il exprime son passage temporel dans le monde: « La perfection de l’homme, c’est-à-dire, sa capacité de devenir ce qu’il peut être en raison de sa liberté pour ses possibilités inaliénables (de son pro-jet), est l’œuvre du souci » (M. Heidegger, 1986, p. 249). Heidegger fait du souci un véritable « a priori ontologique », constitutif de l’être du Dasein.
Dans le cours de sa réflexion, il rappelle que l’interprétation ontologique du Dasein comme souci vise, non pas l’élaboration d’une anthropologie philosophique, mais la préparation de l’ontologie fondamentale qui s’interroge sur le sens de l’être. Si à cette structure, qui articule les trois existentiaux fondamentaux en un phénomène unitaire, Heidegger donne le nom de souci (Sorge), il note la volonté de dépouiller ce terme de toute connotation existentielle et morale et de le prendre exclusivement en un sens ontologique et existential.
Ce choix n’est cependant pas arbitraire, puisqu’il peut alléguer un “témoignage préontologique” qui atteste que le Dasein se comprend lui-même comme souci, en dehors de toute interprétation théorique. Ce témoignage, Heidegger le trouve dans une œuvre poétique, une fable d’Hygin qui avait retenu l’attention de Herder et de Goethe, et où non seulement le souci est envisagé comme ce qui possède l’homme toute sa vie durant, mais où il apparaît aussi en connexion avec la conception qui voit dans l’homme un composé de matière (de terre) et d’esprit. De plus, le latin cura présente le même double sens de souci et de soin que l’allemand Sorge, et Heidegger y voit la désignation de la constitution “une” de la structure essentiellement double du projet jeté.
À la lumière de ce témoignage préontologique, la définition traditionnelle de l’homme comme “animal rationale” apparaît comme non-original, puisqu’elle conçoit l’homme comme un composé de sensible et d’intelligible et non pas comme un « tout ». Heidegger entreprend, en effet, de montrer dans le §41 que le souci est ontologiquement antérieur au vouloir, au souhait, à l’impulsion et au penchant, c’est-à-dire à ces pulsions que l’on considère comme caractéristiques du vivant en général. En affirmant que ce n’est pas sur la base d’une considération de ce qui est propre à la vie que l’on pourra comprendre le Dasein et son souci, Heidegger rompt avec la « philosophie de la vie » qui caractérise la tendance la plus marquée de la pensée allemande depuis le romantisme.
Dans son sens ordinaire, ce mot de Souci se réfère à la précarité de la vie humaine et aux incertitudes de l’avenir. Chez Heidegger, il est lié inséparablement à toute pensée de l’avenir ; alors il faut l’aborder en lui donnant le sens général et vague de présence continuellement penchée sur l’avenir. Die Sorge prend, chez Heidegger, une tonalité particulière ; il ne peut être compris qu’en liaison avec l’existence: « Le mot existence nomme l’être de cet étant qui se tient ententif à l’ouverture de l’être qu’il soutient » (M. Heidegger, 1968, p. 34). Ce soutenir ainsi ressenti prend le nom de Souci.
Ce serait dans la préoccupation inquiète du chrétien, chez saint Augustin, qu’étudie Heidegger dans les années 1920, qu’apparaît le thème du « Souci », thème qui sera progressivement amplifié et étendu, jusqu’à devenir la détermination essentielle et le fondement du Dasein. Le souci est l’élan qui procure au monde sa significativité (A. Larivée et A. Leduc, 2001, p. 30-50).
Après l’analyse du souci chez Martin Heidegger, passons à la deuxième séqence de notre réflexion, consacrée au concept de solidarité.
2. LA SOLIDARITÉ : SENS, ENJEUX ET VALEUR
2.1. Le sens de la solidarité
Dans son acception générale, la solidarité caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent l’exigence fondamentale d’assister d’autres personnes et réciproquement. La solidarité se distingue de l’altruisme : l’altruiste peut souhaiter aider autrui sans pour autant se sentir concerné par ce qui lui arrive, et inversement, on peut se rendre solidaire d’autrui simplement par intérêt bien compris (attente d’une réciprocité) et non par altruisme.
Très souvent, on présente sous cette forme positive des formes de solidarité plus ambiguë : une forme d’échange mutuel où chaque membre se rend solidaire des autres, parce que les autres se rendent solidaires de lui. C’est donc un calcul (économique) et non une démarche généreuse (voire coopération) ; une forme de solidarité imposée où chaque membre se trouve obligé d’adhérer au groupe, sous peine de perdre certains bénéfices (frais de copropriété), voire sous la menace de sanctions (partie socialisée du salaire, impôts, conscription).
Sociologiquement, la notion de « solidarité » a été étudiée par Charles Gide à la fin du XIXè siècle ; théoricien de l’École de Nîmes, mouvement coopératif français, il a développé les idées de coopération émancipatrice à partir de 1886. Puis Émile Durkheim, dans De la division du travail social (2004, 416 p.), a repris et développé la notion de solidarité sociale en tant que lien moral entre individus d’un groupe ou d’une communauté. Selon lui, pour qu’une société existe, il faut que ses membres éprouvent de la solidarité les uns envers les autres. Elle est liée également à la conscience collective qui fait que tout manquement et crime vis-à-vis de la communauté suscite l’indignation et la réaction de ses membres.
Avec Durkheim, le lien social n’est pas le résultat d’un contrat social, c’est-à-dire de décisions individuelles créant une société politique comme le pensait Jean-Jacques Rousseau. Se mettre d’accord suppose déjà, en effet, l’existence de règles communes (une langue, des conventions). E. Durkheim (2004, p. 56) reprend plutôt l’analyse d’Auguste Comte qui voit dans la division du travail autre chose qu’un phénomène purement économique : c’est « la condition la plus essentielle de la vie sociale », puisque « la répartition continue des différents travaux humains » oblige les individus à participer à une oeuvre commune, la solidarité sociale. Il développe les concepts de « solidarité mécanique » (Idem, p. 73) et de « solidarité organique » (Idem, p. 106). Une société donnant lieu à de la solidarité mécanique tient sa cohésion de l’homogénéité de ses membres, qui se sentent connectés par un travail, une éducation, une religion, un mode de vie similaires. La solidarité mécanique se produit normalement dans les sociétés traditionnelles de petite taille. La solidarité organique provient, quant à elle, de l’interdépendance qui vient de la spécialisation du travail et des complémentarités entre personnes, que provoquent les sociétés modernes, industrielles.
La solidarité est l’adhésion circonstancielle à la cause ou à l’entreprise des autres. Le terme est généralement employé pour désigner une action généreuse ou bien – intentionnée. De par son étymologie, le mot désigne un comportement in-solidum, c’est-à-dire que les destins d’au moins deux personnes se joignent. Le terme de « solidarité » dérive, en effet, du latin solidus (massif) et de l’expression latine in-solidum qui signifie « pour le tout ». Ainsi, être solidaire n’est pas seulement apporter son soutien, mais aussi c’est s’engager avec celui ou celle à qui on apporte sa solidarité.
Au sens plus basique, la solidarité est exercée sans discrimination de sexe, de race, de nationalité, de religion ou d’affiliation politique. La solidarité a pour seule finalité l’être humain en besoin. De toute façon, l’usage du terme s’est un peu dénaturé face à l’abus du discours politique et aussi à cause du soi-disant marketing solidaire. La véritable solidarité consiste à aider autrui sans recevoir quoi que ce soit en échange et sans que personne ne le sache. Être solidaire est, dans sa substance, être désintéressé (sans avoir des intentions cachées). La solidarité n’a aucun sens sans la conviction de justice et d’égalité. Elle est une exigence sociale naturelle. C’est le lien qui unit les êtres humains entre eux, dans un réseau de relations qui est devenu planétaire.
2.2. Enjeux et valeur de la solidarité
Dans notre monde, le lien social s’est rompu et des hommes et des femmes se retrouvent démunis, en difficultés, dans la solitude, la maladie, etc. Pour répondre à leurs besoins, des hommes et des femmes sont acteurs dans des organismes caritatifs, confessionnels ou non. Ces personnes et ces organismes, qui s’engagent résolument pour la défense des droits de l’Homme, pour le développement et contre le dénuement, pour la justice et la paix, œuvrent pour une culture de la vie bonne. Chacun doit se tailler une image de figure de proue de ce combat, pour le bonheur des plus fragiles et des “déraillés” du train du développement. La solidarité s’apparente alors à la traduction d’une exigence morale de l’amour du prochain. Elle est aujourd’hui beaucoup plus visible dans ce qu’on qualifie d’action sociale.
L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou règlementaires, et par des actions visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie et à s’adapter au milieu social environnant. L’action sociale consiste à apporter de l’assistance et de l’aide aux plus misérables, aux infortunés de la quotidienneté, en raison d’un droit à la solidarité nationale ou locale ; le plus généralement, en direction des familles et de leurs enfants. L’action sociale, voire l’acte humanitaire prend son essor dans un contexte particulier : celui d’une crise de confiance plus générale vis-à-vis du politique, et en même temps de crise des solidarités. La méfiance à l’égard du politique est, pour une part, à rapprocher de la défiance à l’égard des États, au moment d’ailleurs où les social-démocraties et l’Etat-providence sont eux-mêmes mis en question.
La crise des solidarités, quant à elle, apparaît tandis que la montée des exclusions, à “l’intérieur” de la société et l’élargissement du fossé entre le Nord et le Sud, à “l’extérieur”, sollicitent des interventions humanitaires. En fait, il y a un décalage énorme entre le sentiment de vivre, à un niveau mondial, l’accélération de l’internationalisation du monde et la nécessité pour l’individu de s’inscrire dans le cadre d’une collectivité qui le rassure. Dans ce contexte propice aux contradictions, l’action humanitaire est elle-même porteuse d’ambiguïtés ou d’ambivalence. Ainsi, par exemple, le principe émergeant selon lequel il n’y a pas de revendication juridique égalitaire que partagée par l’ensemble de la « terre-patrie »[3], peut conférer à l’action humanitaire une portée éthique. Et à l’approche en terme de droit, se juxtapose une approche en terme de devoir ; l’individu étant responsable de tous les autres hommes.
Il ne s’agit pas seulement de la « forme décadente de la mauvaise conscience » (O. Mongin, 1994/10, N°37), mais aussi ou surtout de l’apparition de la revendication de dignité. Une telle démarche pourrait être à la fois politique, dépassant l’individualisme, et a-politique, parce qu’elle prétendrait refuser le politique et toute médiation du politique. En même temps, ces démarches humanitaires interviennent dans des situations de dénonciation des exactions de certaines officines politiques. Il serait souhaitable que, face aux enjeux planétaires qui s’amplifient, la solidarité compationnelle laisse place à une solidarité consciente au sein de groupes qui se sentent moralement obliges, car unis par une même destinée. Et J-P. Sartre (1976, p. 620) d’ajouter : « Toute aventure, quoique singulière qu’elle paraisse, engage l’humanité toute entire ».
Il y a sans doute plusieurs formes de solidarité renvoyant toutes à la reconnaissance de chaque humain en tant qu’humain dans un cadre familial, étatique, international ou mondial. L’idée sous-jacente à ces formes est celle du souci de l’autre logé à la même enseigne que soi, cet autre lié par un même destin à porter, une même dette à payer, un même mal à affronter, un même risque à prendre ensemble. Mais la notion est bien complexe et connaît un regain d’intérêt depuis le milieu du 19ème siècle. La solidarité se situe dans le domaine de l’action et des relations humaines. Elle est d’ordre éthique, bien plus que politique : c’est par sa dimension sociale qu’elle apparaît au grand jour, dans le vivre-ensemble. Elle concerne tout aussi bien la vie biologique que la vie morale et sociale. En ce sens, “agir par solidarité” est une manière d’humaniser la vie dans un monde de dette, de don, de distribution et d’aide : un monde d’inquiétude grandissante pour les plus démunis.
S’il en est ainsi, la reconnaissance de chaque humain – saisi comme une fin en soi – semblable à un autre et non pas comme une bête de somme, un objet ou une marchandise, est d’autant plus difficile que les regards qui imaginent et conçoivent des rapports entre humains d’horizons divers n’admettent pas la réciprocité dans la relation. Il y a, par exemple, ceux qui aident d’un côté et de l’autre, ceux qui sont assistés. C’est par ces mots que se présentent à nous un ordre mondial éloigné de la beauté et harmonie cosmique ou de la concorde sociale entre humains, que les Grecs, dans leur philosophie et en leur temps, avaient pu penser. Ici, dans un tel ordre qui se construit sous nos yeux, il pourrait s’agir de « déséquilibre » (T. Piketty, 2013, p. 13) et « d’inégalité » (L. Porras, 2015, p. 26). Il y a, en effet, déséquilibre quand, pour un même contexte ou pour une même chose, nous avons deux mesures distinctes.
Mais qui dit la mesure ? ou qui la donne ? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le côté de la balance qui pèse lourd, celui de la quantité, pourrait être celui qui représente les pays endettés, pauvres, en développement. C’est le plateau du grand nombre. Ces pays où la politique est instable voire chaotique, où les droits humains, dans leur effectivité, sont généralement loin d’être respectés, où la précarité de la vie humaine est monnaie courante. Le plateau de la balance qui domine et tend vers le haut, notamment par sa légèreté et certainement par sa qualité de vie, est celui qui représente les pays industrialisés et dits développés. L’agir solidaire, dans notre ordre national, bien que déséquilibré, est celui qui, d’emblée, pose les humains sur un même plateau avec la finitude et la vulnérabilité de chacun d’eux, quelles que soient leurs appartenances et provenances.
Quant à l’ordre mondial inégal, il se fonde sur l’idée de répartition des biens matériels et des maux. Les pays riches et les pays pauvres se retrouvent face à face dans un tel ordre, dans des mondes différents, plus ou moins cloisonnés, comme si les humains, rejetés dans leurs différences (culturelles, linguistiques, politiques, religieuses…), ne pouvaient entretenir de relations, entre eux, que par accident. Les frontières, d’un pays à l’autre et, surtout, quand elles doivent être franchies à partir des pays “pauvres” vers les pays “riches” sont pensées, aujourd’hui, comme des barrières de sécurité mettant à mal le droit fondamental de l’être humain à circuler librement.
Or, il n’y a de solidarité que dans le lien qui dit le partage des biens et des maux. Et le partage n’est pas la répartition quantitative de possessions, d’avoirs ou de leur manque. Il faut le concevoir comme le lot commun qui fonde chaque différence, dans sa particularité. Partager n’est donc pas prendre part à une répartition, à une distribution ou re-distribution d’avoirs, mais il consiste à assumer ensemble, comme une charge symbolique, un lot commun ou une “faveur divine” (théia moïra), au sens platonicien du terme. En clair, c’est donner juste pour aider, consoler et apaiser ; aider autrui à se relever et à reprendre la route. Il faut supposer, à titre d’hypothèse de travail, que cette faveur divine ne soit pas seulement exclusive, qu’elle sommeille en chacun de nous.
Prenons l’exemple du personnage de Socrate. C’est, sans doute, la prise en compte d’une telle charge qui permet à Socrate de s’ingérer dans les affaires humaines, d’être possédé par son daimonion. Ce “demon”, à vrai dire, est ce génie qui pousse le philosophe à être un homme vivant, à parcourir les ruelles de sa cité, à prendre sur soi les questions que chacun se pose, à interroger chacun, riche ou pauvre, faible ou puissant, en vue de dire le juste et le vrai, le bien et le beau, ces idées capables de lier la population d’une cité: maîtres, esclaves, métèques, femmes et enfants. En ce sens, on pourrait concevoir l’interrogation socratique comme un moment de solidarité, non seulement intellectuelle, mais aussi agissante, car “faire accoucher les esprits”, comme le montre la méthode socratique, c’est aussi éduquer, aider chacun à se prendre en charge intellectuellement et moralement, à vivre en accord avec ses propres aspirations, et d’abord faire prendre conscience de ces aspirations. Socrate apprend à ses contemporains, vivant dans la cité d’Athènes, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, à faire la différence entre être et avoir. Le partage des connaissances aide donc à combattre l’ignorance, mais encore à transformer les individus qui y prennent part. C’est en cela qu’il peut être conçu comme une solidarité agissante. Après Socrate, cette manière de philosopher ne disparaît pas. Dans l’Académie de Platon et dans les écoles philosophiques de l’antiquité, à partir du quatrième siècle, la philia est ce lien qui unit, par exemple, maîtres et disciples, et engage la connaissance théorique de même que tout l’être.
Penser avec Socrate, « philosophe de la vie »[4], suivre son héritage, est un risque à prendre ensemble et qui nous montre en quel sens être solidaire, c’est un mal nécessaire dans l’ordre de la pensée et de l’action. En un sens, Socrate n’est nullement solidaire de la pensée des sophistes, comme le montrent les dialogues, et pourtant, n’est-ce pas lui qui les “aide” à se retrouver eux-mêmes, parce qu’ils entrent en conflit au cœur du « dialogue »[5] ? Aide et dialogue, voilà donc des mots qui, aujourd’hui encore, font partie du vocabulaire qui permet de penser la solidarité. Solidarité comme aide matérielle et dialogique. Solidarité agissante qui panse les blessures, cajole les plus petits, soulage les éplorés, console les orphelins, redonne espoir aux malades, dessine un meilleur avenir éducatif et une véritable réinsertion professionnelle.
Si la solidarité est un lien humain d’ordre éthique et non pas juridique, politique ou économique, l’agir solidaire est comparable à ce que P. Ricoeur (2005, p. 373) appelle « donner quelque chose de soi en donnant une simple chose ». Pour employer une métaphore, la solidarité est le fait pour une main de laver l’autre main. Seules deux mains, parce qu’elles appartiennent au même corps, peuvent se laver ensemble[6]. D’un autre point de vue, la solidarité est, à l’échelle mondiale, mais aussi continentale – en prenant en compte l’Afrique – l’ensemble « des mains rassemblées autour de la jarre trouée »[7]. Chacun, en prêtant sa main, donne une partie de sa force physique et spirituelle, son énergie et son attention au soutien de la communauté en détresse, symbolique de la jarre trouée, dans le sillage des réflexions de Tanella Boni[8].
La solidarité n’a pas pour symbole, comme on a tendance à le penser aujourd’hui, la main qui donne, parce qu’il existe des mains tendues. Cette manière de penser le lien entre riches et pauvres crée la dette et la dépendance. Or la solidarité nous pousse à aller au–delà des schémas qui entérinent les inégalités dans le monde et nous orientent vers une notion du partage difficile à penser dans le cadre des sociétés néo-libérales, face à d’autres qui cherchent leur place sur l’échiquier mondial. Ainsi s’inscrit la solidarité dans l’ordre de la construction d’une humanité libre et heureuse dans un monde habitable. Mais ce partage solidaire ne s’effectue que de proche en proche, d’individu à individu, même si d’un individu à l’autre, du point de vue géographique, la distance peut être incommensurable. L’ordre du monde dont nous parlons, avec ses inégalités flagrantes, ne peut disparaître sous l’effet d’une baguette magique, à cause de quelques actions de solidarité. Il s’agit simplement d’établir le lien avec les plus démunis, là où c’est possible, à un niveau local, d’un lieu à un autre lieu où la vie est menacée de disparaître ou mérite d’être améliorée.
« Tout ce que nous faisons a des répercussions sur le monde. Chacune des pensées que nous exprimons produit un effet. Albert Einstein affirmait qu'”une fois qu’on a formulé une pensée, on ne peut plus la rattraper” ». (A. Grun, 2012, p. 18). Elle se déploie dans les esprits et, par voie de conséquence, dans la société toute entière. Même nos décisions quotidiennes agissent sur notre entourage. Si nous choisissons la joie ou le déplaisir, nous ne serons pas les seuls concernés. Notre choix se communiquera aux autres et, à travers eux, au monde entier. Voilà pourquoi, par nos décisions quotidiennes – qu’il s’agisse d’actions, de pensées ou de sentiments – nous engageons notre responsabilité à l’égard de nous-mêmes et du monde. Cela signifie aussi que par nos décisions, nous produisons un effet sur notre monde. Nos pensées, nos sentiments, nos œuvres, notre rayonnement, tout cela agit. Dès lors, il n’est pas indifférent que nous soyons guidés par des pensées agressives et destructrices ou que nous tâchions d’être en accord avec nous-mêmes.
Par ce que nous faisons, par ce que nous sommes, nous creusons un sillon en ce monde. Nos actes et nos pensées nous mettent toujours en rapport avec d’autres. Il est de notre devoir de rendre ce monde plus humain et plus aimant. C’est déjà ce que disait Sophocle[9] dans sa tragédie Antigone, où il rappelait les hommes à leur responsabilité: je ne suis pas née pour haïr, mais pour aimer. Telle est l’alternative. Si nous choisissons l’amour, nous ferons du bien aux autres. Si nous optons pour la haine, nous engendrerons les désastres. Dans ce monde en pleins bouleversements, dans lequel nous sommes entrés, l’exacerbation des rivalités peut conduire à de nouvelles régressions aussi terribles que celles de la première moitié du XXè siècle. Pourtant cet enchaînement n’est pas fatal. Derrière la face sombre de la mondialisation, qui s’identifie à une globalisation financière, elle-même entrée en crise sous le poids de sa propre démesure, il existe une autre approche de la mondialité centrée sur la conscience de cette communauté de destin qui lie l’humanité, pour le pire et pour le meilleur. Et ce destin se joue autant à l’échelle de nos quartiers qu’à celle de notre planète.
Alors la seule cause qui vaille, la seule qui ne soit pas destructrice ou justificatrice de crimes, de domination, ou d’exploitation d’autres humains, c’est la Cause même de l’Humanité, ce nouvel horizon de toute politique d’avenir digne de ce nom, à laquelle il est essentiel que nos États puissent apporter leurs contributions. Pour y parvenir, nous devons nous tourner vers l’éros, la force de vie, la créativité du nouveau monde en gestation !
L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie également l’invincible espoir. Ce qui reste vrai, à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices commises ou subies, c’est qu’il faut faire un large crédit à la nature humaine ; c’est qu’on se condamne soi-même à ne pas comprendre l’humanité, si on n’a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables. « Chacun de nous peut changer le monde. Même s’il n’a aucun pouvoir, même s’il n’a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde », écrivait Václav Havel quelques semaines après la chute du Mur de Berlin, le 16 décembre 1989. Et quand il a de grands moyens, pouvons-nous ajouter, alors il peut des miracles.
La solidarité, c’est ce qui a permis à un enfant orphelin de père, élevé par une mère pauvre, sourde et illettrée, de devenir prix Nobel de littérature. Il est né, dans le département de Constantine, en Algérie. Il s’appelait Albert Camus et, après avoir reçu son prix, il écrivit en ces termes à son vieil instituteur : « Ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, sans votre exemple, rien de tout cela ne me serait arrive ». (A. Camus, 1994, p. 108).
Le philosophe et mathématicien Blaise Pascal est aussi le produit de la solidarité, cette forme d’égalité des chances accordée aux plus démunis. Orphelin de mère à trois ans, c’est ce qui permit à son père d’assurer une éducation convenable à lui et à ses deux sœurs. Élevé dans une solidarité sociale active, Blaise Pascal manifesta, dès qu’il fut en âge de parler, un talent extraordinaire. À 11 ans, il compose un traité des sons, à 16 ans, un essai sur les coniques, et invente la machine arithmétique à calculer à 19 ans. Agir ainsi pour l’égalité des chances, avoir le souci de l’autre et de notre monde, au sens heideggérien, c’est s’ouvrir à la justice sociale afin de permettre l’émergence de centaines et de milliers d’Albert Camus et de Blaise Pascal dans le monde. Avoir le souci de l’autre, ce n’est pas l’assistanat inactif, c’est la solidarité productiviste, c’est le coup de pouce qui permet aux plus fragiles, aux démunis de rebondir et de retrouver de l’élan d’autonomie.
Derrière la solidarité, il y a l’idée de souci, de préoccupation. L’être solidaire est donc vrai dans les actions ; ce qui l’ouvre aux autres et sans concession avec les besoins et les misères. C’est cette corrélation entre le souci et la solidarité qu’il s’agit, à présent, d’analyser.
3. LE SOUCI COMME UNE FORME DE SOLIDARITÉ
Il nous semble que l’ontologie heideggerienne n’a cessé d’être guidée par une attention de plus en plus rigoureuse aux structures profondes de la phénoménalité. En particulier, lorsqu’il insiste sur la coïncidence de la manifestation de l’Être avec son occultation, sur sa différence radicale, mais aussi sur sa solidarité indépassable avec l’étant, Heidegger s’appuie, comme en témoigne l’usage qu’il fait alors des métaphores visuelles, sur le paradoxe de l’indivisibilité du visible et de l’invisible, qui régit tout phénomène.
Le Dasein est donc toujours implicitement le « là » de l’Ouvert, de la Lichtung, de cette éclaircie ou cette « allégie », pour reprendre une traduction de François Fédier, ordonnée à une dimension chaotique retirée, dans laquelle les étants, les phénomènes, sans raison – « poussés à rien », dit parfois Heidegger, entrent en présence, à chaque fois seulement, pour un temps. Il s’ouvre donc à la « dispensation de l’être » en tant qu’elle est comme un enfant qui joue, dit Heidegger (1983, p. 268), dans le Principe de raison, et qui joue « sans pourquoi », qui « joue parce qu’il joue ». En s’ouvrant ainsi au monde, le Dasein s’arrache au point de vue étroit de la vie oeuvrant exclusivement à son auto-conservation, tournant dans son propre cercle, et ne rencontrant donc l’étant que dans la perspective exclusive de l’usage qu’il en fait. Il s’ouvre au règne incommensurable et inutile de ce qui se déploie sans raison et se dépense à fond perdu ; de ce qui épuise son sens à « être ».
Les anticipations de la perception ainsi réinterprétées dans la direction que suggère Heidegger, dans Qu’est-ce qu’une chose ?[10] nous donnent la clef de l’essence du Begegnenlassen, c’est-à-dire de la Weltbildung. Elles exhibent donc les conditions de possibilité de l’ouverture du Dasein à la manifesteté de l’étant dans son ensemble et comme tel. Or, cela signifie qu’elles exhibent – car c’est la même chose – le sens originel de la vérité entendue comme dévoilement, c’est-à-dire alèthéia, interprétée par Heidegger comme Unverborgenheit. La Weltbildung relève bien de l’a priori, du transcendantal, mais elle ne doit donc pas être comprise en un sens idéaliste et comme quelque chose de subjectif. Comprise à partir des anticipations de la perception, et donc de l’Unverborgenheit, elle consiste à dépasser l’étant vers son être, mais de manière à le regagner et à lui laisser alors faire encontre, comme tel, ou en tant qu’il est, c’est-à-dire du point de vue excentrique de l’être (et il faudrait montrer qu’elle porte l’essence originelle du langage comme pure nomination, antérieure à l’énonciation).
La Weltbildung n’est donc rien d’autre qu’une ouverture à la différence ontologique. Sa fonction est, en effet, de rendre possible une manifestation de l’étant comme étant, de l’on e on, ou encore de l’ens qua ens. Or, prendre en vue l’étant comme étant signifie le prendre en vue en tant qu’il est, qu’il participe de l’être. Dans cette expression, le « comme » – c’est-à-dire, en grec, le « e » dans l’expression on e on, ou en latin le « qua » dans l’expression ens qua ens – désigne le rapport à cet Autre de tout étant qu’est l’Être, sans lequel l’étant ne pourrait être ce qu’il est. Le « comme » dit cette scission (Scheidung) qu’est la différence ontologique, c’est-à-dire ceci que l’étant à la fois se distingue de l’être et cependant en participe. Il exprime cette solidarité totale de l’être et de l’étant en leur différence même qui est la différence ontologique bien comprise. L’étant ne peut être reçu ou accueilli comme étant, comme cela qui est, que dans la mesure où cet Autre de l’étant qu’est l’Être, c’est-à-dire cet au-delà de l’étant qui est, en fait, un en deçà, une dimension antérieure et insondable, est anticipé comme tel. Il ne peut se manifester, en tant qu’étant, que dans et par l’anticipation imaginative, et donc la projection, prenant la forme d’une spontanéité réceptive, de l’horizon ontologique de son propre déploiement. La Weltbildung, comme spontanéité réceptive, est ce qui nous transporte, a priori, dans le point de vue « ex-centrique » de l’être, dans l’Ouvert, dans la vérité originelle, dans l’alèthéia. Tel est le sens originel, non idéaliste, de l’a priori, qui est celui du fragment III de Parménide (to gar auto noein estin te kaï einaï), et qu’a retrouvé Heidegger pour le penser radicalement.
C’est pourquoi la comparaison entre l’homme et l’animal contribue à faire apparaître, par contraste, l’essence ex-centrique du Dasein qui, quant à lui, se tient toujours implicitement dans le dé-voilé de l’étant en son être, dans l’ouverture au règne et à la présence du monde. Cette comparaison permet donc, suivant une expression que nous empruntons à J. Beaufret (1985, p. 62), d’exhiber « … cette initialité radicale d’une liaison a priori entre la présence des choses et l’avènement de l’homme », qui constitue l’essence même du Dasein ».
L’être-au-monde, comme constitution fondamentale du Dasein, selon les termes et les travaux de J. G. Tanoh (2007, p. 8), est caractérisé par trois types de relation : l’être-auprès, l’être-soi-même et l’être-avec. Dans le fond, ces trois types ne sont pas irréductibles, de telle sorte qu’il est impossible de concevoir l’un sans l’autre. Les traits d’union sont, dans ce sens, significatifs. L’un appelle les autres. Cependant, à bien regarder de près, on se rend compte d’une chose : l’être-au-monde est essentiellement déterminé par l’être-avec. Nulle part, Heidegger ne le dit, mais posons-nous la question suivante : quel sens y a-t-il à penser les deux autres, si Heidegger n’a pas la conviction dominante que l’homme partage profondément son être avec son semblable ? Qu’un ’homme soit seul au monde n’exige nullement une etude de soi-même et des choses. C’est la vie en société qui commande une connaissance authentique de l’homme et des choses, afin de la porter à sa vérité. En effet, c’est parce que l’autre participe à l’expression de mon être, qu’il apparaît nécessaire de me saisir et de saisir ma relation avec les choses d’une façon claire ; car en vérité, le monde dans lequel je suis est un monde partagé : « La clarification de l’être-au-monde a montré qu’il n’ « y a » pas d’emblée, (…), un je isolé sans les autres. Toutefois … l’être-au-dans monde, il y a coexistence des « autres », s’ils sont à la fois déjà là avec » (M. Heidegger, 1986, p. 158). De ce point de vue, les autres ne sont pas simplement des hommes que je rencontre, envers qui je dois manifester de l’indifférence voire du mépris ; mais des Daseins-miens, pour autant que dans mon propre être, je partage avec eux les mêmes réalités ontologiques et ontiques.
Et plus vrai, c’est à partir de ma rencontre avec l’autre que, d’une manière ou d’une autre, mon être se définit. « Sur la base de cet être-au-monde affecté d’un avec, le monde est chaque fois toujours déjà celui que je partage avec les autres. Le monde du Dasein est un monde commun » (M. Heidegger, 1986, p. 160). Un monde commun, pas au sens de ce qui serait pour tous, mais au sens de ce que chaque Dasein expérimente profondément sa dépendance à l’autre. Une dépendance non-aliénante, plutôt libératrice, dans la mesure où demeure en moi toujours un aller-vers. Le Dasein qui est mien ne se structure que dans cet aller-vers, c’est-à-dire dans la rencontre avec l’autre. Autrement dit, la rencontre avec l’autre, comme coexistence, est une détermination essentielle de la vérité du Dasein : « Le Dasein qui m’est propre, dans la mesure où il a l’être-avec comme structure essentielle, n’est qu’en tant que coexistence à la rencontre d’autrui » (M. Heidegger, 1986, p. 163).
C’est pourquoi Heidegger souligne que l’autre n’est pas un étant ayant le genre d’être d’un utile, mais proprement le Dasein qui est mien. Dès lors, « cet étant n’est pas ce qui préoccupe, il se tient dans le souci mutuel » (M. Heidegger, 1986, p. 163). Se tenir dans le souci mutuel, c’est partager les mêmes aspirations profondes qui définissent chaque Dasein. Ces aspirations s’originent dans l’exigence d’une substantielle historialité, car nul doute qu’en chaque Dasein habite, profondément, ce constant désir d’une présence dynamique dans l’histoire. Parce que partageant cela, les hommes ne peuvent que se tenir dans le souci mutuel. La compréhension profonde et claire des choses rend libre chaque homme ou Dasein à l’égard de l’autre. Toutefois, comment le Dasein peut-il parvenir à cette compréhension profonde et claire ? Pour Heidegger, c’est à partir du souci véritable, auquel fait déjà signe le souci mutuel, que le Dasein parviendra authentiquement à se comprendre et comprendre les choses, les autres, son monde et s’en préoccuper, s’en montrer solidaire. Et c’est bien en ce sens que se trouve subtilement la pensée de la solidarité chez Martin Heidegger, une forme de souci solidaire.
Conclusion
Il ressort de cette réflexion que, dans le souci, il y a l’idée d’attention, de préoccupation, de sollicitude, et cela peut se dire solidarité. Le souci est à saisir comme ouverture à l’autre et son monde : À travers donc le souci, le Dasein se montre solidaire d’autrui et de son monde. L’être du Dasein ek-siste, il se jette en avant de lui-même. Tout son être réside dans ce mouvement d’aller-vers. Cette structure ontologique, Heidegger la nomme en des termes clairs : “L’être-en avant-de-soi-même”. Elle caractérise le Dasein comme toujours déjà̀ jeté́ dans le monde et en mouvement vers… Son ek-sistence est “factice”, en ce sens qu’elle se déroule toujours dans le monde. Et ce déroulement est un dévalement, une déchéance. Existentialité́, facticité́ et déchéance forment donc bien une unité́ qui pourrait se formuler : « Être-déjà-a (au monde)-en- avant-de-soi-même-comme-être-auprès-de » (M. Heidegger, 1986, p. 242). Cet entre répond précisément à la conception que nous nous faisons du « souci » entendu, en un sens fondamental, comme “être solidaire de…” !
Références bibliographiques
ARENDT Hannah, 1981, La vie de l’esprit, Paris, P.U.F, 576 p.
BEAUFRET Jean, 1985, Le chemin de Heidegger, Paris, Editions de minuit, 133 p.
CAMUS Albert, 1994, « Lettre de Camus à Louis Germain, son premier instituteur, le 19 novembre 1957 » dans Le premier homme, Collection Cahiers Albert Camus (n° 7), Paris, Gallimard, 336 p.
DASTUR Françoise, 1990, Heidegger et la question du temps, Paris, P.U.F, 135 p.
FORESTIER Florian, 2013, « Jean-Luc Nancy et l’énigme de la singularité », EPEKEINA. Revue internationale d’ontologie. Histoire et critiques, Numéro spécial Jean-Luc Nancy.
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et Temps, traduit de l’allemand au français par François Vézin, Paris, Gallimard, 581 p.
HEIDEGGER Martin, 2001, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer, 458 p.
HEIDEGGER Martin, 1985, Concepts fondamentaux (texte établi à titre posthume par Petra Jaeger), traduit de l’allemand au français par Pascal David, Paris, Gallimard, 163 p.
HEIDEGGER Martin, 1968, « De l’essence de la vérité » in Questions I et II, Paris, Gallimard, 602 p.
HEIDEGGER Martin, 1968, Questions I, Paris, Gallimard, 310 p.
HEIDEGGER Martin, 1980, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 238 p.
HEIDEGGER Martin, 1983, Le principe de raison, trad. André Préau, Paris, Gallimard, 280 p.
HEIDEGGER Martin, 1988, Qu’est-ce qu’une chose ? Trad. de l’allemand par Jean Reboul et Jacques Taminiaux, Paris, Gallimard, 272 p.
HEIDEGGER Martin, 1976, Questions IV, Paris, Gallimard, 343 p.
LARIVEE Annie et LEDUC Alexandra, 2001, « Saint Paul, Augustin et Aristote comme sources gréco-chrétiennes du souci chez Heidegger », Revue Philosophie, Paris, Éditions de Minuit, no 69, pp. 30-50.
PIKETTY Thomas, 2013, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 976 p.
PORRAS Laila, 2015, « Croissance, inégalités et pauvreté au sein des pays émergents : le cas des BRICS », Revue de la régulation [En ligne], vol. 18, URL : http://regulation.revues.org/11480.
RICOEUR Paul, 2005, Parcours de la reconnaissance, Paris, Gallimard, 448 p.
SARTRE Jean-Paul, 1976, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, 848 p.
TANOH Jean Gobert, 2007, « Une pensée de l’altérité chez Martin Heidegger », Le Portique [En ligne], URL ; http://leportique.revues.org/1433.
L’“INSOMNIE” COMME EXPRESSION DU PHILOSOPHER CHEZ EMMANUEL LEVINAS
Romuald Évariste BAMBARA
Maître-Assistant, Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (BURKINA FASO)
Résumé : La phénoménologie allemande à travers celle de Husserl et de Heidegger, selon Emmanuel Levinas, s’est enfermée dans une approche classique de l’être : l’être est ; une compréhension identifiant l’être à lui-même. L’existence humaine s’apparente alors à un poids. La solitude devient une des marques de l’être. Critiquant une telle approche qui caractérise par ailleurs l’état de la société occidentale de l’époque, Levinas révèle que l’être, animé par le bruissement anonyme de l’il y a, refuse de s’enfermer, de se replier sur soi. Cet il y a, ni néant, ni être, menace permanente, suscite l’insomnie ou tient le sujet éveillé. L’éveil, loin d’inciter le sujet à s’abriter dans le même, provoque ce besoin pressant de sortir de ce non-sens ou de soi. Ainsi, Levinas à contrario de l’ontologie contemporaine, insiste sur l’extériorité radicale qui caractérise l’autre et impose à l’être une relation éthique, c’est-à-dire une ouverture à autre que soi.
Mots-clés : INSOMNIE, IL Y A, ÉVASION, PHILOSOPHIE, ÉTHIQUE.
Abstract: According to Emmanuel Levinas, the German phenomenology through Husserl’s and Heidegger’ viewpoints, locked itself in a classic approach of the being: the being is; an understanding identifying the being to himself. Thus, the human existence is similar to a weight. Loneliness becomes one of the signs of the being. Criticizing this approach, which also characterizes the Western society of that time, Levinas reveals that the being, animated by the anonymous rustle of the ‘’there is’’, refuses to shut himself away, to turn inwards. This “there is” neither nothingness, nor being, permanent threat, arouses insomnia or keeps the subject awaken. Awakening, far from encouraging the subject to take shelter in the same, causes this pressing need to get out of this nonsense or the self. Thus, Levinas in contrast to contemporary ontology insists on the radical exteriority that characterizes the other and imposes to the being an ethical relationship, i.e. an opening to another than oneself.
Keywords : INSOMNIA, THERE IS, ESCAPE, PHILOSOPHY, ETHICS.
Introduction
Que vient faire le mot insomnie dans la philosophie ? Est-ce bien l’insomnie qui nous tient éveillés et nous ôte tout sommeil ? Telles sont les premières questions qui vous assaillent dès lors que vous tombez sur certains textes d’Emmanuel Levinas, philosophe français contemporain.
L’insomnie est élevée au statut de notion chez Emmanuel Levinas. Et quel sens donne-t-il à cette notion ? Serait-elle une pathologie sanctifiée en mode de vie pensante ? Peut-elle se confondre à des notions comme l’angoisse heideggérienne ou la nausée sartrienne ? L’insomnie n’est-elle pas ce qui définit le mieux la philosophie aujourd’hui, c’est-à-dire en faisant de cette impossibilité du Je à dormir, une alerte permanente qui l’incite à philosopher et l’engage dans une vie pour-l’autre ?
Chez Levinas, l’usage de la notion d’insomnie est intimement lié à d’autres et participe ainsi de la genèse de sa philosophie. Au nombre de ces notions, on peut citer l’« il y a », « l’évasion », « la fatigue », « le visage », « la responsabilité », etc. Ces notions s’imbriquent les unes dans les autres, empiètent les unes sur les autres, tout en participant à une approche nouvelle de ce qu’est la philosophie. Et comment l’insomnie peut-elle être un mode d’être ou une expression du philosopher chez Emmanuel Levinas ?
Notre intention, dans cet écrit, est de retracer la genèse de cette autre manière de comprendre, de définir la philosophie comme insomnie, en montrant ses implications dans la pensée éthique levinassienne. Et pour établir cette approche de la philosophie comme insomnie, nous nous emploierons à reformuler la lecture ou l’interprétation que Levinas donne de la phénoménologie allemande. Notre démarche consistera à partir de l’influence de la phénoménologie allemande, c’est-à-dire husserlienne et heideggérienne sur la philosophie de Levinas, à analyser le renouvellement de la problématique philosophique introduit par Levinas à travers la genèse de la notion d’« il y a », à comprendre ce que recouvre cette notion et celle de l’évasion comme besoin de sortir justement de cet « il y a ».
1. PARTIR DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE DE HUSSERL ET DE HEIDEGGER
Les sources de la philosophie de Levinas s’inspirent, entre autres, de la phénoménologie allemande, celle d’Edmund Husserl et de Martin Heidegger. De Husserl, il garde surtout « l’esprit », s’intéresse à sa réflexion sur la psychologie phénoménologique et la constitution de l’intersubjectivité. Certains des concepts de Levinas ne peuvent être appréhendés ou compris qu’en les rattachant à leur origine husserlienne. E. Levinas (1984, p. 39-40) revendique lui-même sa filiation avec Husserl : « Je commence comme toujours presque avec Husserl ou dans Husserl, mais ce que je dis n’est plus dans Husserl ».
Dans son ouvrage, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, il entreprend un premier travail critique à l’égard du fondateur de la phénoménologie, jugé trop idéaliste et essentialiste. Cette critique levinassienne est partagée avec des auteurs contemporains comme Heidegger, Sartre et Merleau-Ponty, etc. Dans l’après-guerre, Levinas commence à élaborer ses propres ressources philosophiques perceptibles dans des ouvrages comme Totalité et infini, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, ou encore dans De Dieu qui vient à l’idée. Il critique à la fois l’idéalisme de Husserl et l’approche herméneutique ontologique de Heidegger. De cette analyse critique des limites de la phénoménologie allemande, les commentateurs perçoivent le motif proprement levinassien de l’éthique de la responsabilité infinie : l’altérité y devient la catégorie clé d’une expérience qui met radicalement en question le sujet en première personne, c’est-à-dire l’ego transcendantal de Husserl, le Dasein de Heidegger, au profit d’un autre qui peut être l’étranger, la veuve, l’orphelin, etc. Ces deux sujets, c’est-à-dire l’ego transcendantal et le Dasein, selon Levinas, n’appréhendent en fait autrui qu’en se le réappropriant, ne rencontrent l’autre que pour l’assimiler. Ils ne conduisent pas à une relation avec l’autre comme tel. L’autre est réduit au moi.
Levinas, par exemple, perçoit dans la cinquième Méditation cartésienne, une construction de l’alter ego déduite par analogie avec la présence corporelle du moi. En effet, dans le paragraphe 50 des Méditations cartésiennes, Husserl (2014, p. 180) constate que
dans cette nature et dans ce monde, mon corps (Leib) est le seul corps qui soit et qui puisse être constitué d’une manière originelle comme organisme (organe fonctionnant), il faut que cet autre corps – qui pourtant, lui aussi, se donne comme organisme – tienne ce sens d’une transposition aperceptive à partir de mon propre corps. […]. Dès lors, il est clair que seule une ressemblance reliant dans la sphère primordiale cet autre corps avec le mien, peut fournir le fondement et le motif de concevoir “par analogie” ce corps comme un autre organisme.
Husserl ne laisse pas l’autre s’extérioriser dans sa radicale altérité. Une altérité radicale qui signifie l’irréductibilité d’autrui à ce que je suis. Levinas invite à concevoir la conscience autrement que comme une existence absolue, une pure présence à soi, une relation à soi, et la relation autrement que sur le mode analogique. La cinquième Méditation cartésienne, de son point de vue, ne parvient pas à saisir l’autre comme autre, rendre compte de l’autre en tant qu’autrui : Husserl élabore plutôt une altérité neutre, déterminée par la ressemblance. Constituer autrui « par analogie » conduit inéluctablement à privilégier la similitude ou la ressemblance au détriment de l’infinie différence qui caractérise la relation à autrui. Pour éviter de tomber dans le piège du solipsisme engendré par la phénoménologie husserlienne, Levinas passe par l’éthique. L’éthique est perçue comme un au-delà de la phénoménologie. Aussi devant la difficile phénoménologie du visage d’autrui, phénoménologie qui transforme l’autre en objet de connaissance ou en objet à décrire, Levinas affirme que l’accès au visage de celui-ci est d’emblée éthique.
Levinas va s’intéresser particulièrement à un principe méthodique propre à la phénoménologie qui est la réduction. Elle correspond bien à une nouvelle manière de philosopher par le fait de laisser surgir une “expérience fondamentale” par le truchement de l’épochè ou de la mise entre parenthèse du monde. Ce que Levinas retient de ce processus de la réduction, c’est la dimension de rupture qui permet de repartir du sujet comme fondement inébranlable de la vérité. Dans la réduction, il privilégie le vocabulaire du « réveil », un réveil rendu possible par l’intrusion d’une altérité. Le réveil comme lecture de la réduction par E. Levinas (1992, p. 35), signifie simplement ceci : « Il ne faut pas dormir, il faut philosopher ». Levinas se sert du thème de l’insomnie pour signifier un impossible repli du Moi sur lui-même dans le sommeil. Il reconnait à Husserl, à travers sa réduction phénoménologique, son ambition de réveiller le sujet de l’engourdissement dans lequel il se trouve. Aussi sa réduction intersubjective, à partir de l’autre, ouvre-t- elle non seulement celui-ci, mais ne le met plus au centre du monde. Malheureusement, Husserl reste dans la logique de l’analyse de la relation entre moi et l’autre en termes de connaissance.
Pour distinguer la réduction phénoménologique de l’insomnie levinassienne, il faut se référer à la prééminence accordée à l’altérité infinie d’autrui, de manière à ne pas identifier autrui au connu, ni même au connaissable. La réduction phénoménologique husserlienne (caractérisée par un vocabulaire technique, l’usage de concepts, etc.) permet à Levinas d’opérer le passage à la relation éthique (avec un registre poétique). Sa pensée éthique se veut une rupture avec ce qu’il est convenu d’appeler « l’“égoïsme” de l’ontologie » (E. Levinas, 2006a, p.37) ou la pensée égologique.
En somme, Levinas corrige les limites perçues dans la cinquième Méditation cartésienne, en inversant la logique de la pensée husserlienne : ce n’est plus la conscience ou le moi qui me donne l’Autre, c’est l’Autre qui me constitue en sujet. Autrui apparaît à partir de soi et non de moi : ce que Levinas nommera « révélation » ou « épiphanie » à partir de son visage. L’épiphanie du visage est l’exceptionnelle apparition, exposition du visage pour signifier l’extériorité insaisissable de l’autre. Le terme « visage », désigne autrui, c’est-à-dire l’autre différent du même ou du moi et du Monde. Le visage se signifie. Il est une exceptionnelle présentation de soi par soi. Pour Levinas, le visage est par excellence l’incontenable, c’est-à-dire qu’il ne présente pas les caractéristiques objectives ou physiques, la culture, le statut social de l’autre. Le visage révèle simplement autrui, l’individu, l’homme dans sa simple singularité.
Quant à Heidegger, philosophe de Messkirch, la lecture de sa pensée est incontournable et E. Levinas (2006d, p. 33) l’avertit en ces termes :
Un homme qui, au XXe siècle, entreprend de philosopher, ne peut pas ne pas avoir traversé la philosophie de Heidegger, même pour en sortir. Cette pensée est un grand événement de notre siècle. Philosopher sans avoir connu Heidegger comporterait une part de “naïveté”, au sens husserlien du terme : il y a pour Husserl des savoirs très respectables et certains, les savoirs scientifiques, mais qui sont “naïfs” dans la mesure où, absorbés par l’objet, ils ignorent le problème du statut de son objectivité.
En effet, de Heidegger, Levinas s’intéresse à son interrogation sur l’être et ses fondements, à sa phénoménologie de l’être distingué de l’étant. Heidegger se donne en effet comme projet de saisir le sens de l’être-là, c’est-à-dire la réalité humaine ou simplement l’homme. Le problème philosophique fondamental chez lui est la question de l’être : Qu’est-ce que l’être ? La compréhension de l’être, chez Heidegger, comme dans la tradition ontologique, reste liée à la vérité. Le terme Dasein, chez lui, peut se traduire par l’être-là ou être–au–monde. Définir l’être, c’est saisir son essence. L’essence de l’être se confond à sa manière d’être ou à son existence. En effet, il l’affirme dans Lettre sur l’humanisme (1966, p. 92), en ces termes : « Ce que l’homme est, c’est-à-dire, dans la langue traditionnelle de la métaphysique, l’“essence” de l’homme, repose dans son ek-sistence ». Heidegger établit une distinction entre le terme Dasein et le terme Daseiendes. Daseiendes recouvre l’étant, ou nomme simplement ce qui est. En ce sens, il désigne tous les objets, toutes les personnes et Dieu lui-même. Le Dasein renvoie à l’homme lui-même. Reprenant une citation heideggérienne, E. Levinas, dans la revue Philosophie (2007, p. 17.) rappelle que « le Dasein est un être en qui dans son être il y va de son être même ». En d’autres termes, le Dasein est l’être-là (Da-sein) qui cherche à se comprendre ou simplement qui s’intéresse à son propre être ; il est l’étant exemplaire qui a le pouvoir de poser la question de l’être. Il est le seul à questionner quant à son être lui-même. En tant que « Dasein », l’être humain est « projeté » dans le monde : il « est-là » sans l’avoir cherché, vit sa condition d’être jeté ou abandonné dans l’existence sans l’avoir cherché (ce que Heidegger nomme notre déréliction) et pris d’angoisse devant ce devenir qui s’impose à lui. Le Dasein est foncièrement être-au-monde. L’expérience de la précarité radicale de l’existence de « l’être-là », (le Dasein), engendre la peur et l’angoisse. Ce sentiment de précarité, de vulnérabilité et cette angoisse qui se saisissent de l’être-là, lui font prendre conscience qu’il est un être-pour-la-mort. En d’autres termes, la temporalité du Dasein est conçue comme finie et que l’être-au-monde est être pour la mort. L’homme doit penser son existence dans l’horizon de la mort, car la mort est le mode d’être que le Dasein a à assumer.
Levinas perçoit dans cet effort pour saisir l’être, le Dasein, une volonté de réduire l’autre au même. La phénoménologie heideggérienne tombe dans l’approche classique de l’ontologie qui perçoit l’être comme foncièrement animé par son effort d’être et permet ainsi l’autoposition ou l’affirmation narcissique du Moi. Elle devient la phénoménologie du Dasein. Il va jusqu’à qualifier l’ontologie de Heidegger, de « philosophie du Neutre » (2006a, p. 332) ou de « philosophie de l’injustice » (Ibidem, p. 38). La socialité ou l’ouverture à l’altérité incessible d’autrui est loin d’être une préoccupation de Heidegger. Le Dasein est rattaché à un lieu, un sol. En effet, selon E. Levinas (2006a, p. 37),
« Heidegger, comme toute l’histoire occidentale, conçoit la relation avec autrui comme se jouant dans la destinée des peuples sédentaires, possesseurs et bâtisseurs de la terre. La possession est la forme par excellence sous laquelle l’Autre devient le Même en devenant mien ».
Dans la description de la structure ontologique du Dasein par Heidegger, Levinas perçoit justement la négation d’une ouverture à l’altérité radicale d’autrui. Heidegger préfère décrire le Dasein en termes de solitude. Ainsi dans sa critique de l’ontologie de Heidegger, E. Levinas (1997, p. 129) proclame dans la revue Esprit :
Je maintiendrai à l’opposé de Heidegger que la philosophie peut être éthique aussi bien qu’ontologique, elle peut être en même temps grecque et non grecque dans son inspiration. Ces deux sources d’inspiration coexistent comme deux tendances différentes au sein de la philosophie moderne et c’est mon but personnel d’essayer d’identifier ces deux origines du sens […] dans la relation interhumaine.
Aussi, la question fondamentale de la philosophie, de son point de vue, n’est-elle plus celle de Leibniz que Heidegger approuve, c’est-à-dire “Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?” Mais plutôt celle-ci : « Est-ce que je me dois à l’être ? Est-ce qu’en étant, en persistant dans l’être, je ne tue pas ? » (E. Levinas, 2006d, p. 119).
Cette critique de l’ontologie heideggérienne le conduira à faire cette mise au point :
Si au début, nos réflexions s’inspirent dans une large mesure – pour la notion de l’ontologie et de la relation que l’homme entretient avec l’être – de la philosophie de Martin Heidegger, elles sont commandées par un besoin profond de quitter le climat de cette philosophie et par la conviction que l’on ne saurait en sortir vers une philosophie qu’on pourrait qualifier de pré-heideggérienne (E. Levinas, 1998, p. 19).
En d’autres termes, cette volonté de s’arracher à l’ontologie fondamentale de Heidegger est dictée par la nécessité d’aborder l’être autrement en fuyant ce solipsisme foncier qui le caractérise.
Par contre, malgré toutes les réserves émises sur la philosophie heideggérienne, Levinas trouve remarquable l’exploitation de la méthode phénoménologique par Heidegger. Une exploitation judicieuse, efficace, qui lui permet, dans son analyse du Dasein, de décrire les états comme l’ennui, la culpabilité, la crainte, l’angoisse, l’anxiété, la joie, etc. Et c’est surtout la description phénoménologique, pratiquée par Heidegger, d’une réalité affective comme l’angoisse qui a beaucoup marqué Levinas. On découvre, avec Heidegger, que l’angoisse apparaît comme un mouvement affectif sans cause, sans “objet”. Mais, pour lui, c’est le fait que l’angoisse se présente comme un vécu affectif sans objet, qui lui donne de la signification ou du sens. En effet, pour Heidegger, selon les propos de Levinas (2006d, p. 31), « l’angoisse serait l’accès authentique et adéquat au néant ». Elle est l’expérience du néant, liée au néant ou encore donne accès à l’insignifiant.
Toujours est-il que dans cette prise de distance par rapport à Heidegger, Levinas souligne que la notion d’il y a, cause de l’insomnie, est distincte du es giebt heideggérien. Comment Levinas définit-il les notions d’insomnie et d’il y a ? Quel lien peut-on établir entre ces deux notions ?
2. L’INSOMNIE OU LA PRÉSENCE DE L’« IL Y A »
Qu’est-ce qui peut expliquer cette impuissance à dormir, à se reposer ? Les notions d’“insomnie”, de “réveil” ou d’“éveil” sont présentes dans la pensée éthique levinassienne, mais l’histoire de la philosophie nous permet de remonter jusqu’à des auteurs comme Plotin pour voir un usage conséquent de ces notions. L’usage de la notion de « transcendance de l’Un », chez lui, n’exprime rien d’autre que l’éveil philosophique. C’est donc dire que Levinas s’inscrit dans une tradition philosophique familière à l’usage de l’idée d’insomnie quelle que soit la notion utilisée.
L’approche levinassienne de cette notion évoluera en fonction de ses œuvres. Deux grandes lectures peuvent être perçues dans l’exposé de la notion d’insomnie. Ainsi dans De l’existence à l’existant et Le Temps à l’Autre, l’insomnie est assimilée à une vigilance sans but et sans objet, suscitée par l’il y a. En ce sens, l’insomnie est l’éveil au rien ou le rien comme éveil qui s’accapare le sujet. Elle exprime cette vigilance qui se situe au-delà de la conscience, une veille qui n’est pas conscience de soi ou attention à l’objet, mais la veille de l’être anonyme ou de l’« il y a ». L’insomnie, écrit E. Levinas (1996, p. 27), « est faite de la conscience que cela ne finira jamais, c’est-à-dire qu’il n’y a plus aucun moyen de se retirer de la vigilance à laquelle on est tenu. Vigilance sans aucun but ». La conscience a donc cette particularité d’être une vigilance. Mais paradoxalement, elle possède aussi cette possibilité d’avoir sommeil, ce pouvoir de dormir. En somme, pour comprendre le phénomène de l’insomnie, E. Levinas (2006e, p. 242) précise :
L’insomnie ne se définit pas comme simple négation du phénomène naturel du sommeil. Le sommeil est toujours au bord du réveil, il communique avec la veille tout en tentant de lui échapper (« Je dors mais mon cœur veille », dit le Cantique des cantiques) ; il reste à l’écoute de la veille qui le menace et qui l’appelle de son exigence.
Et à partir de Totalité et Infini, de même que dans Dieu qui vient à l’idée, l’insomnie est l’éveil du moi à autrui, l’incapacité ou l’impossibilité de ne pas être attentif à l’autre. Veiller, c’est “veiller au prochain”, se réveiller sans cesse de son égoïsme, de son identité et de sa présence à soi. L’éveil est la non-quiétude du Moi ou simplement cette agitation du Même causée par l’Autre. L’éveil est, pour reprendre des mots levinassiens, une veille-à-l’être, une attention–à. En d’autres termes, « l’insomnie est le déchirement de ce repos dans l’identique », conclut E. Levinas (2006e, p. 243). Dans cette seconde approche, la notion d’insomnie n’est plus pensée comme la veille de l’être, mais l’éveil du moi au Bien, au-delà de l’être. L’autre dans le Même est celui qui l’éveille et c’est cette donnée qui constitue le caractère irréductible de l’insomnie. Ainsi, la philosophie va se définir à partir de la place primordiale accordée à la personne de l’autre ou à la singularité irréductible de l’autre : elle est un discours s’adressant toujours à un autre. P. Hayat, dans la préface de l’ouvrage de Levinas intitulé Altérité et transcendance (1995, p. 20), conclut alors que chez Levinas, « le commencement de la philosophie, ce n’est pas le cogito, mais la relation à l’autre ». La métaphysique s’inscrit aussi dans une telle optique : elle est le respect de la transcendance absolue qui se manifeste dans l’autre.
Mais qu’est-ce qui maintient fondamentalement le sujet en éveil ? Qu’est-ce qui l’empêche de plonger dans un sommeil profond oublieux de soi-même et des autres ?
Levinas convoque la notion d’« il y a » pour justifier l’obligation de veille du sujet. Qu’est-ce que l’« il y a » ? Que signifie cette notion ? Soulignons d’emblée que cette notion est présente chez des écrivains comme Apollinaire et Maurice Blanchot. Une des œuvres d’Apollinaire s’intitule exactement Il y a. Cette notion signifie, chez lui, la joie de ce qui existe, l’abondance, etc. Dans les œuvres de Maurice Blanchot, elle est exprimée à travers des formulations comme le neutre, le dehors, le remue-ménage de l’être ou de sa rumeur, du murmure de l’être, etc.
La notion d’« il y a » est surtout présente dans l’œuvre du philosophe Martin Heidegger, à travers, rappelons-le, son « das es gibt ». Cette formulation du « das es gibt » a été rendue publique et développée dans la Lettre sur l’humanisme en 1949. Il y évoque l’existence d’un « il y a » originel qui est fécond, riche de tout ce qui existe. Gibt vient de geben qui signifie donner, en allemand. Pour E. Levinas (1987, p. 90.), « l’es gibt heideggérien, c’est une générosité. C’est le grand thème du dernier Heidegger, l’être se donne anonymement, mais comme une abondance, comme une bonté diffuse ». Par contre, dans son analyse de l’expérience de l’il y a, E. Levinas (1993, p. 102) oppose
l’horreur de la nuit, “le silence et l’horreur des ténèbres”, à l’angoisse heideggérienne ; la peur d’être à la peur du néant. Alors que l’angoisse, chez Heidegger, accomplit l’“être pour la mort”, saisie et comprise en quelque façon, – l’horreur de la nuit “sans issue” et “sans réponse” est l’existence irrémissible.
L’il y a, selon Levinas, n’est pas une reprise ou une traduction du « es gibt » heideggérien. Une notion qui découle de ces étranges obsessions vécues pendant l’enfance. Des obsessions reparaissant dans l’insomnie. Et c’est cette expérience qu’il a décrite en captivité, pendant la seconde guerre mondiale, et publiée dans son ouvrage De l’existence à l’existant[11] au lendemain de la Libération.
L’« il y a » y est décrit comme une « monotonie présence qui nous étouffe dans l’insomnie » (Idem, p. 98), un silence pendant la nuit. Ce silence ou cet « anonymat essentiel » (Idem, p. 95) est bruissant. Levinas a élaboré cette notion en partant de souvenirs d’enfance, quand l’enfant dort seul et les grandes personnes s’affairent entre elles : l’enfant ressent un silence l’envahir. Dans Autrement qu’être ou au-delà de l’être, Levinas utilise des expressions comme un “bourdonnement incessant”, “un bourdonnement sans répit”, “un écœurant remue-ménage” pour définir ce silence. Et ce silence bruissant est l’« il y a », défini comme l’absolument neutre, l’être impersonnel. L’« il y a », c’est l’anonyme, comme dans l’expression « il fait nuit », « il pleut » ou « il fait chaud ». L’il y a est caractérisé par des adjectifs comme “anonyme”, “neutre”, “monotone”, “présence irrémissible”, etc. En effet, précise-t-il,
il n’y a pas seulement quelque chose qui est, mais “il y a” par-dessus ou à travers ces quelques choses, il y a un processus anonyme de l’être. Sans porteur, sans sujet, comme dans l’insomnie, ça n’arrête pas d’être-il y a (E. Levinas, 1993, p. 95).
L’« il y a » engendre un sentiment insupportable par le sujet. Le sentiment de vivre une monotonie dépourvue de sens : l’il y a éveille une “horrible monotonie”. Des expériences personnelles comme la fatigue, l’insomnie nocturne, la paresse, permettent de mieux comprendre la notion de l’il y a. Dans De l’existence à l’existant, E. Levinas (1993, p. 98) décrit l’ « il y a » en termes d’horreur et d’affolement. En effet, « le frôlement de l’il y a, c’est l’horreur. » (Ibidem) Et « l’horreur met à l’envers la subjectivité du sujet, sa particularité d’étant. » (Idem, p. 100)
La place et le rôle de l’il y a sont bien différents dans De l’existence à l’existant et dans Totalité et infini. On peut noter, dans l’analyse de cette notion chez Levinas, une évolution, voire une contradiction dans sa pensée. Dans le premier ouvrage, c’est-à-dire De l’existence à l’existant, l’il y a est le fond initial à l’anonymat duquel s’arrache le sujet humain. Cet il y a, anonymat essentiel, submerge toute personne ou chose, embrasse et les choses et la conscience. Cet il y a vise l’affirmation de l’existant. Cet existant ne peut surmonter la peur de l’il y a qu’en s’enfermant en lui-même. Et dans le second, c’est-à-dire Totalité et infini, l’abîme de l’il y a heurte un sujet satisfait, fermé sur soi, lui ouvrant ainsi la voie qui conduit à la relation éthique du face-à-face avec autrui. Ici, le sujet sort du non-sens instauré par l’anonymat de l’il y a pour rencontrer le visage de l’autre. Une ouverture à l’altérité d’autrui qui apaise de la peur de l’étrangeté effrayante de l’il y a.
L’il y a ne serait-il pas au commencement de la philosophie ? Qu’est-ce qui pousse à penser, réfléchir ou incite à s’adonner à l’entreprise philosophique ? Cette même question a été posée par Philippe Nemo, lors de son entretien avec Levinas dans Éthique et infini en ces termes : « Comment commence-t-on à penser ? Par des questions qu’on se pose à soi-même et de soi-même, à la suite d’événements originels ? Ou par les pensées et les œuvres avec lesquelles on entre d’abord en contact ? » (E. Levinas, 2006d, p. 11). Et Levinas y répondait :
Cela commence probablement par des traumatismes ou des tâtonnements auxquels on ne sait même pas donner une forme verbale : une séparation, une scène de violence, une brusque conscience de la monotonie du temps. C’est à la lecture des livres – pas nécessairement philosophiques – que ces chocs initiaux deviennent questions et problèmes, donnent à penser (Ibidem).
On peut donc émettre l’hypothèse que la peur informulée, la frayeur indistincte, l’horreur anonyme, suscitées par l’il y a, seraient à l’origine de la réflexion philosophique, du moins de celle de la pensée levinassienne.
La conséquence d’une vie prise dans l’étau de l’« il y a » ou l’horreur de l’« il y a », c’est le dégoût de soi, la lassitude de soi. Le sujet doit s’arracher de cet être neutre, sortir de l’être ou chercher une issue de ce « non-sens » anonyme. En somme, pour sortir de l’il y a, il faut se déposer ou faire acte de déposition pour emprunter des expressions levinassiennes. Cette déposition de la souveraineté par le même ou le sujet consiste dans la réponse à l’appel d’autrui pour s’occuper de la souffrance et de la mort de celui-ci, avant de s’occuper de sa propre mort ou de son être-pour-l’autre.
3. DE L’ÉVASION
Le thème de l’évasion est propre à la littérature contemporaine. Le poète qui rêve d’une vie idéale, de s’éloigner de sa condition de vie, de mener une autre vie, parle d’évasion. L’évasion, dans ces conditions, exprime le souci de rompre avec les conventions, les contraintes sociales ou les règles qui étouffent l’épanouissement de l’individu. Cette idée remonte aux romantiques des XVIIIè et XIXè siècles.
Mais, dans notre contexte, « De l’évasion » est d’abord le titre d’un texte de jeunesse d’Emmanuel Levinas. Un texte d’une vingtaine de pages paru, en 1935 dans le tome V de la revue Recherche philosophique[12]. Ce texte sera repris sous forme de livre, introduit et annoté par Jacques Rolland. Ensuite, l’évasion deviendra une notion spécifique de la philosophie levinassienne.
Dans ce texte de jeunesse des années 1935, Levinas exprimait cette aspiration profonde qui incitait à sortir d’un certain climat, d’une certaine idée ou catégorie de la suffisance qui devenait la caractéristique essentielle d’une certaine civilisation de son temps et de la philosophie. Ce qu’il nomme à travers un néologisme qui lui est propre, le « besoin d’excendance » (E. Levinas, 2011, p. 98) exprime le « besoin de sortir de soi-même, c’est-à-dire de briser l’enchaînement le plus radical, le plus irrémissible, le fait que le moi est soi-même » (Ibidem). En d’autres termes, l’évasion vise à rompre, briser ce lien du moi à soi, cet égologisme inhérent à l’ontologie. Un égologisme qui se complaît dans le fait que l’être est, par conséquent l’existence devient un absolu. Et puisque l’être est, il est déjà parfait, fini et s’inscrit dans l’absolu. Alors l’essai de Levinas veut sortir de cette civilisation de la satisfaction, marquée essentiellement par la pensée heideggérienne, pour entendre un autre sens, trouver un au-delà de l’être. Un besoin de sortir qui n’est guère suscité par un manque ou une privation, mais au contraire par une plénitude ou par un “trop de soi-même”.
« Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme »[13], texte d’Emmanuel Levinas paru dans la revue Esprit, en 1934, sera d’abord repris dans l’ouvrage collectif du Cahier de l’Herne intitulé Emmanuel Levinas[14], ensuite, sous la forme d’un ouvrage intitulé Les imprévus de l’histoire[15]. Ce texte a été écrit avant celui de L’évasion et anticipait sur des événements qui nécessitaient une sortie de l’être. Dans cet article, Levinas percevait cette « fatigue de l’Europe », ce climat de violence et de haine qui sédimentait toute la société occidentale. L’antisémitisme racial ou la haine des Juifs, déjà manifeste dans la société occidentale, annonçait des lendemains difficiles. Une dénonciation de l’idéologie national-socialiste, c’est-à-dire de l’hitlérisme, élevé par Levinas au rang de philosophie et de métaphysique. Une telle idéologie se caractérise par le fait d’exalter le biologique, le corps, le sang et les racines. De telles idées vont engendrer la haine de l’autre homme, de l’autre différent de moi, et finiront par entraîner l’holocauste. Le besoin d’évasion se voulait une anticipation, une solution à ce mal irréversible qui se profilait dans cette Europe.
À partir de la seconde lecture de la notion d’insomnie, c’est-à-dire, rappelons-le, à partir de Totalité et infini, la philosophie, dans la pensée de Levinas, va s’appréhender comme un éveil, une insomnie de la conscience ou une « conscience de la rupture de la conscience » (E. Levinas, 1990, p. 256). L’insomnie invite à l’évasion, autrement dit à sortir de soi. Cette sortie de soi ou de l’être non seulement ne se constitue pas dans les nourritures terrestres ou les jouissances par lesquelles le sujet s’illusionne sortir de sa solitude, mais aussi, elle ne se pratique pas dans la connaissance ; car la connaissance, pour Levinas, se ramène à une assimilation, une identification, une absorption de l’objet connu par le sujet connaissant. La connaissance est de l’ordre de l’annexion, ce qui la rend foncièrement inapte à aider le sujet à sortir de soi. Par contre, la sortie de soi dont parle Levinas est une véritable communion avec l’altérité de l’autre. Elle est de l’ordre de la socialité et récuse le désespoir de la solitude de l’être. Elle est une invite à la vigilance, donc elle joue fondamentalement un rôle critique. Cette sortie de soi permet de critiquer les attitudes, les lois et institutions de la cité, de notre société de consommation. Une telle société plonge l’homme dans le sommeil où il n’y a guère de place pour la ré-flexion.
Alors, Levinas nous exhorte à ne pas dormir, mais à philosopher. Une philosophie qui doit viser essentiellement l’humain dans l’homme. De cet éveil ou de cette insomnie, la philosophie peut « s’ouvrir à l’unicité de l’unique dans ce réel, c’est-à-dire à l’unicité d’autrui. C’est-à-dire, en fin de compte, à l’amour. » (E. Levinas, 1994, p. 199). La rencontre avec l’autre ou cet amour du prochain est le grand événement dans l’acte de philosopher d’aujourd’hui. L’autre, non seulement permet d’être non-indifférent, de nouer des contacts avec le moi, mais c’est avec lui que le sens de la responsabilité et l’effort de développer la socialité vont apparaître. L’altérité d’autrui empêche de dormir ou ôte à l’homme son attitude naïve qui le plonge dans le sommeil.
Au-delà de ce que nous avons évoqué, la relation avec l’autre défait cette crispation du moi sur soi instaurée par la peur de l’il y a, c’est-à-dire empêche le repli du même sur soi. L’altérité de l’autre apaise de l’horreur de la nuit, du “silence et de l’horreur des ténèbres” ou de “l’écœurant remue-ménage et encombrement de l’il y a”. La philosophie comme éveil, comme insomnie se veut simplement une ouverture ou une vocation à autrui. L’insomnie est la manifestation de l’inquiétude du psychisme. La conscience est dépersonnalisée, à tel point que l’on peut affirmer : je ne veille pas, “ça veille”.
La philosophie est une alerte permanente au réveil d’une telle prédisposition, et justement l’insomnie est pour la conscience cette absolue incapacité de se dérober et de se distraire. Et les actes de violence ou de barbarie ne constituent guère des événements accidentels ou des exceptions historiques. La violence ou la barbarie est une prédisposition intrinsèque à l’humain. L’approche levinassienne de la philosophie est en rupture avec la philosophie du Neutre, du Même propre à l’ontologie ; une philosophie dont le discours ne touche guère l’homme dans son humanité, ne l’éveille pas à l’Autre dans son altérité absolue, en somme une philosophie qui occulte Autrui. Dans la Préface à l’édition allemande de Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Levinas re-qualifie la définition étymologique, traditionnelle de la philosophie. Au fond, la philosophie, conçue comme amour de la sagesse dans la tradition philosophique de l’occident, c’est-à-dire dans l’ontologie, exalte le savoir et le pouvoir. Mais au-delà de cette sagesse du connaître, la philosophie, selon Levinas, est aussi sagesse de l’amour ou la sagesse en guise d’amour, car elle se caractérise fondamentalement par la non-indifférence-pour-autrui, l’inquiétude obsessionnelle pour la vie de l’autre. Et la philosophie redevient ainsi, selon E. Levinas (2006a, p. IV), sagesse de l’amour au service de l’amour : « Philosophie comme amour de l’amour. Sagesse qu’enseigne le visage de l’autre homme ! » À partir de là, l’ambition de Levinas se précise :
Nous nous proposons de décrire, dans le déroulement de l’existence terrestre, de l’existence économique comme nous l’appelons, une relation avec l’Autre, qui n’aboutit pas à une totalité divine ou humaine, une relation qui n’est pas une totalisation de l’histoire, mais l’idée de l’infini. Une telle relation est la métaphysique (E. Levinas, 2006a, p. 44).
Seule l’éthique peut être cette philosophie à même de révéler le sens de l’humain. Une éthique qui accorde la prééminence à l’autre, instaure l’obligation à l’égard d’autrui. Elle commence par une mise en question de l’égoïsme du moi par autrui, en conséquence, par une mise en question de l’ontologie.
On appelle cette mise en question de ma spontanéité par la présence d’Autrui, éthique. L’étrangeté d’Autrui- son irréductibilité à Moi- à mes pensées et à mes possessions, s’accomplit précisément comme une mise en question de ma spontanéité, comme éthique, précise Levinas (2006a, p. 33).
L’existence du moi consiste dans le fait de se vouer aux autres et d’être infiniment en mouvement vers l’autre dans son extériorité absolue : tel est le sens de l’être. La relation avec l’autre homme est d’emblée au commencement, avant toute vision des choses ou toute connaissance. Le sens de l’existence du sujet est son don de soi, son sacrifice au prochain.
L’autre est d’une altérité radicale, incessible. L’autre passe avant moi, que ce soit dans la relation de face-à-face ou dans la relation avec la multiplicité des hommes ou la socialité. Cette primauté d’autrui est absolue et ne s’accommode pas avec les relations ordinaires empreintes de réciprocité et d’intérêt. L’éthique levinassienne invite à une responsabilité absolue vis-à-vis de l’autre, à travers le souci permanent de celui-ci, c’est-à-dire de son étrangeté non réductible au Même, aux pensées et désirs du Même. Une responsabilité que le sujet ne saurait récuser et qui se manifeste dans le respect, la courtoisie à l’égard d’autrui, l’accueil de l’autre avec les mains pleines et la maison ouverte. L’éthique levinassienne affirme la prédominance de l’existence et du bonheur de l’autre.
Conclusion
Quitter le climat de l’ontologie contemporaine, incarnée par la phénoménologie allemande à travers Husserl et Heidegger, telle est l’ambition de la philosophie levinassienne. Cette ontologie contemporaine a conçu le moi comme un être se suffisant à soi. Une telle approche de l’être est inspirée par l’image qu’offrent les réalités matérielles comme les choses. En effet, les choses sont, alors on peut déduire que l’être est. Affirmer que l’être est a fini par instaurer le culte de la persévérance en soi ou de l’égoïsme du moi. Mais le moi, selon Levinas, n’est pas dans la quiétude. La conscience est agitée par la présence envahissante de l’il y a qui crée l’insomnie ou maintient le sujet éveillé ou réveillé. Cette insomnie doit être éthique, au sens où l’évasion permet de rompre l’identité de l’être pour sortir de soi-même, c’est-à-dire du non–sens et être responsable d’autrui. Cette sortie instaure l’amour d’autrui.
Une telle approche de la condition de l’existence humaine consacre l’actualité de la philosophie levinassienne et permet d’affirmer que ses textes sont prophétiques : c’est en cela que l’on reconnaît la grandeur de sa pensée. En effet, notre actualité est profondément marquée par l’il y a. Cet il y a s’identifie à l’incertitude, à un questionnement permanent de ce que sera chaque vie prise individuellement et collectivement. Ces temps d’incertitude, de questionnement sur notre vulnérabilité se caractérisent par la présence de cet “anonymat essentiel” qui agite chaque conscience. On peut l’admettre, avec des termes levinassiens, notre époque est marquée par une certaine “fatigue” provoquée par une actualité horrible : attentats, explosions, criminalité urbaine, conditions précaires de vie, etc. Des conditions de vie qui nécessitent l’éclairage de la pensée éthique levinassienne : « L’idée de la charité, l’idée d’engagement à l’égard d’autrui est renforcée par chaque événement mortel » (E. Levinas, 1996, p. 137). Ne sont-ce pas nos conditions d’existence actuelles ? Qu’est-il arrivé à notre virilité ?
Références bibliographiques
COHEN Danielle et ABENSOUR Miguel (dir.,), 1991, Emmanuel Levinas, Cahier de l’Herne, n° 4173, Paris, L’Herne, 626 p.
COHEN-LEVINAS Danielle et CLEMENT Bruno (dir.,), 2007, Emmanuel Levinas et les territoires de la pensée, Paris, P.U.F., 545 p.
DEPRAZ Natalie, 1999, Husserl. Paris, Armand Colin, 95 p.
Entretien de LEVINAS Emmanuel avec VON WOLZOGEN Christoph, 1er mars 2007, « L’intention, l’évènement et l’Autre », dans Philosophie. n°93, p. 12-32.
Entretien LEVINAS Emmanuel avec KEARNEY Richard, juillet 1997, « De la phénoménologie à l’éthique », dans Esprit. n°234, p. 112-140.
Entretiens avec WEBER Elisabeth, VIDAL-NAQUET Pierre, 1996, Questions au Judaïsme, Paris, Desclée de Brouwer, p. 73-104.
ESCOUBAS Eliane § WALDENFELS Bernhard, (dir.,), 2000, Phénoménologie française et phénoménologie allemande, Cahiers de philosophie de Paris, XII-Val de Marne, Paris, L’Harmattan, 640 p.
HEIDEGGER Martin, 1966, « Lettre sur l’humanisme », dans Questions III. traduit par André Préau, Paris, Éditions Gallimard, p. 73-157.
HUSSERL Edmund, 2014 [1947], Méditations cartésiennes. Introduction à la philosophie, traduit de l’Allemand par PEIFFER G. et LEVINAS E., Paris, Vrin, 256 p.
EVINAS Emmanuel, 1983 [1979], Le temps et l’autre. Paris, P.U.F., 92 p.
LEVINAS Emmanuel, 1989 [1930], La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris, Vrin, 223 p.
LEVINAS Emmanuel, 1993 [1947], De l’Existence à l’existant, Paris, Vrin, 174 p.
LEVINAS Emmanuel, 1994 [1972], Humanisme de l’autre homme, Paris, Librairie Générale Française, 123 p.
LEVINAS Emmanuel, 1996 [1984], Transcendance et intelligibilité, Genève, Labor et Fides, 69 p.
LEVINAS Emmanuel, 1998 [1982], De Dieu qui vient à l’idée, Paris, Vrin, 270 p.
LEVINAS Emmanuel, 1998, Éthique comme philosophie première, Paris, Payot & Rivages, 119 p.
LEVINAS Emmanuel, 2001[1949], En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 330 p.
LEVINAS Emmanuel, 2006a [1961], Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Librairie Générale Française, 348 p.
LEVINAS Emmanuel, 2006b [1963], Difficile liberté, Paris, Librairie Générale Française, 443 p.
LEVINAS Emmanuel, 2006c [1974], Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Librairie Générale Française, 287 p.
LEVINAS Emmanuel, 2006d [1982], Éthique et infini (dialogues d’Emmanuel Levinas et Philippe Nemo), Paris, Fayard et Radio-France, 121 p.
LEVINAS Emmanuel, 2006e [1993], Dieu, la mort et le temps, Paris, Librairie Générale Française, 279 p.
LEVINAS Emmanuel, 2006f [1995], Altérité et transcendance, Paris, Librairie Générale Française, 186 p.
LEVINAS Emmanuel, 2008 [1994], Les imprévus de l’histoire, Paris, Librairie Générale Française, 192 p.
LEVINAS Emmanuel, 2011 [1935], De l’évasion, Paris, Librairie Générale Française, 158 p.
POIRIE François, 1987, Emmanuel Levinas, Qui êtes-vous ? Paris, La Manufacture, 182 p.
PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’HUMANITÉ MARIALE. RÉFLEXION A PARTIR DE WHITEHEAD
Séverin YAPO
Maître-Assistant, Université Félix Houphouët-Boigny (CÔTE D’IVOIRE)
Résumé : Établi sur la thèse husserlienne d’une « sphère primordiale » comme nature commune à l’idéel pour sa réalisation dans le temps, et relevant du champ de la philosophie de la religion, cet article, qui se veut une alternative anthropologique à l’idée contemporaine de la mort de Dieu et l’auto-représentation humaine, voit dans l’idée whiteheadienne d’une nature primordiale relevant de la pluralité théologique, l’argument pour une proposition nouvelle, celle de l’humanité mariale, à la fois comme objectivation naturelle de Dieu et fondement d’une humanité du XXIè siècle amicalement représentative du divin.
Mots clés : WHITEHEAD, VIERGE MARIE, VIRGINITÉ, HUMAIN, PLURALITÉ.
Abstract: Established on the husserlian thesis of a “primordial sphere” as a common nature to the idea of its realization in time, and relevant to the field of the philosophy of religion, this article, which is an anthropological alternative to the idea Contemporary with the death of God and human self-representation, sees in the whiteheadian proposition of a relevant primordial nature of theological plurality, the argument of a new proposition, that of Marian humanity, both as the natural objectification of God and the foundation of a humanity of the 21st century friendly representative of the divine.
Key words: WHITEHEAD, VIRGIN MARY, VIRGIN, HUMAN, PLURALITY.
Introduction
En quoi après la théologie analytique d’Alfred North Whitehead, la Vierge Marie constitue-t-elle le pur fondement de l’humanité contemporaine ? Cette question de recherche, qui fait muter le questionnement sur le fondement, non seulement de la métaphysique analytique de l’auteur de Process and reality, mais de la théologie vers l’anthropologie – une anthropologie dont la figure centrale apparaît d’un premier abord non philosophique – semble receler un biais logique qu’avant tout il conviendra de lever.
Nous ne sommes pas les premiers à vouloir faire signe vers l’anthropologie en philosophie de la religion. En 2009, Sebbag observait que Freud, avec son texte sur Le tabou de la virginité, d’une analytique philosophique, fit « irruption dans le domaine anthropologique » (p. 161). L’actualité de l’anthropologie philosophique s’éclaire, dans le domaine de la phénoménologie, des travaux de Blumenberg (2006). Celui-ci, en dénonçant l’interdit anthropologique de Husserl et Heidegger, incline l’avenir de la philosophie vers l’anthropologie comme paradigme. Cette option anthropologique semble pouvoir rectifier les visées non pragmatiques d’un concept de la virginité s’offrant au sens de donné originaire à valeur probante. A contrario, « ramenée à une conception abstraite, la virginité se présente comme un fait discutable [. Mais] à qui, à quoi se rapporte un état si proche des origines ? » (T. Sebbag, 2009, p. 161).
Nous postulons qu’anthropologique, la virginité fait signe vers un originaire marial : « On doit constater un caractère d’irréversibilité de l’inscription qui vient marquer ce qui est vierge » (Ibidem), mieux, non marqué par le péché originel. Du Vè au XVIè siècle, selon la dogmatique chrétienne, « l’idée d’Immaculée se cristallise : une nature acquise de naissance [préserve Marie de Nazareth] de la faute originelle, de toute souillure du corps, de la mort, et lui octroie une virginité perpétuelle » (Idem, p. 171). Pourtant ce n’est ni dans la dogmatique, ni dans la théologie chrétienne que s’inscrira notre réflexion. Elle se voudra globale, philosophique donc. Et pour cause : pour Whitehead (1926), « les fondements des dogmes doivent être posés dans les termes d’une rationalité métaphysique qui critique les significations et cherche à exprimer les concepts les plus généraux adaptés à l’univers dans sa globalité même » (p.71).
L’intérêt d’une étude philosophique sur la Vierge Marie se reçoit de ce que « la teneur des quatre Évangiles canoniques ne permet pas d’expliquer le statut particulier accordé à Marie par les cultes catholique et orthodoxe » (T. Sebbag, 2009, p. 170) car sa figure transcende la sphère religieuse pour se faire perpétuellement et universellement féconde. Ainsi nous apparaît la Vierge Marie, cet étant métaphysique, précisément théologal antique, tel qu’anthropologiquement donné à notre contemporanéité, via la phénoménologie contemporaine, husserlienne, mais surtout dans la métaphysique analytique, whiteheadienne, intéressée par une notion théologique capitale : le processus.
Dans la ligne de J. Cobb (1965), grande figure contemporaine de la théologie du Processus, R. Picon (2007) voit dans le « locus théologal », l’unique cadre théorique pour la métaphysique et la philosophie de la nature élaborées par A. N. Whitehead. Or ce locus, « ici compris au sens premier de ce qui a Dieu pour objet » (Ibidem), les commentateurs l’inclinent en direction de la « pluralité ». Pour Picon en effet, « l’approche whiteheadienne de Dieu fait de la pluralité un locus théologal fondamental » (Ibidem). Ce locus est également compris par l’exégète « comme le lieu où quelque chose de décisif se joue pour [Dieu] et se révèle à son sujet » (Ibidem).
L’idée de la pluralité entendue comme locus théologal occupe une place centrale dans l’œuvre de Whitehead. Par « pluralité », Whitehead entend le fait que ce qui était multiple, en se renouvelant, devient un en s’enrichissant des différences qu’elle intègre à sa propre constitution. Il écrit : « L’entité nouvelle est à la fois, l’ensemble formé par la pluralité qu’elle trouve ; elle est aussi l’une des entités dans la pluralité disjonctive qu’elle quitte ; comme entité nouvelle, elle existe disjonctivement au milieu de la pluralité des entités qu’elle synthétise » (Whitehead, 1995, p. 21). Pour notre part, en tant qu’entité nouvelle, en son humanité, la figure de la Vierge Marie est distincte de celle du Christ. Mais comme telle, Marie constitue l’intégration des différentes figures divine, christique (Dieu et homme) et humaine (ante-contemporaine) dont, comme unité humaine distincte de chacune de ces figures, elle est riche.
En ce sens, décisive nous semble l’humanité mariale en tant qu’elle est révélatrice du divin pris comme idée plurielle de quelque chose de singulier : Dieu. Ce singulier, pour apparaître dans la réalité naturelle, prend particulièrement figure humaine. Si l’imaginaire humain peut aussi se représenter le divin, peut-être est-ce qu’en la pureté de son fondement, virginal, l’humanité constitue l’image de Dieu.
Voyant en la Vierge Marie la pure image de Dieu, et en l’imagination la commune faculté humaine figurant cette pureté virginale, en soi matricielle, cet article part de l’hypothèse que, « constituant un pouvoir fondamental de l’âme humaine, qui sert a priori de fondement à toute connaissance » (Kant, 2006 [1787], p. 193), l’imagination situe dans le domaine d’une nature intrinsèquement intuitive et immanente. Par le mot « imagination », nous entendons l’ensemble de nos représentations mythiques, communes : « Françoise Dolto, interrogée par le psychanalyste Gérard Séverin, déclare dans ce sens à propos de Marie : « C’est une projection des imaginaires préverbaux, du ressenti du vivre dans son corps. Quand je dis mythique, je dis au-delà de l’imaginaire particulier de chacun ; c’est une rencontre de tous les imaginaires sur une même représentation » (T. Sebbag, 2009, p. 174-175).
Mariale, l’imagination relie l’humain au divin, le réel à l’idéel, sur la base d’un passé originairement commun ce, grâce à la « mémoire », un peu comme dans la théologie de la pluralité de Whitehead. Cette hypothèse qui voit en la Vierge Marie l’objectivation naturelle de la subjectivité divine est en lien avec J. Cobb (1982, p. 6), qui a amplement démontré que Dieu constitue la « subjectivité transcendantale de la subjectivité humaine ». La subjectivation humaine justifie d’autre part que l’on fasse de Dieu l’objet de toutes nos représentations. Ainsi que l’explicite R. Picon (2007), « Dieu est toujours sujet et objet de nos représentations ». Une telle hypothèse aura besoin d’être développée tant scientifiquement que philosophiquement. À ce sujet, en nous laissant pour l’essentiel librement accompagner par Raphaël Picon dans son article intitulé « John Cobb, lecteur de Whitehead : la pluralité comme lieu théologique », nous nous appuierons sur l’idée de la « sphère primordiale d’une « nature » spatiale » (E. Husserl, 1953, p. 98) développée dans le paragraphe 55 des Méditations cartésiennes, pour montrer comment la pluralité théologique anthropologiquement objectivée dans la Vierge Marie comme image du divin pourrait fonder l’humanité du XXIè siècle, de nature idéelle.
1. MARIE, IMAGE ANTHROPOLOGIQUE DE LA PLURALITÉ THÉOLOGIQUE
À propos du fondement scientifique de l’humanité mariale comme pure image du divin, il est notoire que Morton (2013) contribua significativement au développement des recherches sur les rapports entre la mémoire, l’émotion et l’imagination dans la détermination du sens de l’agir humain. Évoquant spécifiquement les actes de « mémoire » qui se réfèrent aux émotions, la position de Morton fait écho à la thèse philosophique d’A. Damasio établie en 2003 sur le cerveau des émotions, la mémoire constituant le substrat des émotions. Dans le domaine des neurosciences affectives, « l’imagerie fonctionnelle cérébrale chez l’homme démontre l’existence de ces substrats neuronaux des émotions » (Altéri, 2009). Fonctionnellement immanentes à la nature humaine sont les émotions re-tenues dans le cerveau, cette réalité de l’idéalité constitutive de l’esprit en tant qu’elle s’offre comme la matrice où sont formées les images mentales impulsant toutes nos actions. Pour Å. Wettergren, en relevant que « l’imagination ne doit pas être un acte conscient d’imaginer avec des images mentales » (2014), A. Norton aura supprimé la frontière entre émotion et imagination. Par où, émotionnelle, la mémoire imaginative à la source de notre agir avec nous-même et les autres a-t-elle pour fondement moins la raison comme calcul que ce que Heidegger dénomme le « fond sans fond », mémoire unitaire de l’intelligence humaine : « La Raison pure, théorique et pratique […] est pose du fond, […] elle est le fond de toute fondation : […] elle est ce qui détermine, dans leur unité, toutes les conditions de possibilité de l’étant » (M. Heidegger, 1962 [1957], p. 170). Ce fond, l’étant naturel constitutif de la primordiale unité humaine, nous semble dire ce que Husserl (1953) appelle la sphère primordiale par laquelle nous nous sentons originairement reliés aux autres. Un tel se sentir relié à l’humanité devrait procéder d’un fond rationnel conférant son sens à l’humanité : « Le sens constitue ce qui est propre à recevoir les formes sensibles sans la matière » (Aristote, De l’âme, 429a, 2014, p. 1015). Le sens de l’humanité se reçoit de ce qui, pur, nous affecte de l’intérieur et dont nous saisissons intellectuellement la représentation. Toutefois, l’on est à se demander si ce sens marial de l’humain comme représentation du divin est, dans le monde actuel, encore courant.
En nous intéressant à partir de Heidegger à « Dieu considéré dans son rapport à l’univers » (M. Heidegger, 1962 [1957], p. 220), deux positions contemporaines se dégagent. D’un côté, non plus sensible mais extrêmement rationnelle, l’humanité se définit comme « le moi [aujourd’hui sur-humain qui] se représente et qui est défini comme le sujet certain de lui-même » (Idem, p. 221) dans une vision déicide. D’un autre côté, « notre monde atomique [fait] voir que, si à en croire Nietzsche Dieu est mort, le monde livré au calcul demeure et que partout l’homme est inclus dans un calcul qui, décomptant toute chose, la rapporte au principe de raison » (Ibidem). Pour ne pas être lacunaire, nous proposons une troisième voie, susceptible d’offrir une alternative au reste de l’humanité en regard du déicide anti-pluraliste dominant l’époque. Si l’on suppose que tant pour l’homme que pour Dieu « ratio veut dire compte » (Ibidem p. 218), et si tant est que lorsque l’homme décompte il se représente égoïstement lui-même, la troisième voie invite à prendre toute l’ampleur de l’idée leibnizienne suivante reprise par Heidegger : « Pendant que Dieu calcule, le monde se fait » (Ibidem, p. 221). L’alternative veut que là où l’homme contemporain calcule « egotiquement » en se reproduisant « sous forme de machines à penser » (Ibidem, p. 220), c’est-à-dire d’ordinateurs et autres nouvelles technologies numérisant l’humanité atomisée, Dieu pour sa part calcule au pluriel en laissant le monde se faire avec lui en tant que Dieu lui-même accepte d’avoir pour représentation naturelle l’humanité virginale. Nous soutenons que le sens de l’humanité est quelque chose qui, en tant que forme, est immanent au divin : la Vierge Marie nous semble constituer cette représentation du divin entendu comme lieu du sens, humain. Notre thèse, qui fait de l’unité divine le socle du dialogue de la théologie avec l’anthropologie mariale en esquisse ici sous l’angle de la pluralité comme marque du réel à la fois divin et humain se comprend à la lumière de la pluralité whiteheadienne : « Le multiple détermine ici la possibilité même de l’un. L’unité de base de ce réel […] est la combinaison à chaque fois singulière de toutes les relations de cet événement aux autres entités du monde qu’il appréhende » (R. Picon, 2007). Or, reste à savoir si la portée contemporaine de l’immanence divine trouve un fondement philosophique de premier ordre puis ce en quoi ce fondement nous porte explicitement vers la figure mariale pour que nous y intelligions par excellence la représentation humaine de la pluralité divine.
C’est Aristote qui écrit : « La faculté intellective saisit les formes immanentes aux représentations » (Aristote, De l’âme, 431b, 2014, p. 1031). L’âme humaine, en sa pointe fine – entendez l’esprit – constitue le lieu d’intellection de la représentation de la pureté spirituelle inhérente à ce qui, divin, fait sens pour l’homme. Percevoir en esprit la Vierge Marie comme la « représentation [humaine du divin,] sera le mouvement qui se produit sous l’effet du sens [interne à l’âme humaine] en activité » (Aristote, De l’âme, 429a, 2014, p. 1025). Mais vers quoi d’autre que soi-même comme une âme l’humanité dirigera-t-elle sa perception si elle veut parvenir à connaître la Vierge Marie comme représentation du divin ? « L’âme [humaine] si elle veut se connaître elle-même, doit porter son regard sur une âme » (Platon, Alcibiade, 133b, 2011, p. 39), celle de la Vierge-Marie « et avant tout sur cet endroit de l’âme [humaine] où se trouve l’excellence de l’âme, le savoir, ou sur une autre chose à laquelle cet endroit de l’âme est semblable » (Ibidem). Pour l’homme, se connaître devient synonyme de connaître la Vierge Marie en tant que représentation humaine du divin, en cela originairement perçue comme âme par toute âme. Se connaître soi-même est dès lors inséparable d’avoir le sens de l’humanité, qui est divin et qui a pour représentation la Vierge Marie, comme humanité pure. C’est le sens de la proposition platonicienne suivante : « C’est […] au divin que ressemble ce lieu de l’âme, et quand on porte le regard sur lui et que l’on connaît l’ensemble du divin […], on serait alors au plus près de se connaître soi-même » (Platon, 2011, p. 39). Avoir un tel sens de l’humanité signifie alors un sentir intérieurement sans matière, intellectuellement donc, le divin, en sa représentation humaine que constitue la Vierge Marie. Mais quel véritable lien y a-t-il entre la perception spirituelle de l’humanité mariale et l’émotion inhérente à un possible sentir rationnel de cette humanité ?
La problématique du sentir a été mise en lumière par L. Altéri (2009), dans Eidos et pathos, en particulier au chapitre V sur « l’émotion de la raison ». Pour restituer cette émotion du sentir qui dit la « phénoménologie du pathos », « équivalent latin [du] sentir (et sensus) » Altéri, non seulement y voit le « peu fréquent terme « pathique », déclinaison du terme grec paskein (d’où pathos) » (Ibidem), mais montre également que les « émotions sont revenues au centre du débat philosophique » (ibidem). Chez Wettergren (2014, p. 16), les émotions « filtrent les informations et les options en faisant les unes un peu plus saillantes que les autres » et « relient les représentations de situations réelles à des représentations de diverses possibilités qui en découlent » (Ibidem.). Nous convenons avec Wettergren que les émotions orientent l’imagination et déterminent la teneur affective de l’agir.
Cependant, une rationalité calculatrice pouvant incliner à des émotions mauvaises contaminant peu à peu l’imagination, nous optons pour un concept fondamental de la raison, ainsi purement en lien avec une imagination dès lors créatrice. L’imagination qui crée est de nature fondamentalement mariale. En ce sens, le rôle joué par Dieu dans la théologie christique est désormais dévolu à la Vierge Marie en l’ère anthropologique actuelle. Chez Whitehead, le rôle de Dieu dans le processus de concrescence du réel est centré sur l’apport à chaque entité actuelle de son projet initial (entités idéales, objets éternels). De même, chez nous, la Vierge Marie constitue la mémoire fondamentale qui apporte continûment à chaque homme le fondement spirituel de son développement naturel. Elle confère à chacun son unité. Elle le conduit à sa concrescence. Par « « concrescence » Whitehead (1995) entend « le procès par lequel l’univers, avec sa pluralité de choses, acquiert une unité individuelle propre » (p. 344). Pour notre part, face à l’humanité déicide et auto-représentative, en sa concrescence, l’humanité du XXIè siècle s’objectivera virginalement. Elle s’objectivera en la Vierge Marie. Celle-ci constitue la plurielle unité du Christ au cœur de l’âge atomique. En la nature mariale en procès d’objectivation dans le temps, chaque réalité humaine trouvera sa concrétude et son accomplissement. Tout le devenir humain a pour horizon d’accomplissement la pureté virginale dont Marie constitue l’image pure : alpha et oméga naturels de l’humanisation. Aussi, l’enjeu de notre propos est-il de voir dialoguer la rationalité théologique et l’imagination humaine dans la définition du divin. En conséquence, parvenir au sens de l’humanité signifie détenir une représentation rationnellement sensible, c’est-à-dire émotionnellement pure, ou imaginativement créatrice, du divin : « Dire qu’il y a en l’âme quelque chose de plus divin que ce qui a trait à la pensée […], nous ne le pouvons pas » (Platon, 2011, p. 39). Du coup, l’émotion, qui sélectionne et offre à l’imagination les informations en lien avec celle-ci, nous semble le pendant idéel de la raison sensitive, réelle, comme l’imagination constitue en notre sens le pendant de la raison scientifique, réaliste.
En ce sens, notre intuition fondamentale consiste en ce que le concept de sphère primordiale, que l’on retrouve chez Husserl déjà, ouvre le champ d’un réalisme scientifique whiteheadien qui, ici repris dans le cadre d’une phénoménologie de la religion – relation à Dieu – à orientation génétique, historique, offre des arguments intéressants pour établir dans le sentir du divin le sens même d’un vécu de type marial non seulement fondateur d’humanité mais de communauté comme chez Husserl. La « sphère primordiale », husserlienne, en tant que signe de la « pluralité » whiteheadienne, comme solution contemporaine au problème du fondement marial de l’humanité, nous semble déterminante pour permettre le passage de la théologie de Whitehead vers sa philosophie de la nature en tant que traduction réaliste de l’idéalité des objets qui adviennent dans le temps. Notre thèse procède de la proposition husserlienne selon laquelle « se constitue dans ma sphère primordiale une « nature » spatiale, et elle se constitue en rapport intentionnel avec mon corps en tant que siège des perceptions » (Husserl, 1953, p. 98). En cette proposition, la théologie de la pluralité whiteheadienne se justifie au sens où, en tant qu’« objet » idéel, Dieu se spatialise, se naturalise, il s’objective dans le procès par lequel il se dirige perceptivement vers la pureté immanente à sa propre « nature » dont la forme humaine est le corps de la Vierge Marie où il retrouve l’intégrité de son image souillée par les déicides. Le process whiteheadien de temporalisation des « objets idéaux » husserliens, tel est le cadre où fera sens la présente étude.
2. L’HUMANITÉ MARIALE : UNE OBJECTIVATION PHENOMÉNOLOGIQUE DU MÉTAPHYSIQUE
C’est J. Wahl (1932) qui, commentant Whitehead, écrit : « Les objets sont les éléments de la nature qui ne passent pas […] ils peuvent apparaître ou disparaître dans le monde des événements…. » (p. 118). Comme monade, je suis quelque chose de retenu au sein de ma sphère primordiale, virginale, par l’imagination immanente, unique objet qui comme tel, ne passe pas. En cette pure image où je suis « re-produit » en chacun de mes actes de penser, déjà en naissant, je suis produit par ce dont je constitue l’image. De même en mourant, je disparais, mais encore dans le monde. À la fois comme créature, je me découvre dans le monde comme un objet soumis au temps qui passe, mais étant relié à d’autres êtres pensants, dans un espace donné avec d’autres habitants du monde objectif, au sens phénoménologique de Husserl. Je relève de la sphère primordiale, c’est-à-dire de la catégorie de ce que Whitehead nommera « objets éternels ».
Pour autant, en tant qu’un moi fini, je ne suis pas éternel. Demeurant en ma nature primordiale, je me connais à partir de la finitude de cette Nature. Or celle-ci se trouve en lien avec l’infini de la supra-temporalité. De ce lien, il vient que cette sphère qui définit une Nature primordiale est de tout temps. Elle est caractérisée par « l’omni-temporalité » au sens une fois encore de Whitehead. Car, elle est présente en chacune de mes représentations des objets du monde, un peu comme chez Kant. Mon éternité finitisée, qui appartient en propre à ma Nature primordiale, j’en ai conscience à partir de l’imagination qui est immanente à moi et ma nature. Toutefois, à moi-même comme objet temporel, n’appartient que l’immanence de ma finitude. En ce sens, je puis après Maurice Elie, établir un lien entre le Whitehead de Procès et réalité et le Husserl de la Cinquième des Méditations cartésiennes, qui parle des « objets idéaux » dont la supra-temporalité se révèle être une omni-temporalité au caractère reproductible. Ces objets sont extensibles en tant que figures idéales objectivables et opposables aux réalités objectives individualisés par l’espace et le temps. En ma procession de la supra-temporalité omni-temporelle au travers de laquelle je me découvre comme une temporalité subjective au sens où Heidegger souligne que l’être est temps, je réalise par moments que je suis plus proche de l’objet idéal husserlien que de la réalité objective whiteheadienne, cette dernière étant simplement soumise au temps objectif et à l’espace objectif, naturels.
Mais, comme l’aura observé M. Elie, l’opposition entre Husserl et Whitehead, expression de l’opposition entre l’infini et le fini, n’est qu’apparente. Car l’un comme l’autre recherchent l’unité de la nature et de l’esprit aux fins de parvenir à une conception à la fois globale et scientifique du monde humain en son sens transcendantal. Pour notre part, c’est en relisant avec Husserl et Whitehead le processus de formation de la conscience humaine que nous présenterons les grandes lignes de la phénoménologie que nous concevons comme étant génétiquement mariale, c’est-à-dire procédant d’une histoire qui est celle de la finitude mariale, immanente à tout étant humain mais tenue dans l’infini d’un divin qui spiritualise, autrement dit in-finitise, communique sa forme à l’humain.
Dans Le Concept de nature, Whitehead, qui nomme « bifurcation de la nature », la dualité de nos représentations naturelle et scientifique de la nature, dit qu’elle consiste à diviser la nature en deux parties, « c’est-à-dire la nature » appréhendée par la conscience et la nature qui est la cause de cette conscience (1920, p. 54). Qu’est-ce que la nature physique appréhendée par la conscience ? C’est par exemple ce qu’appréhende Whitehead au sens où « la lueur rouge du crépuscule est […] une partie de la nature ». Qu’est-ce que la nature physique en cause dans cette conscience physicienne ? Dans ce même exemple, ce sont « les molécules ou les ondes électriques par lesquelles les hommes de science expliqueraient le phénomène ». Nous demandons : comment unifier l’explication scientifique du monde et l’explication naturelle du monde ? Whitehead s’est intéressé à cette question. Soucieux de construire un système unitaire de l’idéel avec le réel et qui serait explicatif du monde, Whitehead vise la globalité de la réalité.
Son réalisme est métaphysique. Ainsi qu’il l’énonce dans Procès et réalité, « ce doit être aussi l’un des objectifs d’une cosmologie complète de construire un système d’idées qui rapporte les intérêts esthétiques, moraux et religieux à ceux des concepts du monde qui tirent leur origine des sciences de la nature » (1995 [1978], p. 38). En conséquence, notre ambition, rencontrant celle de Whitehead, consiste à construire une cosmologie qui pour être complète, devra commencer par s’établir sur un fondement qui unit le naturel et le religieux.
En ce sens, au regard de l’apparente division du monde spirituel entre le naturel et le religieux, et en rapport avec l’exemple de la rougeur crépusculaire scientifiquement perçue par Whitehead comme grappe d’ondes électriques, nous demandons : qu’est-ce que la nature humaine appréhendée par la conscience religieuse ? C’est ce que nous appréhendons au sens où l’esprit infini, au temps de l’accomplissement, apparaît sous le voile de la finitude mariale. Et, qu’est-ce que la nature mariale en cause dans cette conscience religieuse ? Ce sont l’ensemble des puissances spirituelles ou des vertus mariales – accueil, don, partage – par lesquelles les disciples de la Vierge Marie expliqueront le phénomène d’humanisation du divin.
Visant dans cette optique une explication globale du monde humain, notre objectif est celui d’une anthropologie qui rapporte les intérêts esthétiques heideggériens – le dernier Heidegger offre une théologie du verbe poétique – moraux kantiens et physico-religieux whiteheado-husserliens à ceux des concepts du monde humain qui tirent leur origine des sciences de la nature humaine en son fond divin. Mais comment rationnellement y parvenir ? Il s’agira de « re produire » en la société contemporaine l’humanité mariale en un procédé whiteheadien.
3. REPRODUIRE AUJOURD’HUI L’HUMANITÉ MARIALE PAR UNE MÉTHODOLOGIE WHITEHEADIENNE
Au moins deux thèses s’opposent sur la détermination de la méthode whiteheadienne. Suivant la première, incarnée par D. Debaise (2006), la méthode whiteheadienne est relation des existences théologique et sociale. En cette relation de l’humain au divin, la méthode, philosophique, est spéculative. Ainsi qu’il l’écrit, « la philosophie spéculative est essentiellement une méthode [qui] rend possible une définition de l’existence à partir de la « créativité ». [L’expérience] se définit par les relations spécifiques entre ces existences, ce que Whitehead appelle des « sociétés » » (p. 21). Exister signifie créer spéculativement une société. Le geste de cette création sociale, qui se prend avec l’expérience humaine en liaison avec ce qu’il y a de plus spéculatif dans l’idéel, à savoir Dieu, consiste en l’expérience scientifique de la « re production » naturelle qui « re présente ».
Mais que peut valoir une expérience de société qui serait spéculative, tant en la figure virginale dont la réalité renverrait à une nature et une société antiques, anachroniques donc, qu’en la figure divine qu’elle prétendrait représenter, nous rétorquerait la moderne philosophie, pratique ?
La thèse de la spéculation comme expérience purifiée est perçue comme non réaliste, comme non plus humaine. Ainsi que le signifie Isabelle Stengers au sujet de la spéculation, « la page est tournée, sans doute, rien ne transcende en effet l’expérience mais l’expérience purifiée […] est […], elle-même, dominée par l’appel à une forme de transcendance, l’appel à des données qui [peuvent] être qualifiées de « primaires », pures de toute interprétation » (Préface à Debaise 2006, p. 11).
La deuxième thèse est justement défendue par Isabelle Stengers. C’est celle du pragmatisme. Elle argue : face à la spéculation naïve, « Whitehead répond par une méthode pragmatique, au sens de Williams James, impliquant l’exploration consciente, processuelle, expérimentale, de ce dont peut témoigner une expérience immédiate, mais jamais dénuée d’interprétation » (Idem, p. 11-12). C’est dire qu’une expérience immédiate, telle celle de Dieu, peut être expérimentée et interprétée par celui qui pour pouvoir la présenter à une tierce, devra l’avoir expérimentée. Pour Whitehead (1995) lui-même, « si nous désirons obtenir l’enregistrement d’une expérience non interprétée, autant demander à une pierre d’enregistrer son autobiographie » (p. 63).
Pour notre part, loin d’opposer expérience spéculative d’immédiate présentation de l’idéel et expérience pragmatiste de la re présentation qui interprète cet idéel en le faisant procéder de sa conscience d’où il émerge comme être naturel, dans la relation de l’une et l’autre expérience semble se trouver la vérité de la méthode de Whitehead. Concevons ainsi la méthode de Whitehead comme un pragmatisme spéculatif, celui du pragmatisme qui re produit socialement ce qui se présente spéculativement. Il s’agit en un mot de la re production re présentative.
La présentation qui suit à la trace le geste divin de la production originelle s’actualisant dans la réalité naturelle se déploie analytiquement, en un procès interprétatif. La création spéculative de la société contemporaine est re production qui re présente de manière double. D’une part, elle est le geste phénoménologique de « création » de l’humanité nouvelle constitutive d’une tautologie analytiquement humaine, celle de l’humanité contemporaine qui émerge de l’expérience spéculative de la Vierge Marie, elle-même étant l’image, la re production de l’humanité du Christ. D’autre part cette société contemporaine traduit analogiquement le geste métaphysique de « création » de l’humanité antique, en une tautologie analytiquement divine : le Christ dont l’humanisation est l’expérience de re production originelle de Dieu. Ce double geste nous semble éminemment marial, en tant que la Vierge Marie constitue le modèle en lequel se réalise scientifiquement dans la nature, l’idéal divin.
En conséquence, relativement à la méthode contemporaine de « re production » de l’humanité, qui est mariale, nous commençons par suivre celle adoptée par Whitehead dans son réalisme métaphysique, qui distingue la causalité efficiente du monde et l’immédiateté de sa présentation. D’une part, la rougeur crépusculaire whiteheadienne et le voile de la finitude mariale figurent l’immédiateté de présentation. D’autre part, molécules, ondes électriques whiteheadiennes et puissances, vertus mariales illustrent la causalité efficiente. Mais de manière conceptuelle, qu’est-ce que la causalité efficiente ?
- Elie souligne qu’il s’agit de ce qui « régit le premier degré de notre expérience, c’est-à-dire la transmission physique des « sentirs », qui continue d’agir sous la perception au sens habituel du terme, que Whitehead nomme « immédiateté de présentation », laquelle est discontinue, éclairant seulement le présent, mais claire et bien localisée » (Elie, 2003, p. 65). Quelle en est la signification mariale ? Avant toute considération mariale, par l’intelligence naturelle nous ressentons en notre organe visuel la sensation de rougeur du crépuscule. Corrélativement, dans l’intelligence religieuse, si l’image de Marie de Nazareth nous affecte, c’est sensiblement que nous percevons le voile constitutif de son manteau virginal. Lorsque l’image de la Vierge Marie affecte sensationnellement une tierce où lorsqu’en son esprit cette personne garde l’habitude de la présentation de Marie, de même lorsqu’au contact physique, l’expérience vécue au premier degré du phénomène marial se communique au présent à un autre individu, tout comme pour le crépuscule drapé de rougeur, la présentation est dans le premier cas immédiate, dans le second cas discontinue. Dans un cas comme dans l’autre, la présentation inaugurale ou l’actualisation de l’affection crépusculaire comme de la visitation mariale, toujours, a lieu à un endroit et à un lieu précis.
En termes de temps, le crépuscule a lieu à l’intersection entre la fin du jour et le début de la nuit ; la visitation de la Vierge Marie, entre le soir de l’époque des dieux – le 20 è siècle où Heidegger dans « Pourquoi des poètes » théorise en modalité nietzschéenne la fuite des dieux, le Christ étant malencontreusement assimilé à un démiurge grec par le philosophe – et l’amorce du temps des hommes – depuis l’heure du début de l’obscurcissement du monde référé par Heidegger dans son Introduction à la métaphysique, avec les atrocités guerrières planétarisées au siècle dernier, seule une nature typiquement humaine, celle de la Vierge Marie, semble à même de porter le divin vers le processus de son humanisation achevée-. En termes d’espace, le crépuscule touche à une partie de la nature, celle qui est détournée du soleil. La visitation mariale est censée toucher davantage à la partie de l’humanité qui éprouve le plus l’éloignement du divin. Mais c’est peu à peu que l’ampleur mariale, qui – de par ses vertus de silence et d’humilité et ses puissances d’accueil du divin et de don de soi partageant l’humaine condition compatissante – affecte l’humanité en auto renouvellement, est perçue par l’entièreté de cette humanité planétaire que pourtant elle englobe spirituellement dès ses origines en tant qu’elle en constitue une fois encore la Nature primordiale par reprise adaptative de la phénoménologie d’E. Husserl. Et, comme l’aura démontré M. Elie, la théorie whiteheadienne de la perception est en lien avec la conception « progressive » de Husserl, pour qui « nous dépendons de la confirmation progressive de la perception » (Husserl, 1990, p. 63), laquelle tend perpétuellement à son achèvement par des « esquisses » successives.
En effet, la théorie whiteheadienne des « préhensions » et des « sentirs » se déploie au sein d’un processus continuel de constitution « préhensive » de ce qu’il nomme les « entités actuelles », par incorporation successive de toutes les « données » du monde. « Une « préhension » whiteheadienne n’est, en effet, que l’« activité par laquelle une entité actuelle effectue, pour son propre compte sa concrétion d’autres choses » (Elie, 2003, p. 65-66). Reste à savoir comment la concrétion progressive husserlo-whiteheadienne se traduit dans le sens marial.
Ainsi qu’on peut le pressentir à l’idée de l’expérience continuelle de l’humanisation du divin dont le point focal n’est autre que l’heure du jour ou encore le moment où le divin et l’humain se rencontrent au crépuscule du jour des dieux qui est l’aurore du jour des hommes plus haut mis en relief, dans la phénoménologie mariale se donne la confirmation progressive de la perception du divin dans l’humain. La perception du divin dans l’humain est figurée par le phénomène de la Nature primordiale incarné par la Vierge Marie. Celle-ci aura perçu, dans son vécu naturel, des réductions phénoménologiques progressives. De celles-ci les séquences ont ultérieurement été consignées dans les dogmes chrétiens, séquences dont les pures images transcendantales s’accomplissement phénoménologiquement au sens du phénomène saturé de J. L. Marion, autre nom de ce que nous avons perçu dans la Nature primordiale de Husserl de même que la permanence du moi chez Kant.
Ces séquences, ce sont par exemple l’Annonciation, immédiateté de la présence du divin telle qu’elle est naturellement manifestée dans sa propre Nativité relatée par les Évangiles apocryphes. La Nativité de la Vierge Marie, où elle apparaît la manifestation humaine de la Nature primordiale, n’est autre que ce que présente le Livre des Proverbes, où elle se qualifie comme première création par le divin avant même la fondation de la terre. Par où la Nativité de la Vierge Marie figure-t-elle la souche non intuitivement expérimentable du fond de la Nature humaine, commune. Possible raison phénoménologique pour laquelle dans l’histoire de l’Église, seuls les Apocryphes relatent la nativité de la Vierge Marie.
Quant aux expériences successives des sentirs mariaux de la proximité du divin, elles se retrouvent dans l’Annonciation, la Visitation, la Nativité du Christ, la Présentation de Jésus au temple, etc. À la visitation, l’Esprit divin qui anime la Vierge se communique au sein de sa cousine Élisabeth portant Jean Baptiste qui alors frémit du sentir divin. De même les anges, « divins », sont présents à la naissance du Christ. À la Présentation de l’enfant au temple, il est prophétiquement annoncé par le divin Siméon qu’un glaive transpercerait le cœur de la Vierge Marie. Ces esquisses successives de la vie divine concrétisée en son humanité par la Vierge Marie, d’un point de vue husserlien, tendent vers leur achèvement dans leur horizon. Celui-ci se constitue le sentir apodictique où s’intuitionne avec évidence l’Esprit Saint dans la communauté des disciples du Christ réunis avec la Vierge Marie à la Pentecôte.
Les sentirs (feelings) apparaissent des préhensions positives. Elles actualisent et approprient les données. Chez Whitehead, il existe des préhensions négatives. Elles « excluent » les sentirs non conformes aux conditions catégoriales. Les sentirs et leurs préhensions sont un cadre pour le discernement de la qualité de l’expérience naturelle, religieuse et communautaire de la monade humaine du point de vue du rapport du naturel au communautaire par l’entremise du divin en tant que condition de validation de l’expérience. Chez Whitehead les sentirs sont « vectoriels », puisqu’ils « ressentent ce qui est là-bas et le transforment en ce qui est ici ».
Aussi, au sens de la Vierge-Marie, il est d’une part ressenti ce qui relève du divin, soit via le don de l’Esprit de Dieu, soit via la vie naturelle insufflée en son âme virginale ici-bas, Esprit et souffle provenant du Ciel, en tant qu’un là-bas. Par exemple, théologico-anthropologiquement pluriel comme tout humain, Salomon dans le livre de la Sagesse 8,20, soutient au sujet de sa propre naissance : « Etant [en ma nature primordiale, idéellement] bon » (Bible, 2004, p. 1289), en me temporalisant, le divin en moi s’est naturellement objectivé en trouvant sa concrétion dans un corps sans souillure, c’est-à-dire virginalement marial. Les natures idéelles, bonnes telle celle de Salomon, image du Christ, se concrétisent par « accouplement », autrement dit en une « constitution par association [de leur nature divine avec leur nature mariale, humaine] dans l’expérience de l’autre » (Husserl, 1953, p. 94). Plus précisément, la nature idéelle de Salomon est transformée lors de l’Annonciation d’abord et de la Nativité de Marie ensuite, en chair divine d’abord humanisée dans le Christ, puis accomplie comme chair humaine objectivée et enfantée dans la Vierge Marie, qui est d’ici-bas.
Une telle approche trouve sa pertinence en étant complémentaire de la dogmatique chrétienne : « Du II e au V e siècle, le rôle de Marie se concentre sur l’Incarnation et se comprend essentiellement en rapport avec le Christ – « conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie » (T. Sebagg, 2009, p. 170).
Conclusion
En somme, pour pouvoir répondre à la question du pourquoi voir en la Vierge Marie le fondement de l’humanité actuelle, la recherche s’est appuyée sur la méthode whiteheadienne du pragmatisme spéculatif. Il s’est agi de la « re production » de l’unité de Dieu en sa « re présentation » comme homme. De cette unité, la Vierge Marie, particularisation de la divinité christique, apparaît le particulier.
Nos résultats débouchent sur la conclusion suivante : l’expérience de particularisation de Dieu en l’humanité contemporaine se déroule dans la nature primordiale (humaine/divine). De celle-ci émergera, concrescence du divin, l’humanité du XXIè siècle. Laquelle procède de l’actualisation du fiat marial. Où sont unifiés l’humain et le divin. L’unification est auto-engendrement de l’unité théologale. C’est dans cet unique but que s’est déployé le pragmatisme spéculatif ayant présidé à notre discussion avec Whitehead. Ce dernier, A. Beaulieu (2012) le présente comme le « précurseur des théories de l’auto-création » (p. 81).
Ces résultats inclinent vers la thèse de l’auto-création de l’humanité du XXI è siècle en la Vierge Marie, particularisation de la pluralité divine. Qui s’établira sur le principe de la pluralité divine/humaine telle que, spéculativement théologique, elle se réalisera tautologiquement en une genèse anthropologique attendue. Dans la phénoménologie génétique mariale, seul importera le sentir pur de l’origine actualisée dans les limites de la raison pure en extension via l’imagination transcendantale au champ de la société contemporaine.
Comme autre résultat important, notre recherche a montré que le sentir originaire peut faire défaut. Et en son lieu peut prendre place ce que Heidegger aurait appelé un semblant de sentir perçu loin de l’originel, dans l’errance du non-monde. La perception peut donc décevoir. Voilà qui explique ce que nous avions découvert au sens de l’auto-représentation contemporaine de l’humanité déicide, laquelle peut déchoir comme rationalité calculatrice et s’opposer à la théologie whiteheadienne de la pluralité présentative de Dieu en sa représentation virginale.
En bref, porteuse d’une humanité nouvelle s’auto-engendrant par la pureté virginale est la figure de Marie de Nazareth, rectificatrice de celle de « la vierge tentatrice Lilith, présentée par la tradition juive comme première épouse d’Adam » (T. Sebbag, 2009, p. 171). Et si se concrétiser en la Vierge Marie consistait à s’auto-engendrer comme une humanité nouvelle, révolutionnaire ? Véritablement révolutionnaire semble l’humanité qui, pour demeurer unie à soi-même, passera par l’incontournable moment d’un rapport pacifié avec le divin, tout aussi marial !
Références bibliographiques
ALTERI Lorenzo, 2009, « Eidos et pathos », p. 365-379, Consulté sur le site https://www.pdcnet.org/zeta-eidos/content/zetaeidos_2009_0000_0000_0302_0363, le 20 janvier 2016.
ARISTOTE, 2014, De l’âme, in Œuvres complètes, s/d de PELLEGRIN P., Paris, Flammarion, 2925 p.
BEAULIEU Alain, 2012, « Alfred North Whitehead précurseur des théories de l’auto-création », Revue d’histoire des sciences, 1/2012 (Tome 65), p. 81-101.
BIBLE, 2004, TOB, Cerf, Paris, Cerf, 1919 p.
COBB John, 1982, Process Theology and Political Theology, Manchester/Philadelphie, Manchester University Press/The Westminster Press.
DEBAISE Didier, 2006, Un empirisme spéculatif : lecture de “Procès et réalité” de Whitehead, Paris, Vrin, 192 p.
ÉLIE Maurice, 2003, Le monde, la raison et le sensible : Husserl, Whitehead, Merleau-Ponty, Noesis n°5, « Formes et crises de la rationalité au XXème siècle ». Tome I : Philosophie.Consulté le 22 janvier 2016 sur le site https://noesis.revues.org/1492?file=1
HEIDEGGER Martin, 1962 [1957], Le principe de raison. Traduit par PREAU A. et BEAUFRET J., Paris, Gallimard, 271 p.
HUSSERL Edmond, 1953, Méditations cartésiennes, trad. LEVINAS E., Paris, Vrin, 136 p.
HUSSERL Edmond, 1990 [1959], Philosophie première (1923-1924), II, trad. KELKEL A. L., Paris, PUF, 2° éd.
KANT Emmanuel, 2006 [1787], Critique de la raison pure, trad. RENAUT A., Paris, Flammarion, 3è édition, 749 p.
PLATON, 2011, Alcibiade, in Œuvres complètes, S/d de BRISSON L., Paris, Flammarion, 2198 p.
PICON Raphaël, 2007, « John Cobb, lecteur de Whitehead : la pluralité comme lieu théologique », Études théologiques et religieuses, 4 (Tome 82), p. 521-531.
SEBBAG Thierry, 2009, « Virginité, virginité. De Gaïa à Marie… », Figures de la psychanalyse, 1 (n° 17), p.161-178.
WAHL Jean, 1932, Vers le concret, Paris, Vrin, 269 p.
WETTERGREN Åsa, 2014, « Adam Morton (2013), émotion et imagination », Management, 1 (vol 17), Cambridge ; Malden : Polity, pp. 62- 71. Consulté le 22 janvier 2015 sur le site https://www.cairn.info/revuemanagement-2014-1-page-62.htm
WHITEHEAD Alfred North, 1998 [1920], Le Concept de nature, trad. DOUCHEMENT J., Paris, Vrin.
WHITEHEAD Alfred North, 1995 [1978], Procès et réalité. Essai de cosmologie, trad. CHARLES D. et al., Paris, Gallimard, 208 p.
WHITEHEAD Alfred North, 2007 [1926], Religion in the Making, trad. citée R. PICON, Macmillan, New York.
[1] Friedrich Adolf Trendelenburg est philosophe et philologue allemand du XIXe siècle. Attiré par les études de Platon et d’Aristote, il produit en 1826 une thèse de doctorat intitulé « L’éclairage des idées de Platon et d’Aristote à partir de la doctrine des nombres », dans laquelle il est parti des critiques d’Aristote pour aboutir à une connaissance plus précise de la philosophie platonicienne.
[2] . Cf aussi, J-L Aka-Evy (2011, p. 40), lorsqu’il soulignait, « La métaphysique a d’abord été un terme bibliographique : il s’agissait de cataloguer les écrits ontologiques d’Aristote qui venaient après (meta) sa « physique ». Or, métaphysique est devenue irrésistiblement un nom commun banalisé au point d’être pour la philosophie greco-occidentale de départ pour instruire les questions de forme, de l’« éidos », de « ce par quoi, quoi est quoi ».
[3] Une notion phare d’Edgar Morin qui a écrit, en collaboration avec Anne-Brigitte Tern, un livre intitulé « Terre-Patrie », paru en 2010 chez l’éditeur Les Points, 243 pages.
[4] Comme nous le montre Platon dans ses premiers Dialogues ou « Dialogues socratiques ».
[5] Voir, entre autres, Socrate et Thrasynaque dialoguant à propos du juste et de l’injuste, au livre I de La République de Platon.
[6] Comme le dit un proverbe que l’on retrouve dans plusieurs langues de Côte d’Ivoire.
[7] Cette phrase est attribuée au roi Ghezo, roi d’Abomey de 1818 à 1858. Les mains rassemblées autour de la jarre trouée symbolisaient l’unité et la solidarité. Les Étudiants de la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF)- fin de la période coloniale et début des indépendances- en avaient fait tout un symbole, pour la construction de l’Afrique.
[8] Communication faite à l’occasion de la Journée mondiale de la Philosophie à Rabat, le 16 novembre 2006.
[9] L’auteur d’Antigone, Sophocle, a cinquante-trois ans lorsque la pièce est jouée, en 442 avant J.-C., et remporte les concours dramatiques. La démocratie se met alors en place dans la cité athénienne. L’imbrication est telle entre l’art dramatique et la vie politique que, selon certains, cette victoire théâtrale permet à Sophocle d’être nommé stratège, et de jouer un rôle important dans le gouvernement d’Athènes.
[10] M. Heidegger, 1988, pp. 166-168.
[11] Emmanuel Levinas, 1993 [1947], De l’Existence à l’existant, Paris, Vrin.
[12] Cette revue était dirigée par Alexandre Koyré et Albert Spaïer, Jean Wahl et Gaston Bachelard.
[13] Emmanuel Levinas, 1934, « Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme », in Esprit, n° 26, p. 199-208.
[14]Danielle Cohen et Miguel Abensour (dir), 1991, Emmanuel Levinas, Cahier de l’Herne, Paris, L’Herne.
[15] Emmanuel Levinas, 2008 [1994], Les imprévus de l’histoire, Paris, Librairie Générale Française.